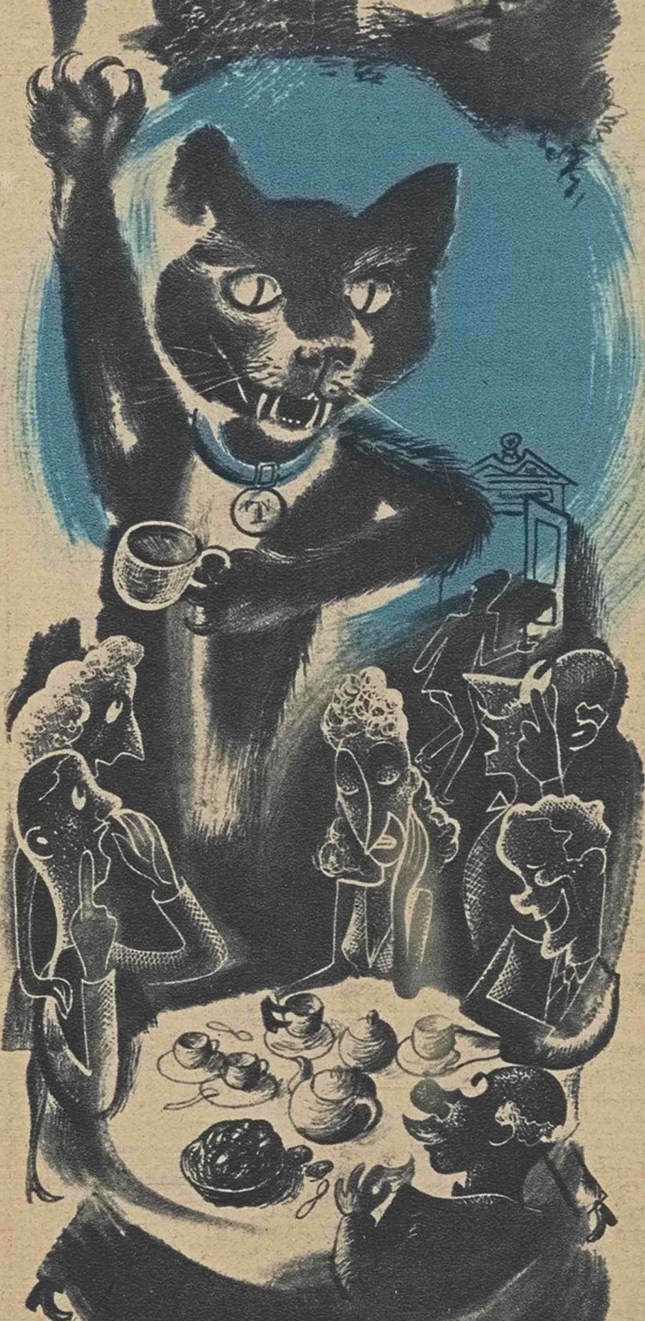PREMIÈRE PARTIE
Le monstre de verre
–––––
Chapitre premier
L’homme me heurta avec une grande violence, et nous faillîmes tous deux rouler à terre. Il arrivait, courant comme un fou, du côté de la rue des Jeûneurs, et c’est au coin de la rue du Sentier et de la rue du Croissant qu’il était entré en si rude contact avec moi.
Il s’accrocha à mes épaules, et, sous l’éclat du réverbère proche, je pus lire sur son visage les traces d’une peur atroce. Ses traits semblaient décomposés par quelque horrible vision, et la sueur trempait son front barré d’une mèche de cheveux blancs.
D’abord, je le crus ivre ; sa voix haletante et terrifiée me renforça dans cette impression.
« Ne me laissez pas ! ne me laissez pas seul ! gémit-il en claquant des dents. « Il » est là ! « Il » me guette ! « Il » veut me tuer ! »
Je parcourus des yeux l’étendue déserte de la rue du Sentier. Rien n’y apparaissait anormal. Derrière les grandes glaces illuminées de Hachette, on devinait l’activité habituelle à cette heure où les camionnettes se préparent à emporter les journaux encore gras d’encre humide vers toutes les villes de France. L’homme suivit mon regard.
« Vous ne pouvez pas le voir, mais il est là ! Il me guette ! Oh ! ne me laissez pas seul ! »
« Il est peut-être un peu ivre, songeai-je, mais il a été réellement effrayé par quelque chose… Je peux essayer de le réconforter. » Un coup d’œil à ma montre. Il était à une heure du matin.
« Venez avec moi, » dis-je.
Face à la porte immense de l’imprimerie du « Journal, » semblable à une gueule noire pavée de dents blanches qui étaient les bobines de papier, un bar était encore ouvert, ses lampes projetant sur le macadam de grands rectangles de lumière. La salle était presque vide. Dans un coin, quelques linotypistes vidaient un demi avant que de rentrer chez eux. De l’autre côté de la rue étroite, le tonnerre des rotatives en pleine action faisait trembler les vitres. Mon compagnon semblait avoir repris quelque assurance ; son visage était plus calme, mais je remarquai que ses mains tremblaient encore. Il avait un visage jeune, long et osseux, avec de hautes pommettes saillantes et des sourcils broussailleux. Par un étrange contraste avec l’aspect juvénile de sa physionomie, sa chevelure en désordre était toute blanche.
Il portait un costume sombre qui semblait neuf, mais était incroyablement sale, rayé de suie et de plâtre, et déchiré en plusieurs endroits. Il y avait de la suie, également, sur son visage et ses mains, et sur les espadrilles à semelles de corde qui le chaussaient.
« Deux cognacs, dis-je au patron. Bien servis ! »
Je poussai l’homme dans un coin, vers une chaise. Il s’y laissa tomber comme à bout de forces. En prenant son verre, il renversa une partie du liquide, avala le reste d’un trait. La brûlure de l’alcool ramena quelque couleur à ses joues. Je ne le pressai pas de parler, devinant qu’il allait me raconter son histoire et ne me souciant guère de le troubler par mes questions. J’étais certain, maintenant, qu’il n’avait pas trop bu. Peut-être était-il un peu dérangé ; mais sa peur était bien réelle. Il reposa sur la table son verre vide, me regarda un moment, haussant légèrement les épaules comme si, hésitant, il se décidait à jouer son va-tout.
« Vous devez me croire fou à lier, fit-il à mi-voix. Ma conduite est bizarre, et pourtant… mon histoire est plus bizarre encore. Je ne sais si vous me croirez. Et pourtant… peut-être pourriez-vous m’aider, si vous saviez… »
Il fit une longue pause.
« Je vais tout vous raconter, vous dire mon aventure exactement comme je l’ai vécue. Si vous pouvez me croire, tant mieux… sinon… (ses mains esquissèrent un mouvement fataliste). Pour commencer, je dois remonter de quelques mois en arrière. De combien ? Je ne sais pas au juste. En quel mois sommes-nous ? »
Cette question extraordinaire fit renaître mes soupçons quant à l’équilibre mental de mon interlocuteur. Pourtant, je répondis :
« En septembre… le 24 septembre.
– Septembre, oui… cela fait trois mois ! Trois mois en dehors du temps, si je peux dire… Trois mois d’une vie en dehors de la vie… Je continue, ou plutôt je commence :
*
Il y a trois mois, j’étais dans une situation épouvantable. Croyez-vous à la déveine, à la malchance noire qui vous poursuit, fait écrouler tous vos projets, échouer tous vos plans ? Moi, j’y crois, par expérience personnelle ! La maison où je travaillais comme aide-comptable après un long séjour en sanatorium, venait de fermer. J’étais sans travail. Ni parents ni amis qui puissent me venir en aide. Tout semblait se liguer contre moi. Je devais déjà deux semaines de pension dans le petit hôtel du quatorzième où je logeais, et je savais que, d’un jour à l’autre, on allait me jeter dehors…
Chaque jour, je faisais la tournée des bureaux de placement, je courais les sociétés susceptibles d’embaucher un secrétaire, un garçon de bureau, n’importe quoi, n’importe quel travail, dans le cadre de ceux que ma mauvaise santé me permettait de faire. Hélas ! les employeurs reculaient devant mes vêtements élimés, mes chaussures par trop éculées, mon air famélique ; et c’est uniquement par acquis de conscience que je répondis un jour à une annonce aperçue dans un journal ; convoqué à ma grande surprise, je me présentai au professeur Albert Gaultier, qui recherchait un assistant pour une tâche non définie.
Le professeur Gaultier logeait, lui aussi, à l’hôtel ; non pas dans un établissement de dernier ordre tel le mien, mais dans l’une des plus luxueuses résidences de la rive droite. Il me reçut très aimablement ; et encore que son abord me surprit, je répondis avec empressement à ses questions, anxieux de ne pas laisser échapper cette chance de refaire ma vie.
Je vous ai dit que son aspect m’avait surpris. Imaginez, pour voir Albert Gaultier, un conquistador, – Pizarre ou Cortez, – même regard de feu, regard de mystique ou de conquérant, même visage buriné par une vie d’aventures au grand large, même collier de barbe évoquant l’ascète ou le soldat… Il aurait paru plus naturel de voir Gaultier couvert de la cuirasse et coiffé d’un morion, ou drapé dans la bure des moines, que de le découvrir en complet veston…
Il m’interrogea longuement, non sur mes diplômes et mes connaissances techniques, mais sur ma famille et mes relations, et je crus le deviner satisfait d’apprendre que j’étais seul au monde. Je pensais que l’assistant d’un professeur devrait posséder au moins une teinture de science ; mais non, la question ne fut pas même effleurée. Quand j’eus terminé mes explications, il m’exposa son offre.
Il commença par me dire qu’il était engagé dans certaines recherches très importantes, qui devaient demeurer absolument secrètes jusqu’à leur aboutissement. Il me faudrait donc habiter chez lui et me résoudre à n’en point sortir avant la fin de ses travaux – qui pourraient s’étendre sur une assez longue période. Il m’offrait un salaire magnifique, mais omit de préciser ce qu’il attendait de moi en échange. Au demeurant, cela importait peu.
« Vous êtes, si je comprends, immédiatement disponible ? me demanda-t-il.
– Certainement… dès que j’aurai réglé ma note à l’hôtel.
– Fort bien. Dès ce soir, nous partirons pour ma résidence. En attendant, je vais vous accompagner chez vous ; nous réglerons vos dettes et embarquerons vos bagages.
– Je n’ai presque rien, dis-je. Quelques chemises, quelques livres… le déménagement ne prendra guère de temps. »
(À suivre)
–––––
(H. Bourdens, in Le Petit Marocain, trente-sixième année, n° 10052, jeudi 4 novembre 1948 ; ce très curieux roman « fantastique, » sur le thème des autres dimensions, n’a jamais été publié en volume ; il est précédemment paru dans L’Avant-Garde, organe central de la Fédération des jeunesses communistes de France, à partir de septembre 1946)
–––––
(in Ce Soir, grand quotidien d’information indépendant, dixième année, n° 1549, vendredi 6 septembre 1946)