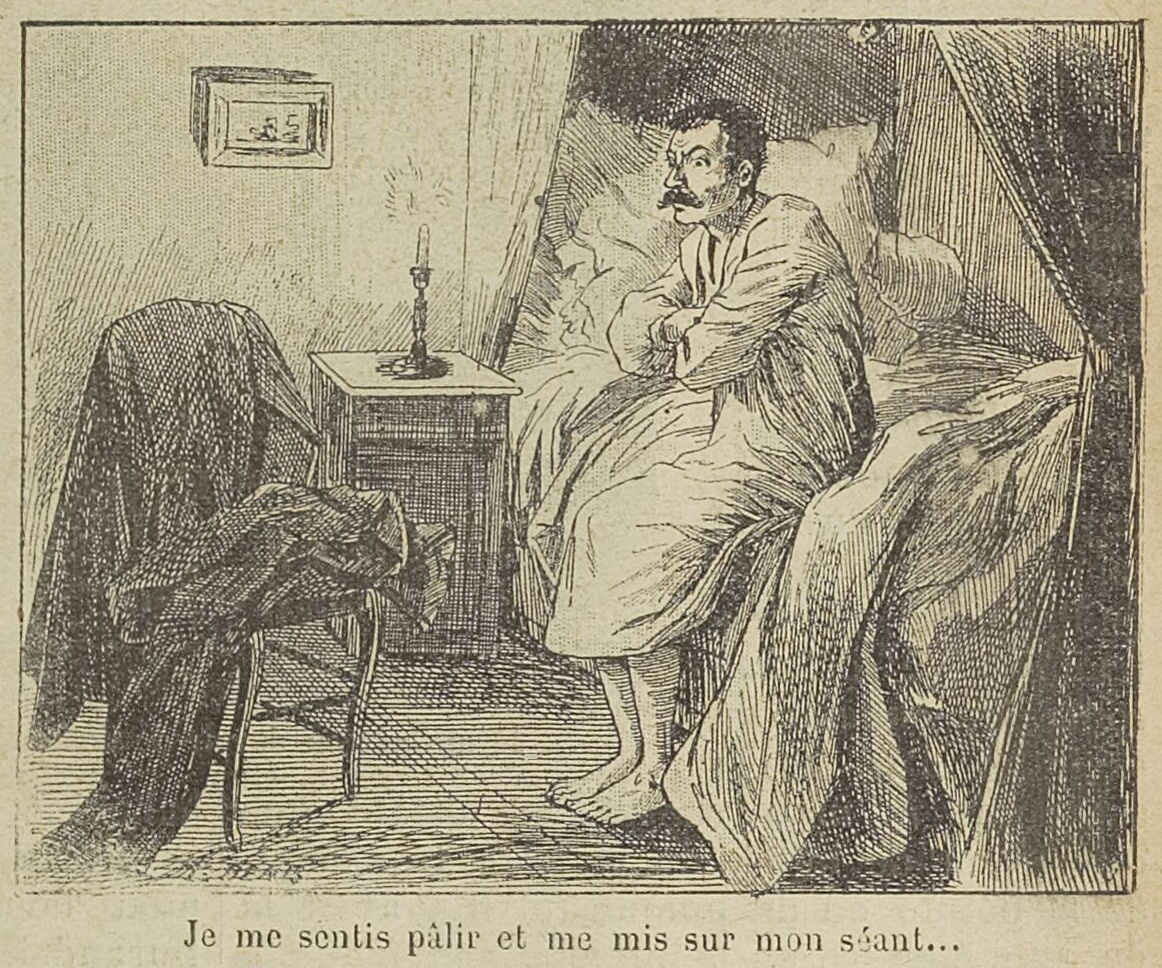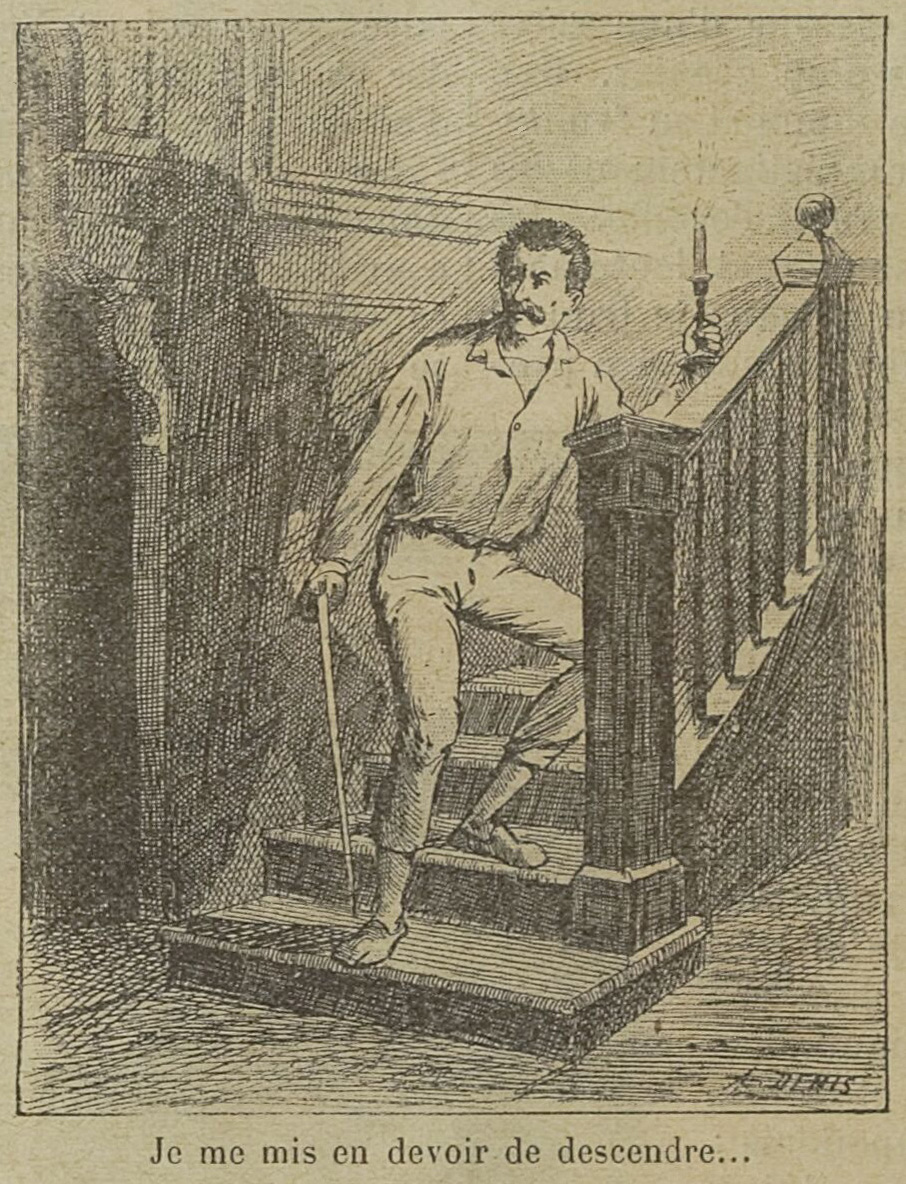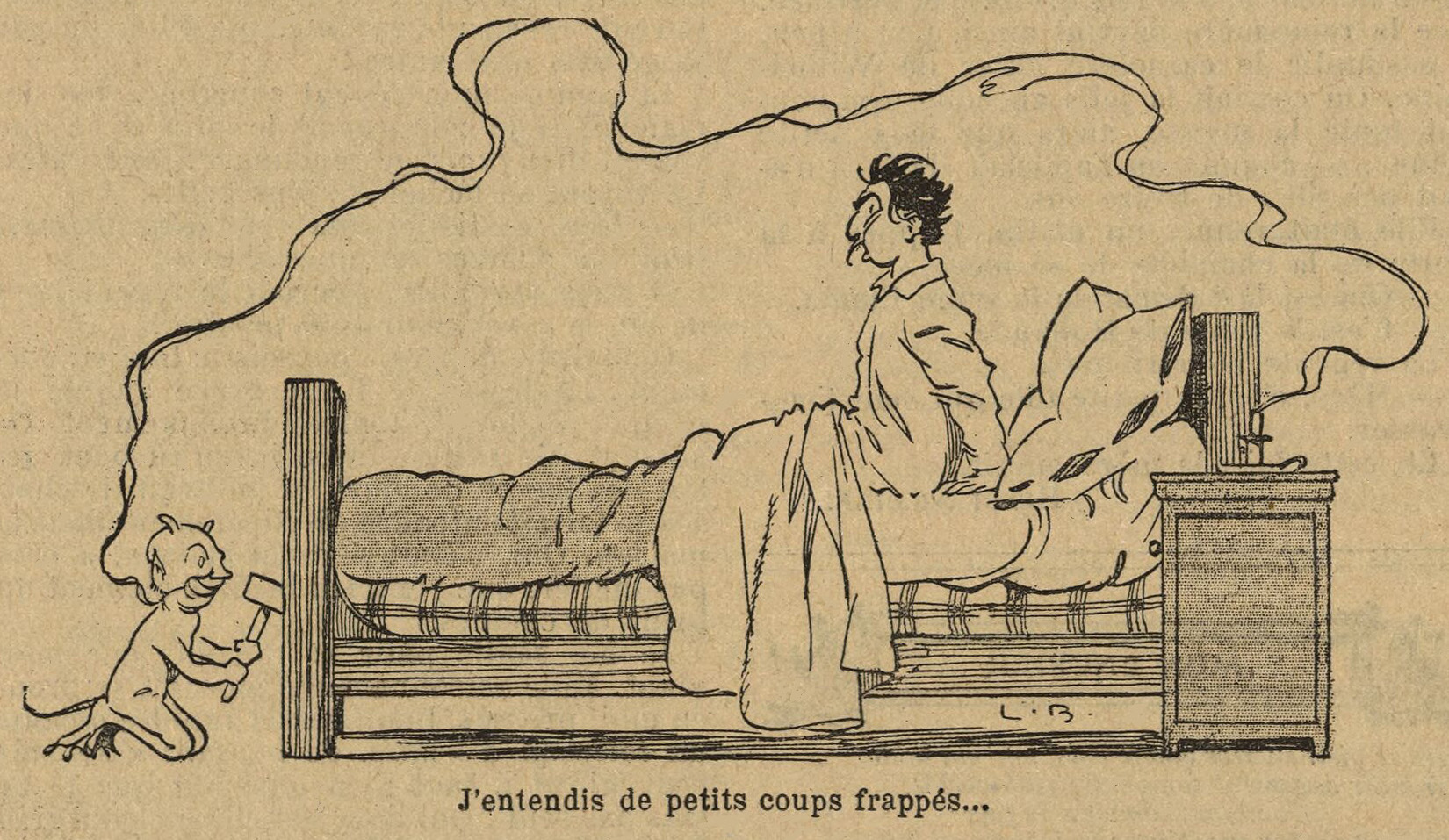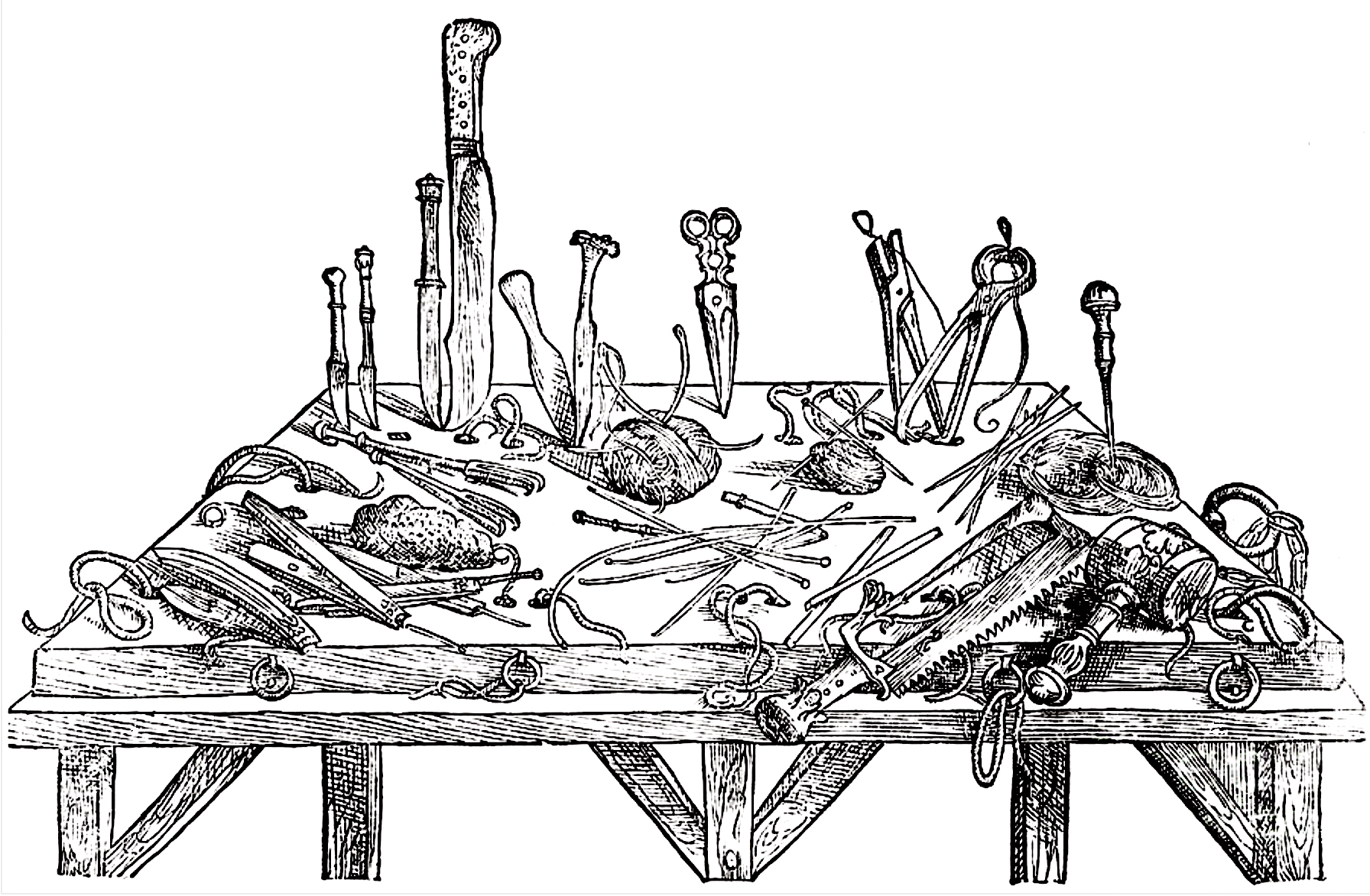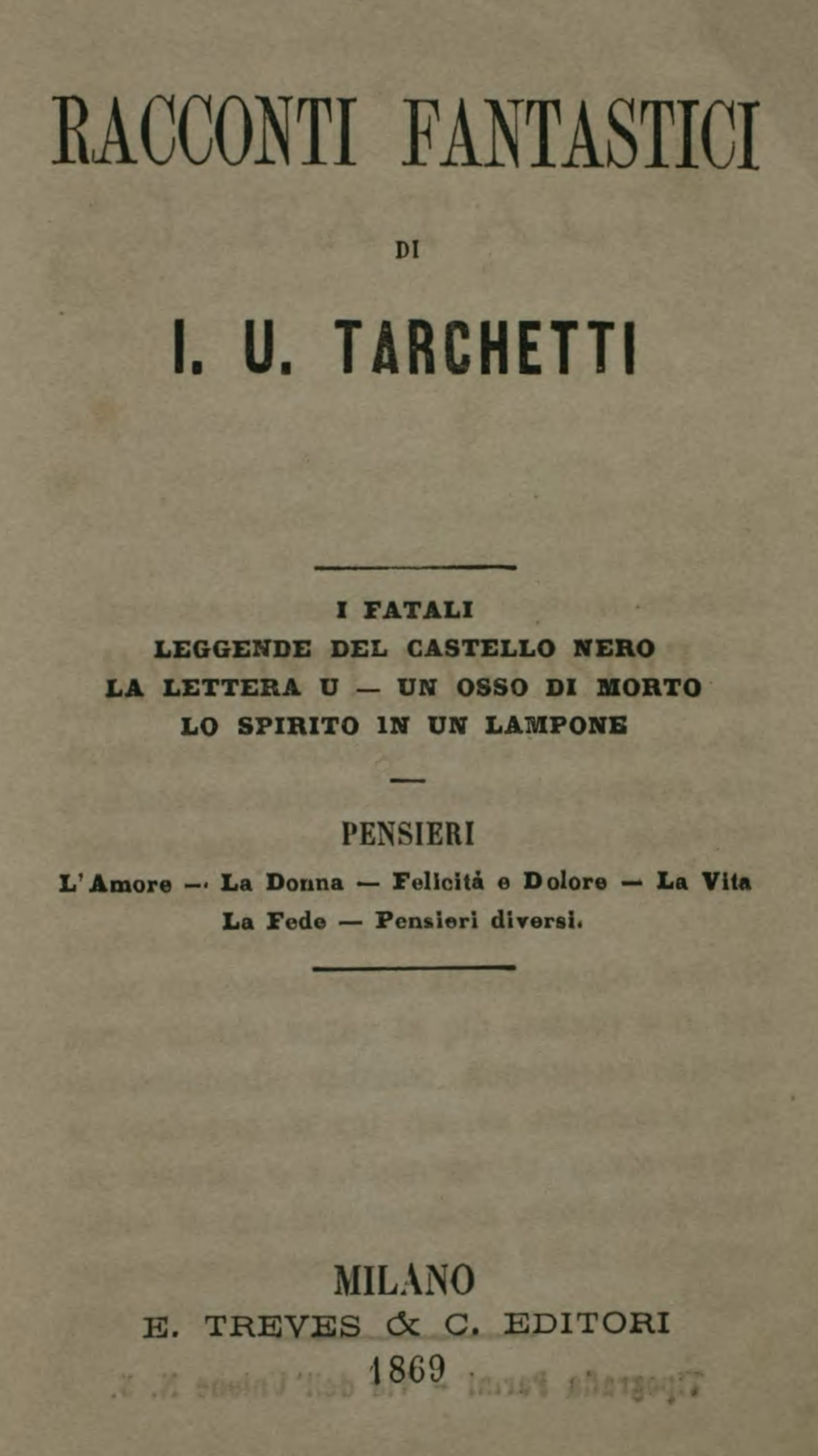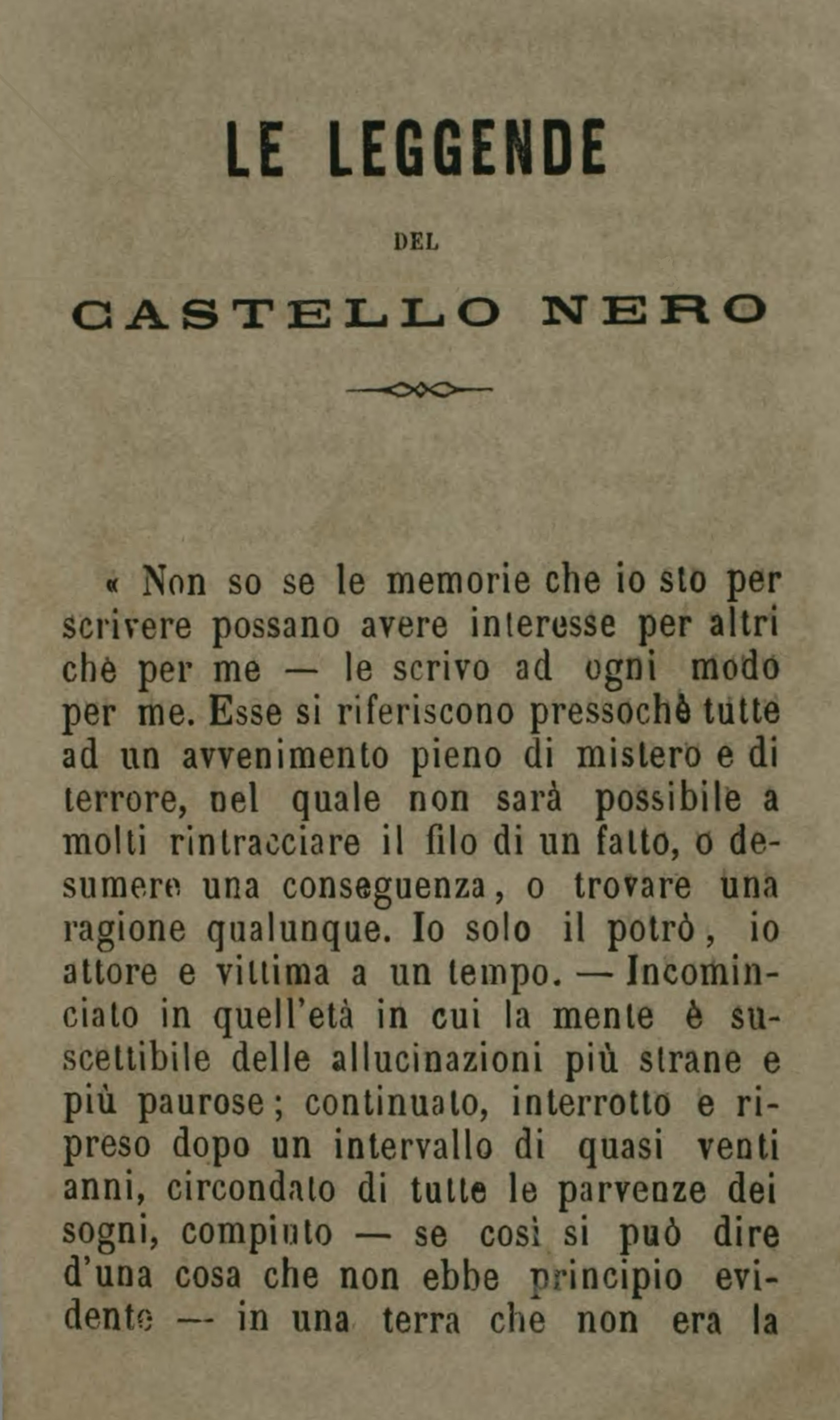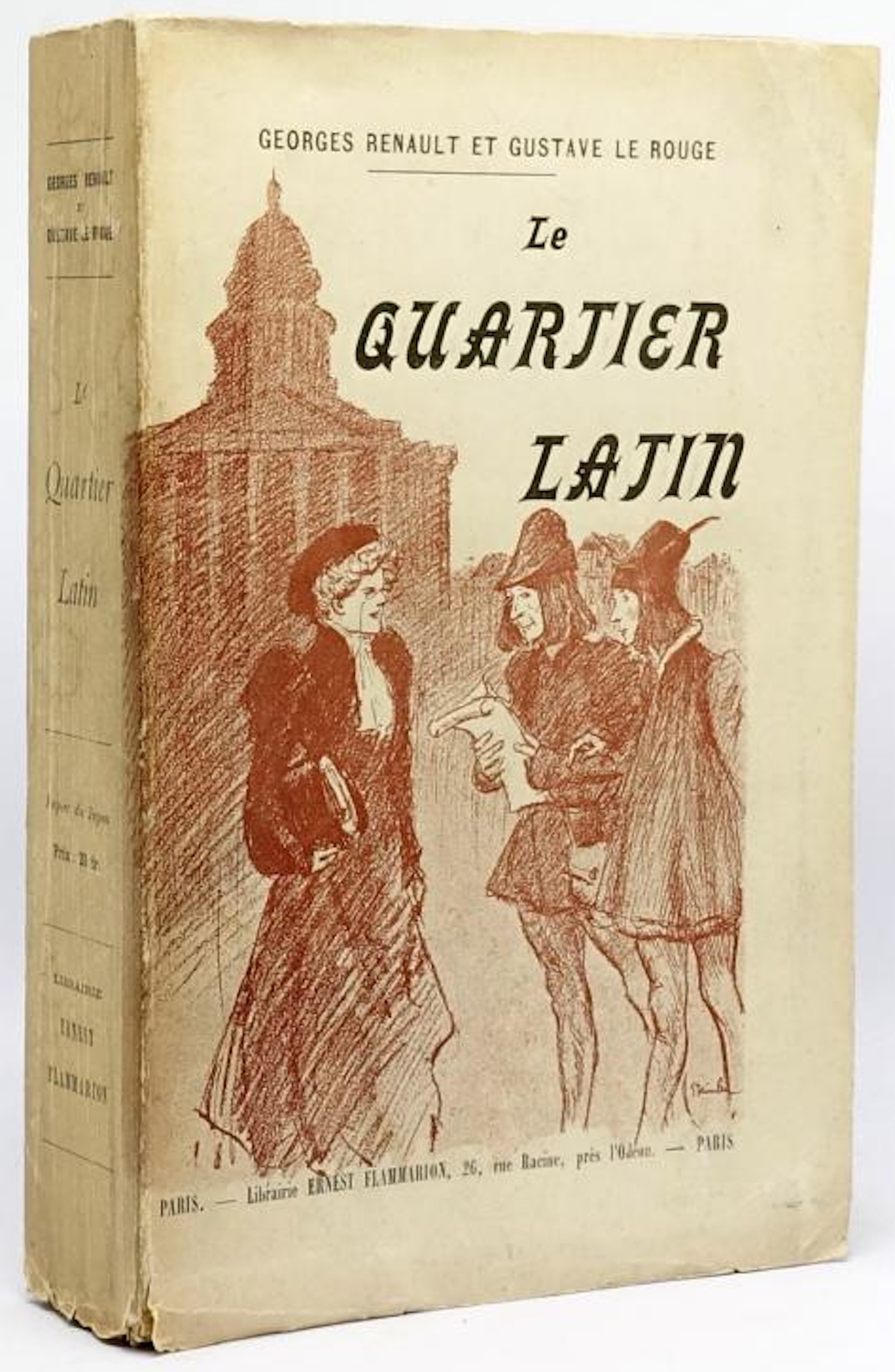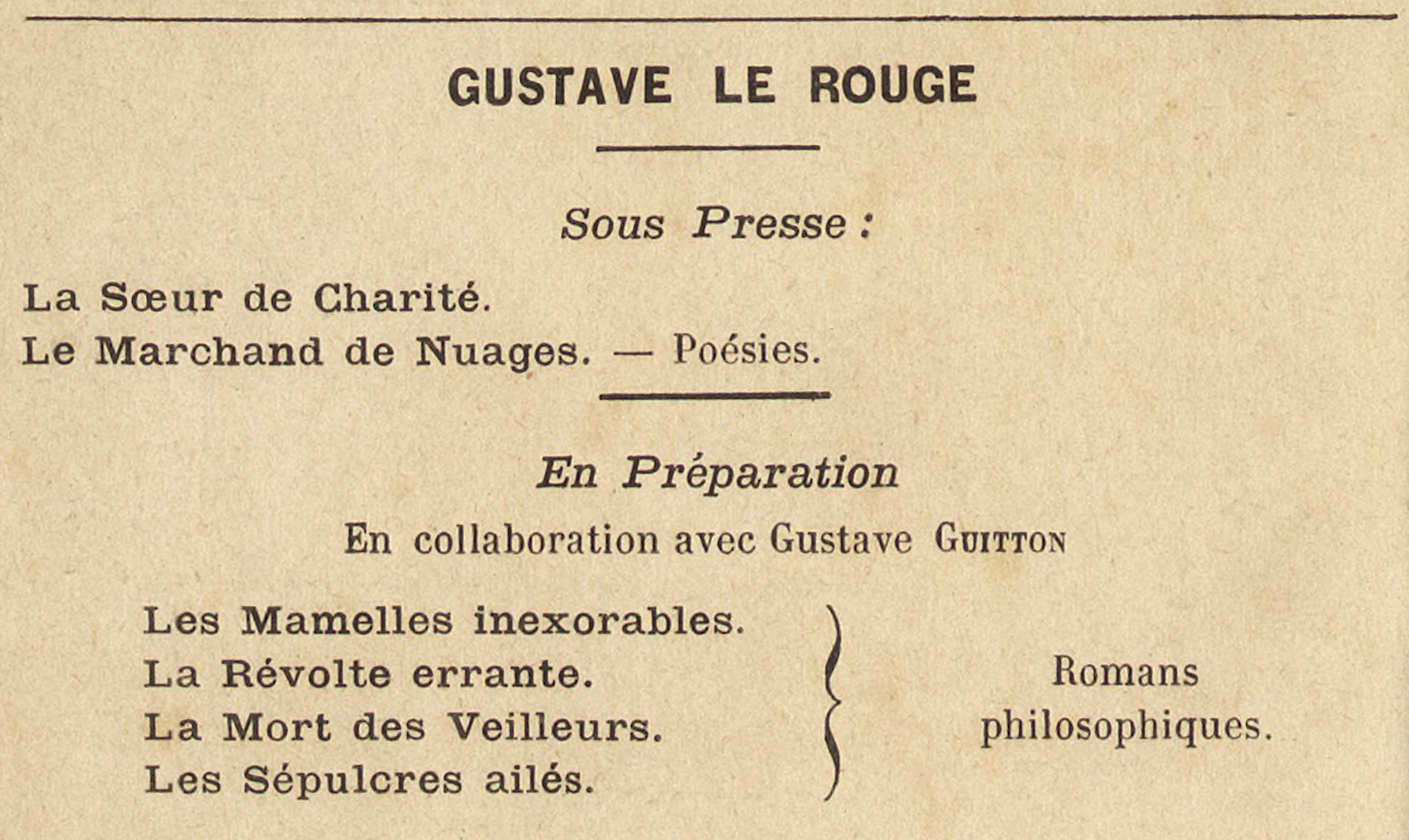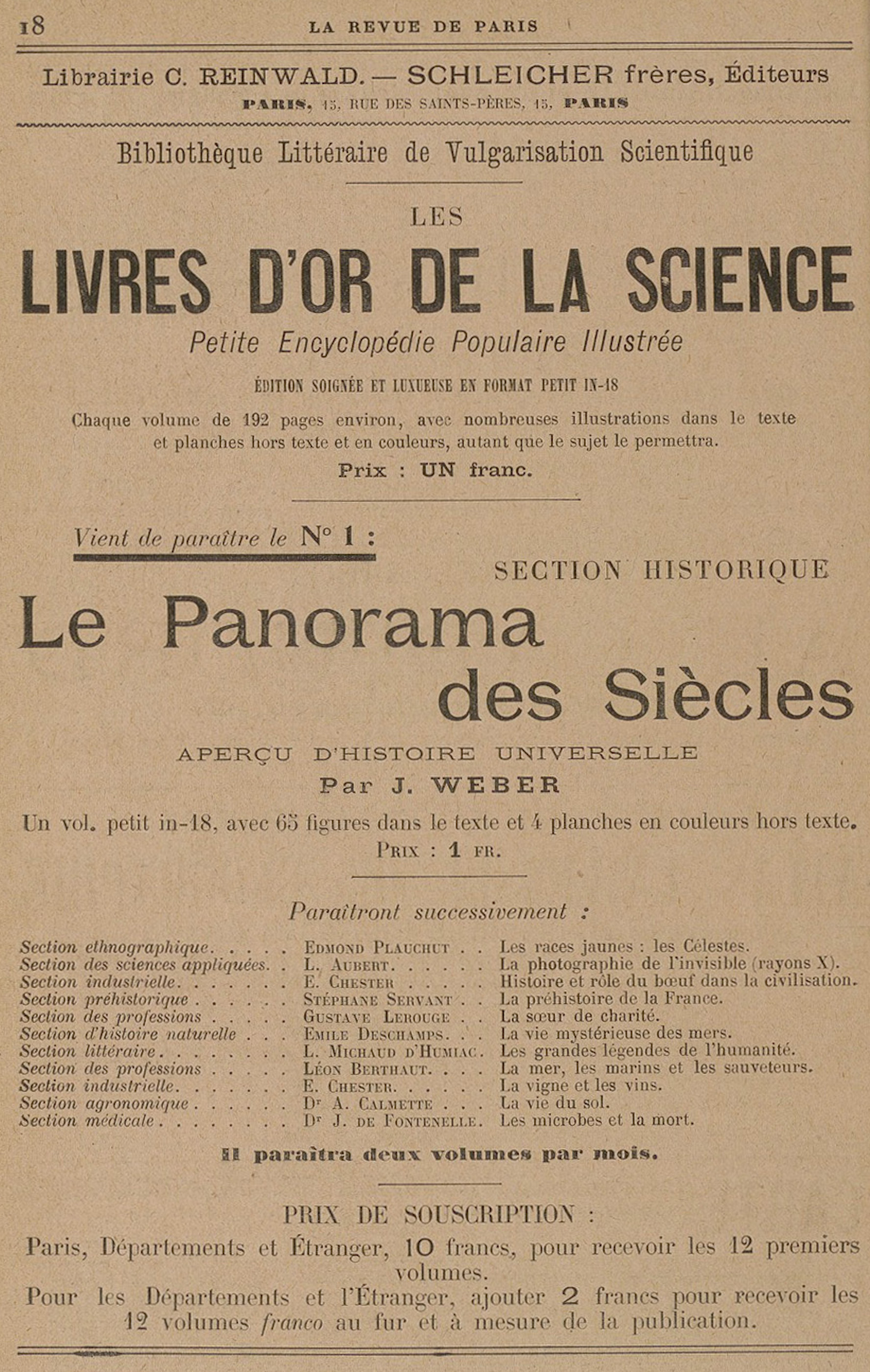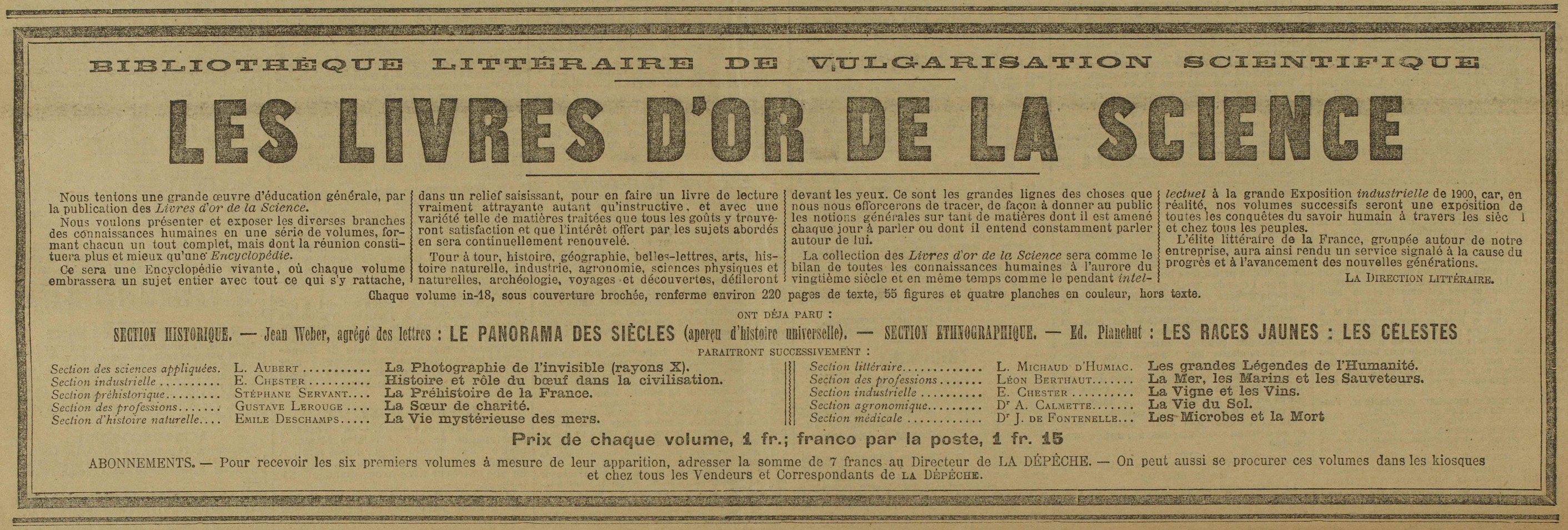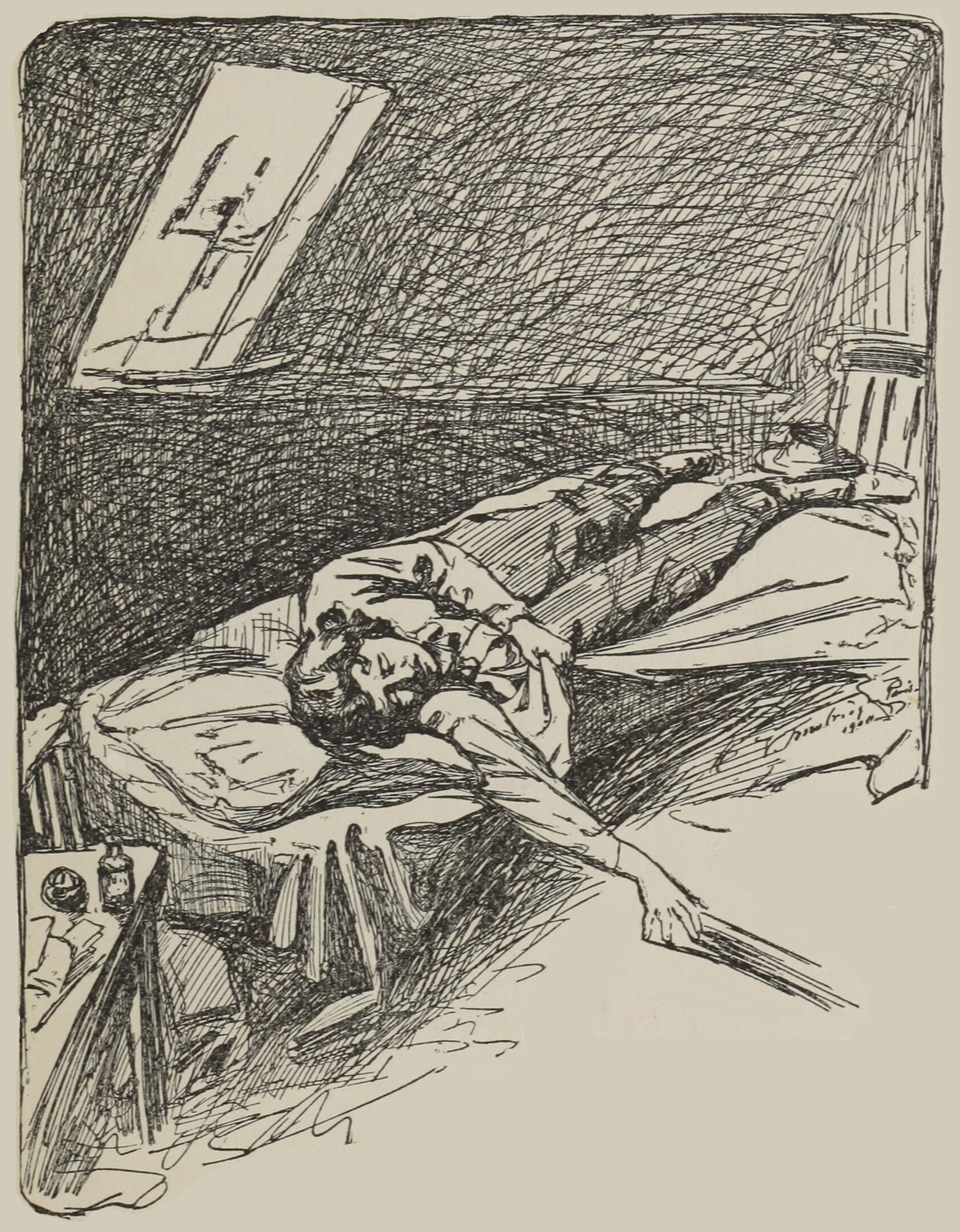Je déambulais dans la brume au long des fortifs, relevant avec intérêt les inscriptions et hiéroglyphes tracés sur les murs voisins par des mains peu artistiques – « mains élémentaires, » disent les chiromanciens.
Un monsieur, surgi de l’ombre, se dressa devant moi et prononça ces mots avec un soupir :
« Paris étrangle ! »
Instinctivement, je regardai le cou du quidam. Il était emprisonné dans un haut col droit.
« Ôtez votre carcan, » lui dis-je obligeamment.
L’individu haussa les épaules avec une urbanité charmante et répondit :
« Je ne vous parle pas de moi. Je vous dis que la capitale avec ses deux millions sept cent mille habitants étrangle ; qu’elle étouffe, si vous aimez mieux, derrière ces remparts inutiles à la défense nationale et qu’il faudrait jeter bas. »
Je regardai plus attentivement cet interlocuteur. Taille moyenne, bouche moyenne, nez moyen, il devait avoir l’esprit comme la taille, la bouche et le nez. Son âge aussi était quelconque.
« Que feriez-vous ensuite de l’emplacement ? » interrogeai-je.
Le monsieur moyen me toisa avec le mépris du petit rentier pour l’artiste qui voudrait lui emprunter cent sous et laissa solennellement tomber ces paroles :
« Quoi ! vous ne le savez pas ? Vous ne lisez donc pas les journaux ? Vous ne fréquentez donc pas vos semblables ? Vous êtes donc étranger à la vie publique ? »
Et comme je baissais humblement la tête, il ajouta :
« Sur cet emplacement, nous élèverons de belles et bonnes maisons à six étages ; nous alignerons des rues avec des magasins, des débits, des ateliers. La circulation, le commerce, les affaires… »
Sans en écouter davantage, je l’interrompis :
« Je vous connais, m’écriai-je. Vous vous appelez Joseph Prudhomme et vous êtes propriétaire. »
L’homme se rengorgea :
« Propriétaire, en effet, et j’ai un neveu architecte. Quels beaux immeubles de rapport on construirait ici en nivelant ces talus et déracinant ces affreux arbres ! »
Cette fois, je ne pus me contenir :
« Barbare ! m’écriai-je, vous n’aurez jamais que cet idéal : faire des affaires ! Éternellement fermé à l’art, à la vie, au simple bon sens, vous n’aurez d’yeux que pour ne pas voir et de bouche que pour ressasser les banalités courantes. Vous dites que Paris étrangle, et votre rêve, c’est de l’étrangler encore davantage en lui enlevant le peu d’air, de lumière et d’espace verdoyant qui lui reste. Un océan de maisons projetant ses vagues de pierre sur la campagne détruite ! des casernes, encore et partout des casernes, voilà ce qu’il vous faut ! »
Et je partis, laissant là, stupéfait, le champion de la circulation et du commerce.
C’est, hélas ! une aberration lamentable, dissimulée sous les apparences du progrès et de l’esprit démocratique, que de vouloir augmenter l’insalubrité déjà suffisante de la capitale pour le plus grand profit des spéculateurs de terrains et constructeurs d’immeubles. Alors que le centre de Paris est encore déshonoré par des cloaques et des boyaux obscurs comme la rue Quincampoix, la rue de l’Homme-Armé, la rue de Venise, foyers de pestilence physique et morale, sans compter les impasses, cours et cités ouvrières des quartiers excentriques ; alors qu’il faudrait d’urgence jeter bas des pâtés de masures, porter dans leurs débris le pic et la torche purificatrice, multiplier les jardins publics et faire pénétrer à grands flots l’air et la lumière dans tous les recoins de la capitale transformée, surgissent les appétits masqués des capitalistes et aspirants capitalistes. L’idée fixe de toute une horde étrangère aux considérations hygiéniques est de remplacer le bien mince ruban vert qui circonscrit encore la ville par une immense ceinture de pierre, trouée çà et là de quelques voies. C’est ce qu’on appelle « élargir » Paris.
Tous ceux qui s’occupent tant soit peu de ces questions connaissent l’immense supériorité sanitaire de Londres sur Paris. C’est que la capitale anglaise n’est, en général, bâtie que de maisons à trois étages : elle s’étend en largeur bien plus qu’en hauteur ; des parcs immenses comme ceux de Regent’s Park, Hyde Park, Saint-James, Battersea élèvent au ciel leurs grands arbres épurateurs de l’atmosphère et offrent leurs pelouses aux promenades des amoureux, au repos des vagabonds. Et l’Angleterre est un pays puritain, aristocratique ! En France, pays joyeux et démocratique, monsieur Prudhomme, qui fait loi, enlèvera aux familles de prolétaires et aux déshérités le seul coin où ils puissent villégiaturer et parfois, étendus le dos sur le gazon, la face tournée vers le ciel, oublier la vie !
Tandis que des quartiers prolétariens comme celui de Plaisance râlent sous l’étreinte de la tuberculose, presque inconnue aux Champs-Élysées ; tandis que le lamentable troupeau des chairs-à-travail, se mourant faute de bains d’air et de lumière, produit une race de malades inaptes à la pensée et à l’effort viril, race que guette la criminalité, d’honorables malfaiteurs rêvent d’asphyxier encore davantage leurs congénères et d’épaissir l’ombre si formidable de la ville tentaculaire. « Au nom du progrès ! » déclarent-ils ; et le brave prolétaire les croit sur parole !
Il ne s’agit pas pour eux – ce qui serait acceptable – de trouer çà et là l’enceinte bastionnée inutile à la défense de Paris. Il ne s’agit pas – ce qui serai désirable – de supprimer définitivement l’octroi et de réunir la capitale à sa banlieue par un réseau toujours plus développé de communications rapides. Ni même de substituer à la sauvagerie des fortifs, qui a son pittoresque, des jardins et des squares agrémentés de guinguettes – comme si celles des alentours ne suffisaient pas ! Il s’agit d’élever encore, toujours et partout, des cubes de pierre, afin d’y emprisonner des familles et d’y vendre au détail un air bientôt empoisonné.
Alors que l’humanité contemporaine, – tout au moins celle des grandes villes, – surchauffée par l’excès des jouissances ou surmenée de privations et de travail, a besoin de se mettre au vert pour un temps et de se constituer des réserves de vie naturelle, la bourgeoisie, aveugle et cupide, continue à ne voir que spéculations, affaires, argent. Périsse le génie humain, pourvu qu’elle remplisse sa caisse ! Et ce sentiment est tellement profond que, même un écrivain de haute originalité comme Wells, teintant ses fantaisies d’un vernis scientifique, en arrive à montrer, d’ici un siècle, Londres peuplé de trente-trois millions d’habitants !
Chercher à investiguer l’avenir avec ses possibilités et ne pas apercevoir ce qui crève les yeux, c’est-à-dire l’irrésistible mouvement des masses ouvrières qui, montant des profondeurs, emportera le salariat et refera à l’humanité de nouvelles conditions de vie, est une aberration semblable à celle de l’astrologue explorant le ciel et tombant dans un puits !
Croire que les humains, économiquement affranchis, continueront à s’agglomérer comme un bétail dans les maisons-casernes et les taudis, dénote une singulière myopie.
Dans des milliers de siècles, nos descendants évolués pourront différer de nous plus que nous ne différons des pithécanthropes. Peut-être alors pourront-ils se passer de ce qui nous est nécessaire aujourd’hui. Pour le moment, la plante humaine, si mobile soit-elle, a encore besoin du sol végétal, de l’eau, de l’air et du soleil.

–––––
(Charles Malato, in L’Action quotidienne, anticléricale, républicaine, socialiste, quatrième année, n° 1329, samedi 17 novembre 1906)