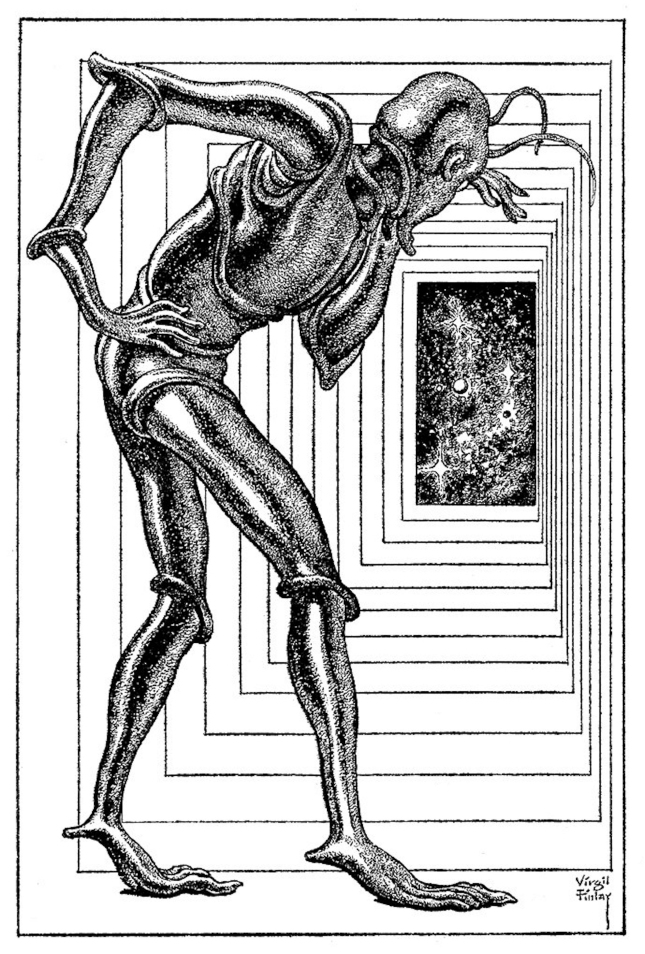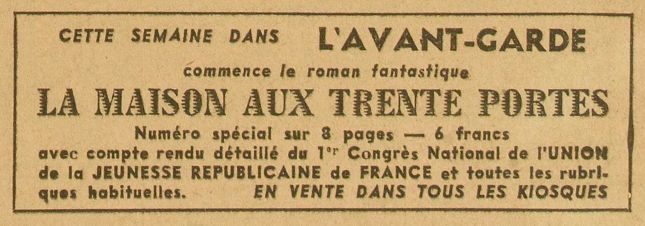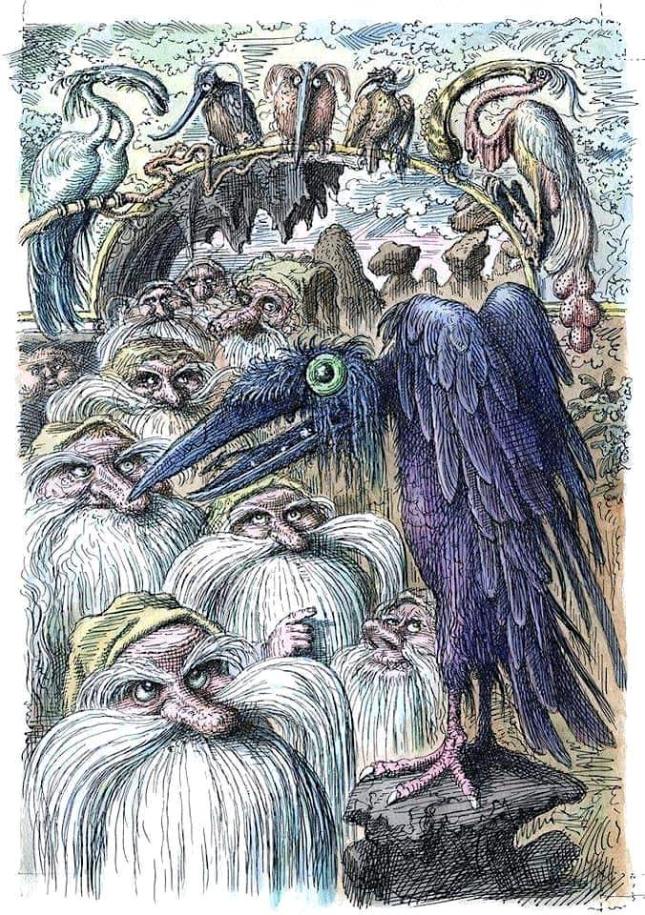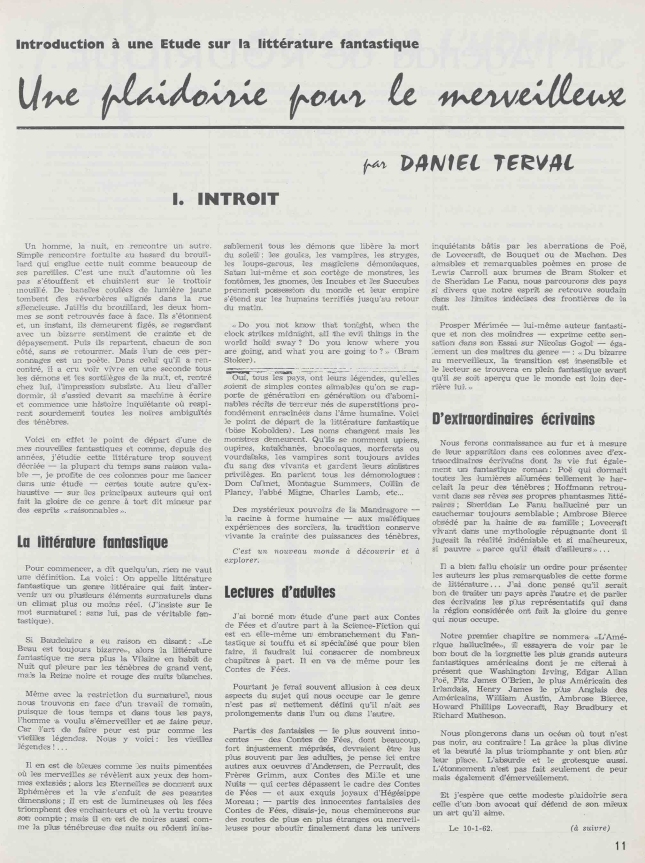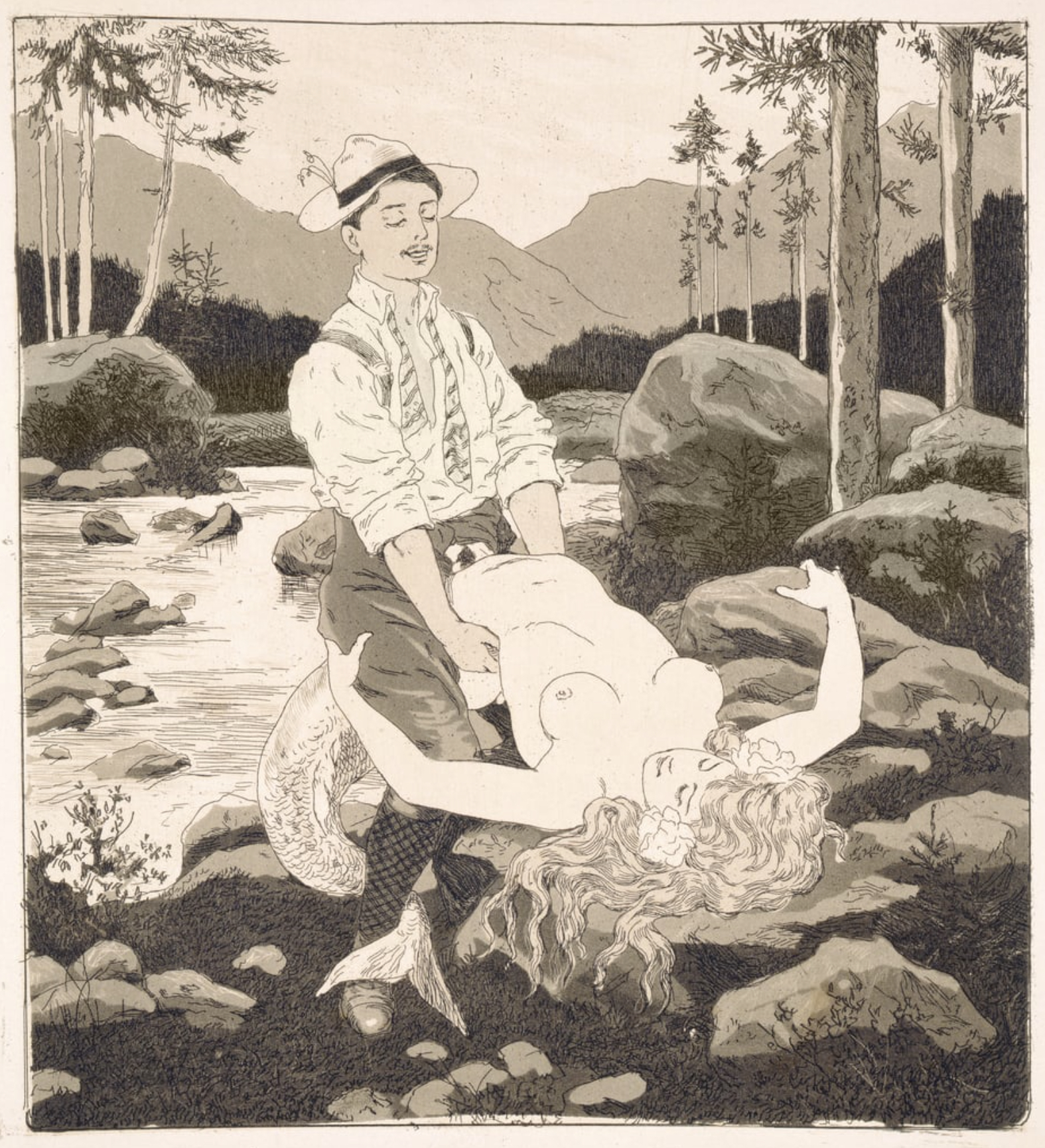La peur est un sentiment qui ne s’explique pas. Elle peut être raisonnée et lointaine, comme instinctive et présente ; tel craintif ayant été l’objet d’une éducation émotionnelle intense peut, à un moment donné, faire un acte d’énergie, de courage, en contradiction avec ses actes passés de timoré ; tel autre brave, ayant à son actif les plus beaux traits de courage, éprouvera de la crainte en présence d’une araignée, d’une souris ou d’un animal inoffensif quelconque ; c’est ce qui est arrivé à mon excellent ami Lagarde, capitaine d’infanterie coloniale qui, l’autre jour, se rendant à Vichy pour soigner sa maladie de foie, m’a raconté l’histoire que voici :
« Tu sais, me dit-il, que j’ai 23 ans de service militaire pendant lesquels j’ai traîné mes guêtres un peu partout : au Tonkin, à Madagascar, en Tunisie, au Maroc, et, finalement, en France, en Macédoine ; que j’ai combattu à l’Yser, sur la Somme, à Verdun au Mont-Cornouiller, à Monastir.
En roulant ma bosse ainsi et surtout dans les cinq ans qui viennent de s’écouler, j’ai vu bien des spectacles impressionnants, des cruautés inouïes, des massacres horribles ; j’étais, tu le sais, du corps d’armée du brave Mangin et je pris part aux sept vagues des Sénégalais, qui le 16 avril 1917 ont été fauchées par la mitrailles des Allemands, vagues qui, du reste, ont sauvé l’armée française. Eh bien ! je n’ai jamais eu le frisson de la peur, je n’ai jamais ressenti le moindre sentiment de crainte ou de frayeur, si ce n’est une seule fois et dans les circonstances suivantes :
Revenant, dans le courant de l’été de 1917, d’une randonnée fort pénible en Macédoine, au cours de laquelle plusieurs de mes hommes moururent d’insolation, je rentrai dans ma cagna vers 6 heures du soir, éreinté, moulu par la longue course que notre bataillon venait de faire, et je me décidai, afin de me délasser, de prendre un tub réparateur.
J’eus vite fait de préparer le nécessaire : eau et récipients, et de me déshabiller ; j’allais commencer mes ablutions, lorsque tout à coup une chauve-souris pénétra par un trou ménagé dans le mur de la cagna pour l’aérer, et se mit à tourner, volant insolemment autour de moi ; elle fut immédiatement suivie de plusieurs autres chauves-souris, et finalement une centaine de ces vilains animaux envahirent mon modeste logement, évoluant d’une façon fantastique, tournoyant dans un cercle dont j’étais le centre.
J’avoue que j’étais fort mal à l’aise, et, le cercle décrit par les chauves-souris se resserrant de plus en plus, elles arrivèrent à me frôler de leurs gluantes ailes. Ce manège dura plus d’une heure et on comprendra facilement quelle devait être ma triste attitude, nu au milieu de ces bestioles, et impossible d’atteindre mes vêtements pour me rhabiller. Paralysé par la peur au point de ne pouvoir ni faire un geste, ni articuler un appel, je me demandai avec effroi ce qu’il allait arriver, prévoyant déjà que les chauves-souris se colleraient bientôt sur tout mon corps, sentant déjà leur succion diabolique, lorsqu’un coup de théâtre modifia ma triste et pénible situation.
Les chauves-souris, élargissant peu à peu leur cercle, s’éloignèrent et allèrent se coller sur les parois de ma cagna à égale distance, constituant ainsi la plus répugnante des tapisseries ; elles s’accrochèrent aussi sur mon lit, sur mes vêtements, et jusque sur la petite glace appendue au-dessus de mes cantines qui me servaient de table de toilette.
Je me demandais quelle était la cause de leur immobilité, et j’espérais reprendre mes sens absolument abolis, lorsque j’aperçus, voletant autour de moi, une de ces chauves-souris énormes appelées vampire ou stryge dont l’envergure est bien de soixante-dix centimètres et que l’on rencontre dans le Haut-Sénégal.
J’avoue que ma crainte première se changea en un indicible effroi, en une épouvante terrible, surtout lorsque je m’aperçus que le monstre limitait son cercle et se rapprochait de plus en plus de mon visage ; je voyais ses yeux perçants me fixer chaque fois qu’il me frôlait, ses oreilles de rat se redresser, et un horrible rictus, laissant voir de fines dents, longues et acérées. J’étais horrifié, littéralement anéanti, dans une torpeur angoissante ; suant à grosses gouttes, incapable de faire le moindre mouvement, j’étais à la fois brûlant et glacé ; j’avais la fièvre, je respirais avec essoufflement, je sentais délirer ma pensée.
Tout à coup, le monstre m’abandonna, jugeant probablement que je serais difficile à croquer et, successivement, il avala une à une toutes les chauves-souris qui se trouvaient chez moi ; d’un coup de mâchoire, il leur brisait les reins ; on entendait un petit cri aigu et la victime disparaissait engloutie.
Le vampire ne s’arrêta qu’après avoir absorbé gloutonnement la dernière chauve-souris et, pendant tout son horrible repas, la peur effroyable qui m’étreignait ne cessa de m’immobiliser de la façon la plus complète ; j’étais hypnotisé par le monstre dont je détaillais les yeux, les oreilles, la bouche, les ailes membraneuses !
Puis le vampire, dont la grosseur était énorme par suite de l’absorption immodérée des chauves-souris, comme pour remplir un dernier devoir, se mit à tourner autour de ma tête et disparut, non pas par le trou par lequel il était entré, car il eût été insuffisant, mais par la porte qu’un violent coup de vent venait d’ouvrir.
J’étais délivré ; je me tâtai et fus tout étonné de me retrouver dans mon lit, un peu fatigué par le cauchemar horrible que je venais d’avoir. J’avais été réveillé par la chute du livre, les « Histoires extraordinaires » d’Edgar Poe, que j’avais lu avant de m’endormir et que, dans un mouvement inconscient, je venais de faire tomber de ma table de nuit.
Tu vois, me dit Lagarde, après son récit, que la peur ne s’analyse pas et qu’un poilu ayant couru les plus grands dangers peut, à l’occasion, éprouver une peur ridicule. »
Pour copie conforme :
–––––
(Achille Robert, in Annales africaines, revue politique et littéraire de l’Afrique du Nord, trente-et-unième année, nouvelle série, n° 29, jeudi 20 novembre 1919 ; Achille Robert, « administrateur principal honoraire de Commune mixte, à Bordj-bou-Arréridj, » « Types algériens : mœurs, coutumes, traditions, » in Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique, historique & géographique du département de Constantine, XVIe volume de la cinquième série, années 1928-1929, Constantine : Éditions Braham)