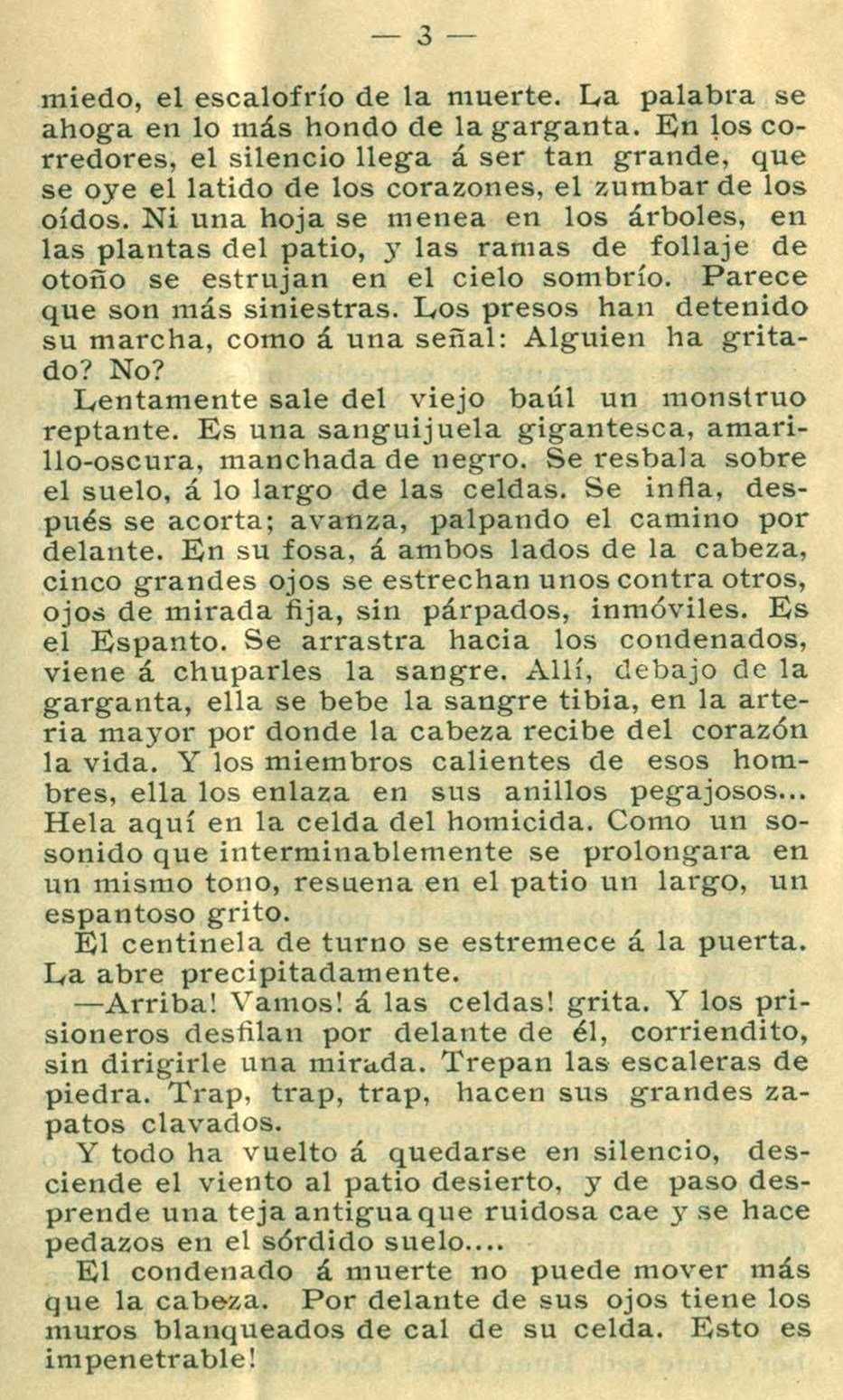La Porte ouverte est heureuse de publier aujourd’hui la traduction de deux nouvelles de Gustav Meyrink, « Der Schrecken » et « Das – – allerdings, » parues en juin et août 1908, dans Roman et vie, le supplément littéraire bimensuel de la Revue, dirigée par l’irremplaçable Jean Finot. À notre connaissance, elles constituent les premières parutions de Meyrink en langue française.
MONSIEUR N
–––––
L’ÉPOUVANTE (1)
–––––
Un bruit de clefs, et dans le préau pénètre un troupeau de prisonniers. – Midi. Deux à deux, en file indienne, on les fait marcher en rond, pour prendre l’air.
La cour est pavée ; au milieu seulement, une tache d’herbe sombre, comme le tertre d’une tombe : quatre arbres grêles, une haie au feuillage triste.
Des murs, tout autour, des murs vieux, jaunes, où des cellules ouvrent leurs petites fenêtres grillées. Dans leurs vêtements gris de détenus, les prisonniers défilent, l’un derrière l’autre, en tournant. Ils causent à peine. – Presque tous sont malades. – Sans but, membres enflés.
Les visages sont gris, gris comme du mastic, les yeux sans flamme. La démarche est égale, les cœurs ne connaissent plus la joie.
En képi, le sabre au côté, le surveillant est là, debout à la porte de la cour. Son regard est fixe.
Le long des murailles, la terre est nue. – Aucune plante n’y pousse. – C’est de la souffrance qui suinte à travers les murs jaunes.
« Lukawsky vient de passer devant le président. » (2) Un prisonnier jette cette nouvelle à mi-voix, par sa lucarne. – La troupe des détenus ne s’est pas arrêtée.
« Quoi donc ? Lukawsky ? » demande à son voisin un prisonnier récemment incarcéré. – Lukawsky l’assassin, condamné à être pendu. Aujourd’hui, je crois, on doit confirmer le jugement, ou lui faire grâce. – L’arrêt de mort a été maintenu, le président lui a a fait lecture, dans la salle du greffe. – Lukawsky n’a pas dit une parole. Il a simplement chancelé. – Oui, mais dehors il a grincé des dents, il a pris une crise furieuse. – Et les gardiens lui ont mis la camisole de force ; ils l’ont attaché sur le banc, pour qu’il ne puisse bouger, jusqu’à demain matin. – Et ils ont placé un crucifix devant lui. »
Par phrases entrecoupées, le prisonnier de la cellule racontait cela au autres, ils marchaient toujours. « Cellule 25, c’est là qu’il est, Lukawsky, » dit un détenu, un des plus âgés. – Tous les regards montent vers la lucarne grillée du n° 25.
Et, l’esprit vide, le surveillant, adossé à la porte, repoussait du pied une vieille croûte de pain tombée sur le chemin…
Dans les couloirs étroits de la vieille prison, les portes des cachots se serrent l’une contre l’autre, nombreuses. Portes de chêne, basses, encastrées dans la maçonnerie, garnies de bandes de fer, de gros verrous, de serrures. – Chaque porte a son petit guichet au grillage serré. – La nouvelle qui court de bouche en bouche, à travers les grilles des fenêtres, partout, a pu cependant passer par là. « Demain, on pend Lukawsky ! »
Un grand silence dans les couloirs, dans toute la prison. Et pourtant une rumeur circule, si légère qu’elle ne s’entend pas ! On la sent glisser. – Traversant les murs, elle vient tourbillonner dehors comme un essaim de moucherons. – Et c’est la vie qui bruit, la vie enchaînée, la vie prisonnière !
Au milieu du corridor central, à l’endroit où il s’élargit, un vieux bahut, vide, dans l’ombre.
Lentement, sans bruit, son couvercle se lève. – Et, dans toute la prison, c’est comme si la peur se glissait, le frisson de la mort. – La parole s’étrangle au fond des gosiers. – Le silence est devenu si grand, dans les couloirs, qu’on entend les cœurs battre, les oreilles tinter.
Pas une feuille ne bouge aux arbres, aux plantes de la cour, et les branches au feuillage d’automne s’agrippent dans le ciel terne. – Elles sont plus sinistres, semble-t-il.
Les détenus ont arrêté leur promenade, comme sur un signal : Quelqu’un a crié ? Non ?
Lentement, un monstre rampant sort du vieux bahut. – C’est une sangsue gigantesque, jaune foncée tachetée de noir. – Elle se glisse sur le sol, le long des cellules. Elle s’enfle, puis diminue de taille ; elle avance, tâtant le chemin devant elle. – Dans leur trou, de chaque côté de la tête, cinq gros yeux se serrent l’un contre l’autre, des yeux au regard fin sans paupières, immobiles. – C’est l’Épouvante.
Elle rampe vers les condamnés, elle vient sucer leur sang. Là, sous la gorge, elle boit le sang tiède, dans la grosse artère par où la tête reçoit du cœur la vie. – Et les membres chauds de ces hommes, elle les enlace de ses anneaux gluants…
La voici dans la cellule du meurtrier. – Comme un son interminablement prolongé sur le même ton retentit jusque dans la cour, un long, un effroyable cri.
Le surveillant en faction à la porte tressaille. Il l’ouvre précipitamment.
« Tous en haut ! Allons ! aux cellules ! » Il crie, et les prisonniers défilent devant lui en courant, sans lui jeter un regard. Ils grimpent les escaliers de pierre. Trapp, trapp, trapp, font leurs gros souliers à clous.
Et tout est redevenu silencieux ; – le vent descend dans la cour déserte, arrachant une vieille tuile. Elle dégringole avec bruit, se brise en éclats qui tombent sur le sol malpropre…
Le condamné à mort ne peut remuer que la tête. – Il a devant les yeux les murs blanchis à la chaux de sa cellule. – C’est impénétrable ! – Demain, au lever du jour, ils monteront le chercher. – Dix-huit heures encore. – Dans sept heures, la nuit. – – – Bientôt viendra d’hiver, puis le printemps, et l’été brûlant. – Il se lèvera de bonne heure, alors – dès l’aube, pour aller dans la rue voir passer l’antique charrette du laitier, et le chien qui la tire… Quelle belle chose que liberté ! – Ne peut-il pas faire tout ce qu’il veut ?
Mais sa gorge se serre encore. – S’il lui était seulement possible de remuer. – Malédiction de malédiction ! – et de cogner les murs de ses poings. — Qu’il sorte ! – de tout briser, de mordre les courroies qui le tiennent. – Il ne veut pas mourir maintenant ! – Il ne veut pas, non, il ne veut pas ! – C’est autrefois qu’ils auraient dû le pendre, quand il venait d’assassiner le vieux – le vieux bonhomme, qui avait déjà un pied dans la tombe… Il ne recommencerait plus son crime maintenant… – Et l’avocat n’en a rien dit. – Mais aussi, pourquoi ne l’a-t-il pas crié aux jurés, aussi, lui-même ? – Ils auraient rendu un autre verdict. – Il faut qu’il le dise maintenant au Président. Que le gardien le mène devant lui. À l’instant – – –
Demain matin, il sera trop tard. Le Président aura sa robe de juge, et il ne pourra pas l’approcher.
D’ailleurs, on ne l’écouterait pas. – Demain ! c’est bien trop tard, on ne pourrait vraiment plus renvoyer tous les gens de police. – Bien certainement, le Président ne les renverrait pas…
Le bourreau lui met la corde au cou, – il a des yeux noirs, qui le regardent avec cruauté. – On tire sur la corde, tout tourne – arrêtez, arrêtez – il veut encore parler, dire quelque chose d’important…
Ne va-t-il donc pas venir, le gardien, et le détacher ce soir de son banc ? – Il ne peut pourtant pas rester ainsi, pendant ses dix-huit heures. – Mais oui, c’est impossible. Il faut bien que le confesseur vienne. Il a lu que cela se passait ainsi. C’est la loi. – Certes, il ne croit à rien, mais il réclamera le prêtre, il en a le droit. – Et il lui cassera la tête, au sale curé, avec la cruche de grès qui est là, dans le coin. – – – Sa langue est sèche. – Il veut boire – il a soif. – Bon Dieu ! – Pourquoi ne lui donne-t-on pas à boire ! – Il va se plaindre ! – Il va comparaître, et réclamer la semaine prochaine, à l’inspection. Il le lui fera payer cher au gardien, à ce chien maudit ! – Il va tant crier qu’on viendra le détacher, crier de plus en plus fort, jusqu’à faire écrouler les murs ! Et ce sera la liberté, le plein air, là-haut, tout là-haut, pour qu’ils ne puissent pas le trouver quand ils le chercheront partout – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – D’où vient-il de tomber ? – Il a reçu un choc dans tout le corps.
A-t-il dormi ? – Il fait presque nuit. – Il veut se prendre la tête, – ses mains sont attachées. – La voix grave de l’horloge tombe de la vieille tour – un, deux – quelle heure peut-il bien être ? – Six heures. – Dieu du ciel, dans treize heures ils lui arracheront la vie de la poitrine.
On va l’exécuter, impitoyablement – on va le pendre. – Ses dents claquent de froid. – À son cœur est accroché quelque chose qui le suce – il ne peut voir quoi. – Puis la nuit se fait dans son cerveau. – Il crie et ne s’entend pas crier. – Tout hurle en lui, les bras, la poitrine, les jambes, le corps entier, – hurle sans reprendre haleine, indéfiniment. – – – –
La fenêtre du greffe est ouverte… C’est la seule qui ne soit pas grillée. Un vieillard s’approche, barbe blanche, figure sévère et sombre. Il jette un coup d’œil dans la cour. Dérangé par le cri, la plainte d’épouvante, il plisse son front, murmure quelque chose, et ferme la fenêtre.
Les nuages, au ciel, passent au galop en lambeaux déchiquetés. Hiéroglyphes mutilés, comme une vieille inscription effacée : « Ne jugez pas, si vous ne voulez pas être jugés ! »
–––––
(1) Collaborateur du Simplicissimus, le célèbre journal satirique allemand, M. Gustave Meyrink est une des personnalités littéraires les plus appréciées de l’Allemagne contemporaine. Il a publié Der Heisse Soldat, Orchideen et Wachsfiguren Kabinett, trois recueils de contes et de nouvelles qui ont eu un grand succès. Tour à tour comparable à Mark Twain, à Peter Altenberg, ou à Edgar Poë [sic] et à Hoffmann, M. Gustave Meyrink sait, par des moyens toujours inattendus, toujours nouveaux, provoquer le rire ou le frisson. Avec la fantaisie la plus extraordinaire, il conte des histoires à faire frémir, ou il prodigue sa verve dans de mordantes satires. Ce qui plaît en lui, c’est l’exubérance de son imagination un peu étrange, c’est son esprit sarcastique, c’est son style enfin, dont il varie avec art les effets, pour produire les impressions les plus diverses et les plus intenses. La forte originalité de son talent lui a valu la faveur du public qui lui a su gré du l’avoir mené un peu hors des sentiers peut-être trop battus de la littérature allemande contemporaine.
(2) Le magistrat qui doit présider à l’exécution. Il est nommé pour chaque exécution et ne peut se démettre. – En Allemagne, les exécutions ne sont pas publiques.
–––––
(Gustave Meyrink, traduit de l’allemand par Jean Letort, in Roman et Vie, bimensuel, n° 14, volume 2, 1er juin 1908. La nouvelle originale, « Der Schrecken, » est d’abord parue dans Simplicissimus, illustrierte Wochenschrift, septième année, n° 12, 17 juin 1902, avant d’être reprise dans le recueil Orchideen: Sonderbare Geschichten, München: Albert Langen, 1905. Elle a été traduite par Élisabeth Willenz sous le titre : « L’Effroi, » dans Le Visage Vert, première série, collection Phantastik, n° 1, janvier 1987, avant d’être reprise dans le recueil Histoires fantastiques, Monaco : Le Rocher, septembre 1987. Lithographie d’Alfred Kubin, « Du sollst nicht töten, » c. 1901)
–––––
☞ Nous profitons de l’occasion pour mettre également en ligne deux traductions espagnoles de « Der Schrecken, » parues respectivement dans les revues Colección Ariel [Costa Rica] et Caras y Caretas [Argentine], en 1908 et 1923.
–––––
GUSTAVO MEYRINK : EL ESPANTO
–––––
–––––
(Gustavo Meyrink, in Colección Ariel [San José], n° 22, juillet 1908)
–––––
GUSTAVO MEYRINK : EL TERROR
–––––
–––––
(Gustavo Meyrink, illustration de Daniel Agrelo, in Caras y Caretas [Buenos Aires], n° 1272, 17 février 1923)
–––––
L’ARGUMENT DÉCISIF
–––––
Mon cher ami Wærndorfer,
J’ai eu le regret de passer chez vous sans vous rencontrer, et vous ai cherché dans toute la ville sans parvenir à vous joindre. Je vous envoie donc ce petit mot qui vous demande de venir ce soir retrouver chez moi Zavrel et le docteur Rolof.
Figurez-vous que le professeur suédois Arjuna Zizerlweis, le célèbre philosophe dont vous avez certainement lu une œuvre quelconque, était hier au cercle, et pendant une heure il m’a entretenu de phénomènes de spiritisme. Je l’ai invité pour ce soir, – et il viendra.
Vous savez qu’il a le plus grand désir de vous connaître, Zavrel, Rolof et vous, et, si nous savons bien nous y prendre, je crois que nous pourrons le gagner à notre cause, et par conséquent rendre à l’humanité un service peut-être inestimable.
Alors, vous venez, n’est-ce pas ? C’est convenu ?
(Que le docteur Rolof n’oublie surtout pas d’apporter les photographies.)
En hâte, votre tout dévoué
GUSTAV.
Les convives, après le dîner, s’étaient réunis dans le fumoir. Le professeur Zizerlweis jouait avec une tête de hérisson de mer qui, sur la table, servait de porte-allumettes.
« Tout ce que vous me racontez, docteur Rolof, me semble bien extraordinaire ; il y a là de quoi troubler les profanes ; mais, vous savez, les faits par lesquels vous voudriez prouver qu’on peut, pour ainsi dire, photographier l’avenir, n’ont rien d’absolument convaincant.
Tout au contraire, ils autorisent une explication qui paraît bien plus simple et plus probable. Résumons-nous : votre ami, M. Zavrel, se prétend un médium ; sa présence seule suffirait donc, auprès de certaines personnes, pour produire des phénomènes que l’œil est incapable de percevoir, mais que la photographie arrive à surprendre.
Vous avez, je crois, messieurs, photographié un jour un homme qui paraissait en parfaite bonne santé, et, quand vous avez développé la plaque…
– C’est bien cela, interrompit le docteur Rolof ; en développant la plaque, nous avons vu apparaître sur l’image de la physionomie une multitude de petites cicatrices. Et ce n’est que deux mois après, vous entendez, deux mois, qu’elles devinrent apparentes sur la peau de la personne en question, à la suite d’une petite vérole.
– Bien, bien, docteur ! Laissez-moi seulement vous répondre, voulez-vous ? Admettons un instant que le hasard ne soit vraiment pas intervenu dans ce phénomène. Pardon, messieurs, je veux dire, voyons, qu’il y ait là tout autre chose qu’un pur effet du hasard ; comment êtes-vous autorisés à penser que vous avez photographié l’avenir ?
Je prétends, moi (et d’ailleurs l’expérience n’est pas nouvelle !), que l’objectif photographique ne fit que reproduire avec précision, et que voir plus de choses que l’œil humain. Les petits boutons, il les a surpris en germe, ces mêmes boutons de la petite vérole dont l’éruption ne s’est manifestée qu’un ou deux mois plus tard, ne les rendant visibles pour nous qu’à ce moment. »
*
Le professeur Zizerlweis jeta un regard de triomphe sur le cercle de ses contradicteurs, en jouissant un moment de leur confusion ; il ranima son cigare qui s’éteignait, et ses yeux louchaient, pour mieux suivre les progrès de cette grave opération.
« Possible ! dit Zavrel, en prenant à son tour la parole. Mais, professeur, comment m’expliquerez-vous les faits que voici ?
Nous avions fait, une autre fois, la photographie d’un homme, jeune encore ; le connaissant à peine, nous ne savions rien de sa vie intime ; c’était une de ces relations qu’on fait au café, et, certes, nous n’aurions jamais eu l’idée de l’utiliser comme sujet d’expériences, si Gustav, pourquoi, je n’en sais rien, n’avait cru deviner en lui un cas tout à fait extraordinaire, et qui serait pour nous, dans nos recherches scientifiques, une véritable aubaine… Nous prenons le cliché, nous le développons, et voici que se montre sur l’épreuve, au beau milieu du front, une tache ronde, noire et très nette. »
Il y eut un instant de silence.
« … Ah ! dit le philosophe. Et alors ?
– Alors ?… Quinze jours après, l’homme se tua… en se logeant une balle de revolver dans le front.
Regardez… exactement à la même place ; voici les deux photographies, celle du cadavre, et celle que nous avions prise quinze jours auparavant.
Comparez-les vous-même ! »
Le professeur Zizerlweis parut, pendant quelques minutes, profondément absorbé dans ses réflexions, et son œil devint terne comme le papier bleu dont on enveloppe les pains de sucre.
« Cette fois, nous le tenons, » dit à voix basse Wærndorfer en se frottant les mains.
… Cependant, le philosophe était sorti de sa rêverie et demandait :
« Votre sujet a-t-il eu entre les mains l’épreuve sur laquelle il était reproduit avec la tache au front ? Oui ? Parbleu ! c’est tout simple, alors ! L’individu est déjà hanté d’idées de suicide. Vous lui montrez la photographie, et lui, sachant fort bien qu’il s’agit là d’une expérience de spiritisme, subit sans aucun doute l’effet d’une suggestion… Je ne prétends pas que ce fut la cause de son suicide, non ; mais l’homme se tira un coup de revolver dans le front, et ne se rendit pas compte que l’image en question avait déjà fait naître en lui l’idée de choisir ce genre de mort. S’il n’avait jamais vu ce portrait, c’est peut-être d’une tout autre manière qu’il aurait mis fin à ses jours ; il se serait jeté à l’eau, il se serait pendu, empoisonné, que sais-je ?
– Et la tache, professeur ? Comment est-elle donc apparue sur le cliché ?
– La tache ? Une ombre, une poussière dans l’objectif ; quoi, un insecte qui passait, un défaut de la plaque, un petit rien, tout ce que vous voudrez… Bref, ce n’est pas avec des exemples pareils que vous aurez raison de moi. Voyons ! Pas un de vos faits ne force la conviction ! »
Les trois amis, désappointés, étaient assis, courbant la tête sous le flot de paroles que déversait sur eux avec volubilité le professeur Zizerlweis, qui les écrasait de sa victoire.
« Si nous pouvions seulement répondre aux hypothèses du bonhomme ! dit le maître de la maison à l’oreille du docteur Rolof. Est-il assommant avec ses radotages ! Son menton court et ses moustaches lui donnent l’air de porter un cadenas noir suspendu sous le nez, ne trouves-tu pas ? Le déplaisant animal ! Il n’est peut-être pas plus suédois que moi ! Zizerlweis !… Professeur Arjuna Zizerlweis !
– Ne te monte pas la tête ! » dit Rolof en calmant son ami, pendant que Wærndorfer se démenait comme un beau diable, pour inculquer au moins au professeur des principes d’art à peu près raisonnables, puisque, en fait de spiritisme, il ne voulait plus rien savoir.
« Pas de révolte, voyons ! Peut-être… mais, bon Dieu ! nous sommes donc tous fous ? Nous avons oublié de raconter le fait le plus important ! Mes enfants ! Le portrait sans tête !
– Hourra ! Le portrait sans tête ! s’écrièrent-ils ; et c’était notre première expérience, notre meilleure aussi ! Monsieur le professeur, monsieur le professeur, écoutez un peu !
– Laissez-moi parler, c’est moi qui veux raconter ! cria Gustav, tout radieux. Connaissez-vous ici, dans la ville, un certain Chicier, monsieur le Professeur ?
– Non.
– Cela ne fait rien, d’ailleurs ; il est aujourd’hui lieutenant en premier, mais autrefois il était commis dans une maison de chicorée. Il y a bien bien seize années de cela : nous faisions, à ce moment, nos premières expériences de spiritisme photographique.
Du diable si je sais comment nous sommes tombés sur ce commis, ce Chicier. Bref, nous avions ce garçon en vue, et nous étions bien décidés, malgré sa résistance, à le photographier au magnésium pendant une séance de spiritisme…
La séance eut lieu sans que rien ne se passât… pas le moindre petit phénomène ; aussi le résultat de la photographie n’en fut-il que plus extraordinaire. J’irai tout à l’heure vous chercher le cliché, afin que vous puissiez bien vous convaincre vous-même.
L’image apparut rapidement dans le révélateur, mais, à notre grand étonnement, la tête manquait ; oui, pas moyen d’en trouver trace ; c’était bien un décapité, un homme sans tête que nous avions sous les yeux.
– Vraiment ! interrompit le professeur Zizerlweiss.
– Écoutez maintenant la suite de l’histoire : nous faisons conjectures sur conjectures, nous n’arrivons à aucune solution Alors, enveloppant soigneusement la plaque, nous allons le lendemain la porter chez Fuchs, – photographe officiel, là, tout en face d’ici, – Obstgasse.
Et le voilà qui soumet le cliché aux produits chimiques les plus puissants, destinés à faire venir sur la plaque beaucoup de détails encore.
En effet, immédiatement au-dessus du col de chemise du portrait, à l’endroit où aurait dû se trouver la tête, apparaissent, en cercle, et se précisent de plus en plus, treize taches de lumière d’inégale dimension ; tenez, disposées ainsi : une-deux ; puis une-deux, quatre, quatre et une ; exactement la disposition caractéristique des astres dans la constellation du Bélier.
Eh bien ! monsieur le professeur, êtes-vous convaincu ?
Le symbole est assez clair pour qu’on ne puisse s’y méprendre ! »
Le professeur Zizerlweis avait l’air quelque peu embarrassé.
« Je ne vois pas très bien, dit-il, le rapport que cela peut avoir avec la prétention que vous émettez de photographier l’avenir…
– Allons, allons, monsieur le professeur, vous n’avez donc pas saisi ? s’écrièrent-ils tous à la fois. On vient de vous raconter que le sujet en question était entré quelque temps après dans la carrière militaire, qu’il était officier d’infanterie ! »
La surprise du savant fut si grande qu’il laissa tomber son cigare ; et, la stupeur l’empêchant de trouver ses mots :
« Hum ! Hum ! vous m’en direz tant !… »

–––––
(Gustav Meyrink, traduit de l’allemand par Jean Letort, in Roman et Vie, bimensuel, n°18, volume 3, 1er août 1908. La nouvelle originale, « Das – – allerdings, » est d’abord parue dans Simplicissimus, illustrierte Wochenschrift, neuvième année, n° 33, 8 novembre 1904, avant d’être reprise dans le recueil Wachsfigurenkabinett, München: Albert Langen, 1908. Herman Reijers, « What Me, Stupid? » fusain, 1975)