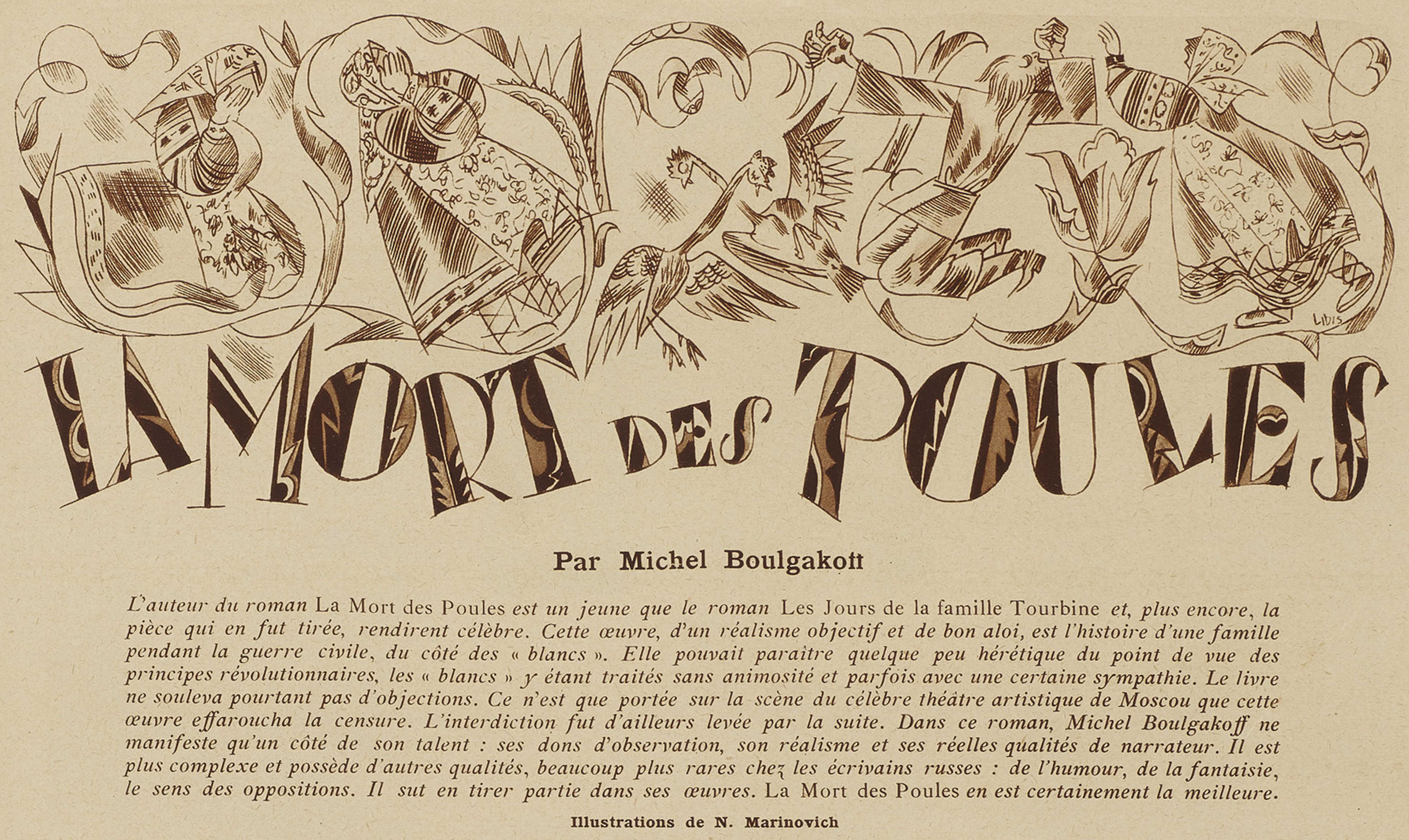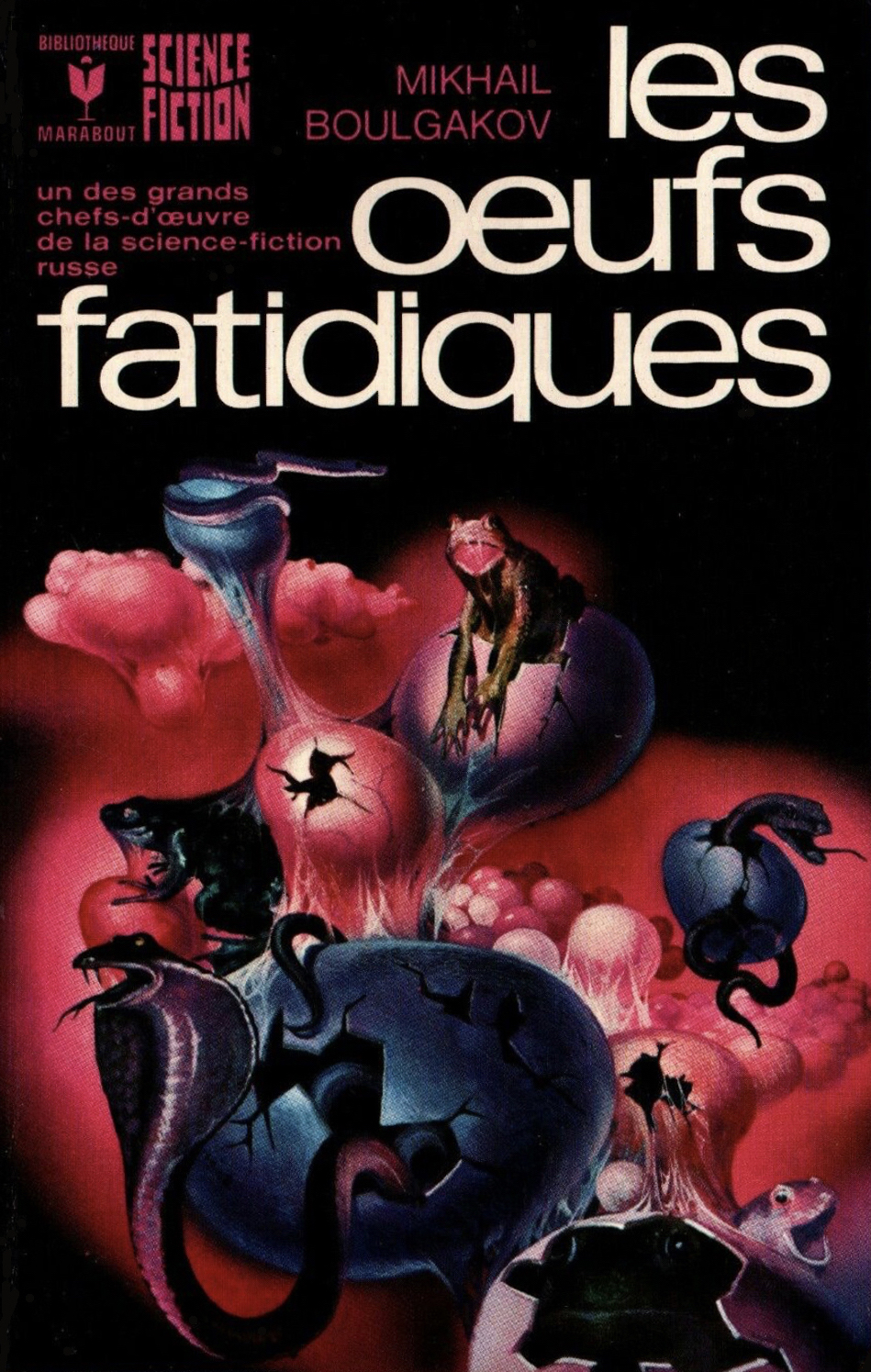CHAPITRE PREMIER
LE PROFESSEUR PERSIKOFF
Le 16 avril 1928, dans la soirée, Wladimir Persikoff, professeur de zoologie à la quatrième Université et directeur de l’Institut zoologique à Moscou, entra dans le laboratoire de l’Institut, situé rue Hertzen. Il alluma le plafonnier et parcourut la pièce des yeux.
C’est de ce soir qu’il faut dater le début de la terrible catastrophe qui va être relatée et c’est au professeur Persikoff qu’il sied d’en faire porter toute la responsabilité.
Il avait exactement cinquante-huit ans. Une tête extraordinaire, en pointe, chauve, avec des touffes de cheveux roux des deux côtés du crâne. Les joues et le menton rasés, la lèvre inférieure proéminente, ce qui donnait une expression boudeuse à son visage. D’anciennes lunettes à monture d’argent chevauchaient son nez rouge et protégeaient ses yeux petits et brillants. Il était de haute taille, légèrement voûté et parlait d’une voix aiguë, crissante et coassante. Il avait en outre l’habitude de cligner des yeux et de recourber l’index en forme de crochet lorsqu’il énonçait une opinion avec assurance et poids. Comme le professeur Persikoff parlait toujours avec assurance (car, dans son domaine, il possédait une érudition qui tenait véritablement du prodige), le crochet apparaissait très souvent devant les yeux de ses interlocuteurs. De choses ne se rapportant pas à son domaine scientifique, qui comprenait la zoologie, l’anatomie, l’embryologie, la botanique et la géographie, le professeur Persikoff ne parlait presque jamais.
Il ne lisait pas de journaux, n’allait pas au théâtre, et Madame Persikoff avait abandonné en 1913 le domicile conjugal pour suivre un ténor de l’opéra. Elle avait laissé à son mari, pour lui expliquer sa fuite, la lettre suivante :
« Tes grenouilles me donnent un insupportable frisson de dégoût. Je serai toute ma vie malheureuse à cause d’elles. »
Le professeur ne se remaria pas et resta sans enfant. C’était un savant de tout premier ordre et, dans le domaine des reptiles, il n’avait d’égal que le professeur William Wackle, de Cambridge, et peut-être le professeur Djacomo Bartolomeo Beccari, de Rome. Il lisait couramment en cinq langues et parlait le français et l’allemand aussi bien que le russe.

Persikoff était très emporté, mais se calmait vite ; il aimait le thé avec de la confiture et habitait, à la Pretchistenka, un appartement de cinq pièces, dont l’une était occupée par une petite vieille, Marie Stepanovna, qui était chargée du ménage et soignait le professeur comme un enfant. Les années 1918 et 1919 avaient été excessivement dures pour Persikoff, ainsi que du reste pour toute la population de la République. Personne ne mangeait plus à sa faim et il n’y avait pas de combustible. Dans les appartements non chauffés, les familles avaient fini par habiter une seule pièce en se serrant autour d’un petit poêle en fonte, où disparaissaient peu à peu les meubles de bois, les bibliothèques, – tout ce qui pouvait alimenter le feu.
Mais s’il était possible d’entretenir une certaine température dans des pièces habitées, on ne pouvait par contre arriver à chauffer les salles et les amphithéâtres de l’Université ou de l’Institut zoologique. Il était donc assez naturel de les voir vides aux heures des cours. Les étudiants ne se résignaient plus à grelotter dans ces vastes espaces parcimonieusement éclairés et lugubres, et ils avaient en outre bien autre chose à faire qu’à suivre des cours qui ne pouvaient remplir leurs estomacs vides.
Persikoff, pourtant, s’obstinait. Il continuait ses cours, emmitouflé dans une grosse pelisse, sa toque de fourrure sur la tête et le cou enveloppé dans un gros cache-nez. Il n’avait devant lui que deux ou trois auditeurs affamés et transis, mais obstinés comme leur professeur.

L’hiver 1919 fut particulièrement rigoureux. Persikoff prit froid ; il dut s’aliter et faillit mourir. Sa convalescence fut très longue. Quand il fut rétabli, le plus dur était passé. La vie peu à peu rentrait dans ses droits, la population s’adaptait aux conditions nouvelles et les gouvernants de leur côté avaient été forcés de tenir compte des circonstances. La nouvelle politique économique laissa quelque liberté au commerce privé à l’intérieur du pays, et les vivres et le combustibles réapparurent comme par enchantement sur les marchés de la République.
L’Institut zoologique aussi reprenait son existence normale. Des crédits lui avaient été ouverts, les réparations nécessaires avaient été effectuées, les animaux morts de faim et de froid avaient été remplacés. Persikoff reprit ses habitudes de vieux savant maniaque pour lequel son travail seul avait de l’importance dans la vie.
CHAPITRE II
LA BOUCLE COLORÉE
Le professeur avait allumé le plafonnier. Il fit de même pour le réflecteur au-dessus de la longue table de travail, et passa une blouse blanche.
De nombreuses automobiles cornaient sous les fenêtres du laboratoire et, toutes les minutes, la maison était ébranlée par un des tramways qui montaient ou descendaient la rue Hertzen. Le professeur ne les entendait pas. Il s’était installé sur un tabouret à vis et, de ses doigts jaunis par la nicotine, manœuvrait doucement la crémaillère d’un magnifique microscope Zeiss, étudiant avec une attention soutenue une préparation simple et non colorée de rhizopodanuda (protozoaires).
Persikoff actionnait prudemment la crémaillère du microscope pour porter l’agrandissement de cinq à dix mille, quand la porte s’entrouvrit, laissa passer une barbiche en pointe, et l’assistant du professeur l’appela :
« La grenouille est prête. Voulez-vous la voir ? »
Persikoff descendit vivement du tabouret, sans plus s’occuper de la crémaillère, et, tournant lentement une cigarette entre ses doigts, il passa dans le laboratoire de son assistant.
Sur une table en verre, une grenouille, à moitié suffoquée et pétrifiée par la peur et par la douleur, était fixée sur un châssis de liège, et ses organes intérieurs, visqueux et transparents, sortis de son ventre ensanglanté, étaient étalés sous le verre du microscope.
« Très bien, » dit Persikoff en s’installant devant celui-ci.
Ce qu’il voyait était sans doute fort intéressant. La course pressée des globules de sang tout le long des vaisseaux accapara l’attention de Persikoff, qui oublia les protozoaires et resta une heure et demie chez son assistant.
Ils s’emparaient du microscope à tour de rôle et échangeaient à haute voix et avec une grande animation des réflexions, inintelligibles pour le commun des mortels.
Persikoff lâcha enfin le microscope, en déclarant :
« Le sang se coagule, malheureusement. Il n’y a plus rien à faire. »
La grenouille remua faiblement la tête et, dans ses yeux déjà presque éteints, on pouvait clairement lire sa dernière pensée : « Quelles brutes vous êtes, tout de même ! »
Le professeur se leva, fit quelques pas mal assurés sur ses jambes engourdies et retourna dans son laboratoire. Il alluma une cigarette, bâilla, frotta légèrement ses paupières éternellement enflammées. Puis, ayant jeté la cigarette, il s’assit sur le tabouret, devant le microscope, posa ses doigts sur la crémaillère et allait déjà tourner la vis, mais il ne le fit pas. L’œil droit de Persikoff voyait un disque blanc et trouble, des protozoaires troubles et pâles, et au milieu du disque une boucle colorée, qui ressemblait à une mèche sur le front d’une femme. Persikoff et des centaines de ses élèves avaient souvent vu cette boucle et personne ne s’y intéressait. Elle n’était en effet d’aucun intérêt. Ce petit faisceau coloré gênait l’observateur et se trouvait en outre en dehors du champ d’observation. Aussi le faisait-on disparaître par un simple tour de vis, afin que le champ tout entier fût éclairé d’une lumière uniforme et blanche. Les doigts longs et nerveux du zoologue avaient déjà esquissé le geste habituel, mais un tremblement les agita et le geste ne fut pas achevé. C’est l’œil droit de Persikoff qui en était la cause. Cet œil marqua de l’étonnement d’abord, de l’émotion ensuite, et même de l’angoisse. Pendant de longues minutes, l’être supérieur observa l’être inférieur dans un silence absolu. Pancrate, le gardien de l’Institut, dormait déjà dans sa loge, à côté de l’entrée. Pierre Ivanoff, l’assistant, venait de partir.
La voix de Persikoff s’éleva dans le vide et c’est à un interlocuteur invisible qu’il adressa sa question.
« Qu’est-ce que c’est ? Je ne comprends rien… »
Lorsque le professeur se leva et, d’un pas incertain, s’approcha des fenêtres, une aube claire et blanche illuminait le ciel, et une raie d’or traversait le porche de l’Institut. Livide et inspiré, Persikoff écarta les jambes et, ses yeux larmoyants fixés sur le parquet, il parla :
« Mais, comment cela peut-il se faire ? C’est monstrueux, » répéta-t-il, en se tournant vers les crapauds et les grenouilles dans l’aquarium. Mais ceux-ci dormaient et ne lui répondirent pas. Persikoff resta quelque temps immobile, puis il écarta les rideaux, leva les stores et éteignit l’électricité. Il s’assit de nouveau sur le tabouret et regarda dans le microscope.
« Ho – ho – ho – ho, grogna-t-il, il a disparu. Je co-om-prends, oui, je co-om-prends, c’est simple. »
Il fit descendre les stores, referma les rideaux, ralluma l’électricité. Il regarda dans le microscope et sourit joyeusement, et même avec une sorte de férocité.
« Je l’attraperai, déclara-t-il solennellement, en levant un doigt, je l’attraperai. Peut-être vient-il aussi du soleil. »
Persikoff regarda par la fenêtre en essayant de se rendre compte où le soleil se trouverait dans l’après-midi.
Le professeur avait l’air d’exécuter une danse étrange : il s’approchait de la croisée, s’en éloignait, pour y revenir encore, puis, l’ayant ouverte, il se pencha au-dehors, le ventre appuyé sur le rebord de la fenêtre.
Après quoi, il entreprit un travail mystérieux. Il recouvrit le microscope d’une cloche de verre, fit fondre de la cire et scella les bords de la cloche à la table, imprimant son pouce en guise de cachet dans la pâte molle et brûlante. Il ferma le gaz, sortit et donna deux tours de clé à la porte de son laboratoire.
À travers la pénombre des couloirs, Persikoff parvint jusqu’à la loge de Pancrate et se mit à cogner contre la porte. Cela dura longtemps. Il entendit enfin une sorte de grognement, comme d’un chien enchaîné, suivi d’un meuglement enroué, et Pancrate fit son apparition, vêtu d’un caleçon rayé. À moitié endormi, il fixa sur le professeur un regard hébété, en gémissant doucement.
« Pancrate, dit Persikoff, en le dévisageant par-dessus ses lunettes, excuse-moi de t’avoir réveillé. Note bien ceci : il ne faut pas entrer dans mon laboratoire. J’y ai laissé un travail, auquel il ne faut pas toucher. Tu as compris ?
– Ou – ou – ou – i, je – je – comprends, répondit Pancrate, qui n’avait rien compris.
– Non, écoute-moi ; réveille-toi, Pancrate, » dit Persikoff, et il lui enfonça doucement les doigts entre les côtes.
Le visage de Pancrate exprima de la frayeur et son regard devint plus conscient.
« J’ai fermé à clef le laboratoire, continua Persikoff ; il ne faut pas y entrer avant mon retour ; tu as compris ?
– Oui, monsieur.
– C’est très bien, va te coucher. »

Pancrate fit demi-tour et disparut dans sa loge, où il tomba sur son lit comme une masse, tandis que le professeur s’emparait de son pardessus et de son chapeau. S’en étant couvert, il se souvint de ce qu’il avait observé dans le microscope, et cela l’absorba à tel point, qu’il resta en contemplation devant ses caoutchoucs comme s’il les voyait pour la première fois. Il finit par chausser le pied gauche, mais essaya en vain de le faire entrer dans le caoutchouc du pied droit.
« Quel monstrueux hasard, qu’il m’ait appelé juste à ce moment, murmurait Persikoff ; sans cela, je ne l’aurais jamais remarqué. Mais qu’est-ce que cela peut donner ?… Cela peut donner Dieu sait quoi… »
Persikoff sourit, cligna des yeux, contempla ses caoutchoucs, enleva celui du pied gauche et chaussa son pied droit.
« Mon Dieu, mon Dieu ! peut-on même imaginer toutes les conséquences ? »
Persikoff repoussa avec mépris le caoutchouc gauche dans lequel il ne parvenait pas à faire entrer son pied droit, et se dirigea vers la sortie. En ouvrant la lourde porte d’entrée, il laissa tomber son mouchoir, mais ne le remarqua pas. Dans la rue, il s’arrêta pour chercher des allumettes. Il fouilla dans toutes ses poches, à plusieurs reprises, finit par trouver la boîte, et se mit en route, sa cigarette non allumée entre les lèvres.
« Comment ne l’ai-je pas remarqué jusqu’ici ? quel drôle de hasard ! Zut, quel idiot ! » Il regardait ses pieds, dont un seul était chaussé d’un caoutchouc. « Comment faire ? Retourner à l’Institut ? Mais Pancrate a le sommeil si dur ! C’est dommage de le jeter. Il n’y a qu’un moyen. »
Il enleva le caoutchouc et, le tenant à la main d’un air dégoûté, il se remit en route et rentra chez lui.
CHAPITRE III
PERSIKOFF A ATTRAPÉ LE RAYON
Quand le professeur approcha son œil du microscope, il remarqua pour la première fois dans sa vie que, dans la boucle multicolore, un rayon se détachait avec une netteté particulière. Ce rayon était d’un rouge vif et se projetait hors de la boucle en pointe d’aiguille.
Ce fut certainement un malheur que le rayon eût attiré l’attention d’un œil aussi exercé que celui de Persikoff. Dans ce rayon, le professeur distinguait ce qui était mille fois plus important que le rayon même, phénomène instable et né par hasard d’une combinaison de verres, – du miroir et de l’objectif du microscope. Grâce à l’intervention de l’assistant, les protozoaires restèrent exposés pendant une heure et demie à l’action du rayon rouge, ce qui eut un effet surprenant dans le disque ; en dehors du rayon, les protozoaires restaient inertes, tandis qu’à l’endroit traversé par l’épée rouge et pointue d’étranges événements se produisaient. Dans la petite raie rouge, tout était vie et mouvement. Les protozoaires grisâtres tendaient de toutes leurs forces vers la raie et, lorsqu’ils y étaient parvenus, ils devenaient, comme par enchantement, étrangement mobiles. Ils luttaient avec une énergie féroce pour une place dans le rayon, où une procréation furieuse, – il n’y a pas d’autre terme, – avait lieu. Renversant toutes les lois, si bien connues de Persikoff, les protozoaires se disloquaient en parties indépendantes dont chacune devenait en deux secondes un organisme nouveau. Ces derniers mûrissaient en quelques instants et donnaient aussitôt une nouvelle génération. Dans la raie rouge et ensuite dans le disque tout entier, il n’y eut bientôt plus de place, et une lutte féroce s’ensuivit. Les nouveaux-nés se jetaient les uns sur les autres, s’entre-déchiraient et se dévoraient. Les plus forts et les mieux adaptés restaient vainqueurs. Et ceux-ci étaient affreux. Ils étaient deux fois aussi grands que les protozoaires ordinaires et, en outre, se distinguaient par une vitalité et une méchanceté extraordinaires. Toute la seconde soirée fut employée par le professeur, pâli et maigri, à l’étude de cette nouvelle génération de protozoaires. Ce n’est que le troisième jour qu’il se consacra à l’étude du rayon. Le bec de gaz sifflait doucement, la rue était bruyante comme d’habitude, quand le professeur, intoxiqué par une centaine de cigarettes, s’adossa au siège de son fauteuil et ferma les yeux.
« Oui ; à présent, tout est clair. C’est le rayon qui les a ranimés. C’est un rayon nouveau, non étudié encore, et que personne n’a découvert jusqu’ici. Il importe avant tout de savoir s’il provient de l’électricité seulement ou, aussi bien, du soleil. »
Une journée et une nuit suffirent pour mettre cette question au point. Dans trois microscopes, Persikoff obtint trois rayons. Le soleil ne donna rien, et Persikoff résuma ainsi ses recherches : « Il faut présumer qu’il ne se trouve pas dans le spectre solaire… hum… c’est-à-dire, en un mot, qu’on ne peut l’obtenir que par la lumière électrique. »
Il regarda avec tendresse le plafonnier en verre dépoli, resta quelques instants songeur, et invita ensuite Ivanoff à entrer dans son laboratoire.
Il lui raconta tout et lui montra les protozoaires. L’assistant fut stupéfait, annihilé par cette révélation : comment était-il possible qu’une chose aussi simple, que cette petite flèche rouge n’ait pas été remarquée jusqu’ici ? Mais n’importe qui aurait pu la remarquer, et lui-même tout le premier… Oui, lui- même, l’agrégé Ivanoff… C’était monstrueux.
« Regardez, regardez, criait presque Ivanoff, ne pouvant détacher son œil horrifié du microscope. Regardez ce qui se passe. Ils grandissent à vue d’œil… Regardez donc…
– Je les observe depuis trois jours, » répondit Persikoff d’un air inspiré.
Après quoi les deux savants eurent un entretien dont l’essence se pouvait résumer ainsi : Ivanoff se chargeait de la fabrication d’une chambre composée de lentilles et de miroirs, afin d’y obtenir le rayon rouge, agrandi et sans microscope. Il obtiendrait le rayon, le professeur pouvait se fier à lui. Après cette déclaration, il y eut un court silence gêné.
« Quand je publierai mon travail sur ce sujet, je mentionnerai le fait que les chambres ont été conçues et exécutées par vous, déclara Persikoff, sentant qu’il fallait dissiper cette sensation de gêne.
– Cela n’a aucune importance… Quoique… tout de même… »
La petite équivoque avait reçu la solution nécessaire, et à partir de ce moment le rayon rouge absorba entièrement l’assistant. Tandis que Persikoff, maigrissant et s’épuisant, passait ses journées et une bonne partie de ses nuits penché sur le microscope, Ivanoff travaillait dans le laboratoire de physique, étincelant de lumières, et combinait lentilles et miroirs, aidé par son technicien.
Sur la demande de Persikoff, adressée au commissariat de l’Instruction publique, trois envois arrivèrent d’Allemagne, contenant des miroirs, des verres convexes, des verres concaves, et même des verres concaves et convexes en même temps. Ivanoff réussit à construire la chambre où il obtint le rayon rouge. Il faut lui rendre cette justice que le rayon était magnifique : ample, fourni, mesurant quatre centimètres de diamètre, et puissant.
Le premier juin, la chambre fut installée dans le laboratoire de Persikoff et il commença ses expériences avec des œufs de batraciens.
Les résultats furent étourdissants : en quarante-huit heures, toute une nouvelle génération était née et, vingt-quatre heures plus tard, les têtards s’étaient transformés en énormes grenouilles, tellement féroces et voraces qu’une moitié fut immédiatement dévorée par l’autre. Cette dernière se mit à pondre sans perdre un instant, et, en quarante-huit heures, mais cette fois sans l’aide d’aucun rayon, une deuxième génération était mise au monde, une génération littéralement innombrable. Le laboratoire de Persikoff fut débordé par ces hordes déchaînées, qui bientôt envahirent l’Institut entier. Dans les aquariums, sur les parquets, dans tous les recoins, des chœurs coassaient sans cesse, comme au milieu des marais. Pancrate, qui craignait Persikoff comme le feu, n’éprouvait plus à son égard qu’une peur mortelle.
Après huit jours, le professeur lui-même se sentit devenir fou. Une odeur d’éther et de cyanure emplit l’Institut, et Pancrate, qui avait enlevé son masque trop tôt, faillit être empoisonné avec les grenouilles. La gent aquatique fut détruite, les laboratoires furent longuement aérés.
Persikoff déclara à son assistant :
« L’action du rayon sur les deuteroplasmes et sur la cellule en général est stupéfiante. »
Ivanoff, un gentleman compassé et froid, interrompit le professeur :
« Comment pouvez-vous parler de ces détails insignifiants ? Soyons francs : vous avez découvert quelque chose de formidable. » Ivanoff fit un effort, et continua : « Professeur Persikoff, vous avez découvert le rayon de la vie. »
Les joues non rasées et jaunes de Persikoff se colorèrent légèrement.
« Voyons, voyons… murmura-t-il.
– Vous allez avoir une telle célébrité, continua Ivanoff… La tête me tourne… Voyez-vous, professeur, les héros de Wells ne sont rien, sont moins que rien, comparés à vous… Et moi qui croyais que c’étaient des contes de fées… Vous vous souvenez de sa Nourriture de dieux ?
– C’est un roman ? répondit Persikoff.
– Mais oui, bon Dieu, un roman célèbre.
– Je l’ai oublié, dit Persikoff ; je l’ai bien lu, mais j’ai oublié…
– Comment avez-vous pu oublier ? Mais regardez donc cela… »
Ivanoff souleva par la patte une grenouille morte, de dimensions incroyables et le ventre enflé. Elle avait gardé une expression féroce même dans la mort.
« C’est vraiment monstrueux. »
CHAPITRE IV
PERSIKOFF TRAQUÉ
Dieu sait comment l’histoire du rayon rouge, découvert par Persikoff, se répandit à travers l’énorme cité. Était-ce par suite d’une indiscrétion de l’assistant, ou bien les nouvelles sensationnelles ont-elles la faculté de traverser l’espace ? mais des rumeurs, assez vagues il est vrai, sautillaient comme un oiseau blessé, parmi les habitants de la capitale, surgissaient on ne sait d’où et disparaissaient aussitôt. Enfin, vers la mi-juin, une courte notice sur le rayon rouge parut à la vingtième page du Journal Isvestia, sous la rubrique : « Nouvelles scientifiques et techniques. »
(À suivre)
–––––
(Michel Boulgakoff [« Роковые яйца, » in Недра (almanach Niedra), février 1925], illustrations de Nicolas Marinovich, in Vu, journal de la semaine, n° 68, mercredi 3 juillet 1929. Cette nouvelle a été traduite par François Cornillot et Alain Préchac dans le recueil Les Oeufs fatidiques, Verviers : Marabout-Gérard, collection « Bibliothèque Marabout Science Fiction » n° 452, 1973)
–––––