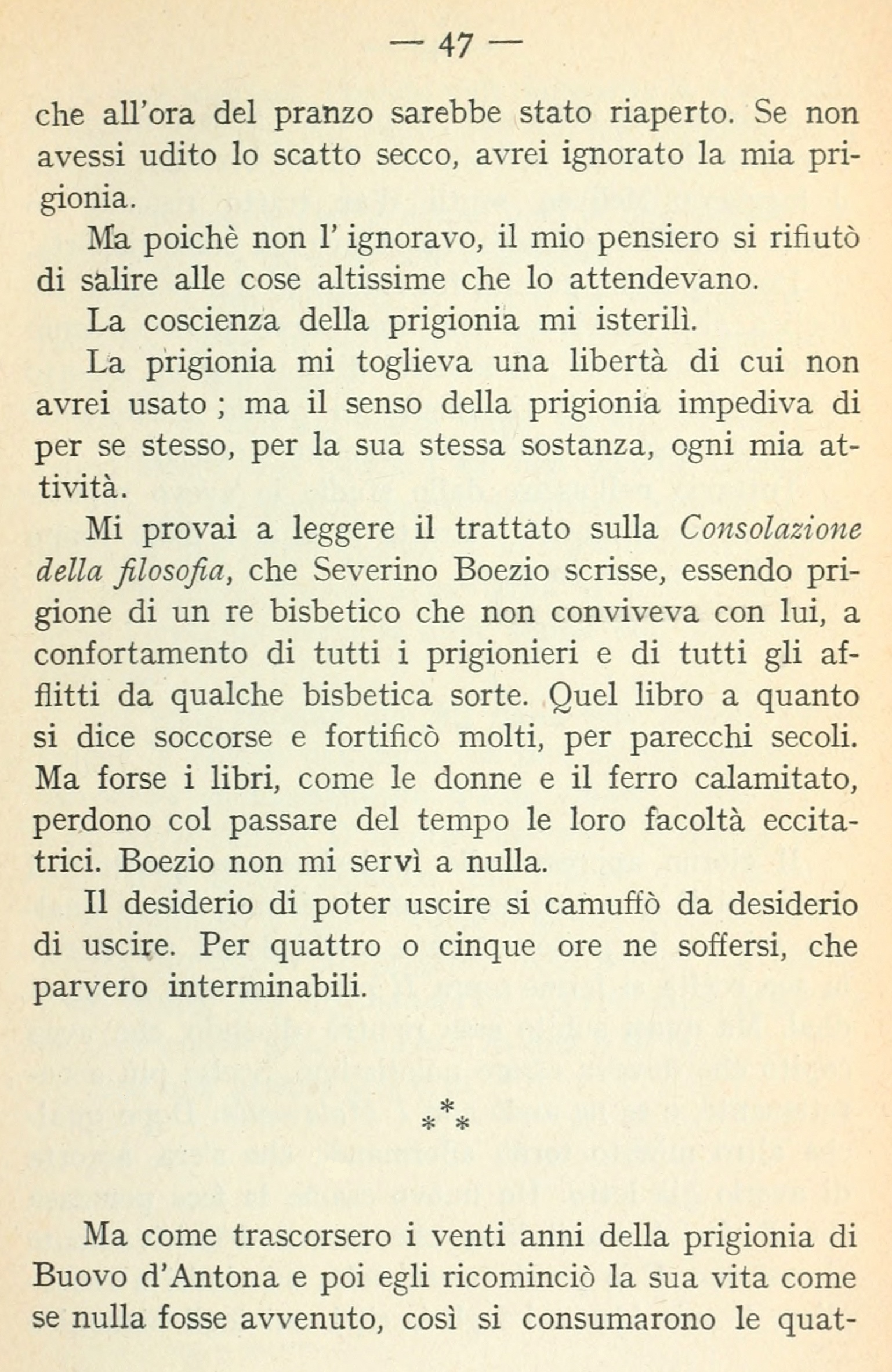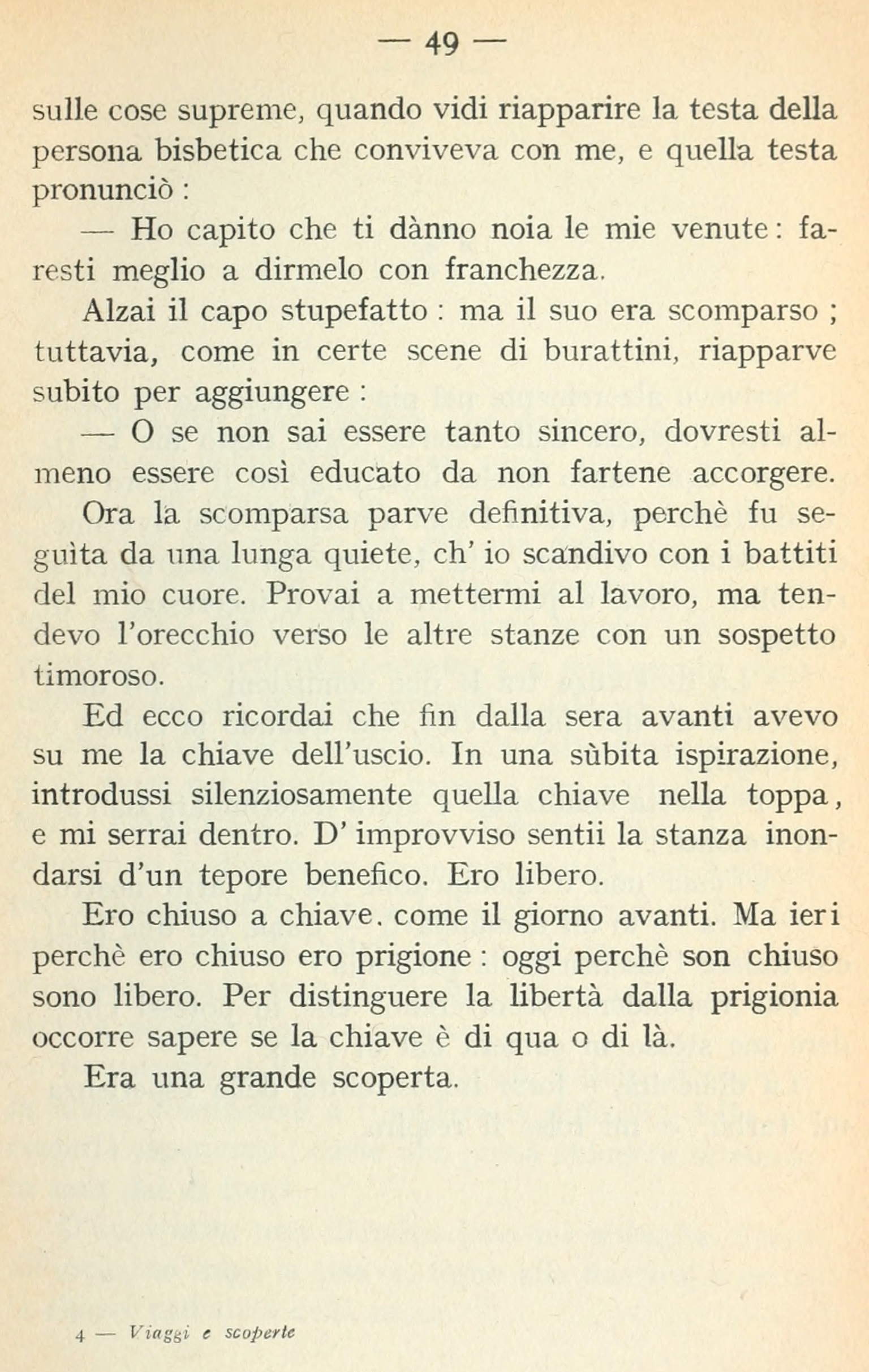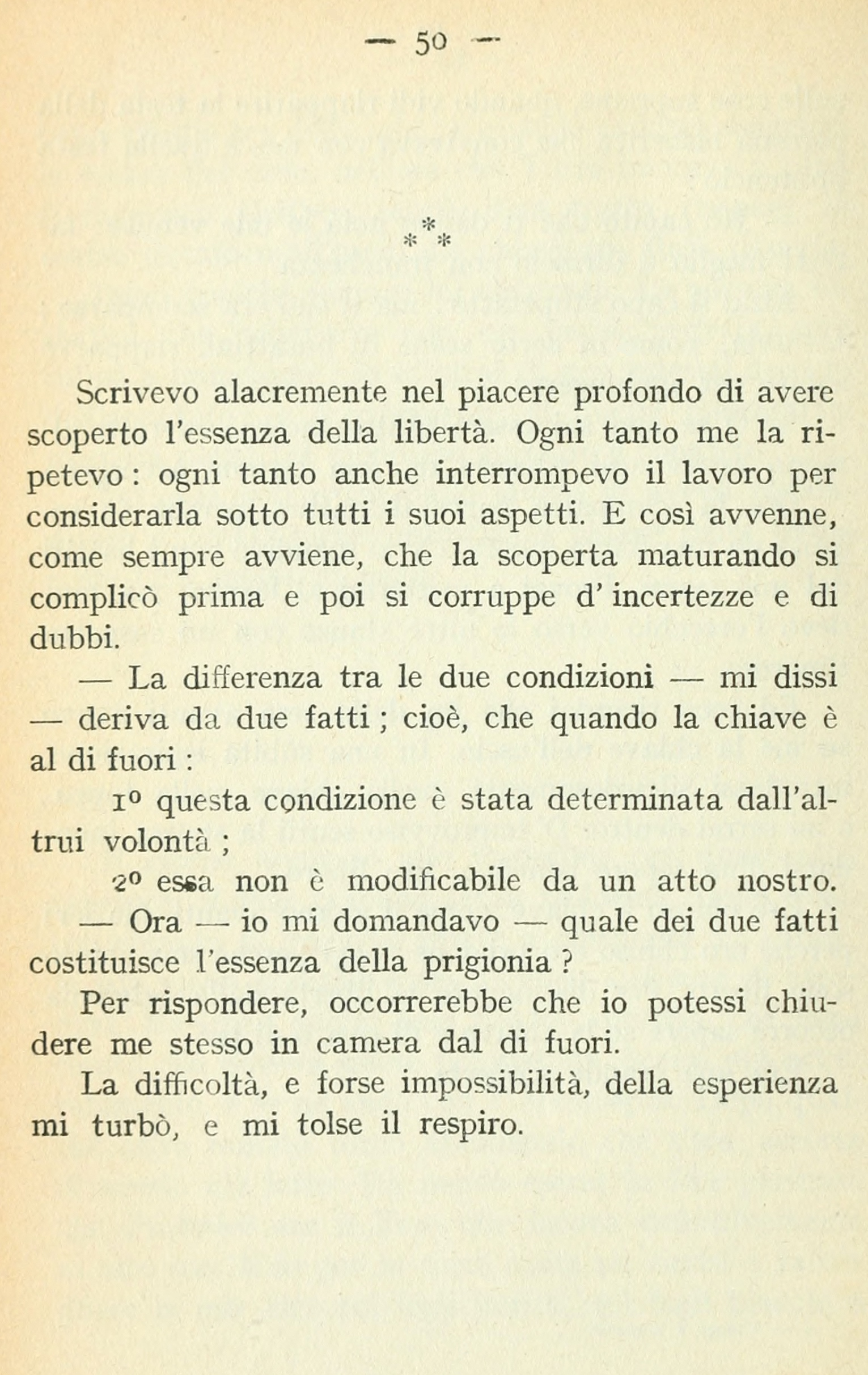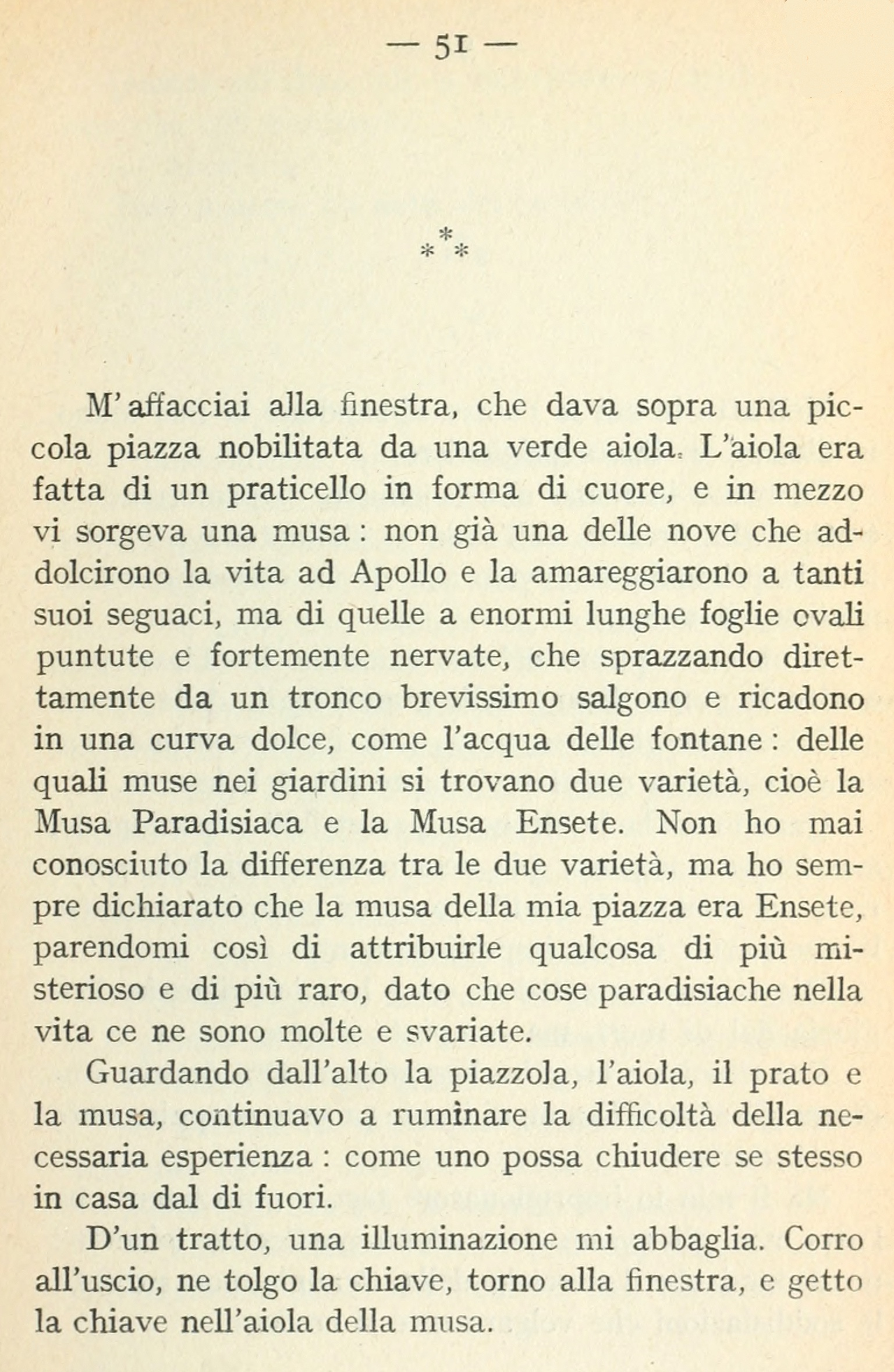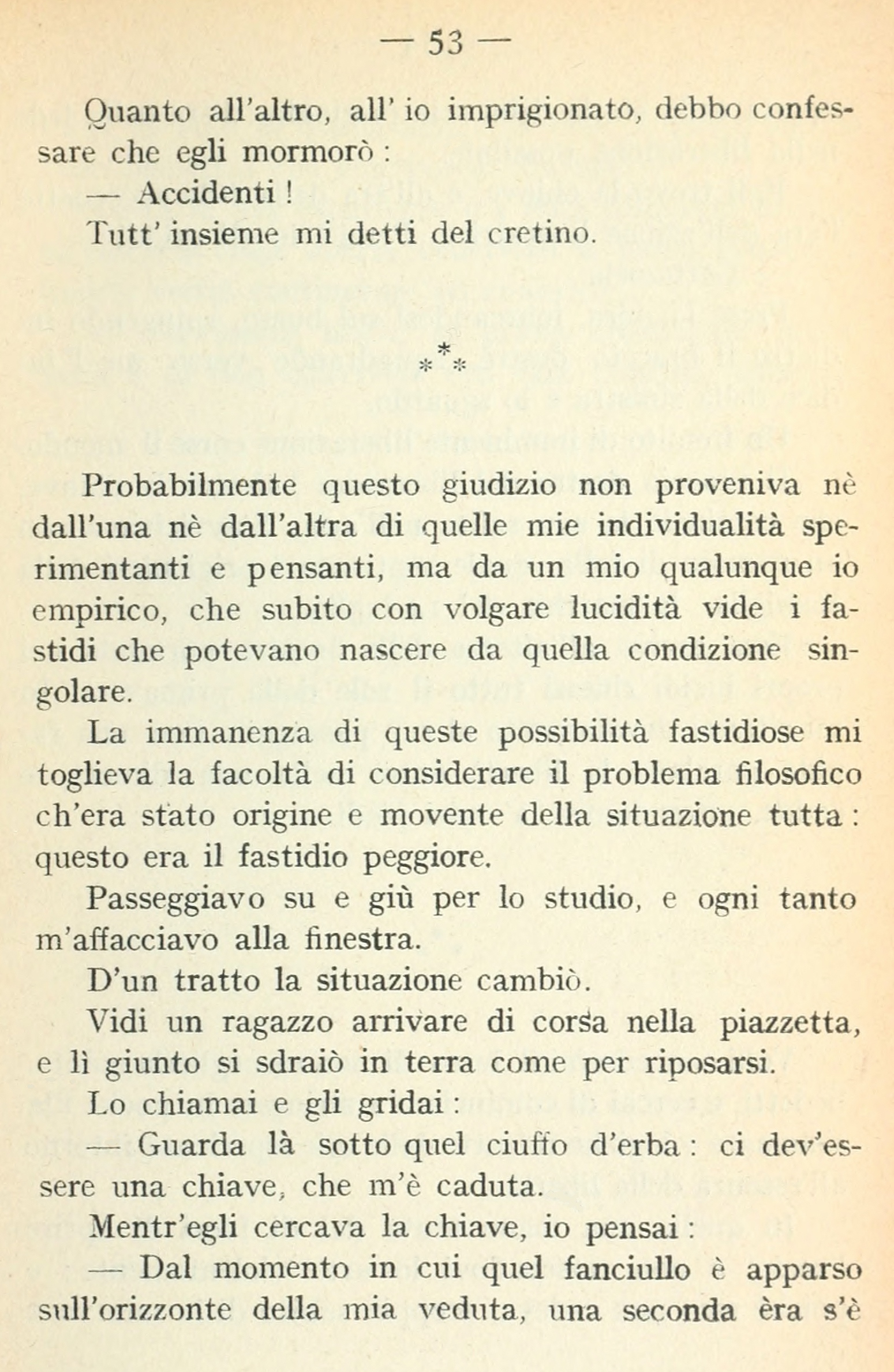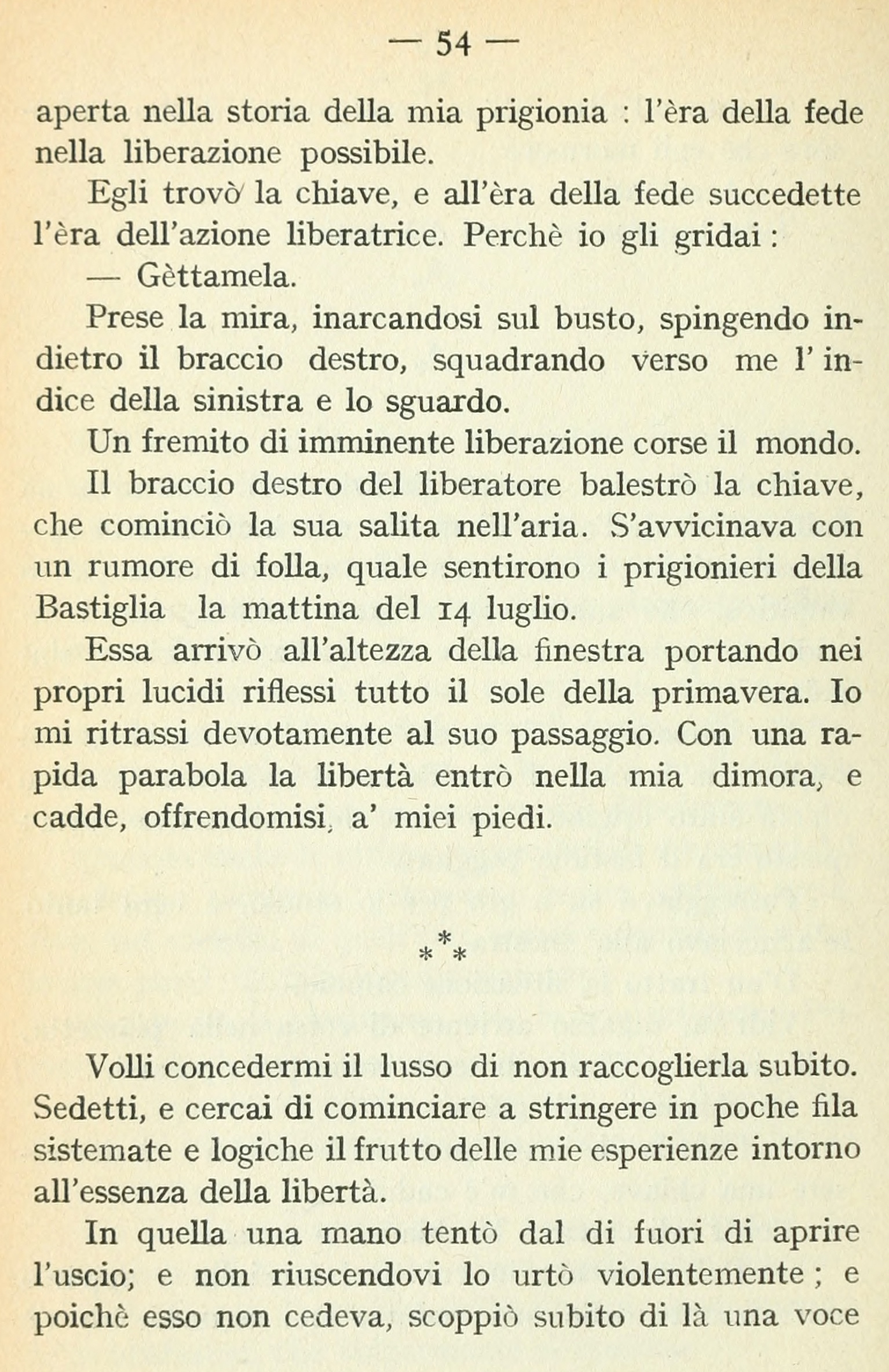Il fut une époque de ma vie où je cohabitais, je ne sais plus pour quelle raison, avec une personne acariâtre. Cette personne soulageait sa mauvaise humeur en m’infligeant toute une gamme de tracasseries qui allait des plus simples aux plus compliquées, des plus ingénieuses aux plus bêtes.
Une des plus simples, et en même temps des plus stupides, fut la suivante.
Rentrant un jour chez moi sur les deux heures de l’après-midi, j’allai tout droit vers mon bureau et traversai un salon où se tenait cette personne. Ce faisant, j’avais commis je ne sais plus quelle faute, réelle ou supposée, qui me valut une décharge de reproches acerbes. À mi-chemin de mon bureau, je m’arrêtai pour écouter, dans cette attitude d’insolente soumission qui se prend avec les personnes acariâtres (une telle attitude a pour effet de les irriter davantage et l’attitude contraire a le même résultat).
À un certain moment, j’entendis ces paroles : « Va-va-va ! »
Il me sembla que ce triple monosyllabe avait un sens impératif. Je me remis donc en route et pénétrai dans mon bureau.
À peine entré, assis à ma table devant quelques feuilles écrites et un grand nombre de feuilles blanches, comme je m’apprêtais à concentrer mon esprit sur de hautes et graves questions, j’entendis un petit bruit métallique dont je soupçonnai aussitôt l’origine : ma porte venait d’être fermée à clef.
J’y courus et tentai vainement de l’ouvrir. Les pas de la personne derrière la porte s’éloignaient avec un battement de talons sarcastique et disparaissaient dans le silence.
Comme je l’ai dit, cette petite persécution était aussi simple que stupide. J’avais coutume de rester enfermé dans mon bureau de cette heure-là jusqu’au repas du soir. Que la porte fût ou non fermée à clef, c’était sans importance : je savais qu’elle s’ouvrirait à l’heure du dîner. Si je n’avais entendu ce petit bruit, j’aurais ignoré ma captivité.
Mais comme je ne l’ignorais point, mon esprit refusa de prendre son essor vers les très hautes pensées qui l’attendaient.
La conscience de ma captivité me stérilisait.
Cette captivité ne me privait que d’une liberté dont je n’aurais pas fait usage ; mais, par lui-même, par sa force propre, le sentiment d’être prisonnier paralysait en moi toute activité.
Je m’efforçai de lire le traité De la Consolation de la philosophie, que Boèce, étant prisonnier d’un souverain acariâtre, écrivit pour le réconfort de toutes les victimes de la persécution et de la tracasserie. Ce livre, à ce qu’on dit, en secourut et fortifia un grand nombre pendant plusieurs siècles. Mais peut-être les livres sont-ils comme les femmes et le fer aimanté, qui perdent avec le temps leur vertu excitante. Boèce ne me servit à rien.
Le désir de pouvoir sortir se camoufla en désir de sortir. J’en souffris pendant quatre ou cinq heures qui parurent interminables.
Mais de même que s’écoulèrent les vingt années de prison de Bovo d’Antona et qu’il reprit ensuite sa vie antérieure comme si rien n’était advenu, ainsi se consumèrent les quatre ou cinq heures de ma captivité, et quand descendirent plus grandes les ombres du ciel, à l’heure où Tityre convie à partager son repas Mélibée chassé par la guerre, je reconnus le petit bruit métallique : la clef avait tourné dans la serrure. Au bout de quelques minutes, je m’entendis appeler. La personne acariâtre avec qui je cohabitais semblait parfaitement calme et sans souvenir. De mon côté, je fis comme si je ne m’étais aperçu de rien, et le reste de cette mémorable journée se passa de la façon la plus normale et habituelle.
Cependant, au sortir de mon bureau, d’un geste rapide et inaperçu, j’avais retiré la clef de la serrure et l’avais glissée dans ma poche.
Le lendemain, à l’heure accoutumée, je regagnai ma petite table sans incidents. Après quelques minutes, la personne entra pour demander un livre ; son choix s’arrêta sur Le Rouge et le Noir. Mais presque aussitôt elle revint, disant que ce devait être mortellement ennuyeux. Elle fit un choix plus attentif et partit avec Les Malavoglia, de Verga. Quelques minutes encore, et elle rapportait le livre, s’étant aperçu qu’elle l’avait déjà lu. Un nouvel examen la persuada qu’en définitive Pickwick était l’œuvre qui lui convenait. Et moi, pour la troisième fois, je m’efforçais de rassembler mes idées devant feuilles écrites et feuilles blanches, sur les choses suprêmes, quand je vis réapparaître la tête de la personne acariâtre, et cette tête parla :
« J’ai compris que mes venues t’ennuient : tu ferais mieux de me le dire franchement. »
Je levai le front, stupéfait ; déjà, la tête avait disparu, mais, comme dans une scène de marionnettes, elle réapparut aussitôt pour ajouter :
« Ou si tu n’es pas capable d’une telle sincérité, tu devrais au moins être assez bien élevé pour ne pas laisser voir tes sentiments. »
Cette fois, la disparition sembla définitive, car elle fut suivie d’un long silence que scandaient les battements de mon cœur. J’essayai de me remettre au travail, mais je tendais l’oreille vers l’autre pièce et mon esprit était livré au soupçon et à la crainte.
Tout à coup, je me souvins que, depuis la veille, j’avais sur moi la clef de la porte. Pris d’une inspiration subite, j’introduisis silencieusement cette clef dans la serrure et je m’enfermai. J’étais libre.
Comme la veille, ma porte était fermée à clef. Mais hier, étant enfermé j’étais prisonnier ; aujourd’hui, étant enfermé, je suis libre.
Pour distinguer la liberté de la prison, il faut savoir si la clef est dedans ou dehors.
C’est une découverte.
J’écrivais avec feu, stimulé par la profonde satisfaction d’avoir découvert l’essence de la liberté. De temps à autre, je me répétais ma découverte, ou bien j’interrompais mon travail pour la considérer sous tous ses aspects. Il advint ainsi, comme il advient toujours, que cette découverte en mûrissant se compliqua, puis se mêla d’incertitudes et de doutes.
La différence des deux situations, me dis-je, dérive de deux éléments. En effet, quand la clef est dehors, cette situation :
1) a été déterminée par la volonté d’autrui ;
2) n’est pas modifiable à notre gré.
Lequel de ces deux éléments, me demandai-je, constitue l’essence de la condition de prisonnier ?
Pour répondre, il faudrait que je puisse m’enfermer moi-même du dehors.
Le sentiment de la difficulté, de l’impossibilité peut-être d’une telle expérience, me troubla, me coupa la respiration.
Je m’accoudai à la fenêtre, qui donnait sur une petite place ornée d’un vert jardin. Ce jardin consistait en une pelouse en forme de cœur au milieu de laquelle se dressait une muse : non point l’une des neuf sœurs qui rendirent si douce la vie d’Apollon et si amère celle de tant de ses disciples, – non, – une de ces muses dont les grandes feuilles ovales et fortement innervées, jaillissant directement d’un tronc très court, montent et retombent en une courbe gracieuse, comme l’eau des fontaines.
Observant d’en haut la petite place, le jardin, la pelouse et la muse, je continuais de ruminer ce problème difficile : comment s’enfermer soi-même du dehors ?
Soudain, la lumière m’éblouit. Je cours à la porte, je prends la clef, je retourne à la fenêtre et je jette la clef dans le petit jardin de la muse.
À l’instant même, de libre je devins prisonnier.
À mesure que la clef – parcourant le trajet de la fenêtre au jardin – s’éloignait de moi, ma captivité s’enrichissait d’un élément consolidateur : le temps.
Sur son chemin, la clef heurta la pointe d’une des grandes feuilles de la muse. Elle atteignit le sol et la feuille ondula encore un peu, toujours plus faiblement.
Quand les dernières et imperceptibles vibrations de la feuille prirent fin, aucun signe visible n’apparaissait plus au monde de cet acte désormais entièrement accompli : mon emprisonnement.
Restait ma situation de prisonnier, emprisonné du dehors, mais par ma propre volonté.
J’avais réussi à réaliser mon expérience. Maintenant, je devais en étudier les effets. J’examinai mon propre dédoublement et m’interrogeai.
Mais mon moi emprisonneur resta muet ; il me parut qu’il n’avait tiré de son acte aucun plaisir particulier : j’en déduisis que l’exercice de la tyrannie ne procure pas les satisfactions qu’on lui attribue vulgairement.
Quant à l’autre, au moi emprisonné, je dois confesser qu’il murmura : « Malheur ! »
Tout compte fait, je me traitai de crétin.
Ce jugement, sans doute, n’était dû ni à l’une ni à l’autre de mes individualités cherchantes et pensantes, mais à un quelconque moi empirique, lequel aperçut soudain avec une lucidité vulgaire les ennuis qui pouvaient résulter de cette singulière situation.
La pensée de ces possibilités désagréables me mettait hors d’état de considérer le problème philosophique qui avait été à l’origine de toute l’affaire. J’allais et venais dans mon bureau et, de temps à autre, je me mettais à la fenêtre.
Puis, d’un coup, la situation changea.
Je vis un gamin qui arrivait en courant sur la petite place et s’allongeait par terre comme pour se reposer.
Je l’appelai et criai :
« Regarde, là, sous cette touffe d’herbe ; j’ai laissé tomber ma clef. »
Pendant qu’il cherchait la clef, je me disais : « À l’instant où cet enfant est entré dans mon champ visuel, une nouvelle phase de l’histoire de ma captivité a commencé : l’ère de la foi dans la possibilité d’une libération. »
Il trouva la clef, et à l’ère de la foi succéda celle de l’action libératrice. Car je lui criai : « Jette-la-moi ! »
Il visa, arquant son buste, lançant en arrière son bras droit, dirigeant vers moi son regard ainsi que l’index de sa main gauche. Un frémissement d’imminente libération traversa le monde.
Le bras droit du libérateur lança la clef, qui commença son ascension dans l’air. Elle se rapprochait avec une rumeur de foule telle que l’entendirent les prisonniers de la Bastille au matin du 14 juillet.
Elle arriva à la hauteur de ma fenêtre, apportant dans ses reflets lumineux tout le soleil du printemps. Je m’écartai pieusement à son passage. Parcourant une rapide parabole, la liberté entra dans ma demeure et tomba, offerte, à mes pieds.
Je voulus m’accorder le luxe de ne pas la ramasser aussitôt. Je m’assis et tentai de lier logiquement ensemble les fils de toutes mes recherches sur l’essence de la liberté.
Là-dessus, une main essaya d’ouvrir la porte, et, n’y réussissant pas, la frappa violemment. Et comme la porte ne cédait pas, j’entendis une voix coléreuse, la voix de cette main, la voix de ces coups, la voix acariâtre avec laquelle je cohabitais.
Toutes mes expériences, tous mes syllogismes sur l’essence de la liberté cédèrent alors la place à cette vérité empirique : la première condition pour être libre est de ne pas cohabiter avec une personne acariâtre.
–––––
(Massimo Bontempelli, traduit de l’italien par Georges Roditi, in La Parisienne, revue littéraire mensuelle, juillet 1953. La nouvelle originale est parue sous le titre : « Scoperta, » dans le recueil Viaggi e scoperte. Ultime avventure, Firenze: Vallechi Editore, 1922. René Magritte, « La Clef des champs, » huile sur toile, 1936)
MASSIMO BONTEMPELLI : SCOPERTA
–––––