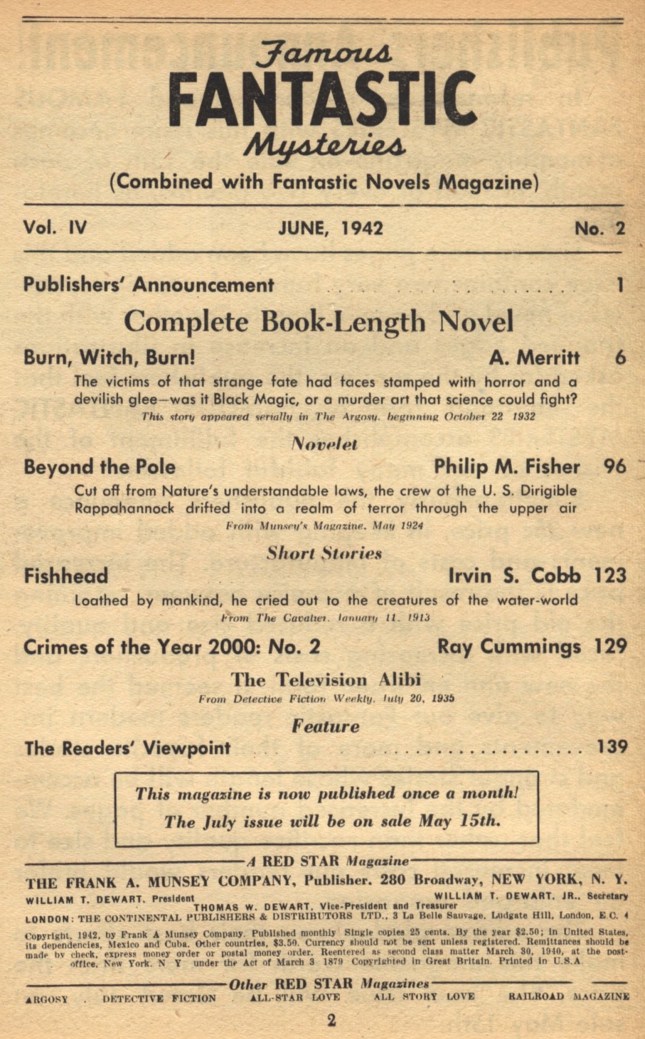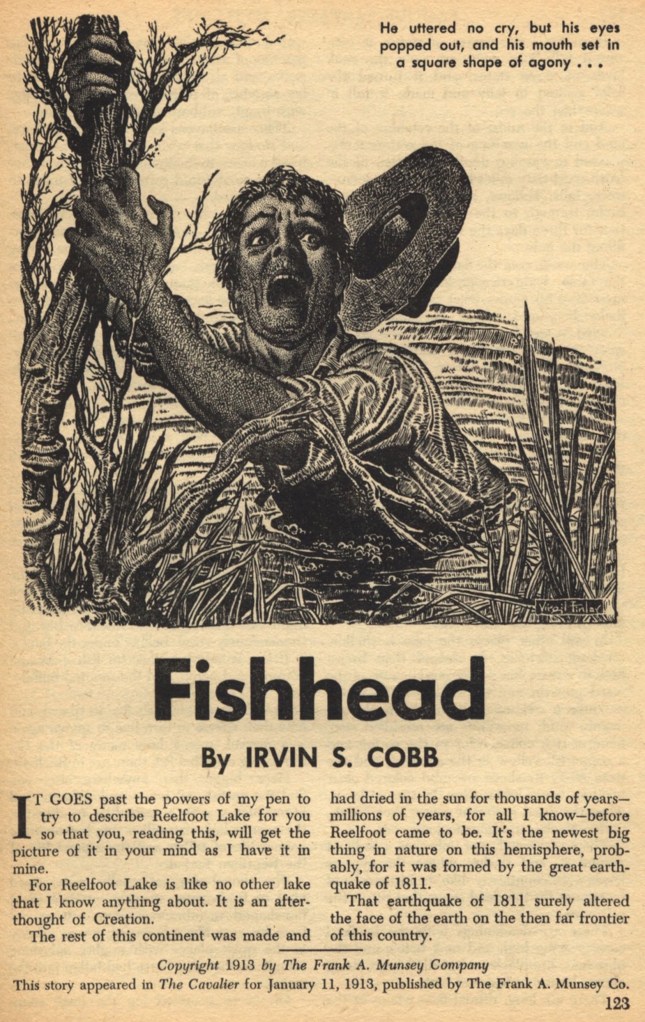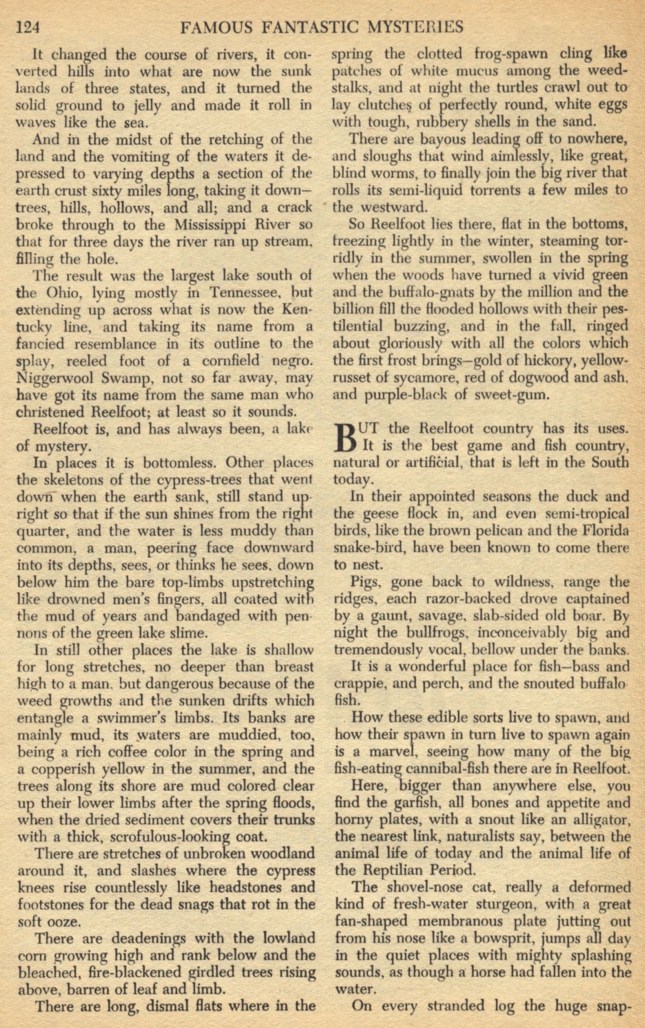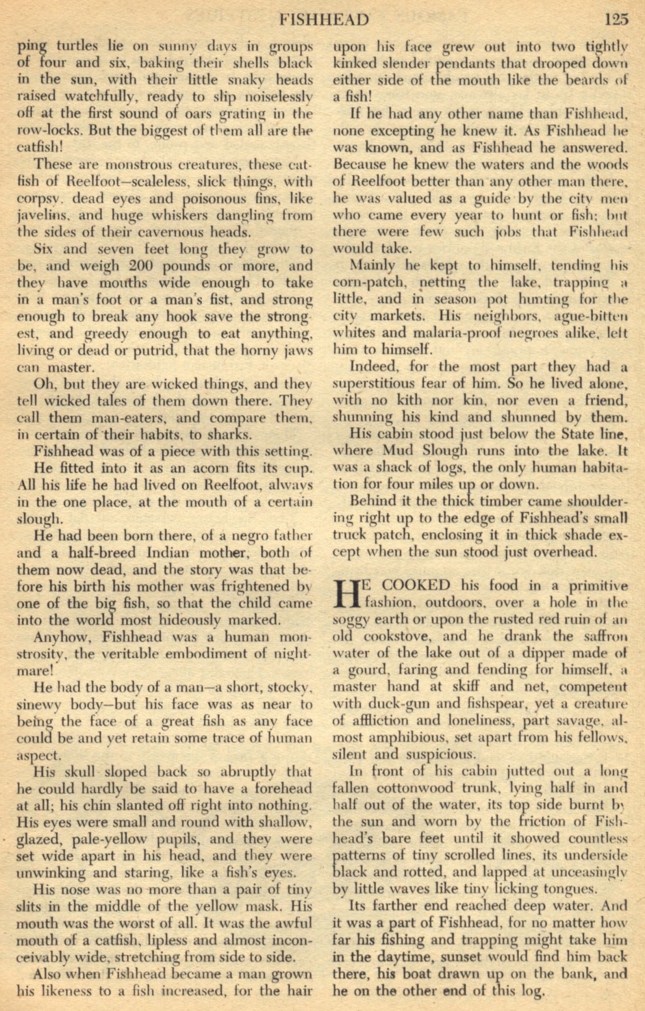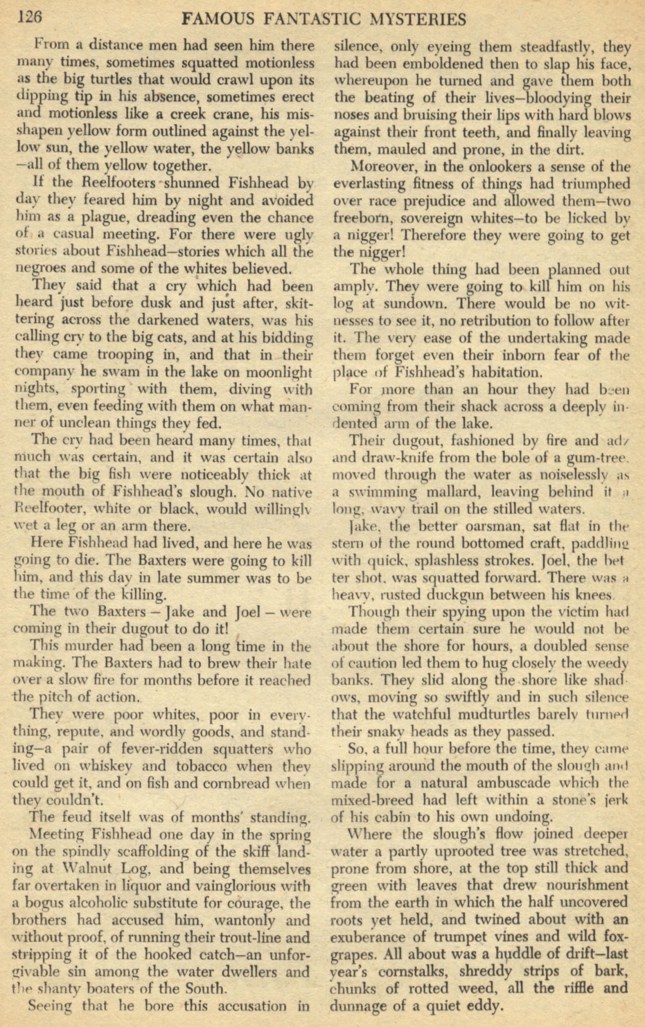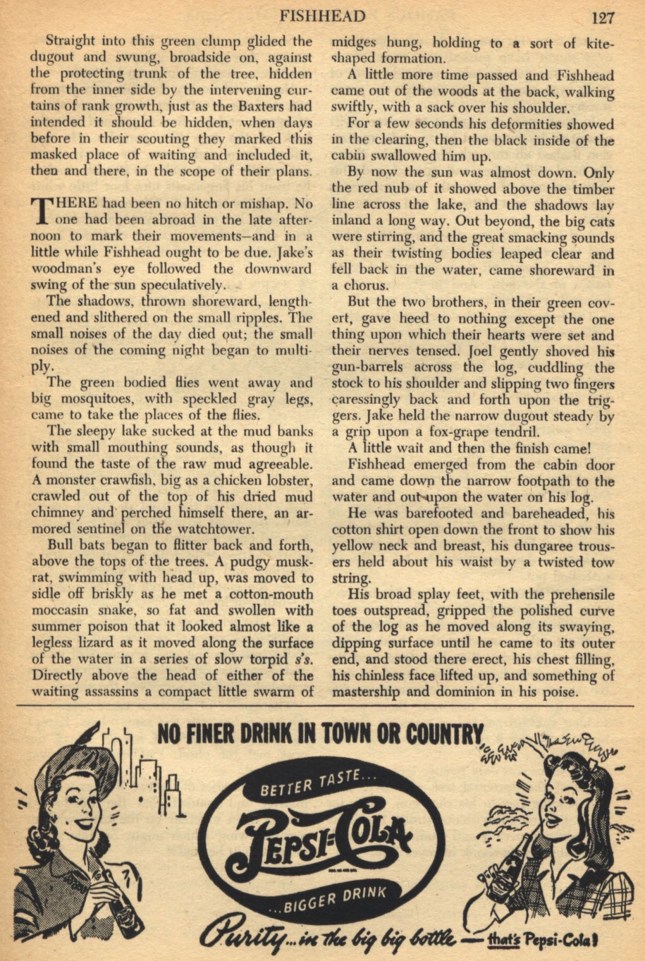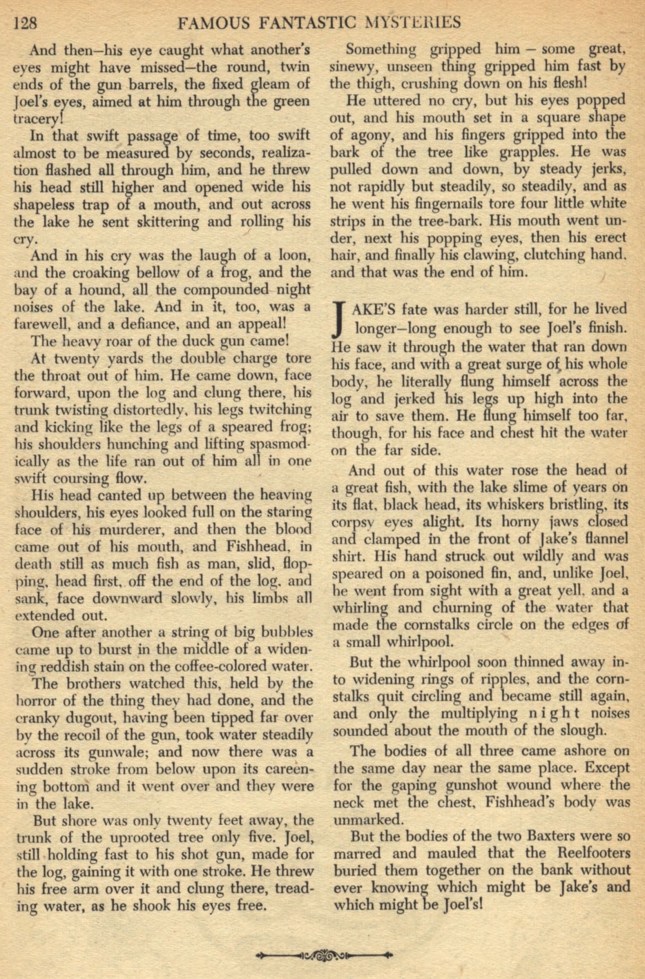Ce conte attribué à Edgar Poe par le magazine américain Munsey’s a été retrouvé récemment dans les papiers de mistress Waistmicot, petite-cousine de la femme de l’auteur. L’attribution à Edgar Poe fait, en ce moment, l’objet de chaudes discussions dans la presse américaine. Nous le publions sous toutes réserves, en faisant remarquer que l’auteur, quel qu’il soit, s’est inspiré d’une légende qui se retrouve dans le folklore de divers pays.
–––––
Le lac Rumpus n’est semblable à aucun autre lac de la création.
Formé par le tremblement de terre de 1711, qui transforma du tout au tout la région sud du Tennessee et fit d’une colline boisée une dépression bientôt emplie par les eaux du Mississippi, – un vaste lac qui ressemble à l’empreinte du pied d’un nègre, – il est et demeure mystérieux.
Par endroits, il n’a pas de fond, à d’autres, les squelettes des arbres disparus avec la colline se voient encore, lorsque l’eau est moins boueuse que de coutume, tendant, rigides vers la surface, leurs branches nues et recouvertes d’une couche d’alluvions séculaires. Les rives du lac sont vaseuses, ses eaux couleur café au lait, et la forêt, le long des berges, a partout une teinte de rouille. Les environs sont giboyeux, l’onde du Rumpus poissonneuse, malgré les poissons carnassiers qui y abondent plus qu’ailleurs. Le plus vorace de ces poissons dévoreurs de leurs congénères est, à coup sûr, la lamproie-chat, une créature monstrueuse, sans écailles, gélatineuse, aux yeux morts et cadavériques, aux nageoires venimeuses et pointues comme des javelines, et aux longues moustaches tombant de chaque côté des mâchoires.
Pesant de deux à trois cents livres, armées d’un bec osseux capable de trancher la jambe d’un homme, elles sont la terreur des pêcheurs qui les appellent « requins d’eau douce. »
C’était à ces bêtes immondes que « Tête de poisson » ressemblait. Né sur les rives du Rumpus quelque trente ans auparavant, il était fils d’un Indien et d’une négresse métissée. Sa mère, à ce que l’on contait, ayant eu, avant qu’il naquît, peur d’une énorme lamproie-chat, l’enfant était venu au monde horriblement défiguré.
« Tête de poisson » était un monstre, un cauchemar à forme humain. Il avait bien le corps d’un homme, un corps solide, quoique noueux, mais sa tête était comparable à celle d’un des requins d’eau douce. Son crâne fuyait de façon telle qu’il semblait n’avoir point de front, son menton n’était pas marqué, ses gros yeux cerclés, d’un jaune pâle, étaient largement écartés, écarquillés et toujours fixes ; il n’avait en guise de nez que deux fentes étroites dans son masque, et sa bouche était effrayante, – l’horrible gueule d’une lamproie-chat, – s’étendant d’une oreille à l’autre et de largeur inconcevable.
« Tête de poisson » vivait solitaire, tantôt pêcheur, tantôt trappeur, fournissant, selon la saison, les différents marchés des villes. Ses voisins, blancs mordus de fièvre, ou nègres atteints de malaria, le laissaient toujours à lui-même, car ils avaient tous peur de lui, une peur superstitieuse. Seul, sans parents et sans amis, sans famille et sans compagnons, il habitait une cabane à la frontière du Tennessee, à l’endroit où le « Ru boueux » vient se confondre avec le lac. C’était une cahute en planches (la seule maison qu’on rencontrât dans un rayon de quelques milles), sise à l’orée de la forêt qui s’étendait jusqu’à l’enclos, le couvrant de son ombre épaisse, sauf au moment où le soleil se trouvait en plein au zénith. « Tête de poisson » se nourrissait d’une manière primitive, cuisant ses vivres au-dehors, au-dessus d’un trou dans la terre, et buvant l’eau trouble du lac, dans un gobelet des plus grossiers fait d’une calebasse évidée.
Son adresse à la canardière et au harpon, sa vélocité de pagayeur, sa chance au filet, ajoutaient à sa réputation de sorcier, et c’était pourquoi cette créature amphibie et demi-sauvage était tenue à l’écart des autres hommes et suspecte à tous. Sur le devant de sa hutte s’était abattu jadis le tronc énorme d’un arbre à coton, qui gisait à demi dans l’eau, le dessus brûlé par le soleil, usé par le frottement des pieds du métis, le dessous noirâtre et pourri, léché sans cesse par les petites vagues du lac. L’extrémité la plus éloignée surplombait l’eau profonde, et c’était là le coin favori de « Tête de poisson. » Si loin que sa pêche et sa chasse l’entraînassent pendant la journée, le crépuscule l’y retrouvait immanquablement. On l’apercevait souvent à distance, tantôt étendu sans mouvement à la façon des lourdes tortues qui s’y hissaient pendant son absence, tantôt juché sur ses jambes, perdu en contemplation, semblable à quelque courlis de crique, son corps difforme et couleur d’ocre se confondant avec le soleil jaunâtre, les rives ocreuses, l’ensemble jaune.
Si les riverains du Rumpus évitaient « Tête de poisson » pendant la journée, ils le craignaient pendant la nuit et le fuyaient comme la peste, car des histoires à faire frémir couraient sur le compte du « monstre. » On prétendait qu’un cri lugubre qu’on entendait au crépuscule, après le coucher du soleil, cri sauvage se répercutant sur la surface enténébrée, était celui qu’il employait pour appeler les lamproies-chats. On chuchotait qu’à son appel les voraces arrivaient en troupes, et qu’alors, en leur compagnie, il nageait à travers le lac, par les nuits pâles de clair de lune, qu’il plongeait en les imitant et qu’il se nourrissait comme elles de toute espèce de choses immondes.
Que pareil cri ait retenti, il n’y avait pas le moindre doute ; il était également certain que les lamproies-chats abondaient aux abords du tronc et du Ru.
« Tête de poisson » vivait là, et c’est là qu’il devait mourir. Les Baxter allaient le tuer, et le jour fixé pour le meurtre était ce vendredi d’automne. Les deux Baxter, Jack et Joël, des squatters blancs mangés de fièvre, s’en étaient pris au malheureux, dont le mauvais œil, selon eux, était cause de leur malchance. Il leur fallait la peau du nègre. Morte la bête, et mort le sort ! Ils s’étaient dit qu’ils le tueraient sur son tronc d’arbre au crépuscule. Vers deux heures de l’après-midi, ils avaient quitté leur cabane, dans leur pirogue façonnée dans le tronc léger d’un gommier, et avaient filé sur les eaux le long des berges. Par prudence, Jack, le meilleur « nageur » des deux, assis à l’arrière du bateau, trempait sa pagaie dans l’eau noire sans qu’une goutte rejaillît. Joël, accroupi à l’avant, tenait sa lourde canardière.
Une heure avant la fin du jour, ils atteignirent, près du tronc d’arbre, un rideau de saules pleureurs dont les longues branches retombantes masquaient leur pirogue du large et dont les troncs assez serrés empêchaient qu’on la vît de terre. Nul ne les avait aperçus, et tout marcherait à souhait.
Jack et Joël, gorgés d’alcool, oubliaient la peur instinctive que « Tête de poisson » leur causait. Le soleil descendait déjà. « Tête de poisson » allait venir. Les ombres s’allongèrent vers le rivage. Les petits bruits du jour cessèrent ; les petits bruits de la nuit qui approche se multiplièrent. Les mouches au corselet vert s’éloignèrent et de gros moustiques gris vinrent prendre leur place. La brise commença de charrier des hannetons au-dessus de la cime des arbres ; des bandes d’étourneaux tournoyèrent. Quelques instants passèrent encore, puis « Tête de poisson » sortit du bois, portant un sac sur ses épaules. Pendant quelques instants, ses difformités se montrèrent dans la clairière, puis disparurent dans l’ombre de la cabane. Le soleil était presque couché. Auprès du tronc, les lamproies-chats sautaient hors de l’eau et plongeaient, s’ébattant comme des dauphins.
Mais les deux frères assassins, derrière leur abri de verdure, ne faisaient attention à rien de ce qui n’était pas leur dessein. Joël épaula doucement, glissant deux doigts sur la gâchette. Jack maintint la pirogue étroite en s’accrochant à une branche.
Après quelques moments d’attente, « Tête de poisson » reparut. Il était pieds nus et nu-tête ; sa chemise de coton s’ouvrait sur sa poitrine et sur son cou, et son pantalon de toile bise n’était retenu à sa taille que par une simple ficelle. Il atteignit l’extrémité de l’arbre et, se tenant là tout droit, emplissant sa poitrine, levant son visage sans menton, il promena sur le lac un regard de maître. C’est alors que son œil perçant aperçut le canon du fusil de Joël, dirigé vers sa poitrine. Et, levant sa tête encore plus haut, ouvrant sa bouche démesurée, à travers le lac endormi, il lança son grand cri sauvage. Et ce cri, qui tenait du rire du pluvier, du croassement de la grenouille, de l’aboiement du chien de chasse, était un composé de tous les bruits nocturnes du lac. C’était aussi un adieu, un défi et un appel.
La détonation de la canardière retentit. À vingt mètres, la double charge lui emporta la gorge. Il s’abattit, la face en avant, sur le tronc d’arbre, et s’y cramponna, le corps contorsionné, les jambes gigotantes comme les pattes d’une grenouille harponnée. Ses épaules se soulevaient spasmodiquement, tandis que la vie s’écoulait avec le sang en un double jet. Sa tête se souleva d’entre ses épaules ; ses yeux se posèrent sur les visages de ses assassins, le sang lui sortit de la bouche et « Tête de poisson, » aussi poisson dans la mort qu’il l’avait été dans la vie, glissa la tête la première du haut du tronc d’arbre et coula lentement dans l’eau bourbeuse, les membres étendus, rigides. Quelques bulles montèrent à la surface, au milieu d’une mare de sang.
Les frères contemplèrent leur œuvre, frappés par l’horreur de leur acte, tandis que la pirogue, donnant de la bande par suite du recul, s’emplissait légèrement d’eau. Il y eut un choc soudain sur le fond rond et sans quille ; l’embarcation chavira et ils se trouvèrent dans le lac…
Mais la rive n’était qu’à vingt brasses, les troncs des saules à sept ou huit. Joël, tenant toujours son fusil, se dirigea vers le tronc du mort ; l’atteignant sans aucune peine, il s’y cramponna de sa main libre et s’apprêta à se hisser. Soudain, quelque chose l’agrippa, quelque chose d’énorme et d’invisible, qui lui broya la cheville. Il ne poussa pas un cri, mais ses yeux sortirent des orbites et sa bouche se crispa de douleur. Ses doigts se plantèrent dans l’écorce de l’arbre comme des grappins. Il était entraîné vers le fond par à-coups suivis, doucement, sûrement, si doucement que ses ongles cassèrent l’un après l’autre dans l’écorce. Sa bouche disparut, puis ce fut le tour de ses yeux hagards, de ses cheveux hérissés, de sa main crispée, et ce fut ainsi qu’il finit.
Le sort de Jack fut encore plus terrible, car il vécut plus longtemps, assez longtemps pour voir mourir son frère. D’un élan de son corps, il s’était littéralement jeté hors de l’eau sur la même souche, lançant ses jambes hors de portée, mais son élan fut trop violent et sa figure et sa poitrine heurtèrent l’eau de l’autre côté. Alors, de l’eau surgit la tête d’une monstrueuse lamproie-chat, tête plate et noire, recouverte d’une couche de vase ancienne, tête dont les moustaches se hérissaient, dont les yeux ronds brillaient étrangement. Les mâchoires osseuses se refermèrent avec un bruit sec sur la chemise de Jack. Dans un grand geste qu’il fit, sa main s’empala sur une épine des nageoires, et il disparut avec un cri terrible dans un tourbillon qui fit danser les roseaux près du rivage.
Les cadavres des trois hommes revinrent à la surface le même jour et furent portés par le courant au même endroit. À part la blessure au cou, le corps de « Tête de poisson » était intact, mais ceux des deux Baxter étaient si déchiquetés, et dans un état si pitoyable, qu’on dut les enterrer tous deux sur la berge, sans savoir qui était Jack et qui pouvait être Joël.
Edgar Poe (?)
Adapté de l’anglais [sic] par Fred Maël.
–––––
(Irvin S. Cobb, adapté par Fred Maël, in Le Gaulois du Dimanche, supplément littéraire, n° 13181, samedi 15 novembre 1913 ; illustration de Virgil Finlay, 1942. La nouvelle de Cobb, « Fishhead, » est initialement parue dans The Cavalier, la revue éditée par Frank A. Munsey, le samedi 11 janvier 1913 ; la fausse attribution à Edgar Poe et l’histoire de sa prétendue découverte parmi les papiers de Mrs. Waistmicot sont une pure mystification du traducteur)