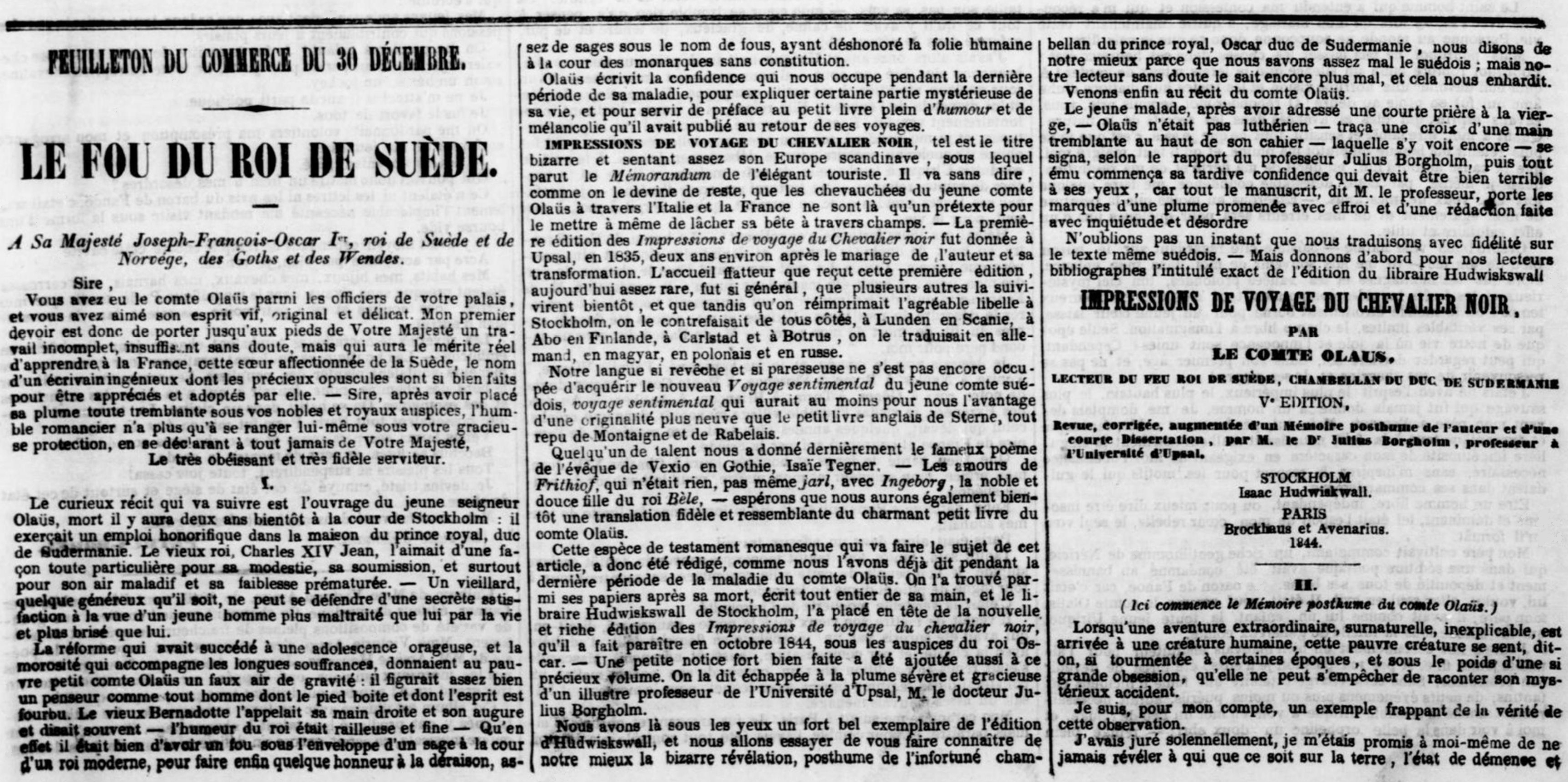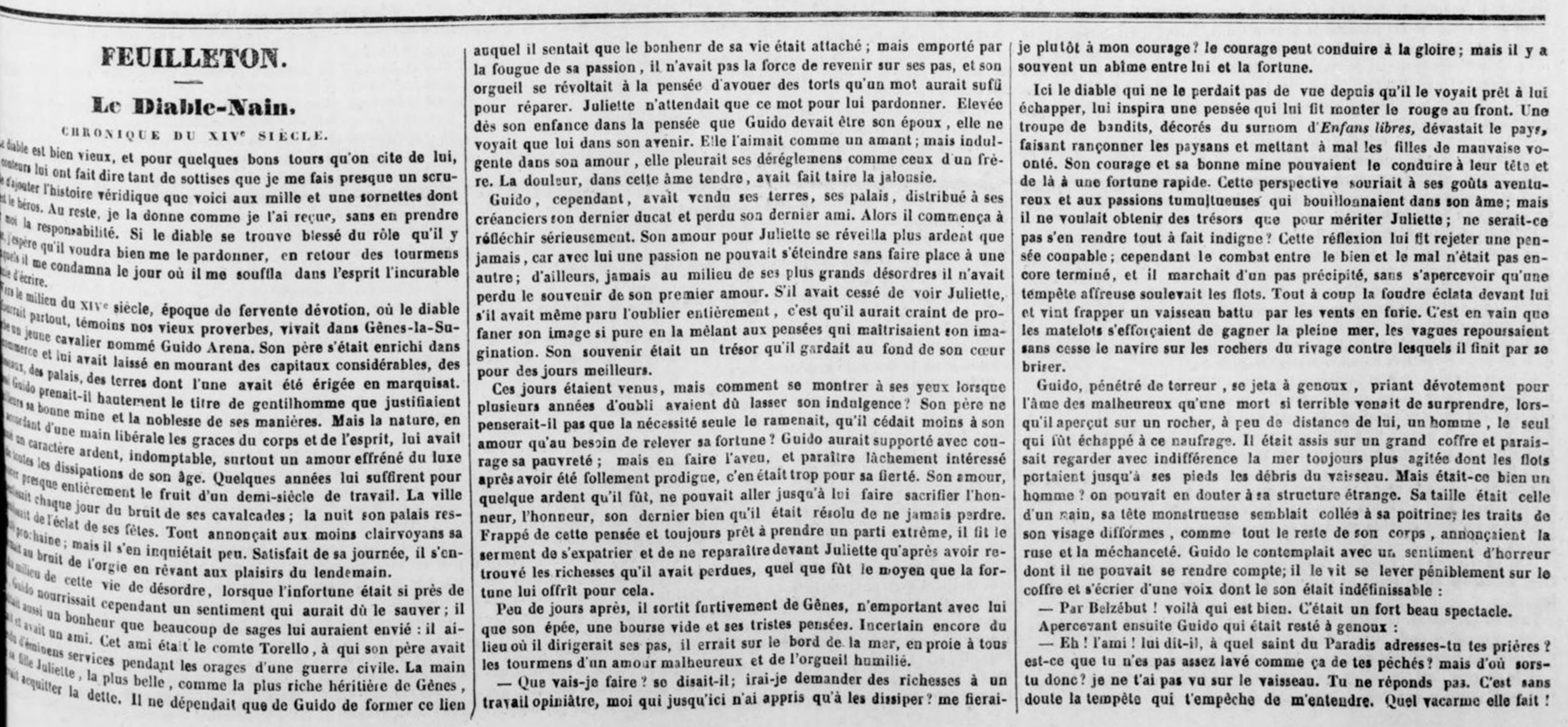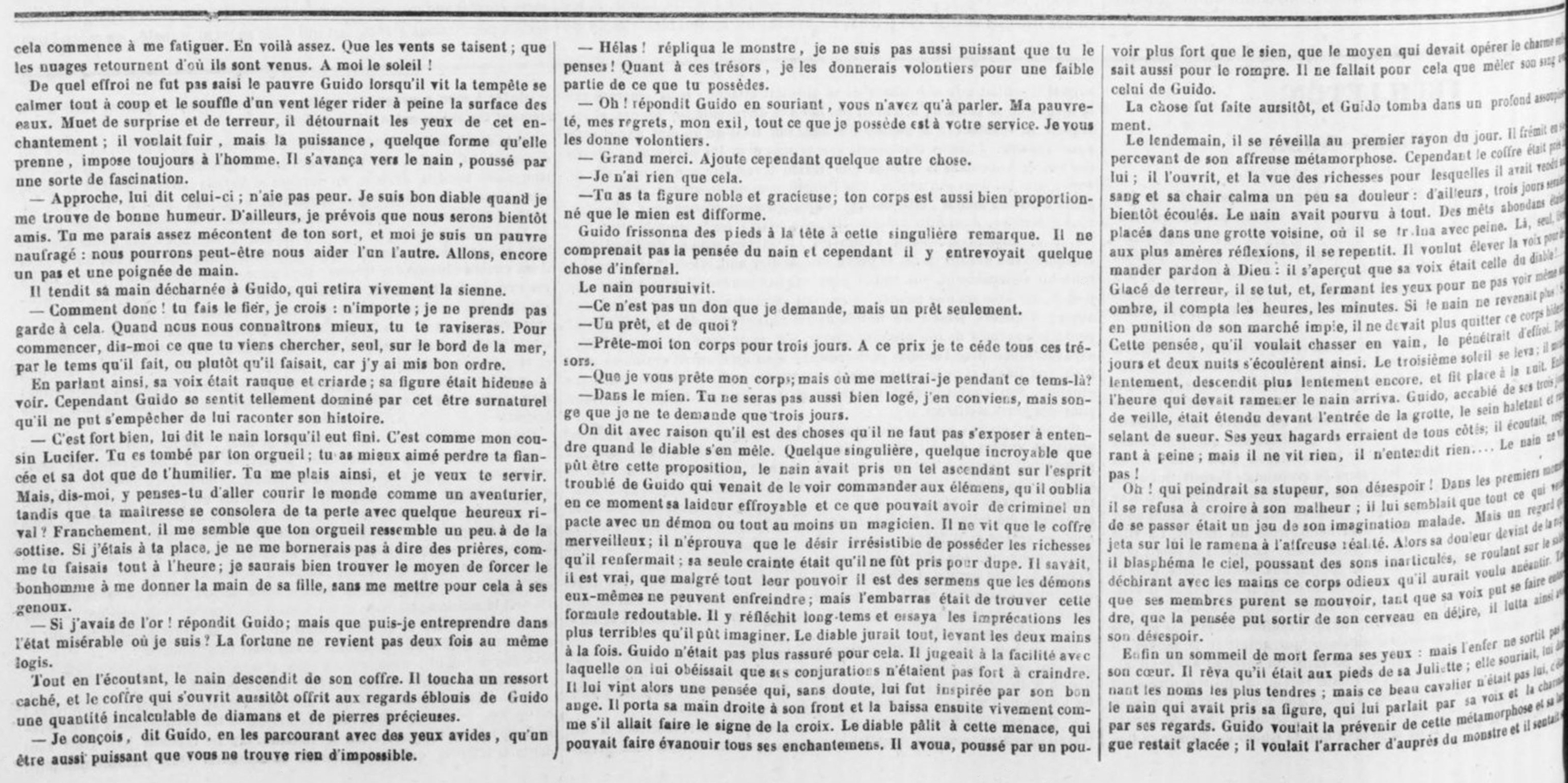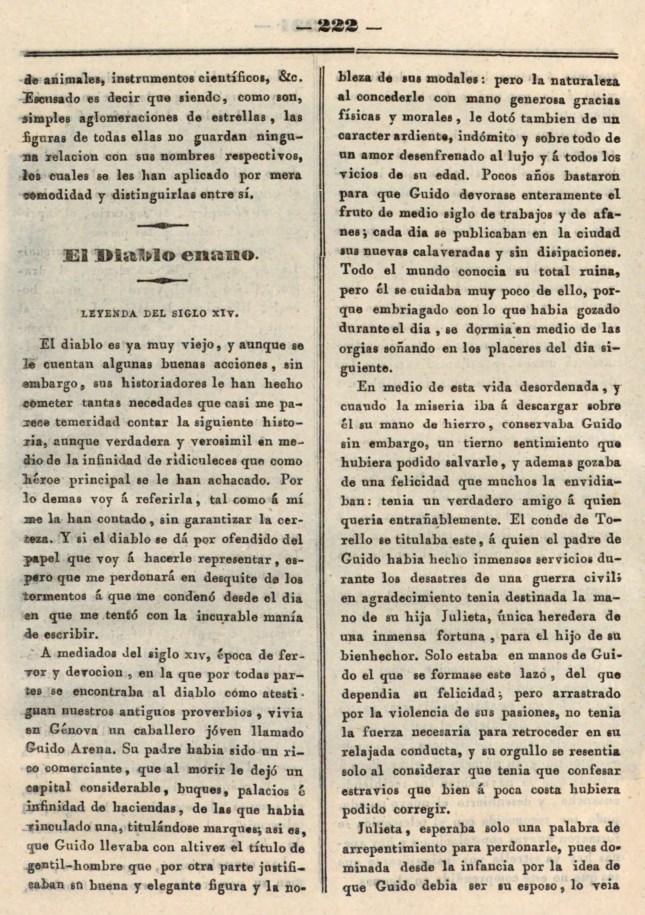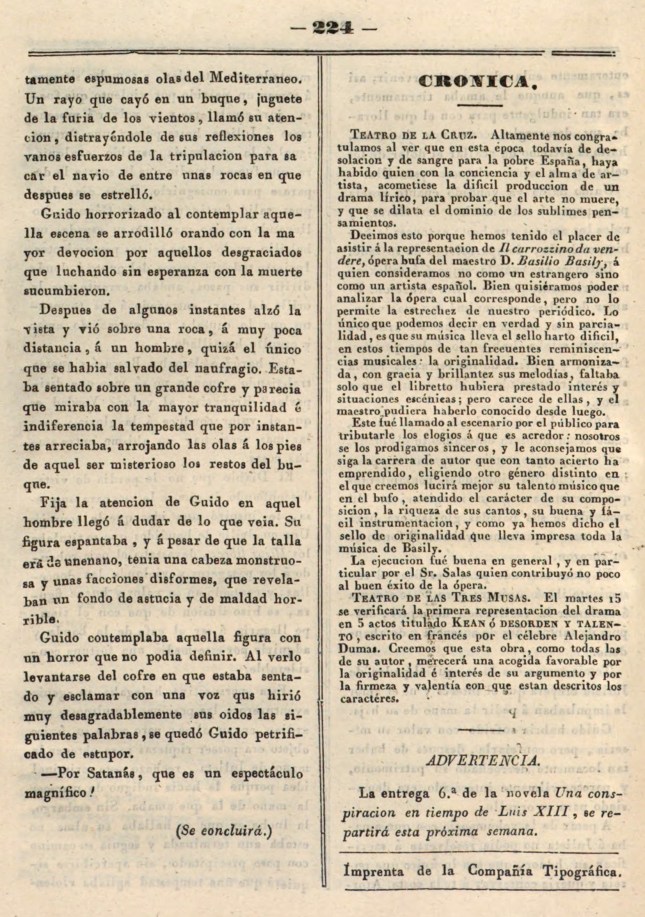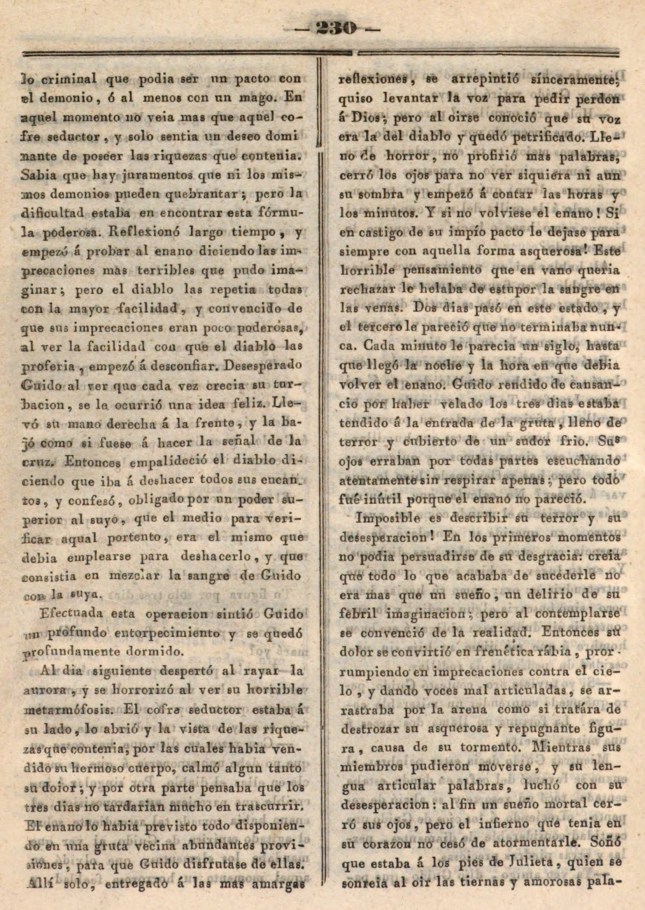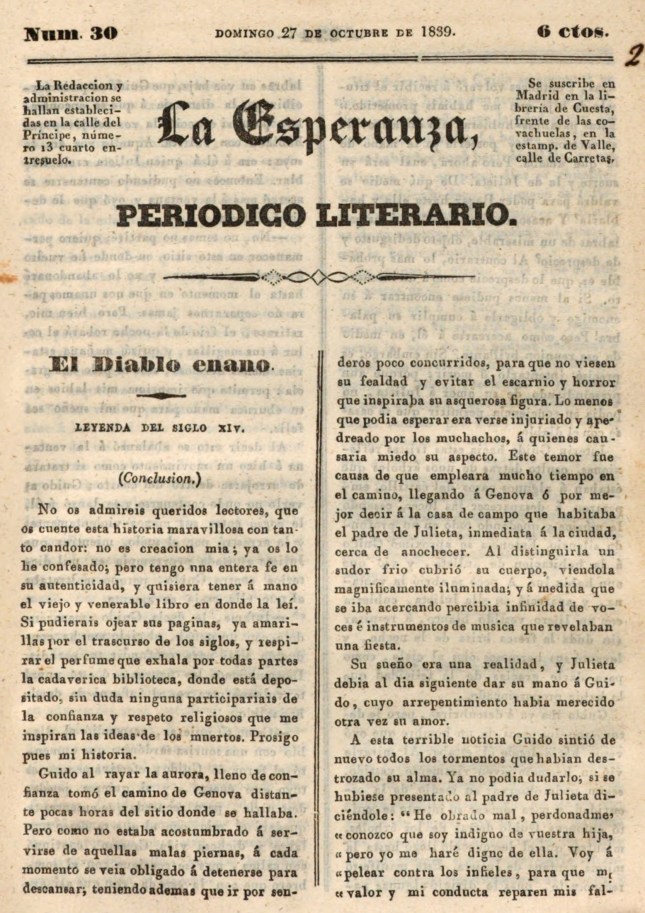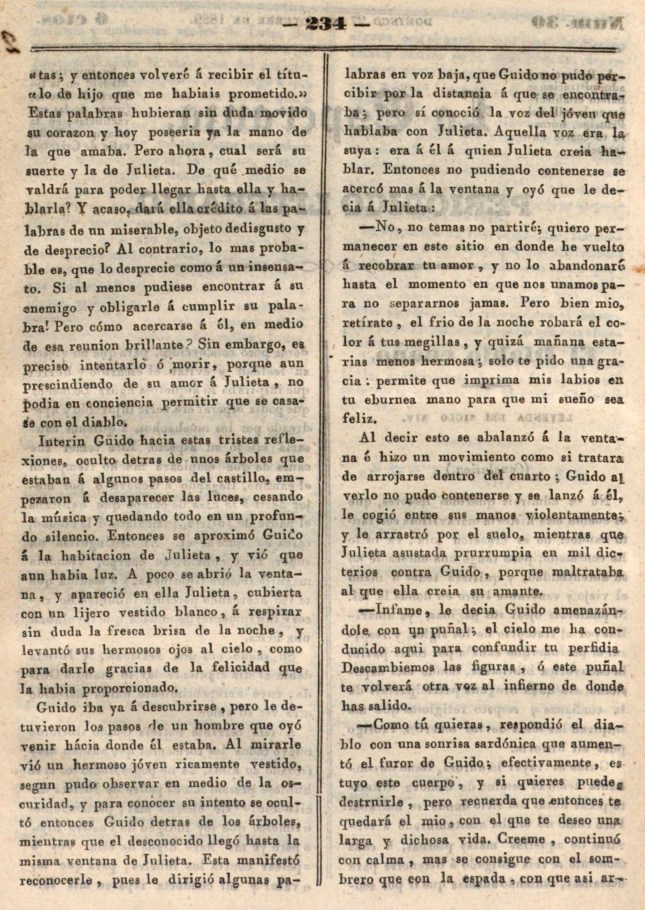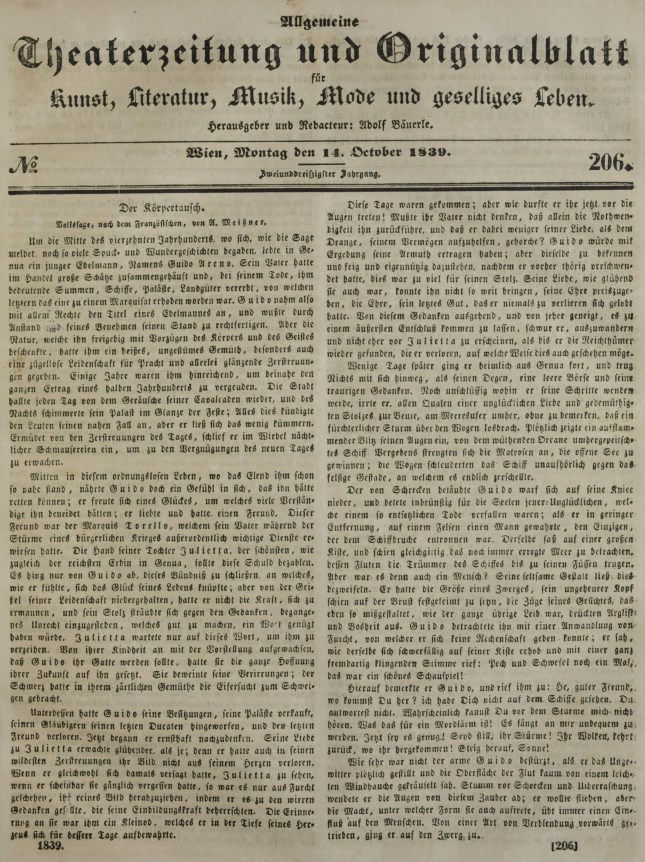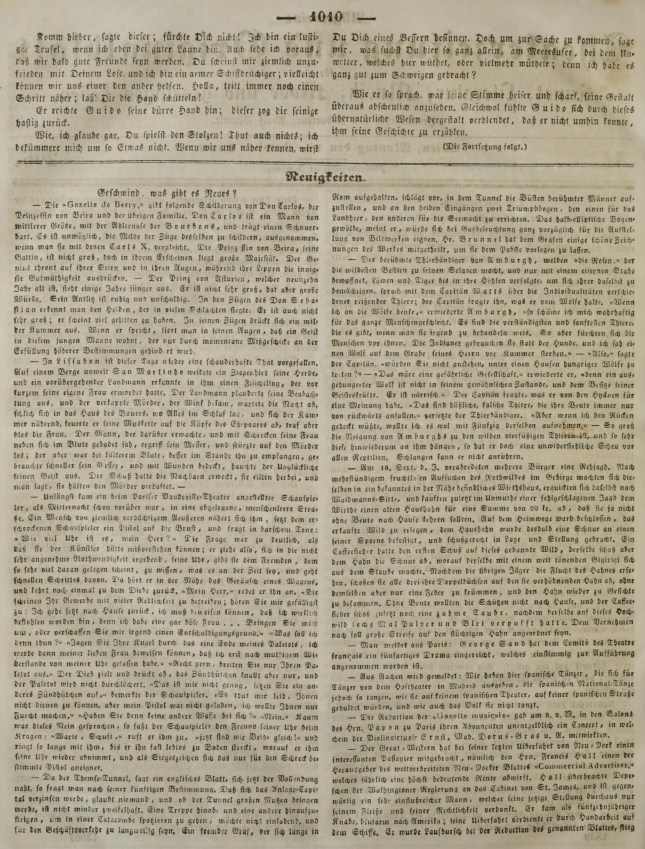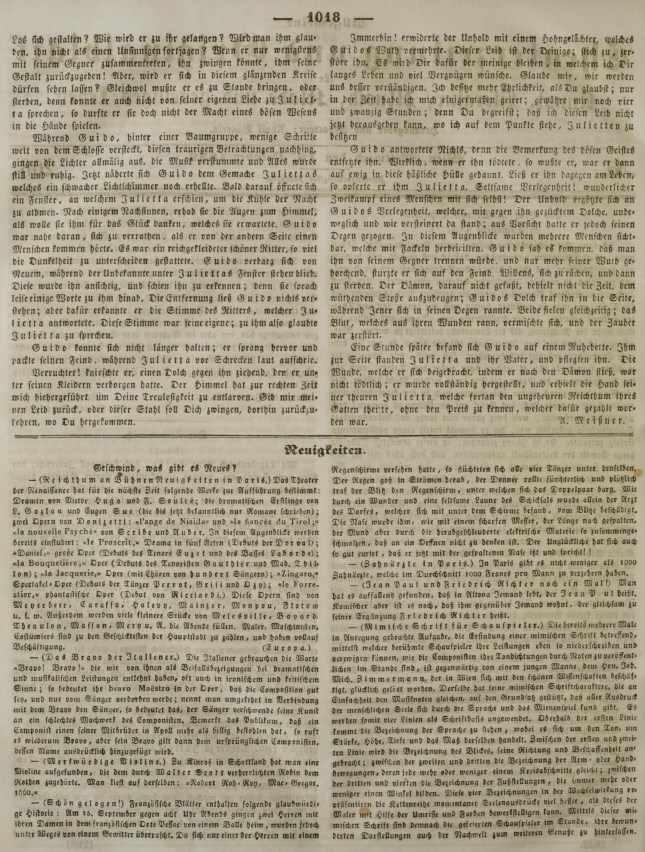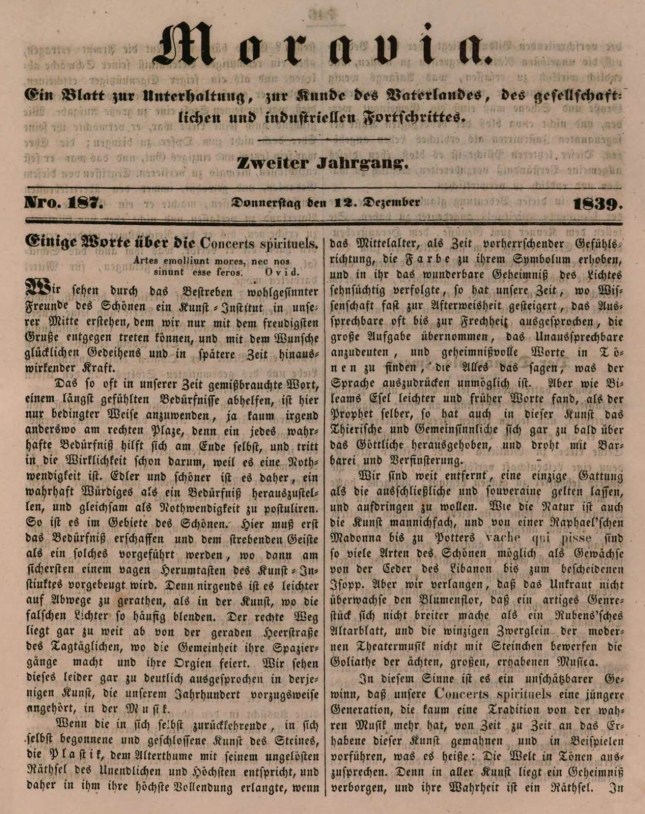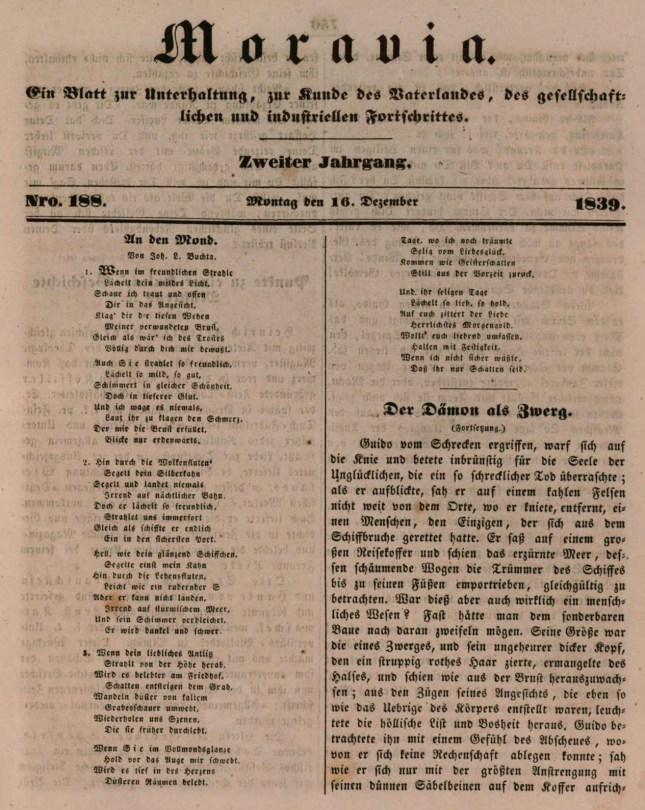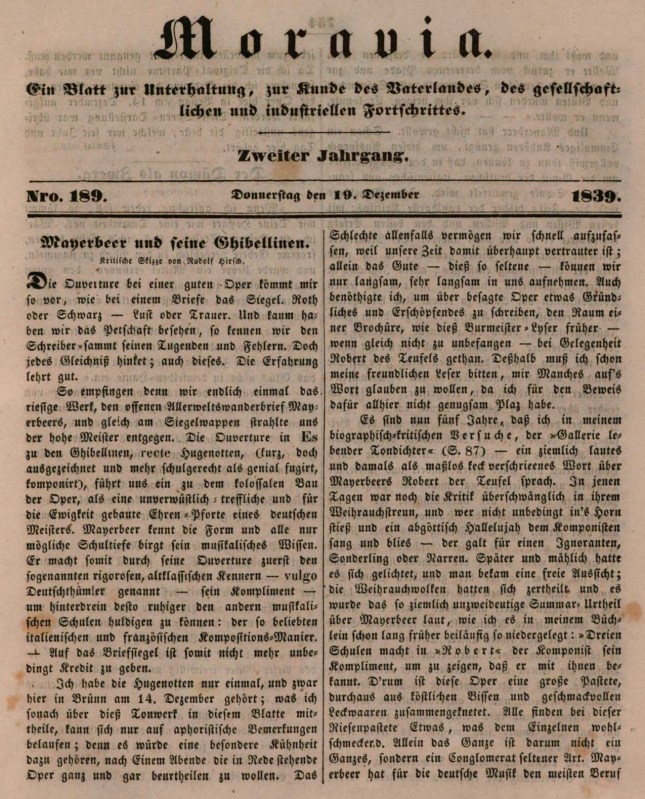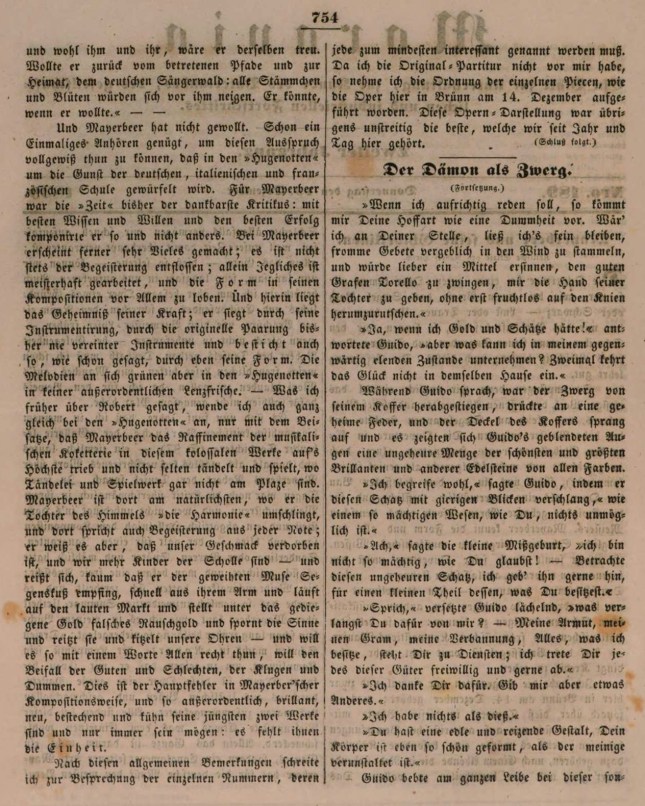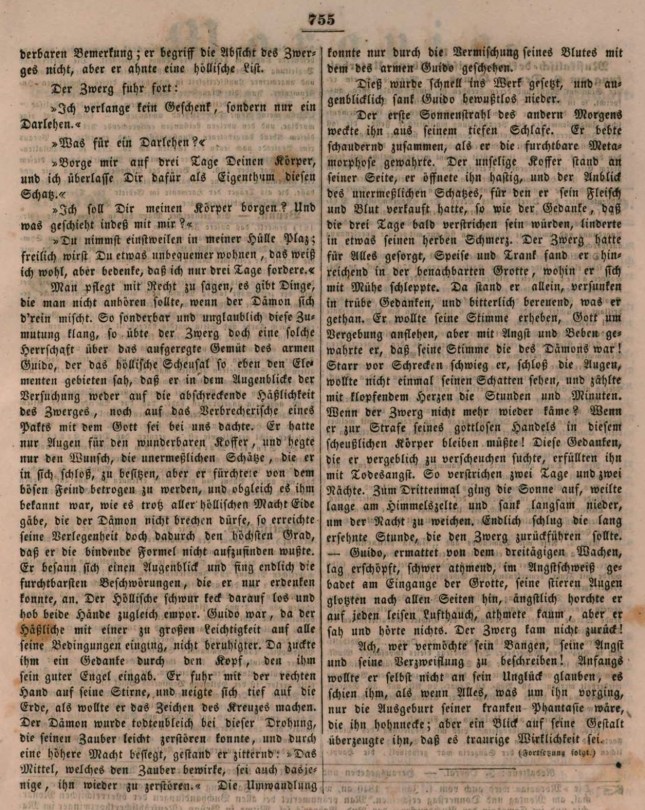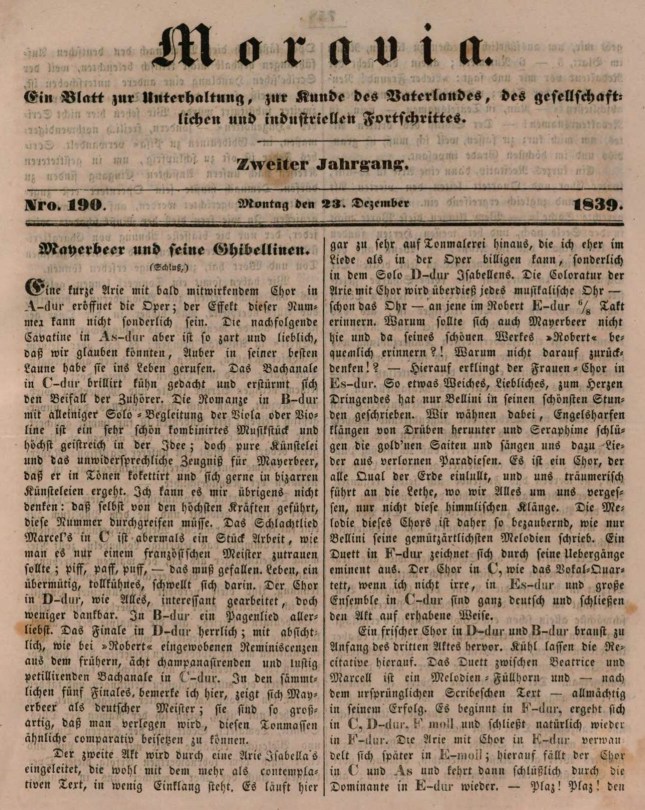« Ne vous étonnez pas, mes chers lecteurs, si je vous raconte avec tant de candeur cette merveilleuse histoire. Je ne l’ai pas inventée, j’en ai fait l’aveu modeste, mais j’ai une foi entière dans son authenticité. Si, comme moi, vous aviez devant les yeux le bouquin vénérable d’où je l’ai tirée, si vous pouviez feuilleter ses pages jaunies par le temps, respirer ce parfum de cadavre de bibliothèque qu’il exhale de toutes parts, vous partageriez ma confiance et mon respect religieux pour la parole des morts. »
Les amateurs de littérature fantastique n’ignorent pas que la nouvelle de Pétrus Borel, « Le Fou du roi de Suède, » parue dans Le Commerce, journal politique et littéraire en 4 livraisons [vingt-huitième année, n° 364 et 365, n° 1 et 2-3, mardi 30 et mercredi 31 décembre 1845, jeudi 1er, vendredi 2-samedi 3 janvier 1846], est un plagiat ou plutôt une réécriture de « Transformation » de Mary Shelley paru dans The Keepsake for MDCCCXXXI, éd. Frederic Mansel Reynolds, Londres : Hurst, Chance, and Co., [1830].
Nous avions déjà eu le plaisir de republier dans Le Visage Vert n° 23, en novembre 2013, la première adaptation française du texte de Shelley par Mme de *** [Troyes], parue sous le titre « L’Échange infernal, » dans le recueil Contes et nouvelles, imités de l’anglais, Paris : Charles Gosselin, 1831, avant d’être reprise trente ans plus tard par Alfred Bonnardot dans L’Abeille impériale, onzième année, n° 4, 5 et 7, 1er et 15 mars, 15 avril 1862.

Or, il se trouve que la nouvelle de Shelley a fait l’objet d’une autre adaptation française, la deuxième en date, qui a connu une indéniable fortune littéraire, puisqu’elle a été reprise dans la presse française à cinq reprises au moins et qu’elle a bénéficié d’autant de traductions en espagnol et en allemand.
En effet, le texte de Mary Shelley, « Transformation, » a également été plagié sous le titre : « Le Diable-Nain, chronique du XIVe siècle, » signé des initiales J. G., dans Le Commerce, le dimanche 1er septembre 1839, soit six ans avant la publication de la version de Pétrus Borel dans le même périodique. Comme pour « L’Échange infernal, » nous ne saurons sans doute jamais si Borel en a eu connaissance, mais cela nous semble peu probable ; ce qui est certain en tout cas, c’est qu’il a établi son adaptation sur le texte original anglais. (1)
–––––
Cette nouvelle adaptation de Shelley n’est cependant pas tout à fait inconnue, au moins des lecteurs hispaniques. Pilar Vega Rodríguez a en effet consacré un intéressant article à une de ses traductions espagnoles : Románticos ingleses en un cuento de « La Esperanza » (1839), que le lecteur pourra lire avec profit sur le site de la Bibliotheca virtual Miguel de Cervantes :
Bien qu’il ait pressenti une source étrangère au conte « El Diablo Enano, » Pilar Vega Rodríguez ignorait qu’il s’agissait à l’origine d’une adaptation française, qui avait également été traduite dans deux autres périodiques espagnols : El Corresponsal, en septembre 1839, et la Revista de teatros, en juillet 1842.
La Porte ouverte est donc particulièrement heureuse de mettre en ligne aujourd’hui ce plagiat non répertorié de Mary Shelley, ainsi que ses différentes traductions espagnoles et allemandes.
MONSIEUR N
–––––
(1) Voir le texte de Petrus Borel et l’excellent article, « Lucius Enius, ou le héros transformé, » que lui a consacré Xavier Legrand-Ferronnière dans Le Visage Vert n° 4, février 1998.
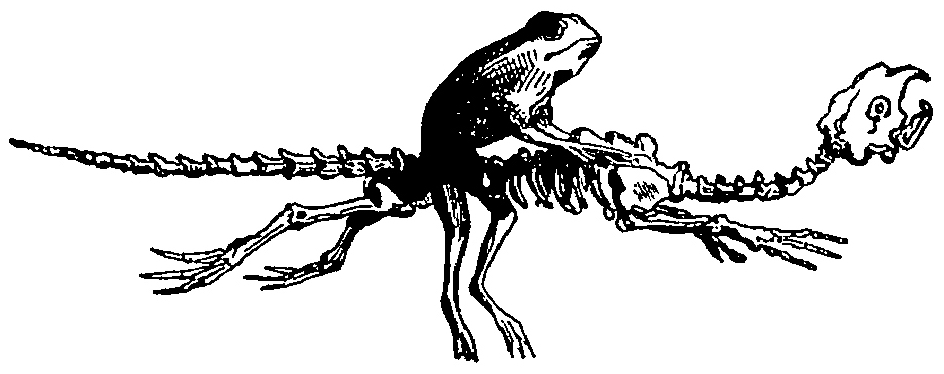
☞ « Le Diable-Nain, » parutions françaises :
– « J. G., » in Le Commerce, feuille politique et littéraire, n° 244, dimanche 1er septembre 1839
– in Psyché, modes, littératures, théâtres et musique, sixième année, n° 276 et 277, jeudis 19 et 26 septembre 1839
– in Le Moniteur parisien, n° 210 et 211, mardi et mercredi 28 et 29 juillet 1840 ; le texte est amputé de deux paragraphes : l’introduction et l’intervention du narrateur, depuis : « Ne vous étonnez pas, mes chers lecteurs… » jusqu’à : « Je poursuis donc… »
– in Journal du Cher, politique, littéraire, industriel ; annonces judiciaires et avis divers, trente-troisième année, n° 98 et 99, mardi 18 et jeudi 20 août 1840 ; idem.
– in L’Aube, journal des intérêts de la Champagne, deuxième année, n° 238, 240 et 242 samedi 10, mardi 13 et jeudi 15 octobre 1840
– in Moniteur industriel, douzième année, nouvelle série, n° 658, dimanche 16 octobre 1842
☞ Traductions espagnoles :
– « El Diablo-Enano, cronica del siglo XIV, » in El Corresponsal, n° 101 et 102, lundi 9 et mardi 10 septembre 1839
– « N. P., » « El Diablo enano, leyenda del siglo XIV, » in La Esparanza, periodico literario, n° 28, 29 et 30, dimanches 13, 20 et 27 octobre 1839
– « El Diablo Emano [sic], Crónica del siglo XIV, » in Revista de teatros, periódico de literatura y artes, deuxième série, tome II, n° 13 et 14, 1842
☞ Traductions allemandes :
– « Der Körpertausch, Volkssage, nach dem Französischen, » [L’Échange de corps, légende populaire, adaptée du français] von A. Meißner, in Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt für Kunst, Literatur, Musik, Mode und geselliges Leben, n° 206, 207 et 208, 14, 15 et 16 octobre 1839
– « Seraphin, » « Der Dämon als Zwerg » [Le Diable-Nain], in Moravia, ein Blatt zur Unterhaltung, zur Kunde des Vaterlandes des gesellschaftlichen und industriellen Fortschrittes, deuxième année, n° 186, 187, 188, 189, 190 et 191, lundi 9, jeudi 12, lundi 16, jeudi 19, lundi 23 et jeudi 26 décembre 1839
_____
_____
LE DIABLE-NAIN, CHRONIQUE DU XIVe SIÈCLE
_____
Le diable est bien vieux, et pour quelques bons tours qu’on cite de lui, les conteurs lui ont fait dire tant de sottises que je me fais presque un scrupule d’ajouter l’histoire véridique que voici aux mille et une sornettes dont il est le héros. Au reste, je la donne comme je l’ai reçue, sans en prendre sur moi la responsabilité. Si le diable se trouve blessé du rôle qu’il y tient, j’espère qu’il voudra bien me le pardonner en retour des tourments auxquels il me condamna le jour où il me souffla dans l’esprit l’incurable manie d’écrire.
Vers le milieu du XIVe siècle, époque de fervente dévotion où le diable se fourrait partout, témoins nos vieux proverbes, vivait dans Gênes-la-Superbe un jeune cavalier nommé Guido Arena. Son père s’était enrichi dans le commerce, et lui avait laissé en mourant des capitaux considérables, des vaisseaux, des palais, des terres dont l’une avait été érigée au marquisat. Aussi Guido prenait-il hautement le titre de gentilhomme, que justifiaient d’ailleurs sa bonne mine et la noblesse de ses manières. Mais la nature, en lui accordant d’une main libérale les grâces du corps et de l’esprit, lui avait donné un caractère ardent, indomptable, surtout un amour effréné du luxe et de toutes les dissipations de son âge. Quelques années lui suffirent pour dévorer presque entièrement le fruit d’un demi-siècle de travail. La ville retentissait chaque jour du bruit de ses cavalcades ; la nuit, son palais resplendissait de l’éclat de ses fêtes. Tout annonçait aux moins clairvoyants sa chute prochaine ; mais il s’en inquiétait peu. Satisfait de sa journée, il s’endormait au bruit de l’orgie en rêvant aux plaisirs du lendemain.
Au milieu de cette vie de désordre, lorsque l’infortune était si près de lui, Guido nourrissait cependant un sentiment qui aurait dû le sauver ; il goûtait aussi un bonheur que beaucoup de sages lui auraient envié : il aimait et avait un ami. Cet ami était le comte Torello, à qui son père avait rendu d’éminents services pendant les orages d’une guerre civile. La main de sa fille, de Juliette, la plus belle comme la plus riche héritière de Gênes, devait acquitter la dette. Il ne dépendait que de Guido de former ce lien auquel il sentait que le bonheur de sa vie était attaché ; mais, emporté par la fougue de sa passion, il n’avait pas la force de revenir sur ses pas, et son orgueil se révoltait à la pensée d’avouer des torts qu’un mot aurait suffi pour réparer. Juliette n’attendait que ce mot pour lui pardonner. Élevée dès son enfance dans la pensée que Guido devait être son époux, elle ne voyait que lui dans son avenir. Elle l’aimait comme un amant ; mais, indulgente dans son amour, elle pleurait ses dérèglement comme ceux d’un frère. La douleur, dans cette âme tendre, avait fait taire la jalousie.
Guido, cependant, avait vendu ses terres, ses palais, distribué à ses créanciers son dernier ducat et perdu son dernier ami. Alors, il commença à réfléchir sérieusement. Son amour pour Juliette se réveilla plus ardent que jamais ; car, avec lui, une passion ne pouvait s’éteindre sans faire place à une autre ; d’ailleurs, jamais au milieu de ses plus grands désordres il n’avait perdu le souvenir de son premier amour. S’il avait cessé de voir Juliette, s’il avait même paru l’oublier entièrement, c’est qu’il aurait craint de profaner son image si pure en la mêlant aux pensées qui maîtrisaient son imagination. Son souvenir était un trésor qu’il gardait au fond de son cœur pour des jours meilleurs.
Ces jours étaient venus ; mais comment se montrer à ses yeux lorsque plusieurs années d’oubli avaient dû lasser son indulgence ? Son père ne penserait-il pas que la nécessité seule le ramenait, qu’il cédait moins à son amour qu’au besoin de relever sa fortune ? Guido aurait supporté avec courage sa pauvreté ; mais en faire l’aveu, et paraître lâchement intéressé après avoir été follement prodigue, c’en était trop pour sa fierté. Son amour, quelque ardent qu’il fût, ne pouvait aller jusqu’à lui faire sacrifier l’honneur, l’honneur, son dernier bien qu’il était résolu de ne jamais perdre. Frappé de cette pensée, et toujours prêt à prendre un parti extrême, il fit le serment de s’expatrier, et de ne reparaître devant Juliette qu’après avoir retrouvé les richesses qu’il avait perdues, quel que fût le moyen que la fortune lui offrît pour cela.
Peu de jours après, il sortit furtivement de Gênes, n’emportant avec lui que son épée, une bourse vide et ses tristes pensées. Incertain encore du lieu où il dirigerait ses pas, il errait sur le bord de la mer, en proie à tous les tourments d’un amour malheureux et de l’orgueil humilié.
« Que vais-je-faire ? se disait-il. Irai-je demander des richesses à un travail opiniâtre, moi qui jusqu’ici n’ai appris qu’à les dissiper ? Me fierai-je plutôt à mon courage ? le courage peut conduire à la gloire ; mais il y a souvent un abîme entre lui et la fortune. »
Ici le Diable, qui ne le perdait pas de vue depuis qu’il le voyait prêt à lui échapper, lui inspira une pensée qui lui fit monter le rouge au front. Une troupe de bandits, décorés du surnom d’Enfants libres, dévastait le pays, faisant rançonner les paysans et mettant à mal les filles de mauvaise volonté. Son courage et sa bonne mine pouvaient le conduire à leur tête et de là à une fortune rapide. Cette perspective souriait à ses goûts aventureux et aux passions tumultueuses qui bouillonnaient dans son âme ; mais il ne voulait obtenir des trésors que pour mériter Juliette ; ne serait-ce pas s’en rendre tout à fait indigne ? Cette réflexion lui fit rejeter une pensée coupable ; cependant, le combat entre le bien et le mal n’était pas encore terminé, et il marchait d’un pas précipité, sans s’apercevoir qu’une tempête affreuse soulevait les flots. Tout à coup, la foudre éclata devant lui, et vint frapper un vaisseau battu par les vents en furie. C’est en vain que les matelots s’efforçaient de gagner la pleine mer ; les vagues repoussaient sans cesse le navire sur les rochers du rivage, contre lesquels il finit par se briser.
Guido, pénétré de terreur, se jeta à genoux, priant dévotement pour l’âme des malheureux qu’une mort si terrible venait de surprendre, lorsqu’il aperçut sur un rocher, à peu de distance de lui, un homme, le seul qui fût échappé à ce naufrage. Il était assis sur un grand coffre, et paraissait regarder avec indifférence la mer, toujours plus agitée, dont les flots portaient jusqu’à ses pieds les débris du vaisseau. Mais est-ce bien un homme ? on pouvait en douter à sa structure étrange. Sa taille était celle d’un nain, sa tête monstrueuse semblait collée à sa poitrine ; les traits de son visage, difformes comme tout le reste de son corps, annonçaient la ruse et la méchanceté. Guido le contemplait avec un sentiment d’horreur dont il ne pouvait se rendre compte ; il le vit se lever péniblement sur le coffre, et s’écrier d’une voix dont le son était indéfinissable :
« Par Belzébuth ! voilà qui est bien ! C’était un fort beau spectacle ! »
Apercevant ensuite Guido qui était resté à genoux :
« Eh ! l’ami, lui dit-il, à quel saint du Paradis adresses-tu tes prières ? est-ce que tu n’es pas assez lavé comme ça de tes péchés ? mais d’où sors-tu donc ? je ne t’ai pas vu sur le vaisseau. Tu ne réponds pas. C’est sans doute la tempête qui t’empêche de m’entendre. Quel vacarme elle fait ! cela commence à me fatiguer. En voilà assez. Que les vents se taisent, que les nuages retournent d’où ils sont venus. À moi le soleil ! »
De quel effroi ne fut pas saisi le pauvre Guido lorsqu’il vit la tempête se calmer tout à coup, et le souffle d’un vent léger rider à peine la surface des eaux. Muet de surprise et de terreur, il détournait les yeux de cet enchantement, il voulait fuir ; mais la puissance, quelque forme qu’elle prenne, impose toujours à l’homme. Il s’avança vers le nain, poussé par une sorte de fascination.
« Approche, lui dit celui-ci, n’aie pas peur ! Je suis bon diable quand je me trouve de bonne humeur. D’ailleurs, je prévois que nous serons bientôt amis. Tu me parais assez mécontent de ton sort, et moi je suis un pauvre naufragé : nous pourrons peut-être nous aider l’un l’autre. Allons, encore un pas et une poignée de main. »
Il tendit sa main décharnée à Guido, qui retira vivement la sienne.
« Comment donc ! tu fais le fier, je crois : n’importe ; je ne prends pas garde à cela. Quand nous nous connaîtrons mieux, tu te raviseras. Pour commencer, dis-moi ce que tu viens chercher, seul, sur le bord de la mer, par le temps qu’il fait, ou plutôt qu’il faisait, car j’y ai mis bon ordre. »
En parlant ainsi, sa voix était rauque et criarde ; sa figure était hideuse à voir. Cependant, Guido se sentit tellement dominé par cet être surnaturel qu’il ne put s’empêcher de lui raconter son histoire.
« C’est fort bien, lui dit le nain lorsqu’il eut fini. C’est comme mon cousin Lucifer. Tu es tombé par ton orgueil ; tu as mieux aimé perdre ta fiancée et sa dot que de t’humilier. Tu me plais ainsi, et je veux te servir. Mais, dis-moi, y penses-tu d’aller courir le monde comme un aventurier, tandis que ta maîtresse se consolera de ta perte avec quelque heureux rival ? Franchement, il me semble que ton orgueil ressemble un peu à de la sottise. Si j’étais à ta place, je ne me bornerais pas à des prières, comme tu faisais tout à l’heure ; je saurais bien trouver le moyen de forcer le bonhomme à me donner la main de sa fille, sans me mettre pour cela à genoux.
– Si j’avais de l’or ! répondit Guido ; mais que puis-je entreprendre dans l’état misérable où je suis ? La fortune ne revient pas deux fois au même logis. »
Tout en l’écoutant, le nain descendit de son coffre. Il toucha un ressort caché, et le coffre qui s’ouvrit aussitôt offrit aux regards éblouis de Guido une quantité incalculable du diamants et de pierres précieuses.
« Je conçois, dit Guido, en les parcourant avec des yeux avides, qu’un être aussi puissant que vous ne trouve rien d’impossible.
– Hélas ! répliqua le monstre, je ne suis pas aussi puissant que tu le penses ! quant à ces trésors, je les donnerais volontiers pour une faible partie de ce que tu possèdes.
– Oh ! répondit Guido en souriant, vous n’avez qu’à parler. Ma pauvreté, mes regrets, mon exil, tout ce que je possède est à votre service. Je vous les donne volontiers.
– Grand merci ! Ajoute cependant quelque autre chose.
– Je n’ai rien que cela.
– Tu as ta figure noble et gracieuse ; ton corps est aussi bien proportionné que le mien est difforme. »
Guido frissonna des pieds à la tête à cette singulière remarque. Il ne comprenait pas la pensée du nain, et cependant il y entrevoyait quelque chose d’infernal.
Le nain poursuivit :
« Ce n’est pas un don que je demande, mais un prêt seulement.
– Un prêt, et de quoi ?
– Prête-moi ton corps pour trois jours. À ce prix, je te cède tous ces trésors.
– Que je vous prête mon corps ; mais où me mettrai-je pendant ce temps-là ?
– Dans le mien. Tu ne sera pas aussi bien logé, j’en conviens ; mais songe que je ne te demande que trois jours. »
On dit avec raison qu’il est des choses qu’il ne faut pas s’exposer à entendre quand le diable s’en mêle. Quelque singulière, quelque incroyable que pût être cette proposition, le nain avait pris un tel ascendant sur l’esprit troublé de Guido, qui venait de le voir commander aux éléments, qu’il oublia en ce moment sa laideur effroyable et ce que pouvait avoir de criminel un pacte avec un démon, ou tout au moins un magicien. Il ne vit que le coffre merveilleux ; il n’éprouva que le désir irrésistible de posséder les richesses qu’il renfermait ; sa seule crainte était qu’il ne fût pris pour dupe. Il savait, il est vrai, que, malgré tout leur pouvoir, il est des serments que les démons eux-mêmes ne peuvent enfreindre ; mais l’embarras était de trouver cette formule redoutable. Il y réfléchit longtemps, et essaya les imprécations les plus terribles qu’il pût imaginer. Le diable jura, tout levant les deux mains à la fois ; Guido n’était pas plus rassuré pour cela ; il jugeait, à la facilité avec laquelle on lui obéissait, que ses conjurations n’étaient pas fort à craindre. Il lui vint alors une pensée qui, sans doute, lui fut inspirée par son bon ange. Il porta sa main droite à son front, et la baissa ensuite vivement comme s’il allait faire le signe de la croix. Le diable pâlit à cette menace, qui pouvait faire évanouir tous ses enchantement. Il avoua, poussé par un pouvoir plus fort que le sien, que le moyen qui devait opérer le charme suffisait aussi pour le rompre. Il ne fallait pour cela que mêler son sang avec celui de Guido.
La chose fut faite aussitôt, et Guido tomba dans un profond assoupissement.
Le lendemain, il se réveilla au premier rayon du jour. Il frémit en s’apercevant de son affreuse métamorphose. Cependant, le coffre était près de lui ; il l’ouvrit, et la vue des richesses pour lesquelles il avait vendu son sang et sa chair calma un peu sa douleur. D’ailleurs, trois jours seraient bientôt écoulés. Le nain avait pourvu à tout. Des mets abondants étaient placés dans une grotte voisine, où il se traîna avec peine. Là, seul, livré aux plus amères réflexions, il se repentit. Il voulut élever la voix pour demander pardon à Dieu ; il s’aperçut que sa voix était celle du diable !… Glacé de terreur, il se tut, et, fermant les yeux pour ne pas voir même son ombre, il compta les heures, les minutes. Le nain ne revenait plus ! Si, en punition de son marché impie, il ne devait plus quitter ce corps hideux ! Cette pensée, qu’il voulait chasser en vain, le pénétrait d’effroi. Deux jours et deux nuits s’écoulèrent ainsi. Le troisième soleil se leva ; il monta lentement, descendit plus lentement encore, et fit place à la nuit. Enfin, l’heure qui devait ramener le nain arriva. Guido, accablé de ses trois jours de veille, était étendu devant l’entrée de la grotte, le sein haletant de sueur. Ses yeux hagards erraient de tous côtés, respirant à peine ; mais il ne vit rien, il n’entendit rien…. Le nain ne vint pas !
Oh ! qui peindrait sa stupeur, son désespoir ! Dans les premiers moments, il se refusa à croire à son malheur ; il lui semblait que tout ce qui venait de se passer était un jeu de son imagination malade. Mais un regard qu’il jeta sur lui le ramena à l’affreuse réalité. Alors, sa douleur devint de la rage ; il blasphéma le ciel, poussant des sons inarticulés, se roulant sur le sable, déchirant avec les mains ce corps odieux qu’il aurait voulu anéantir. Tant que ses membres purent se mouvoir, tant que sa voix put se faire entendre, que la pensée put sortir de son cerveau en délire, il lutta ainsi avec son désespoir.
Enfin, un sommeil de mort ferma ses yeux ; mais l’enfer ne sortit pas de son cœur. Il rêva qu’il était aux pieds de sa Juliette ; elle souriait, lui donnant les noms les plus tendres ; mais ce beau cavalier n’était pas lui, c’était le nain qui avait pris sa figure, qui lui parlait par sa voix et la charmait par ses regards. Guido voulait la prévenir de cette métamorphose, et sa langue restait glacée ; il voulait l’arracher d’auprès du monstre, et il sentait ses pieds attachés à la terre. Il s’éveilla en sursaut, et ne vit autour de lui que les grèves du rivage et la mer sur laquelle se jouaient les derniers rayons du soleil.
« Sans doute, se dit-il, ce rêve est un avertissement du ciel qui m’a pris en pitié. Il m’annonce le malheur qui me menace, et ce que je dois faire. J’irai à Gênes : je romprai le maléfice qui fascine les yeux de Juliette, ou je mourrai à ses pieds. »
Ne vous étonnez pas, mes chers lecteurs, si je vous raconte avec tant de candeur cette merveilleuse histoire. Je ne l’ai pas inventée, j’en ai fait l’aveu modeste, mais j’ai une foi entière dans son authenticité. Si, comme moi, vous aviez devant les yeux le bouquin vénérable d’où je l’ai tirée, si vous pouviez feuilleter ses pages jaunies par le temps, respirer ce parfum de cadavre de bibliothèque qu’il exhale de toutes parts, vous partageriez ma confiance et mon respect religieux pour la parole des morts. Je poursuis donc.
Guido, le cœur rempli de confiance, prit dès le point du jour le chemin de Gênes. Quelques heures devaient suffire pour ce trajet ; mais ses jambes étaient si mal jointes, il était si peu accoutumé à s’en servir, qu’il ne pouvait faire quatre pas sans reprendre haleine. Il lui fallait aussi éviter les lieux habités ; car, outre qu’il était peu agréable pour lui de montrer sa laideur, il n’était pas rassuré sur l’accueil que lui feraient les paysans. Le moins qu’il pouvait attendre, c’était de se voir pourchassé, si ce n’est lapidé, par les enfants que son aspect n’aurait pas mis en fuite. Ce ne fut donc qu’à la nuit qu’il arriva à Gênes, ou plutôt à la maison de campagne que le père de Juliette habitait à peu de distance de la ville. Le cœur faillit lui manquer lorsqu’il la vit brillamment illuminée ; à mesure qu’il approchait, il distinguait les éclats de voix d’une foule joyeuse, et les sons de divers instruments de musique. Tout annonçait une fête : son rêve ne l’avait pas trompé. Juliette devait dès le lendemain épouser son cher Guido, que le repentir avait rendu à son amour.
Guido, à cette affreuse nouvelle, sentit se réveiller toutes ses douleurs. Il ne pouvait en douter maintenant ; s’il avait agi comme le maudit qui lui avait volé sa figure ; s’il s’était présenté au père de Juliette et qu’il lui eût dit : « J’ai eu tort ; pardonnez moi ; je suis indigne de votre fille, mais permettez-moi de la mériter un jour. Je vais servir contre les infidèles ; mon courage et ma bonne conduite répareront mes fautes, et alors je viendrai vous redemander le titre de fils que vous m’aviez promis, » ces paroles l’auraient touché sans doute, et c’est pour lui que retentiraient aujourd’hui ces chants de fête. Maintenant, quel sera son sort et celui de Juliette ? Comment parviendra-t-il jusqu’à elle ? Ajoutera-t-on foi aux paroles d’un misérable objet de dégoût et de mépris ? On le chassera comme un insensé. Si du moins il pouvait rencontrer son ennemi et le forcer à tenir sa parole ! Mais pourra-t-il l’approcher au milieu de cette foule brillante ? Il fallait le tenter cependant ou mourir ; car, sans parler de son amour pour Juliette, il ne pouvait pas, en conscience, lui laisser épouser le diable.
Tandis que Guido faisait ces tristes réflexions, caché derrière une touffe d’arbres à quelques pas du château, les lumières commencèrent à disparaître, la musique cessa de se faire entendre et tout rentra dans le repos. Guido s’approcha alors de l’appartement de Juliette, qu’une faible lueur éclairait encore. Bientôt, une fenêtre s’ouvrit, et Juliette parut, à peine couverte d’un voile léger, pour respirer la brise du soir. Après un moment de rêverie, elle leva ses beaux yeux vers le ciel, comme pour lui rendre grâce du bonheur qui l’attendait. Guido, hors de lui, allait se trahir, lorsqu’il entendit un homme venir de son côté. C’était un cavalier richement vêtu et de bonne mine, autant qu’il en put juger au milieu de l’obscurité. Il se cacha de nouveau, tandis que l’inconnu vint s’arrêter sous la fenêtre de Juliette. Celle-ci l’aperçut et parut le reconnaître, car elle lui adressa quelques paroles à voix basse. L’éloignement où se trouvait Guido l’empêcha de les entendre ; mais il reconnut la voix du cavalier qui répondait à Juliette. Cette voix était la sienne ; c’était à lui que Juliette croyait parler. Alors, ne pouvant se contenir plus longtemps, il s’approcha en silence, et il entendit le cavalier dire à Juliette :
« Non, je ne partirai pas ; je resterai dans ce lieu où mon amour a obtenu grâce devant toi ; j’y attendrai le moment où nous devons nous rejoindre pour ne plus nous quitter. Mais toi, ma bien-aimée, retire-toi ; le froid de la nuit pâlirait tes joues, et demain peut-être tu serais moins belle. Laisse-moi seulement presser de mes lèvres ta blanche main : je dormirai plus doucement. »
En parlant ainsi, il s’approcha de la fenêtre et fit un mouvement comme pour s’élancer dans la chambre. Guido se précipita sur lui et l’entraîna violemment à quelques pas de là, tandis que Juliette poussait des cris d’effroi.
« Infâme ! lui disait-il, en levant sur lui un poignard qu’il avait caché sous ses vêtements. Le ciel m’a conduit ici pour confondre ta perfidie. Rends-moi mon corps, ou ce fer va te faire rentrer dans l’enfer d’où tu es sorti.
– Soit, lui répliqua celui-ci avec un rire moqueur qui redoubla la fureur de Guido. Ce corps est le tien ; frappe, détruis-le. Il te restera le mien, dans lequel je te souhaite longue vie et beaucoup de plaisir. Crois-moi, arrangeons-nous plutôt. J’ai plus de bonne foi que tu ne penses ; seulement je me suis trompé de temps ; accorde-moi encore vingt-quatre heures, la première nuit de mes noces ; après quoi je te cède la place. Je veux connaître, pour mon instruction, les délices qui m’amènent tous les jours tant de tes pareils. C’est une étude physiologique que j’ai besoin de faire. Pour cela, je te rends l’homme le plus riche de ce monde de misères : il me semble que c’est payer généreusement une bonne fortune. »
Guido ne répondit pas à cette impertinente harangue ; mais il fut frappé de la réflexion du diable. En effet, s’il le tuait, il lui fallait garder pour jamais sa hideuse enveloppe. D’un autre côté, s’il le laissait vivre, il perdait Juliette. Étrange perplexité ! singulier duel d’un homme contre lui-même ! Le diable, qui avait arrangé tout cela, aurait été peut-être fort en peine de sortir de ce mauvais pas. Il jouissait de l’embarras de Guido, qui, le poignard levé sur lui, restait immobile et comme pétrifié ; par précaution, cependant, il avait tiré son épée. En ce moment, le bruit de plusieurs personnes qui arrivaient en tumulte avec des flambeaux fit juger à Guido qu’ils allaient être séparés. N’écoutant plus que sa fureur, il se jeta sur son adversaire avec la seule pensée de se venger et de mourir ensuite. Le diable, qui n’avait pas prévu cela, n’eut pas le temps de parer le coup qu’il lui portait ; il reçut dans le flanc le poignard de Guido, tandis que celui-ci s’enferrait de son épée. Tous deux tombèrent à la fois ; le sang qui sortait de leurs blessures se mêla et le charme fut détruit.
Une heure après, Guido se trouvait couché sur un lit, entouré de Juliette et de son père, qui lui prodiguaient leurs soins. La blessure qu’il s’était faite en frappant le diable n’était pas mortelle ; il fut promptement rétabli, et il reçut la main de sa chère Juliette, qui jouit de la miraculeuse fortune de son amant, sans se douter du prix qu’il l’avait payée. Quant au diable, l’auteur du vieux livre d’où j’ai tiré cette histoire ne dit pas ce qu’il devint. Il finit seulement par cette remarque que, pendant sa métamorphose, Guido n’eut pas même la pensée qu’il pût toucher le cœur de Juliette, quoiqu’on perdant sa beauté il eût gardé son amour et les charmes de son esprit. Il tire de là cette impertinente conclusion que, pour plaire aux dames de son temps, les grâces du corps étaient le premier de tous les mérites.
Qu’en pensent les dames d’aujourd’hui ?
J. G.
_____
(« J. G., » in Le Commerce, feuille politique et littéraire, n° 244, dimanche 1er septembre 1839 ; repris en deux livraisons dans Psyché, modes, littératures, théâtres et musique, sixième année, n° 276 et 277, jeudis 19 et 26 septembre 1839 ; dans Le Moniteur parisien, n° 210 et 211, mardi et mercredi 28 et 29 juillet 1840 ; le texte est amputé de deux paragraphes : l’introduction et l’intervention du narrateur, depuis : « Ne vous étonnez pas, mes chers lecteurs… » jusqu’à : « Je poursuis donc… » ; dans le Journal du Cher, politique, littéraire, industriel ; annonces judiciaires et avis divers, trente-troisième année, n° 98 et 99, mardi 18 et jeudi 20 août 1840 ; dans L’Aube, journal des intérêts de la Champagne, deuxième année, n° 238, 240 et 242 samedi 10, mardi 13 et jeudi 15 octobre 1840 ; dans le Moniteur industriel, douzième année, nouvelle série, n° 658, dimanche 16 octobre 1842. Gravure de Gustave Doré, d’après les aventures de Sindbad la Marin)
El DIABLO ENANO
_____
_____
(« El Diablo-Enano, cronica del siglo XIV, » in El Corresponsal, n° 101 et 102, lundi 9 et mardi 10 septembre 1839)
_____
(« N. P., » « El Diablo enano, leyenda del siglo XIV, » in La Esparanza, periodico literario, n° 28, 29 et 30, dimanches 13, 20 et 27 octobre 1839)
_____
(« El Diablo Emano [sic], Crónica del siglo XIV, » in Revista de teatros, periódico de literatura y artes, deuxième série, tome II, n° 13 et 14, juillet 1842)
_____
DER KÖRPERTAUSCH
_____
_____
(« Der Körpertausch, Volkssage, nach dem Französischen, » [L’Échange de corps, légende populaire, adaptée du français] von A. Meißner, in Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt für Kunst, Literatur, Musik, Mode und geselliges Leben, n° 206, 207 et 208, 14, 15 et 16 octobre 1839)
DER DÄMON ALS ZWERG
_____
_____
(« Seraphin, » « Der Dämon als Zwerg » [Le Diable-Nain], in Moravia, ein Blatt zur Unterhaltung, zur Kunde des Vaterlandes des gesellschaftlichen und industriellen Fortschrittes, deuxième année, n° 186, 187, 188, 189, 190 et 191, lundi 9, jeudi 12, lundi 16, jeudi 19, lundi 23 et jeudi 26 décembre 1839)