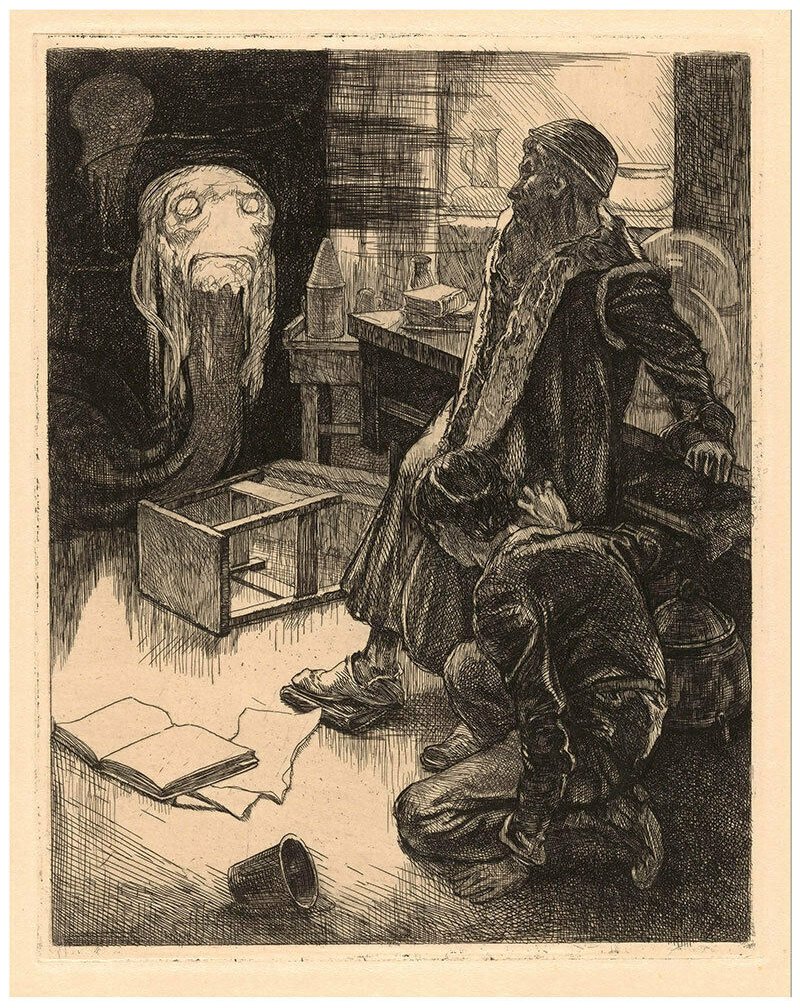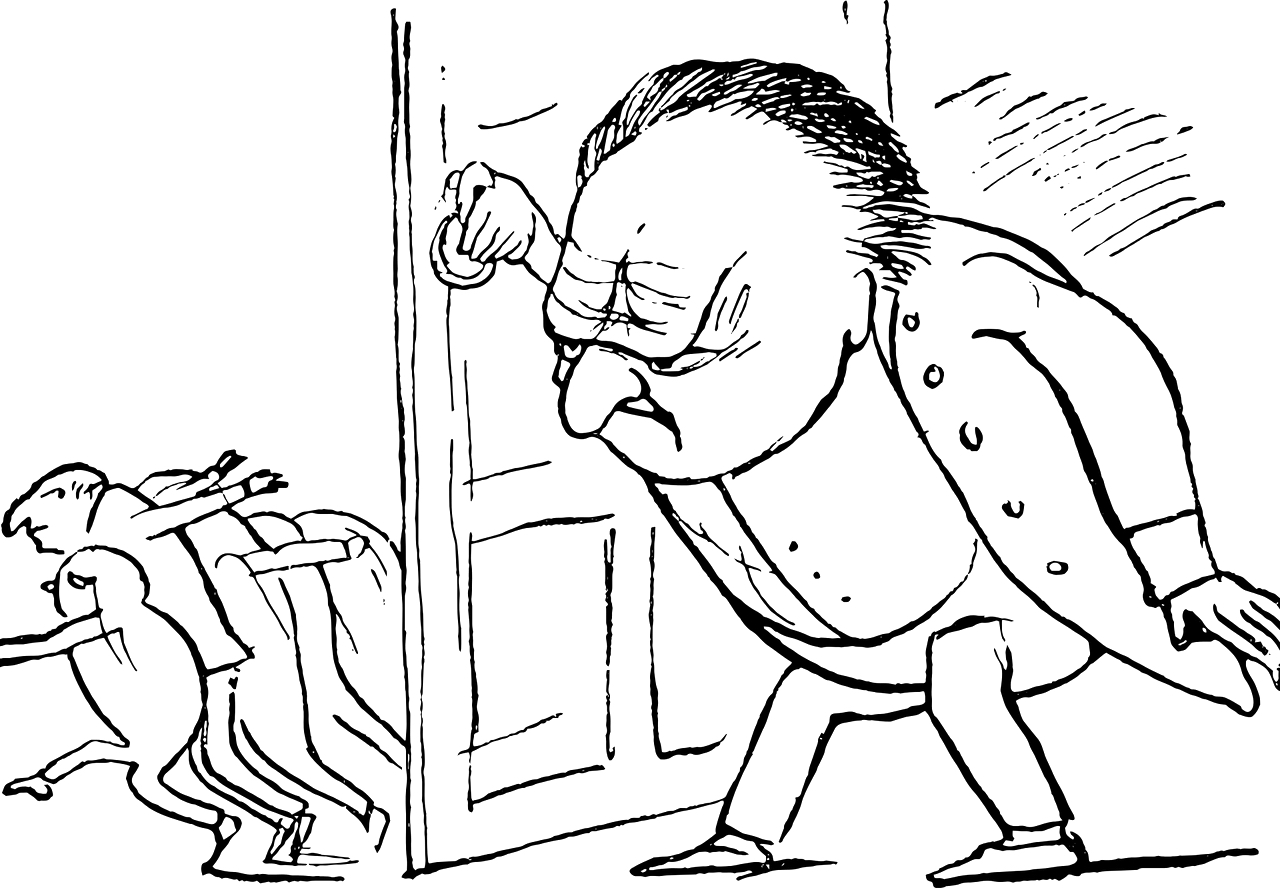« Tous trois se comprenaient parfaitement ! Suivez bien mon raisonnement, monsieur, » poursuivit le docteur en s’animant, puis répétant par trois fois : « Tous trois se comprenaient parfaitement et tous trois comprenaient les paroles de la grande sœur. Je regardai tous les petits enfants qui peuplaient le jardin, ceux-là mêmes qui n’étaient capables que des gazouillements les plus vagues, dont ni vous ni moi nous n’aurions pu deviner le sens, tous, vous m’entendez, tous se comprenaient entre eux, se comprenaient pareillement à mes oiseaux, à mes fourmis, à mes chiens, à mes chats, à mes poissons, à toutes les bêtes. Les grandes personnes étaient moins instruites qu’eux, puisqu’ils avaient la clef de nos discours, tandis que nous ne possédions point la clef des leurs.
Eux, ils possédaient le vrai langage humain, le langage original de l’homme ; nous n’en avions qu’une fermentation, qu’une forme embrouillée, disloquée, alourdie de complications inouïes. Leur vocabulaire devait être susceptible de comparaison avec celui des autres animaux, et quiconque l’aurait compris eût été peut-être sur la trace de la plus curieuse découverte du monde.
Restait à trouver le moyen de constituer ce vocabulaire. J’y songeai fort longtemps, et j’arrivai à imaginer un moyen fort simple en soi :
« Rechercher l’homme à l’état le plus voisin de l’état primitif (qui se puisse trouver), étudier les langues les plus rudimentaires, les comparer, noter les cris des enfants des peuplades les moins civilisées, les comparer aux langages de ces peuplades, puis – si, ce qui était plus que probable, la langue essentielle de l’espèce humaine variait suivant les races, les milieux, les climats, les modes d’alimentation, etc., etc. – chercher des équivalents à chaque type humain dans un type animal. »
Le docteur, tout enfiévré par cette tirade, se tourna vers Christian.
« Comprenez-vous maintenant le fonds de mon système, Christian ? » – Puis s’adressant à moi : « Devinez-vous à peu près ce que je veux dire, monsieur ? »
Je ne sais si c’était le ton du docteur et sa parfaite conviction qui me pénétraient, mais il me semblait comprendre parfaitement. Il s’enfonça alors dans le développement de ce qu’il appelait « la théorie des cris naturels et des cris primitifs, formant la langue réelle des homme, à l’état naturel et vrai » ; il esquissa à grandes lignes les différences qui existaient entre les cris primitifs des différentes races. Par suite de déductions physiologiques et ethnologiques, il appuya ses arguments des remarques les plus curieuses sur l’influence des civilisations et des conquêtes, l’absorption des races les unes par les autres, la force de résistance particulière à certaines races douées de la faculté de surnager, pour ainsi dire, parmi les événements qui avaient inondé d’autres races.
Répéter son discours est au-dessus de mes forces et de ma compétence :
« Celui qui connaîtrait les langues initiales de chaque race et l’histoire des transformations de ces langues pourrait, par un travail d’ethnologie universelle et de philologie, établir la Loi universelle du verbe. Il n’aurait plus alors qu’à traduire en langue vulgaire. »
Comme j’ouvrais de très grands yeux, le docteur crut que je ne le comprenais pas ; il daigna se mettre à ma portée.
« Ce que j’appelle la Loi universelle du verbe, c’est la loi en vertu de laquelle la conformation d’un être animé étant connue, étant connues ses origines et ses transformations et aussi toutes les analogies qu’il présente avec les autres êtres animés, on doit déterminer, en vertu de toutes ces causes, la forme primitive de ce que, pour plus de simplification, j’appellerai sa parole. »
Et le docteur termina, plein de bonne humeur, son discours par un : « Ça n’est pas plus malin que ça ! » qui avait le ton d’une excuse et celui d’une gaminerie. Cette façon plaisante de conclure remit un peu de gaieté dans notre causerie, qui vraiment tournait au grave, au très grave même.
Christian, revenu de cette sorte de vertige que l’étrangeté, l’élévation et l’énormité de la théorie du docteur lui causaient comme à moi-même, poussa cette exclamation :
« Et votre Charlotte, Rosenijed mon ami ? et votre Charlotte ?
– Ah bien ! elle était loin, ma Charlotte, quand j’eus ébauché la première esquisse de mon système. Je continuais à aller au jardin public, mais alors je n’avais plus aucun doute sur le sentiment qui n’y amenait. Je venais pour mes fourmis, mes oiseaux, mes abeilles, ma petite ménagerie, en un mot ; et, dans ma ménagerie, ce qui m’intéressait le plus, c’était les petits enfants.
Un jour, hélas ! je m’aperçus que le petit frère de ma Dulcinée articulait des mots ; la petite sœur, quoique plus jeune, le comprenait parfaitement, et bientôt elle sut même échanger des propos avec lui. En pensant que c’était sans doute ma Charlotte qui corrompait ainsi ces petits êtres si utiles à mes observations, j’eus une rage naïve et profonde et je fus pris d’un réel dégoût pour cette fille. Je fus d’autant plut violemment dépité que, même dans cette transformation du verbe naturel et invariable en un idiome de convention (absolument mobile suivant l’éducation), il y avait un élément de découvertes le plus intéressant, le plus substantiel, le plus concluant du monde. Le trait d’union entre les deux langages, les formes diverses de la transition de chacun à chacun, les combinaisons de celui-ci avec celui-là, devaient, l’un étant connu, révéler les éléments de l’autre ; mais les deux petits diables étaient si vigoureusement poussés par leur institutrice qu’ils faisaient les progrès les plus déplorablement rapides. Toutes les complications de notre jargon national leurs furent bientôt familières.
J’essayai de faire des observations analogues sur d’autres marmots, mais partout je me vis contrecarré par des mères, des sœurs, des nourrices, des gouvernantes et le reste. J’en demeurai navré. Il n’était pas pour moi d’injures assez grossières pour qualifier ces mégères. Quand je songe aujourd’hui encore à ces colères d’autrefois, j’en ai comme un écho, qui me résonne au fond du cœur. Ah ! les coquines ! » criait le docteur, comme pour se soulager du poids de sa vieille rancune.
À cette exclamation, Christian ne put tenir son sérieux, et moi, je me mordais les lèvres jusqu’à les faire saigner. Le docteur, voyant Christian rire, en fit autant, et moi, voyant le docteur, je l’imitai. C’était plaisir de le voir rire ; les accès de gaieté étaient chose rare dans sa vie, et l’on voyait qu’il en jouissait avec un laisser-aller enfantin et charmant, et, bien que ce bon grand rire de moine, d’athlète et de philosophe, ne soit pour rien dans le récit de la journée que je passai près du savant, je m’y arrête, en dépit de moi-même, comme à l’un de mes bons souvenirs. C’était quelque chose comme le rire d’un grand-père qui raconte quelque bonne grosse malice bête d’un de ses petits-enfants.
« Savez-vous, continua Rosenijed, savez-vous par qui j’ai été sauvé de la misanthropie dans laquelle toutes ces femelles m’auraient fatalement fait tomber ? Non ! Eh bien, ce fut par une bande de Samoïèdes, échoués je ne sais comment dans nos parages. Quels braves gens ! ils avaient le vocabulaire le plus pauvre, les conjugaisons les plus indigentes, les déclinaisons les plus misérables, les constructions de phrases les plus rudimentaires. Ils avaient des chiens et des rennes qu’ils traitaient comme s’ils eussent été leurs pareils. Tout cela vivait ensemble et se ressemblait. Je me pris d’affection pour eux, je ne les quittai plus ; ils campèrent ici, j’allai camper en leur compagnie, et lorsqu’ils partirent nous étions des amis inséparables, à ce point que je les suivis, et c’est avec eux que je fis les premières études d’une science que nos élèves appellent, dites-vous, la sauvageologie. Nos élèves ne savent que la moitié de la vérité. Ce n’est pas seulement la sauvageologie, c’est encore la puéro-sauvageologie. Dites-leur bien qu’ils se trompent et qu’ils aient à rectifier leurs plaisanteries. En matière scientifique, une plaisanterie, elle-même, doit être exacte. Pour suivre leur mode d’étymologie par à peu près, c’est sauvageo-puéro-sauvageologie comparée qu’ils devraient appeler ma science.
Mais revenons-en à nos Samoïèdes. Je les suivis durant quatre mois, pendant lesquels j’errai parmi les Kirghis, les Ostiaks et les Samoïèdes. Vous comprendrez facilement que mon retour à la maison paternelle fut salué de la façon la plus éclatante. Mon père, chimiste éminent mais peu fantaisiste, après avoir trouvé plus que bizarre ma cohabitation avec ces sauvages polaires, lorsqu’ils étaient ici, était entré dans une grande fureur en apprenant que je m’étais enfui en leur compagnie ; aussi, le jour où je revins, je n’eus pas même le temps d’ouvrir la porte de son laboratoire avant que sa voix me criât : « Sortez d’ici, vagabond ! ne reparaissez plus devant mes yeux, insensé ! »
Pour la première fois l’idée de l’inconvenance de ma fuite m’apparaissait nettement ; je n’y avais pas songé jusque-là. J’avais trouvé tout naturel de faire n’importe quoi pour l’amour de la science. J’allais expliquer mon cas à mon père, et j’étais si fier des premières découvertes que je rapportais de mon voyage, qu’il me semblait qu’il serait trop heureux de m’écouter et s’enorgueillirait d’avoir un fils tel que moi. Je fus vite détrompé.
Comme je m’avançais pour l’embrasser, mon père fit un bond vers moi ; les bras étendus, il me saisit par les deux épaules, me fit pirouetter sur mes talons et, en même temps, je sentis l’empreinte de son soulier se manifester sur le fond d’un superbe pantalon de peau de phoque, taillé à la dernière mode yakoustk, et avec lequel je circulais fort naturellement depuis plus de quinze jours à travers la Scandinavie civilisée, comme si c’eût été un inexprimable anglais ou un Dusautoy authentique.
Ce que mon père venait de me dire ainsi, je ne me le fis pas dire une seconde fois, et j’allai chercher un asile chez des voisins compatissants. »
(À suivre)
–––––
(Maurice Dreyfous, in Le Moniteur universel, n°88, vendredi 30 mars 1877 ; « Twee Mannen en een Monster in een Werkkamer » [Deux Hommes et un monstre dans un atelier], estampe de Johannes Josephus Aarts ; illustration d’Edward Lear pour A Book of Nonsense, 1846)