Au grand dîner que donnait ce soir-là, à l’occasion de son retour à Paris, le richissime Américain Norbert Partridge, il n’était question que de l’épouvantable série des naufrages qui, depuis quelque temps, décimaient les paquebots de toute nationalité, naviguant dans les mers australes.
Après la guerre, le trafic maritime entre les États-Unis et l’Australie avait pris un essor formidable.
De San Francisco pour Melbourne et de Melbourne pour San Francisco, les départs de navires, naguère très espacés, étaient devenus quotidiens. Le temps n’était pas éloigné où l’activité de cette ligne serait comparable aux relations transatlantiques entre New-York, la France et l’Angleterre.
Or, depuis quelques mois, les sinistres maritimes s’étaient multipliés dans des proportions qui rappelaient les pires périodes des torpillages boches.
Chose singulière, c’était dans la même région de l’Océan, c’est-à-dire entre l’île Norfolk et l’archipel de Cook, que ces naufrages répétés se produisaient avec une terrible fréquence.
Rien que dans le courant du mois précédent, deux grands paquebots de la Pacific Star Line, véritables villes flottantes de construction allemande, le Selenos et le Cosmic, internés à San Francisco durant la neutralité américaine, puis passés sous le pavillon de l’Union, avaient péri corps et biens entre l’archipel de Cook et l’île Norfolk.
Ensuite, ç’avait été le cargo hollandais Zuyderzee ; puis deux grands vapeurs anglais, le Warwick et le City of Bristol ; puis deux autres steamers britanniques de plus faible tonnage, le King-Harry et l’Uranus ; un italien, le Carlo-Alberto ; et, enfin, l’un des plus beaux spécimens de la flotte américaine de commerce, le superbe Californian, que ses aménagements, caractérisés par un luxe inouï, avaient fait surnommer « le bateau des milliardaires. »
Si l’on avait connu les circonstances de ces multiples naufrages, répartis sur une période de trente jours et qui s’étaient tous produits sur le même secteur de la même ligne de navigation, on n’aurait pu que déplorer une pareille accumulation de catastrophes maritimes, plaindre les victimes, les armateurs et les compagnies d’assurances. Or, ces naufrages étaient inexpliqués et inexplicables.
Les services météorologiques n’avaient signalé aucune tempête dans la région océanienne en question. Pas de brumes persistantes non plus. Bref, aucun phénomène auquel attribuer un naufrage en pleine mer ou une collision.
Tous les navires disparus, partis normalement, soit de Melbourne, soit de San Francisco, avaient été signalés aux environs de l’île Norfolk ou de l’archipel de Cook, et ils n’étaient pas arrivés à destination. Voilà tout ce que l’on savait…
Trois d’entre eux seulement avaient lancé par télégraphie sans fil le signal de détresse : S. O. S. Un seul, le Californian, avait fait suivre ce signal de l’indication approximative de sa position en mer ; mais lorsqu’un vapeur suédois, le Balticus, touché par le message, était arrivé sur le lieu du sinistre, il n’avait trouvé que quelques menues épaves impossibles à identifier et pas un survivant. Or, il faisait un temps splendide.
Autre particularité étrange : dans cette même région de l’Océan et dans la même période, pas un seul voilier ne fut mentionné comme perdu.
Tous les naufrages concernaient exclusivement des vapeurs, et même surtout des vapeurs pourvus des derniers perfectionnements.
C’était à croire qu’un pirate allemand, ayant réussi à conserver une base secrète dans une des innombrables îles océaniennes, continuait, par-delà la guerre terminée, sa besogne meurtrière.
Telle fut bien, d’ailleurs, l’hypothèse à laquelle s’arrêtèrent les autorités maritimes internationales ; mais les investigations de police faites à terre, de même que les croisières spéciales ordonnées à deux navires de guerre, un anglais et un américain, ne donnèrent aucun résultat. Or, trois semaines s’étaient écoulées depuis l’inexplicable naufrage du Californian, le dernier en date des bâtiments perdus en mer entre l’île Norfolk et l’archipel de Cook, et nul autre sinistre analogue n’avait plus été enregistré sur ce que les journaux du monde entier appelaient « le secteur fatal. »
Pourtant, aussi bien en Europe qu’en Amérique et ailleurs, le public continuait à se passionner pour ce mystère tragique, sans précédent dans les annales de la navigation.
Et l’élite de la société parisienne et étrangère qui se trouvait réunie ce soir-là dans le somptueux hôtel que l’Américain Norbert Partridge possédait sur l’avenue du Bois de Boulogne, avait un motif tout particulier pour s’intéresser au « secteur fatal » : le maître du logis, en effet, qui venait d’arriver d’Australie à bord de son célèbre yacht l’Œdipe, avait, tout au début de la terrible période des naufrages précités, effectué sans encombre la traversée de Melbourne à San Francisco.
De là, Partridge avait gagné New-York par le chemin de fer et le Havre par un transatlantique.
Entre trente-cinq et cinquante ans, grand, maigre, osseux, les traits énergiques, l’expression impénétrable, les yeux d’une vivacité singulière, Norbert Partridge était une physionomie inoubliable, un de ces êtres qui s’imposent à première vue, qui ont le prestige, qui ont la force.
Cet Américain, qui était venu se fixer à Paris pendant la guerre, avait créé et subventionné nombre d’œuvres avec une générosité qui lui avait tôt valu la réputation d’un grand philanthrope.
Son train de maison décelait une fortune énorme. Pourtant, Norbert Partridge n’était roi ni de la margarine, ni des pâtes alimentaires, ni de l’acier bruni. Mais on le disait intéressé dans de vastes entreprises très variées.
Grand voyageur, il décidait parfois de la façon la plus soudaine l’appareillage de l’Œdipe pour une croisière aux antipodes ; telle la randonnée qu’il venait d’effectuer dans les mers australes.
Comme on servait le café dans le merveilleux jardin d’hiver de l’hôtel, Norbert Partridge, qui, jusqu’alors, avait évité de donner formellement son opinion sur l’énigme des naufrages du « secteur fatal, » préférant induire ses invités à formuler la leur, fut sollicité par le professeur Beaumesnil, membre de l’Académie des sciences et spécialiste de l’océanographie, de dire clairement toute sa pensée.
L’Américain réfléchit un instant, puis :
« Je pense, prononça-t-il, qu’aucune des hypothèses qui ont été raisonnablement émises ne doit être rejetée a priori. Le sous-marin allemand persistant à opérer en temps de paix n’est pas invraisemblable, malgré le résultat négatif de l’enquête officielle. Plausible aussi, la rencontre de mines flottantes dont se serait débarrassé dans cette région lointaine un corsaire allemand dans le genre du Mœwe. Et je crois encore du domaine des possibilités des accidents de bord telle qu’une soudaine et forte explosion déterminant le naufrage en moins de cinq minutes. Pas impossible non plus, le fait d’un bâtiment s’écartant de sa route normale et allant heurter des brisants insuffisamment repérés sur ses cartes, auquel cas on apprendra dans quelques mois que la mer a rejeté des épaves révélatrices sur quelque archipel où il passe un ou deux navire par an.
– Tout cela serait fort bien, dit quelqu’un, s’il s’agissait d’un seul naufrage. Mais songez qu’à ne considérer que le mois passé, nous sommes en présence de neuf sinistres inexpliqués.
– Assurément, répondit tranquillement Norbert Partridge. Mais je n’ai pas dit qu’il faille s’en tenir à une seule des hypothèses émises. Ces naufrages ont pu être causés, les uns par le sous-marin dont j’admets l’existence, un autre – et même deux ou trois – par les mines ; et il nous reste encore au moins deux hypothèses à appliquer au restant. »
Les auditeurs ne semblaient pas convaincus.
Le lieutenant de vaisseau Henri Rochenave, technicien naval émérite attaché au cabinet du ministre de la Marine, résuma le sentiment général en disant :
« Il y a certainement autre chose que les suppositions émises jusqu’ici.
– Je ne demande pas mieux que de l’admettre, fit l’Américain en fixant sur l’officier de marine un regard d’une étrange intensité, mais quoi ?… Avez-vous une solution originale à proposer, monsieur Rochenave ?
– Je veux seulement vous demander, monsieur Partridge, à vous qui revenez directement d’Océanie, si vous ne jugeriez pas absurde l’explication que voici… L’origine volcanique de nombreuses terres océaniennes est avérée. Eh ! bien, imaginez un cataclysme, ou plutôt une série de cataclysmes volcaniques se produisant au fond de l’Océan, c’est-à-dire dans le sous-sol du continent submergé qui constitue le fond de la mer… Ce tremblement de terre sous-marin – je continue à supposer – entraîne un bouleversement titanique. Il y a des creusements et des soulèvements formidables, et leur configuration est telle qu’il se produit un vidage partiel de la mer en un point déterminé… L’eau, trouvant une issue soudaine, se précipite dans une crevasse nouvellement ouverte et il s’ensuit, à la surface, la formation d’un ou de plusieurs tourbillons énormes, successifs ou simultanés, en tout cas si puissants que le paquebot, surpris par leur irrésistible giration, est entraîné au fond, tel un simple nageur… »
Cette théorie du lieutenant de vaisseau Henri Rochenave eut le don d’impressionner fortement toute l’assistance, les savants comme les profanes.
Norbert Partridge, qui n’était certainement pas le moins intéressé par cette hypothèse ingénieuse et plausible, dit à l’officier :
« Comment se fait-il, monsieur Rochenave, que vous n’ayez pas produit plus tôt une explication aussi judicieuse ?… De toute manière, votre théorie jette sur cette troublante et douloureuse énigme un jour nouveau…
– Si je n’ai pas parlé plus tôt, répondit Rochenave, c’est tout simplement parce que cette idée, à laquelle vous voulez bien attribuer quelque intérêt, je viens à peine de la concevoir… Et je m’empresse d’ajouter que cette idée ne saurait avoir une importance réelle que si elle était vérifiée par des investigations et des expériences scientifiquement menées sur place… Or, une telle vérification exigerait qu’on organisât une expédition coûteuse et périlleuse… Les hommes de cœur ne manqueraient pas à une telle entreprise, mais les millions… Les gouvernements ne délient pas facilement les cordons de leur bourse pour des tentatives de cet ordre. Au reste, la France n’est pas directement intéressée, puisque, jusqu’à ce jour, aucun navire battant notre pavillon n’a sombré sur le « secteur fatal »… Il est vrai que ce n’est pas une raison pour qu’un Français ne tente pas l’aventure…
– Je suis persuadé que vous la tenteriez, vous, monsieur Rochenave, énonça Norbert Partridge.
– Pourquoi pas ? fit l’officier. Mais il ne saurait en être question, puisqu’il n’y a pas apparence qu’on m’en fournisse jamais les moyens… »
À ce moment, un familier de la maison, qui n’avait pas assisté au dîner, entra en coup de vent dans le salon. C’était le directeur de l’édition européenne d’un grand journal de New-York, John Warrings, ami personnel de Partridge.
John Warrings tenait un télégramme à la main.
Sans s’attarder aux formules de politesse :
« Voici, Partridge, dit-il, la chose qui m’a empêché d’être des vôtres à dîner… Quand vous aurez lu, vous comprendrez…. »
Et il mit sous les yeux de son compatriote le télégramme, qui était ainsi conçu :
« Nouveau navire perdu corps et biens sur « secteur fatal, » aussi inexplicablement que précédents. C’est un vapeur français, la Saintonge. »
Norbert Partridge s’empressa, naturellement, de donner lecture de cette dépêche à ses invités.
Un cri d’angoisse en accueillit le dernier mot, et tout le monde regarda celui qui l’avait poussé.
C’était le lieutenant de vaisseau Rochenave, qui, devenu soudain livide, se soutenait à peine.
« Qu’avez-vous, monsieur Rochenave ? questionnèrent Partridge et quelques autres.
– Vous avez bien dit la Saintonge ?… balbutia l’officier.
– Lisez vous-même…
– C’est mon frère, Jacques Rochenave, qui commande la Saintonge… »
Le premier moment de stupeur passé, Norbert Partridge dit à Henri Rochenave, qui, domptant sa douleur, s’était ressaisi avec la stoïque énergie du marin :
« Au moment où Warrings a apporté sa dépêche, j’allais vous offrir, monsieur Rochenave, de faire les frais d’une expédition ayant pour objet de découvrir la vérité, la vérité scientifique, sur les causes des naufrages du « secteur fatal »… Puis-je encore vous faire cette offre ?
– Tantôt, répondit l’officier, je l’aurais acceptée avec joie… À présent, je l’accepte le cœur tordu par la douleur… Mais la passion que je mettrai à arracher à la mer le secret de la mort de mon malheureux frère est une garantie au moins égale à l’ardeur du chercheur désintéressé… »
Il y avait, parmi les invités de Norbert Partridge, une personne qui ressentait presque aussi douloureusement que lui-même le coup qui avait frappé Henri Rochenave : c’était Mlle Blanche Beaumesnil, la fille du savant océanographe.
Blanche et Henri s’aimaient. Mais ce dont ni l’officier ni la jeune fille ne se doutaient, c’est que Norbert Partridge avait jeté les yeux sur Blanche ; d’autant plus violemment épris qu’il n’avait jamais manifesté son sentiment, il avait décidé qu’elle serait sa femme.
Moins de deux mois après le dîner offert par Norbert Partridge, le steamer qu’il avait affrété pour rechercher la vérité sur les sinistres du « secteur fatal » – navire dont il avait confié le commandement à Henri Rochenave – approchait de la région océanienne où avaient sombré si énigmatiquement tant de navires, y compris la Saintonge.
C’est dire que pas une minute n’avait été perdue dans l’organisation de cette expédition, puisqu’il faut plus d’un mois aux meilleurs marcheurs, parmi les paquebots, pour aller de Marseille à Melbourne.
Donc, après une courte escale à Nouméa, l’Hamadryade – c’était le nom du bâtiment commandé par Henri Rochenave – mettait le cap sur la région redoutable.
Depuis la disparition de la Saintonge, les naufrages s’étaient considérablement raréfiés sur le « secteur fatal. » On en comptait tout juste trois. Et encore, ils avaient coïncidé avec une effroyable tempête, qui, n’eût été la tragique réputation de la contrée maritime où ils s’étaient produits, eût suffi à les expliquer.
Il est vrai que cette raréfaction des naufrages pouvait être due au fait que la plupart des paquebots préféraient désormais faire un long détour et perdre plusieurs journées, plutôt que d’emprunter le trajet maléficieux.
Au vrai, le « secteur fatal » était devenu le secteur où l’on ne naviguait plus…
Pour bien se rendre compte de ce qui va suivre, il convient de ne pas perdre de vue quelques précisions essentielles. Les seules données que possédât Henri Rochenave, c’étaient : 1° la position approximative du Californian au moment du naufrage, soit 9° 28’ 15” de latitude sud et 170° 17’ 25” de longitude ouest ; 2° la position approximative de la Saintonge à l’instant où elle avait sombré, soit 9° 27’ 17” de latitude sud et 170° 18’ 20” de longitude ouest.
Seuls, en effet, de tous les navires mystérieusement coulés sur le « secteur fatal, » ces deux bâtiments en perdition avaient pu faire suivre leur appel de détresse par T. S. F. de l’indication de leur point.
Mais, si sommaires que fussent de telles données, elles n’en présentaient pas moins une concordance impressionnante, qui devait circonscrire étroitement le champ des investigations.
Le point du Californian et le point de la Saintonge, rapprochés, signifiaient que les deux navires avaient coulé à quelques milles l’un de l’autre.
Autant dire que si l’hypothèse d’Henri Rochenave était la bonne, s’il était vrai que les naufrages fussent dus à la formation d’un tourbillon consécutif à un cataclysme sous-marin d’origine sismique, le centre – ou tout au moins l’un des centres – de ce cataclysme, se trouvait fort exactement repéré.
Dans son impatience d’agir, le commandant de l’Hamadryade aurait voulu piquer directement sur le point tragique ; mais la plus élémentaire prudence lui conseillait de ne pas risquer son navire, sans avoir mis de son côté le maximum de chances de réussite.
Aussi bien, Henri Rochenave avait-il résolu de procéder méthodiquement.
Les terres les plus rapprochées des points géographiques où se situaient les naufrages du Californian et de la Saintonge étaient deux groupes d’îlots sans nom officiel, ou, du moins, qui ne portaient pas le même nom sur toutes les cartes marines. Les unes désignaient cet archipel minuscule sous la dénomination de : « les Sept Îles » ; d’autres les appelaient « l’archipel 7 » ; une carte américaine les portait sous cette mention : « les îles du Bracelet » ; un cartographe londonien les avait bibliquement baptisées : « les sept Chandeliers de l’Apocalypse »…
Politiquement, « les Sept Îles » – adoptons le vocable le plus simple – étaient revendiquées par l’Angleterre, par la France et par la Hollande. Mais il est à croire qu’aucun des trois gouvernements n’attachait une importance capitale à sa revendication. Le conflit demeurait à l’état de fiction diplomatique depuis des années. Il est juste d’ajouter que « les Sept Îles » ne comportaient aucun établissement colonial, maritime ou commercial d’aucune sorte. Elles appartenaient à cette catégorie de terres océaniennes où aucun navire n’aborde jamais, qui n’ont même pas l’importance géographique et maritime d’un récif réputé dangereux.
Henri Rochenave décida de faire des « Sept Îles » sa base d’opérations.
L’Hamadryade devait trouver un mouillage suffisant dans une anse nettement creusée au flanc du plus important des sept îlots. Au reste, la saison était favorable. Depuis Nouméa, le navire voguait sur une mer excellente.
Mis à part les sentiments douloureux qui le faisaient se replier sur lui-même, Henri Rochenave était peu communicatif, lorsqu’il commandait en premier. Prêt à assumer seul toutes les responsabilités, il était peu enclin à mettre d’avance ses subordonnés dans la confidence de ses résolutions.
L’Hamadryade n’était plus qu’à une journée de navigation de l’archipel des « Sept Îles, » lorsque le commandant réunit son état-major dans le carré des officiers pour lui communiquer ses décisions.
Bâtiment très résistant, remarquable marcheur, l’Hamadryade, qui, pendant la guerre, avait rendu de signalés services comme croiseur auxiliaire français, était de faible tonnage. Aussi bien, ce valeureux petit navire comportait-il un équipage peu nombreux et, outre le capitaine, le médecin et le commissaire du bord, cinq officiers seulement : le second, trois lieutenants et le chef mécanicien.
Henri Rochenave avait naturellement choisi son personnel lui-même, et avec le plus grand soin. Un seul, parmi les officiers, n’était pas connu de lui depuis longtemps : le premier lieutenant, un Américain du nom de Grollyson, qui lui avait été recommandé par Norbert Partridge comme ayant servi avec distinction à bord de son yacht l’Œdipe.
Le commandant de l’Hamadryade avait d’autant mieux accueilli Grollyson, présenté par son généreux armateur, que cet officier avait beaucoup navigué dans les mers australes.
Devant ses auditeurs attentifs, Henri Rochenave révéla et développa son plan qui consistait essentiellement en ceci : 1° s’établir dans l’archipel des « Sept Îles » ; 2° explorer la zone des naufrages en aéroplane : ne s’aventurer sur cette zone, soit avec l’Hamadryade, soit avec une embarcation spécialement armée en vue de sondages scientifiques et d’explorations sous-marines, qu’après avoir approfondi les résultats de l’exploration aérienne.
L’exposé de ce plan ne laissa pas de provoquer quelque surprise de la part des officiers, car, sauf le second, tous ignoraient qu’il y eût un avion à bord ; mais cette surprise ne préjudiciait pas à l’admirative approbation de l’état-major. La méthode adoptée par Henri Rochenave valait, en effet, autant par la logique que par l’ingéniosité.
Seul, Grollyson ne parut pas partager le sentiment de ses camarades ; et, sans se soucier de les froisser, il demanda au commandant un entretien particulier, afin de lui soumettre certaines objections.
Henri Rochenave, ayant accédé à son désir, fut frappé de l’attitude étrange du premier lieutenant, qui semblait réprimer avec peine les éclats d’une nervosité proche de l’exaspération.
« Mon commandant, dit-il, je m’excuse de vous dire que votre plan est impraticable et qu’il est de toute urgence que vous y renonciez…
– Plaît-il ? fit Rochenave, en fronçant les sourcils.
– Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas aller aux « Sept Îles »…
– Monsieur Grollyson, j’admets les observations intelligentes, mais non pas les suggestions impératives. Je vous donne deux minutes pour formuler convenablement votre pensée, puis vous irez reprendre votre service…. »
Grollyson se lança dans une harangue assez confuse par laquelle il essayait de démontrer qu’aborder aux « Sept Îles, » c’était vouloir la perte de l’Hamadryade, cet archipel étant abondant en brisants.
Pourtant, Rochenave ne fut pas convaincu et, comme le quart de Grollyson allait précisément commencer, il lui renouvela expressément l’ordre de maintenir la direction du navire sur les « Sept Îles. »
La nuit venait. L’Hamadryade serait certainement en vue du minuscule archipel le lendemain dans le courant de l’après-midi.
Or, durant son quart, Grollyson, désobéissant au capitaine, prit sur lui de modifier la direction de l’Hamadryade, de manière à l’éloigner considérablement de sa route. Bien plus, lorsqu’il passa le service au second lieutenant, il lui dit froidement que la modification prescrite à l’homme de barre avait été ordonnée par le commandant lui-même.
Henri Rochenave, qui dormait mal, ayant eu l’idée de faire une inspection nocturne pendant le quart du second lieutenant, découvrit vite ce qui s’était passé. Il fit prendre à Grollyson les arrêts de rigueur et l’Hamadryade navigua de nouveau droit sur les « Sept Îles. »
Le commandant, toutefois, demeura assez troublé par cet acte d’insubordination qu’un soudain dérangement des facultés mentales de Grollyson pouvait seul expliquer, encore que le médecin du bord ne trouvât pas au premier lieutenant les allures d’un fou.
« Terre par tribord avant ! » signala la vigie vers trois heures du soir.
Le point avait été fait à midi. Nul doute possible. C’étaient bien les « Sept Îles » qui venaient d’apparaître au-dessus de l’horizon.
En dépit de ce qu’avait dit Grollyson, le mouillage de l’Hamadryade dans l’anse repérée par Henri Rochenave s’effectua sans difficulté.
Des embarcations furent envoyées à terre. Les « Sept Îles » ne mentaient pas à leur réputation. La présence de l’homme ne s’y décelait nulle part. Pourtant, la végétation était opulente et le gibier pullulait. C’étaient sans doute des bêtes qui avaient tracé les sentes menant aux nombreuses sources vives, dont l’eau exquise fit les délices de l’équipage de l’Hamadryade.
Sans perdre un instant, Henri Rochenave fit édifier, en un point judicieusement choisi de l’îlot principal, des baraquements, dont le plus grand devait être le garage et l’atelier de montage de l’avion, avec lequel le commandant lui-même, habile pilote aviateur, se proposait d’explorer le « secteur fatal. »
Deux jours et deux nuits s’étaient passés sans incidents. Les travaux ordonnés par Henri Rochenave avançaient normalement, lorsque, dans la matinée du troisième jour, un matelot provençal nommé Maximin Trespidou, qui avait beaucoup braconné dans sa jeunesse et dont les talents cynégétiques pourvoyaient la table de l’équipage de nombreuses et succulentes pièces de gibier, prit à part le commandant pour lui dire :
« Ce matin, à l’aube, mon commandant, en pourchassant une bestiole dans les fourrés qui coiffent le sommet de l’îlot d’en face, j’ai fait une drôle de découverte…
– Quoi donc ? demanda brusquement Rochenave.
– Je me suis trouvé en présence d’une espèce d’entrée de caverne qui ne m’a point paru être l’œuvre de la nature…
– La caverne ?
– Non, l’entrée… Elle avait été visiblement agrandie à coups de pic… Et même, je ne serais pas étonné si on avait fait jouer la dynamite en cet endroit…
– Cela me paraît bien invraisemblable, mon brave Trespidou !
– Hé ! j’ai rencontré plus invraisemblable encore en pénétrant dans cette caverne, ou, du moins, dans ce qui en est comme qui dirait le vestibule… Car cette caverne m’a tout l’air d’un couloir extrêmement long…
– Ça, Trespidou, c’est moins invraisemblable… Ces îlots étant d’origine volcanique, ils peuvent fort bien être troués comme un pain de fromage de gruyère…
– Mais ce n’est pas tout, mon commandant… De ce « vestibule, » j’ai entendu des bruits extraordinaires… comme des grondements lointains, et des coups sourds frappés à intervalles réguliers…
– C’est très probablement le bruit des vagues qui est parvenu à ton oreille, altéré par les cornets acoustiques que forment les excavations et les couloirs de la roche…
– Mon commandant, je suis sûr que ce serait intéressant pour vous d’y aller faire un tour.
– Eh ! bien, nous irons demain, car aujourd’hui, j’ai mieux à faire… Oui, dans une heure, l’avion sera prêt, et je ne veux pas retarder d’une minute ma première exploration aérienne… »
De fait, une heure plus tard, le biplan triplace apporté jusqu’aux « Sept Îles » par l’Hamadryade prenait son vol au-dessus d’une mer merveilleusement calme et pointait vers le « secteur fatal. »
L’avion avait à bord Henri Rochenave, un quartier-maître qui avait servi dans l’aviation navale et le chef mécanicien, homme remarquablement instruit, capable plus que tout autre de seconder le commandant dans ses observations.
L’Hamadryade était munie d’un poste de télégraphie sans fil ; mais ce n’était point par ce poste que le navire devait demeurer en communication avec les aviateurs ; pour cela, il y avait le téléphone sans fil, installé au garage-atelier.
Il s’était écoulé environ une heure depuis que l’avion s’était envolé vers la pleine mer, lorsque le poste de télégraphe sans fil de l’Hamadryade, muet depuis bien avant le mouillage du navire aux « Sept Îles, » enregistra un message S. O. S., un message de détresse lancé par un navire en perdition au large. Mais ce message fut interrompu avant que le nom du navire en danger eût pu être complètement transmis.
Le matelot télégraphiste avait à peine avisé l’officier de quart de la réception de ce message inachevé, que le poste de téléphone sans fil du garage-atelier entendait la voix d’Henri Rochenave prononcer ces mots :
« Nous avons assisté à un spectacle effroyable… un naufrage inouï. Nous revenons pour prendre les dispositions qui s’imposent… »
L’avion fut bientôt de retour.
Henri Rochenave et ses deux compagnons avaient vu, de leurs yeux vu, un vapeur naviguant sur une mer à peine ridée par une faible houle, s’enfoncer soudains dans l’eau et disparaître en moins d’une minute.
Or, aucun phénomène physique visible n’avait précédé cette disparition aussi inexplicable pour ses témoins oculaires que le serait, plus tard, pour le public, le même fait narré par les journaux. Il n’y avait eu ni tourbillon attribuable à un cataclysme sous-marin, ni explosion à bord du bateau…. La mer calme avait tranquillement et instantanément englouti sa proie…
L’émotion provoquée parmi les hommes de l’équipage de l’Hamadryade, aussi bien à bord qu’à terre, était à son comble, lorsqu’un incident, qui pouvait paraître de minime importance en comparaison, fut porté à la connaissance d’Henri Rochenave, par un matelot effaré : le premier lieutenant Grollyson, maintenu aux arrêts de rigueur, n’était plus dans sa cabine, et toutes les recherches faites pour le retrouver étaient demeurées vaines.
Le commandant était bien trop ému par ce qu’il venait de voir, bien trop préoccupé par la détermination à prendre, pour ne pas négliger momentanément la fugue de l’officier puni, lequel d’ailleurs, ne pouvait être allé très loin.
Il venait donc de renvoyer le matelot, quand Maximin Trespidou parut devant lui, les vêtements en désordre, l’air égaré.
« Mon commandant, fit-il, haletant, je m’en doutais bien… Il y a du monde dans la caverne, et le lieutenant Grollyson s’est échappé pour rejoindre ces gens-là… Je l’ai suivi… »
Quelques jours après les événements qui viennent d’être rapportés, les journaux du monde entier publiaient la dépêche suivante, communiquée par le ministère français de la Marine :
« La cause des sinistres maritimes multiples et inexpliqués désignés dans la presse sous l’appellation de « naufrages du secteur fatal » a été découverte par l’expédition spéciale du lieutenant de vaisseau Henri Rochenave, attaché au cabinet de ministre de la Marine et mis en congé sur sa demande.
Si cet officier n’avait fourni des preuves irréfutables à l’appui de son rapport, on aurait peine à croire à une malfaisance aussi savante que celle révélée par ses investigations.
Dans une immense cavité naturelle, creusée au centre d’un des îlots dénommés « l’archipel des Sept Îles, » avait été installée secrètement une usine électrique, mue par un dispositif utilisant ingénieusement la force des marées.
Cette usine actionnait plusieurs gigantesques électro-aimants immergés au fond de l’Océan.
Un navire passait-il dans le champ d’attraction de ces engins ? Il suffisait de leur envoyer un courant suffisant et le bateau, irrésistiblement happé, était attiré au fond de la mer.
Un voilier, construit en bois, était indemne. Un vapeur, tout fer et acier, coulait inéluctablement.
Les navires ainsi envoyés par le fond étaient méthodiquement dépouillés de tous les objets précieux et valeurs quelconques qui se trouvaient à bord par des équipes de scaphandriers qu’un sous-marin amenait à pied d’œuvre.
On se trouve ici en présence d’une organisation formidable de naufrageurs scientifiques. Des documents saisis dans leur repaire souterrain par le lieutenant de vaisseau Henri Rochenave, il résulte que cette organisation était appelée à créer sur d’autres points du globe des établissements analogues à celui des « Septs Îles. »
Les naufrageurs usaient de procédés d’une ingéniosité diabolique pour visiter les épaves immergées et détruire sous l’eau les corps des naufragés.
En explorant à son tour, dans le submersible des naufrageurs réduits à merci, la nécropole sous-marine constituée par les épaves des navires coulés au moyen des électro-aimants, le lieutenant de vaisseau Henri Rochenave n’a pas retrouvé la dépouille de son frère, Jacques Rochenave, qui commandait le vapeur Saintonge.
L’odieuse équipe des naufrageurs, comprenant une vingtaine d’individus, tous spécialistes et techniciens de première force, a été amenée à Nouméa sous bonne escorte. »
Ce que le communiqué du ministère de la Marine ne disait pas, mais ce que les journaux publièrent bientôt, d’après leurs propres sources d’information, c’est que les naufrageurs des « Sept Îles » opéraient pour le compte de Norbert Partridge, qui n’était pas américain, mais allemand.
Privé par la paix des subsides princiers qu’en échange de son activité occulte, lui fournissait la direction du service secret de Berlin, Partridge, de son vrai nom Hans Luft, avait imaginé de se créer des ressources opulentes en industrialisant scientifiquement les naufrages.
En affrétant l’Hamadryade sous le commandement d’Henri Rochenave, Hans Luft l’envoyait tout simplement à une mort certaine. Et Grollyson avait mission de mener la victime droit au piège.
Le plan d’opérations du commandant avait bouleversé cette machination criminelle.
Si les choses s’étaient passées conformément aux intentions de Partridge, l’Hamadryade eût coulé aussi inexplicablement que les autres, mais Grollyson se fût sauvé à temps.
Partridge, qui s’était posé en mécène, se serait ainsi débarrassé fort élégamment de son rival et eût peut-être épousé Blanche Beaumesnil. Au lieu de cela, il fut condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Blanche devint Mme Henri Rochenave.
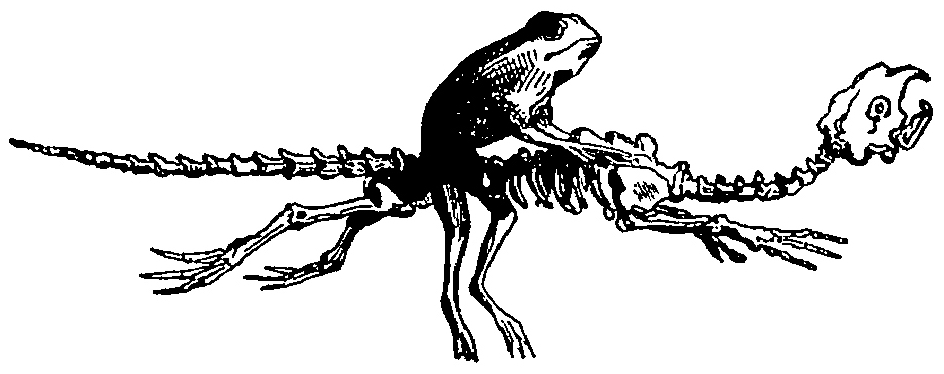
–––––
(Gabriel Bernard, « Contes du Journal de Vichy, » in Journal de Vichy, journal des baigneurs, soixante-dix-neuvième année, lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 mai 1924. Illustration de Harry Heusser, extraite de l’ouvrage de Donald Macintyre et Basil W. Bathe, Les Navires de combat à travers les âges)

