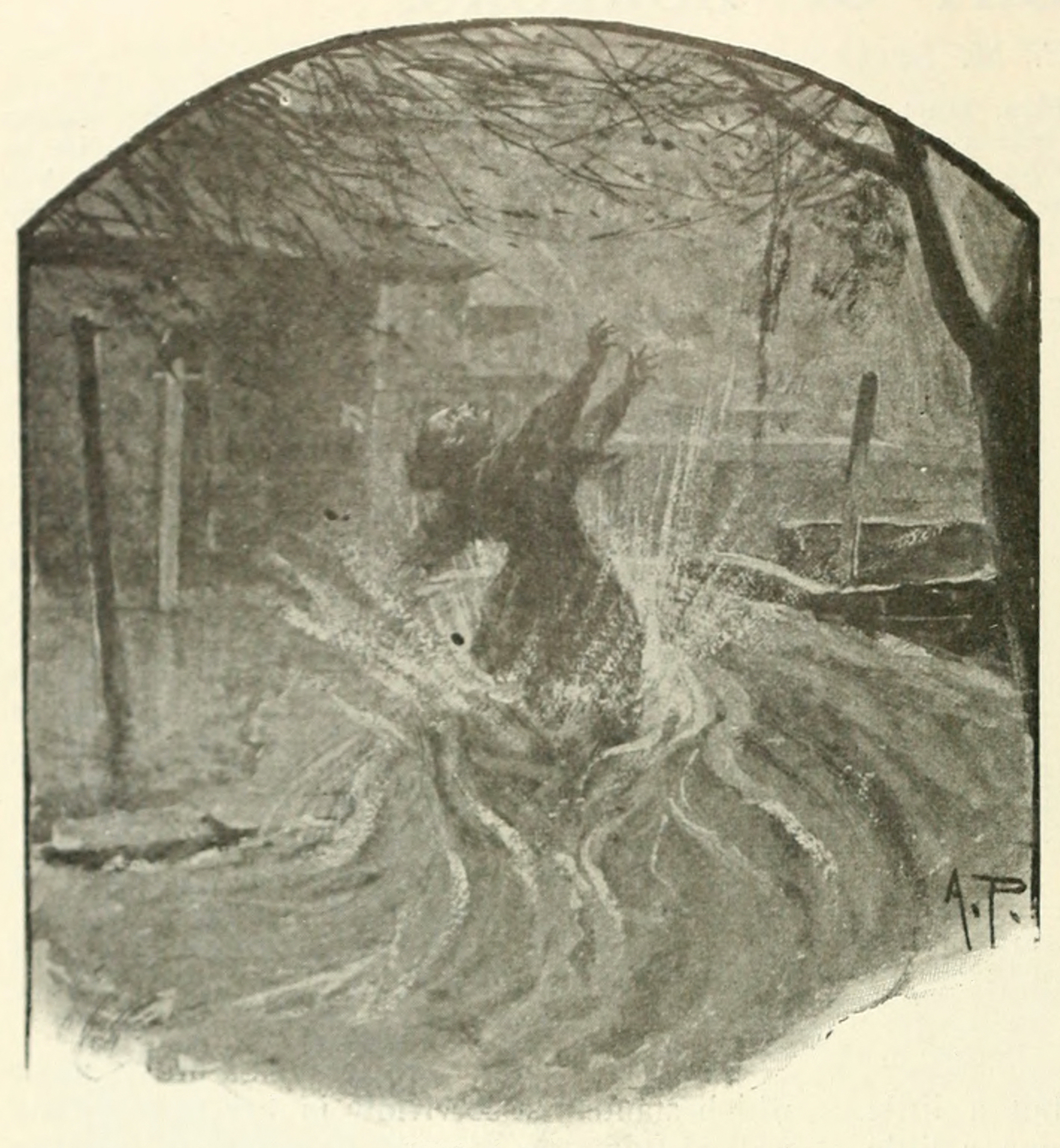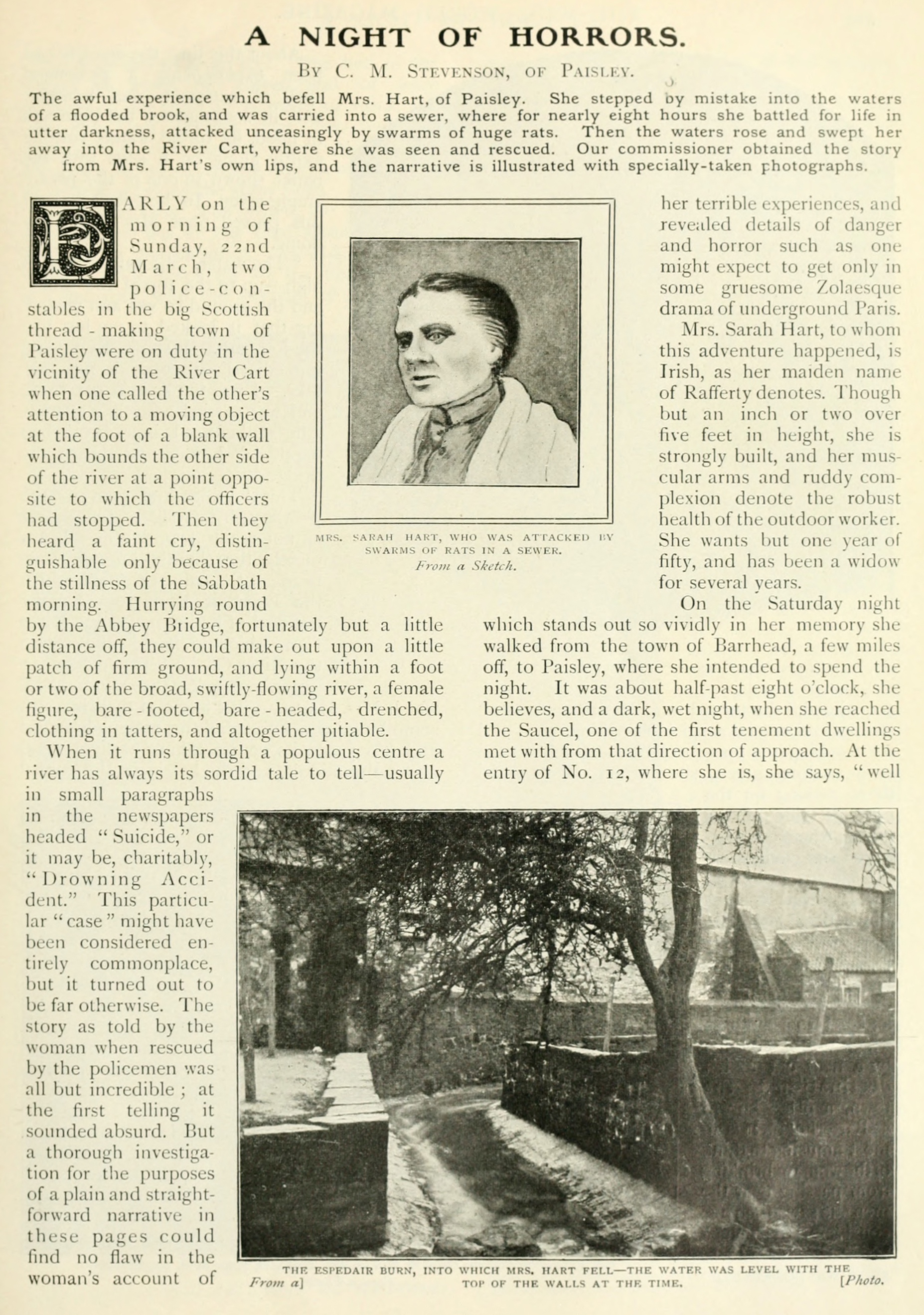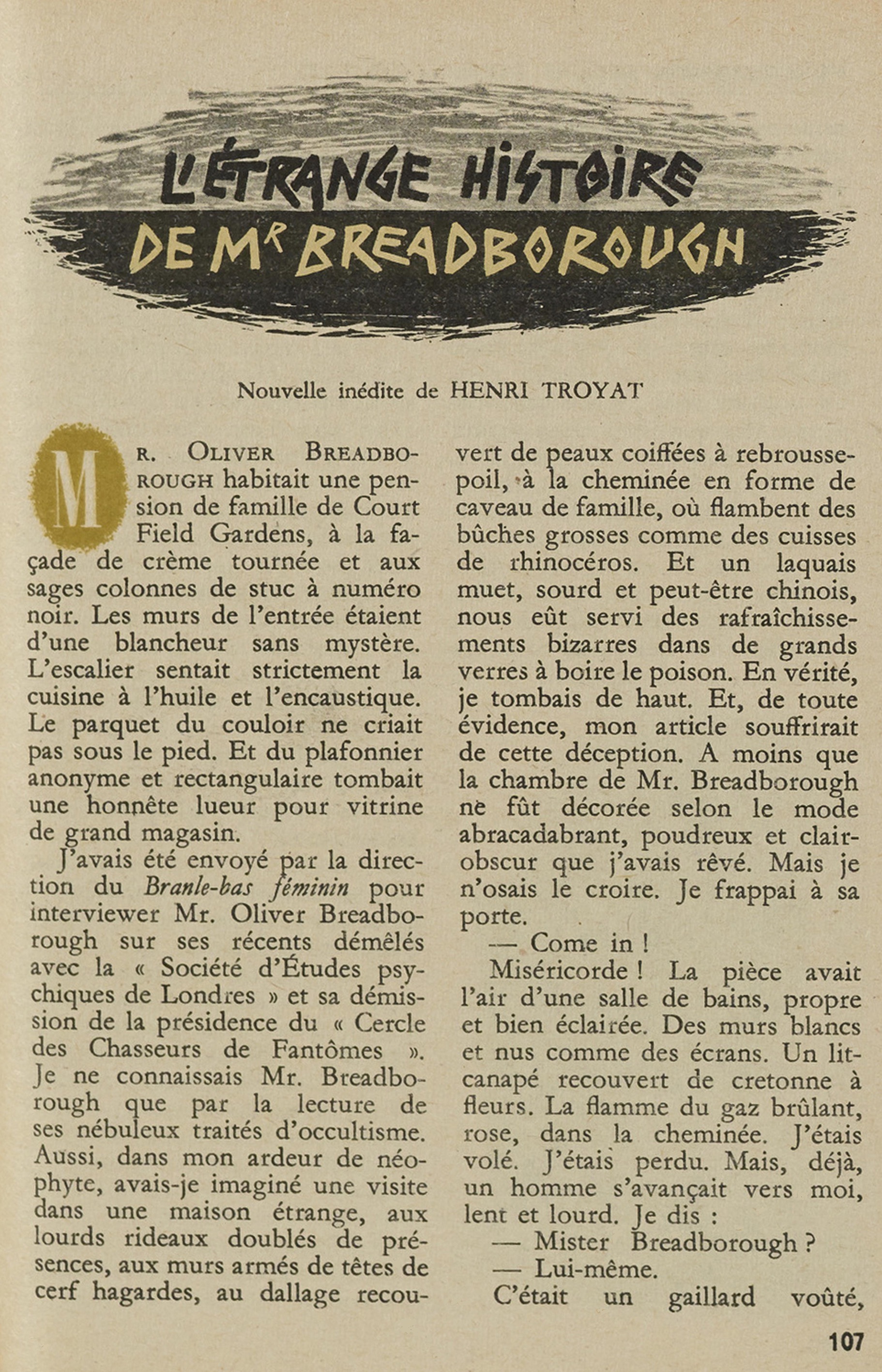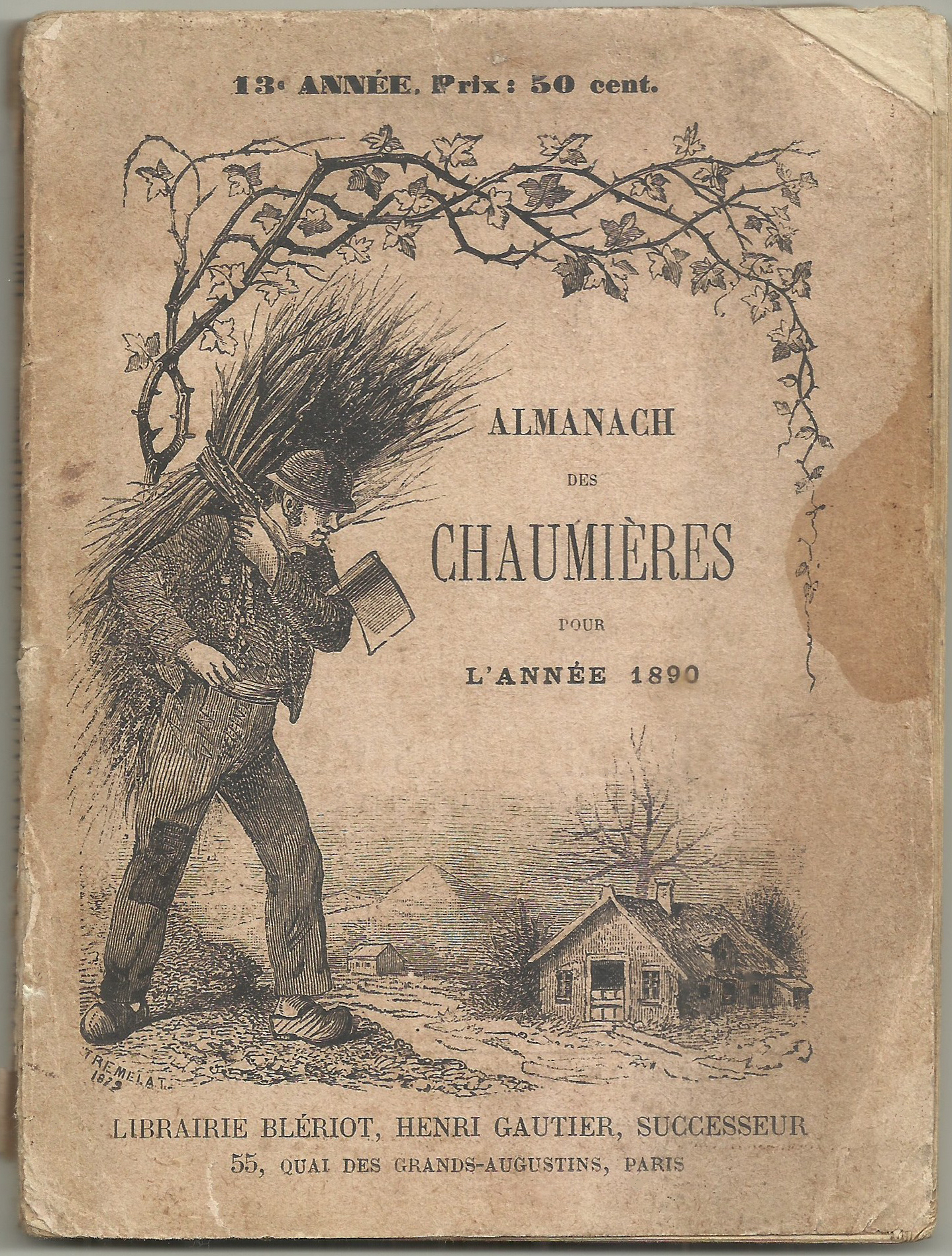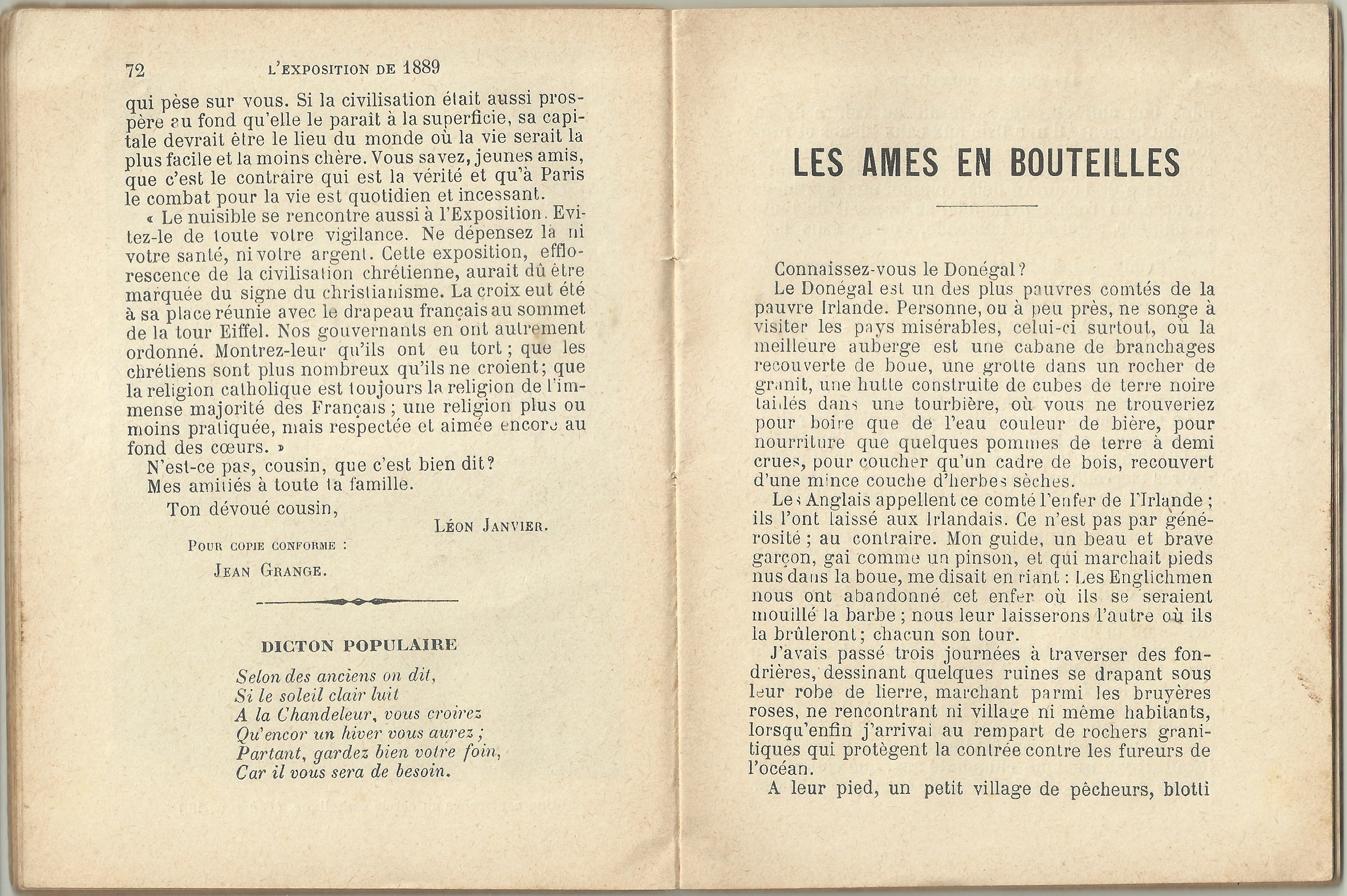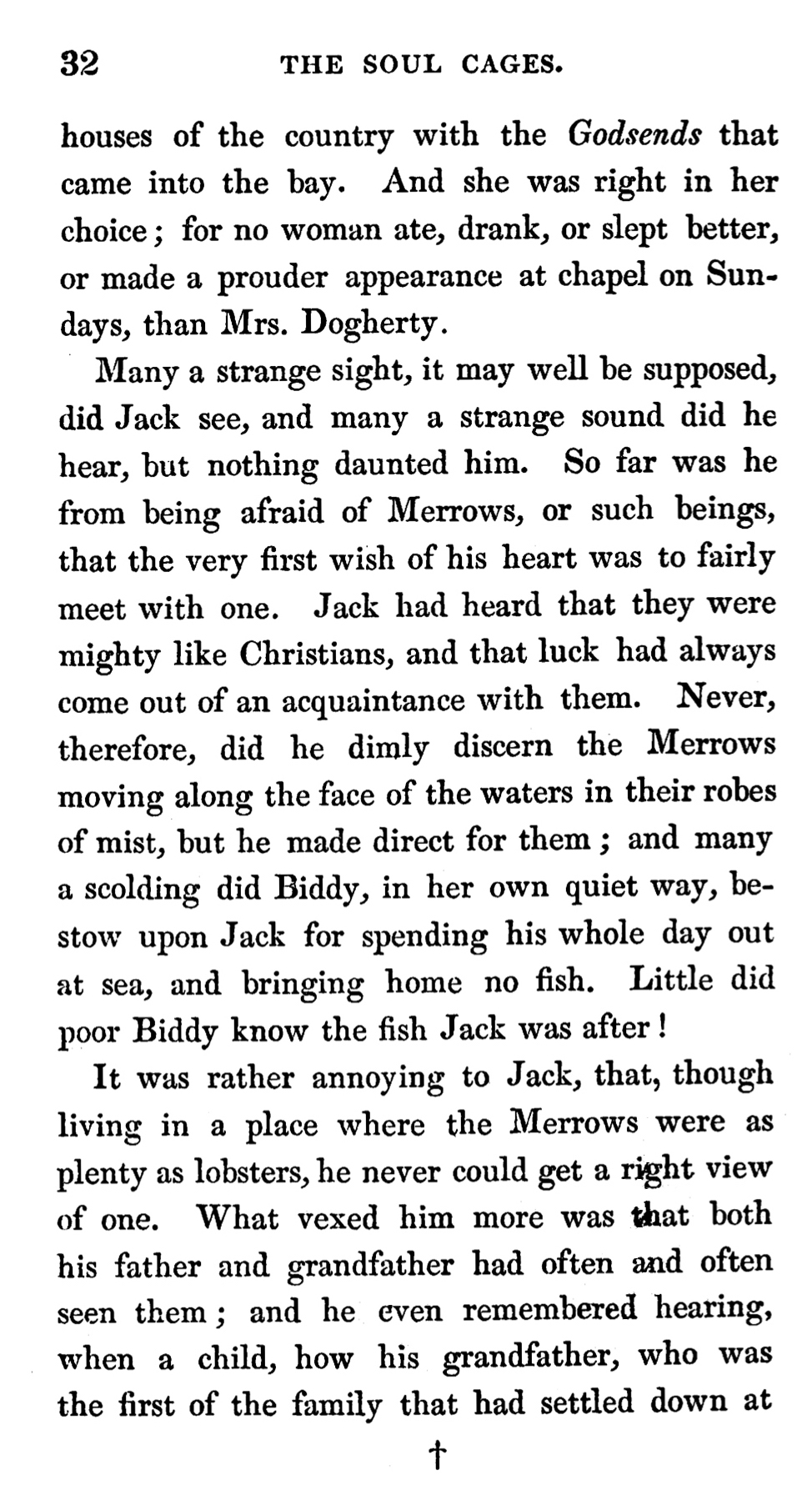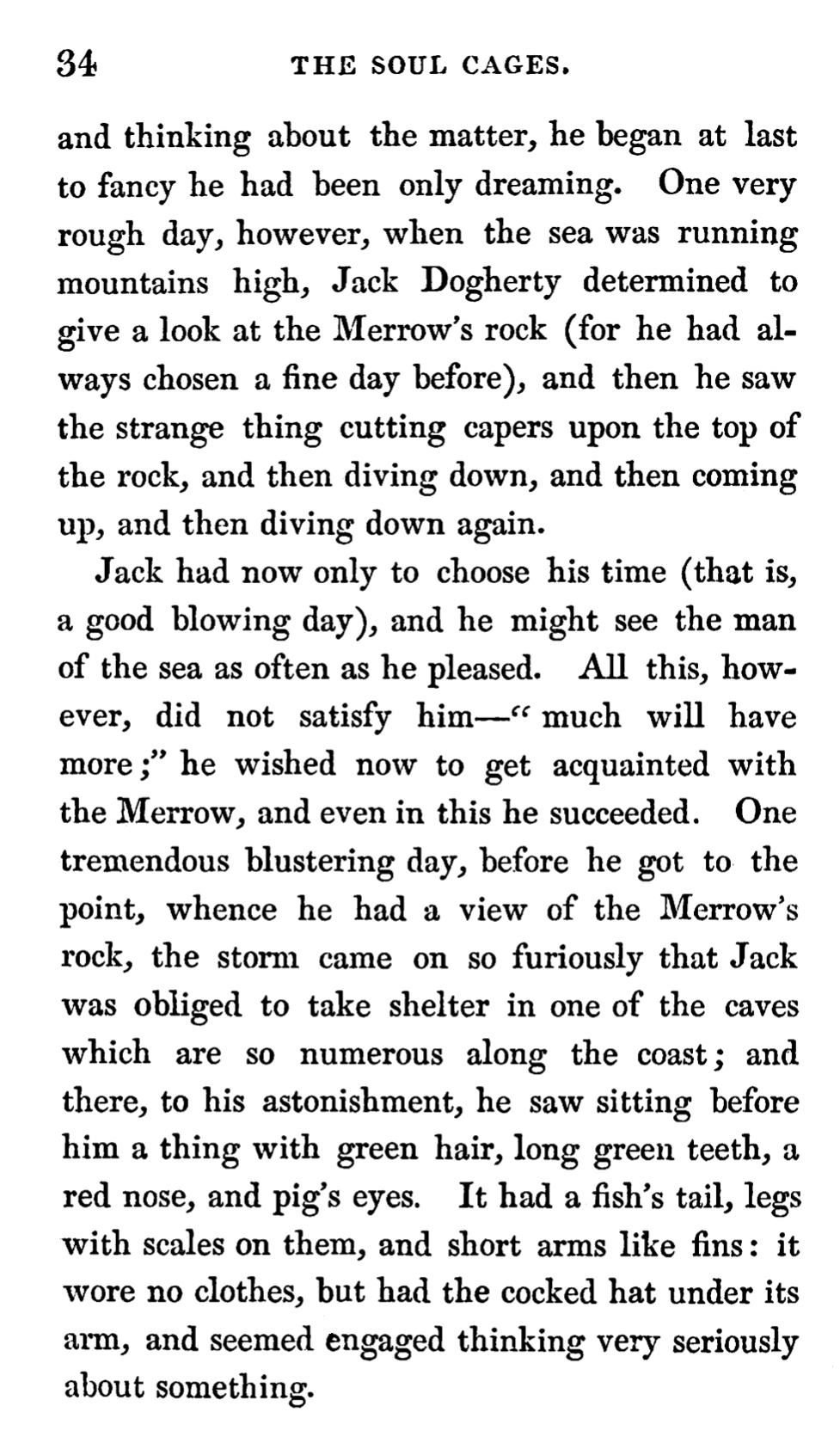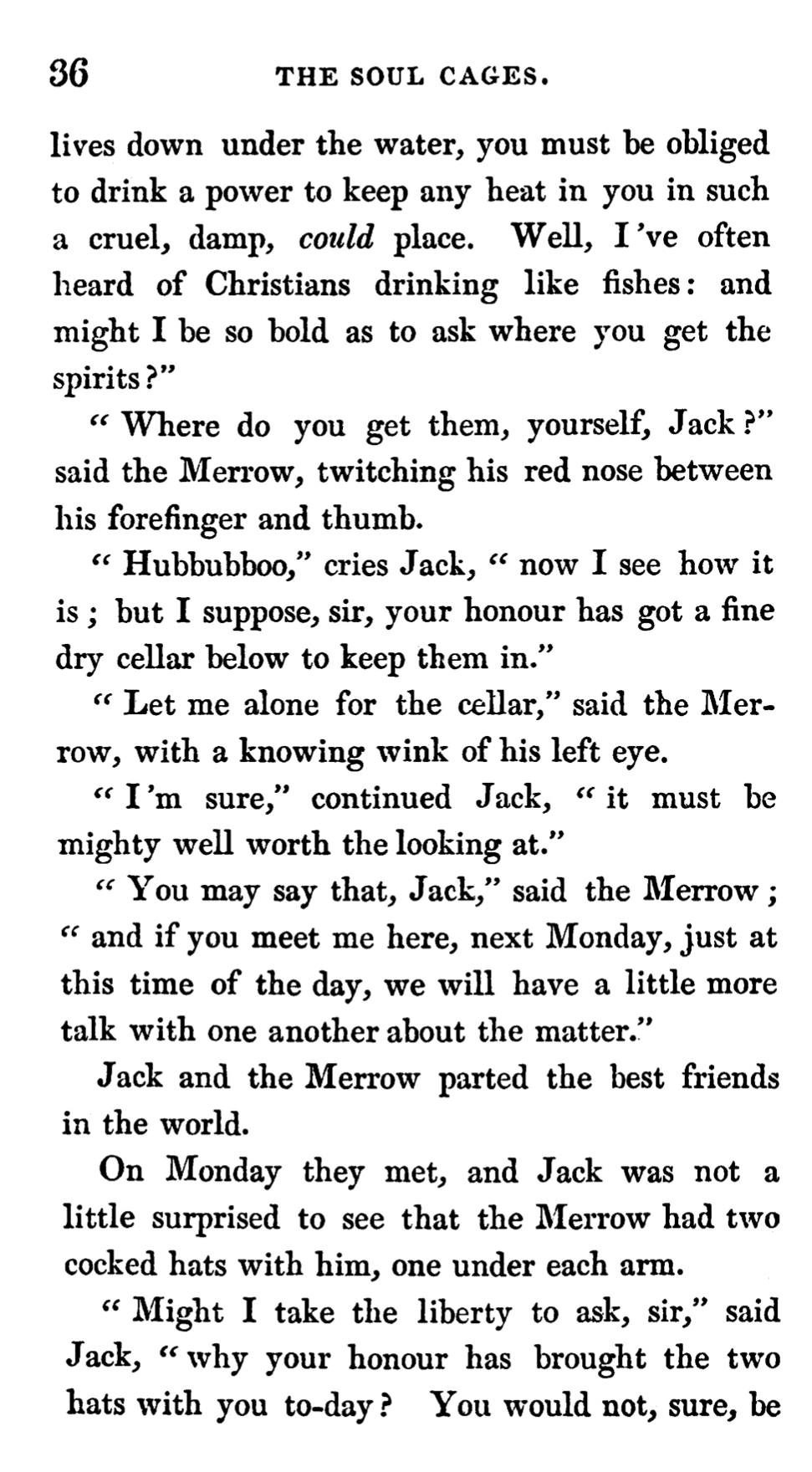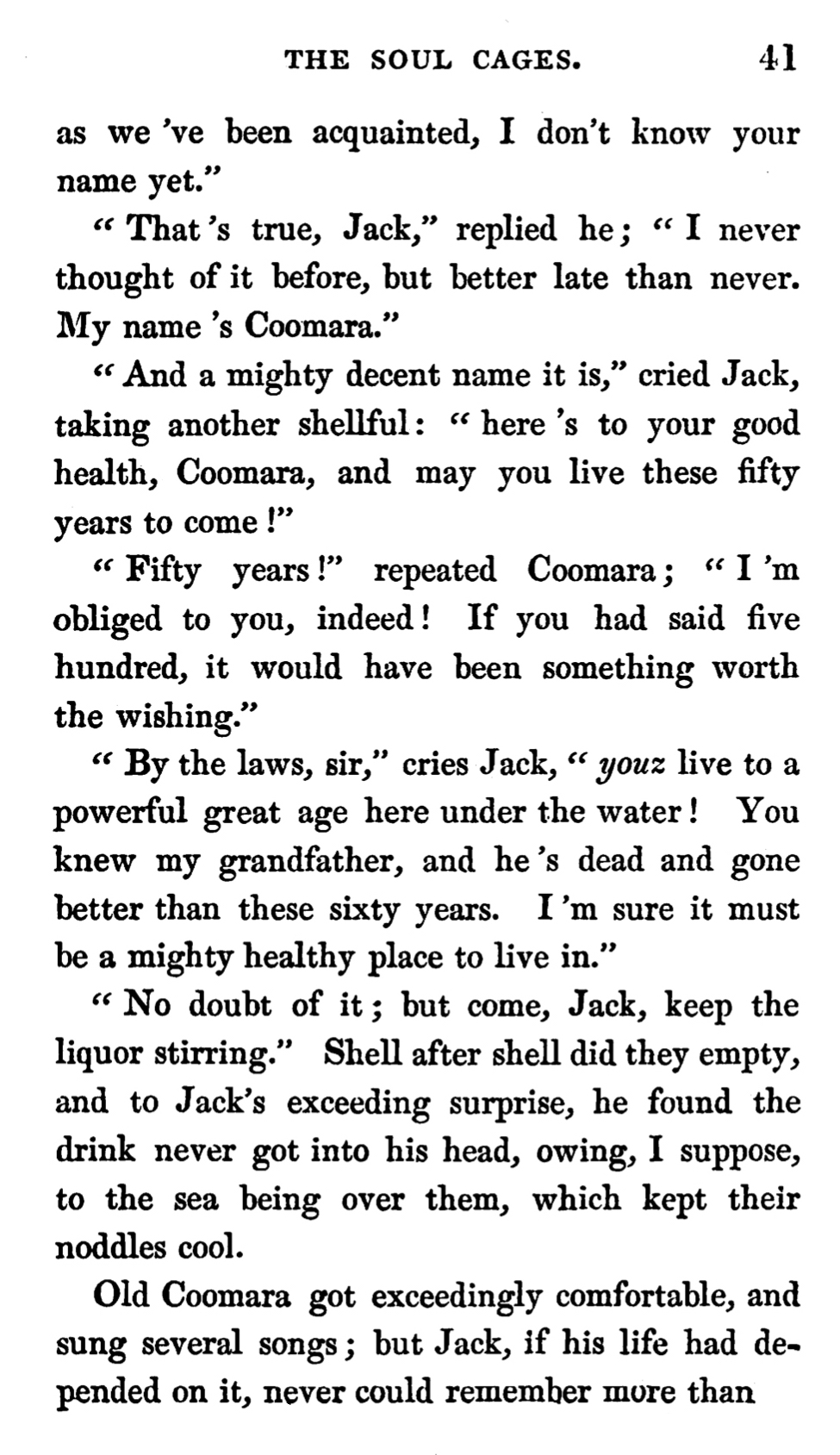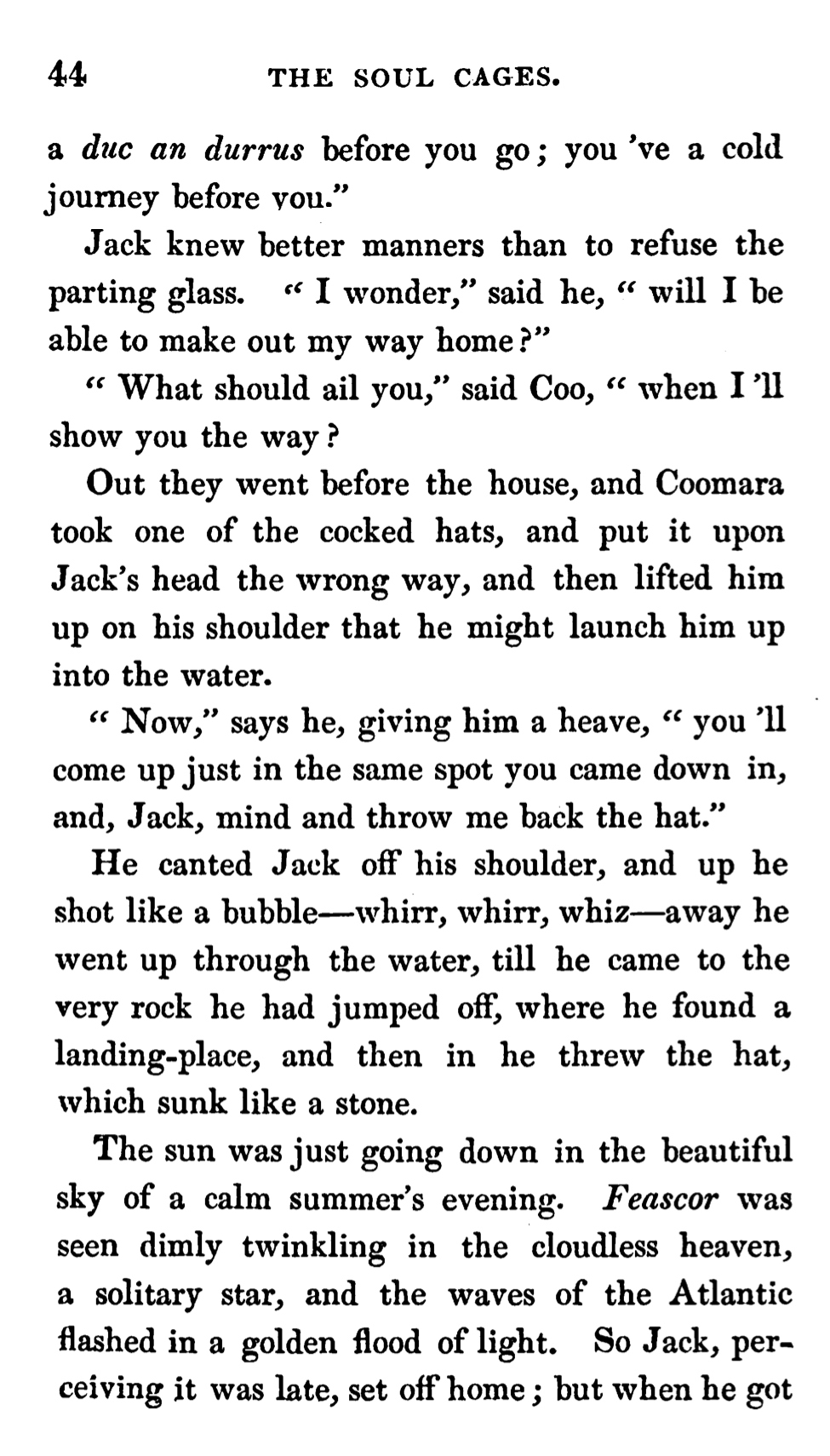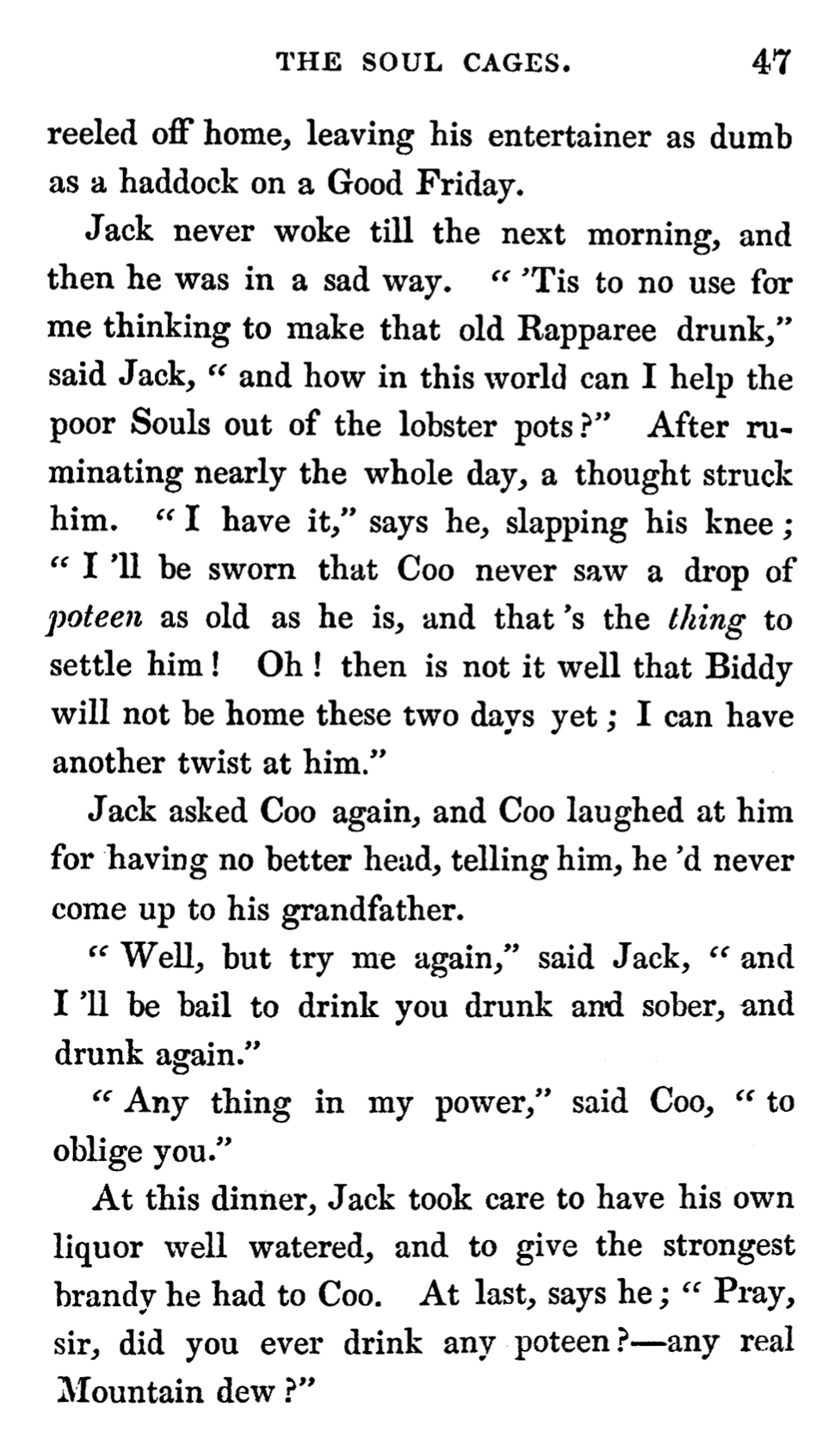I
« Ainsi, dis-je, vous refusez de me raconter comment les Rois-Mages processionnaient autour de ces collines, avec tous les petits chevaux en bois, bridés d’or et sellés de velours, qui semblaient échappés d’une boîte de joujoux, et les girafes, et les singes, et les lynx, et aussi les petits pages-poupées soufflant dans de minuscules trompettes ? Et pourtant, c’est ici qu’ils vinrent, je le sais ; j’ai vu ce paysage dans les tableaux et je le reconnais : ce sont bien là les collines polies par les eaux et devenues semblables aux mamelles de la Diane d’Éphèse ; ce sont bien les rangées de cyprès et de sapins, tirés, eux aussi, de la boîte de jouets. Oui, c’est ici-même qu’ils sont venus ; Benozzo Gozzoli a peint tout cela en son temps et, alors déjà, vous habitiez ces lieux, je présume ? »
Sa robe me le faisait supposer, car elle était passée de mode ; mais je ne voulais pas faire allusion à cela. C’était cette sorte de toilette que l’on portait au temps du « Printemps » de Botticelli : mousseline brodée de petits bouquets de myrte et de genêt, nouée en bouffettes bizarres aux coudes et à la taille ; sur la tête, une guirlande d’églantines et d’ellébore aux feuilles palmées. On ne pouvait s’y tromper.
La nymphe Terzollina (car c’était elle, sans doute, la divinité tutélaire de l’étroite vallée qui s’étend derrière la célèbre villa Médicis) hocha seulement la tête, déplaça l’un de ses pieds nus, sur lequel elle était assise à l’ombre d’un cyprès, et continua d’enfiler les fleurs jaunes des genêts.
« En tout cas, vous pouvez me parler de Laurent le Magnifique, dis-je, un peu impatienté de son obstination. Vous savez fort bien qu’il avait coutume de venir ici vous faire la cour et sans doute composer des vers. »
L’exaspérante déesse leva son mince et brun visage, où brillaient des dents pointues d’écureuil et des yeux étincelants comme ceux d’une chèvre. « Elle est bien jolie, pensai-je, mais un peu passée, comme le sont toutes les dames symboliques de ce monde-là. » Elle arracha une touffe de menthe sèche qu’elle écrasa entre ses doigts, et l’air chaud en fut parfumé. Elle leva les yeux avec un regard futé et timide de petite paysanne, qui semblait absurde chez une dame aussi respectable et aussi soigneusement parée. Alors, d’une voix berçante, elle commença à réciter quelques stances in ottava rima. Telle fut sa complainte :
« La maison, où le bon vieux chevalier Gualando cachait la petite princesse, était elle-même cachée dans cette vallée reculée. Cette maison était petite et toute blanche, avec de gros barreaux de fer aux fenêtres. Devant le logis s’étendait une longue pelouse, étoilée de trèfle blanc, et, de chaque côté, jusqu’à la lisière des cyprès et des pins, se déroulaient des champs de blé. Tout cela était bien à l’écart des splendeurs du monde ; et quand le coucou était silencieux ou que les rossignols avaient perdu leur voix, l’on n’entendait d’autre bruit que le roucoulement des ramiers, le babil du torrent et le gazouillis des jeunes alouettes.
Le vieux chevalier Gualando avait caché sa brillante armure dans un coffre de chêne. Il allait chaque jour à la ville lointaine, vêtu du sarreau bleu des paysans, et chassant un âne devant lui. Il revenait de la ville avec des friandises pour la petite princesse et des nouvelles du méchant usurpateur. Jamais personne n’avait soupçonné son origine ni découvert sa retraite mystérieuse.
Durant son absence, la petite princesse – elle se nommait Fiordispina – avait coutume d’enfiler des perles et passait ainsi les heures chaudes, tandis que le soleil dardait ses rayons à travers les arbres et que la pointe argentée des blés verts commençait à se teinter d’or pâle. La princesse se rappelait avoir vu un même soleil dans la chapelle du château : une peinture le représentait comme une grosse boule d’or repoussé, qui semblait sortir de la toile ; et on lui permettait de la caresser du doigt les jours de fête.
Le soir, quand le ciel devenait d’un blanc de perle et que la brise frémissait à travers les pins et les cyprès, frange noire au sommet de la colline, ou pièces de velours duveté appliquées sur ses flancs, la petite princesse sortait et se promenait de-ci de-là, dans ses vêtements de paysanne, son joli visage plus bruni par le soleil que s’il eût été frotté de brou de noix. Elle escaladait les collines et respirait l’odeur de la résine surchauffée par le soleil, et la douce senteur des genêts : ils étalaient leur splendeur sur toutes les collines et le roi, son père, n’avait jamais possédé autant d’aunes de drap d’or.
Mais, un soir qu’elle errait plus loin que de coutume, elle vit sur un talus, à la lisière d’un champ de blé, cinq grands lis blancs tout en fleurs. Elle rentra à la maison, prit des ciseaux d’or dans leur gaine, et coupa l’un des lis. Le lendemain, elle revint encore et en coupa un autre ; ainsi fit-elle jusqu’à ce qu’elle les eût tous cueillis.
Or, il arriva qu’une vieille sorcière, qui demeurait dans le voisinage, s’en vint ramasser des herbes parmi les collines. Elle avait remarqué les cinq lis et les avait maudits, parce qu’ils étaient blancs. Elle s’aperçut que l’un d’entre eux avait été coupé, puis un autre, et encore un autre. Elle détestait ceux qui aiment les lis. Quand elle vit que le cinquième lis avait disparu, elle fut grandement étonnée et monta sur la hauteur pour voir où leurs tiges avaient été coupées. C’était une femme avisée, qui savait beaucoup de choses. Elle posa son doigt sur la tige coupée et dit : « Ceci n’a pas été tranché avec du fer » ; et, posant ses lèvres sur la tige coupée, elle sentit que cela avait été taillé avec des ciseaux d’or : car rien ne coupe aussi bien que l’or.
« Oh ! Oh ! dit la vieille sorcière, où il y a des ciseaux d’or, il doit y avoir des étuis d’or ; et où il y a des étuis d’or, il doit y avoir de petites princesses ! »
« Ah ! et alors ?… demandai-je.
– Oh ! rien de plus, répondit la nymphe Terzollina, l’amante de Laurent le Magnifique, qui avait vu la procession des Rois-Mages. Je vous souhaite le bonsoir. »
… Et à l’endroit où sa robe de mousseline blanche, brodée de bouquets de genêts et de myrtes, s’était étalée sur l’herbe sèche et la menthe écrasée, il n’y avait plus, sous les cyprès, qu’un buisson de myrte étoilé de blanc et une touffe de genêt d’or.
II
Il faut avoir du temps pour converser avec les déesses. Du reste, pendant un été de Toscane, lorsque tout le monde est dispersé dans ses maisons de campagne et a de la peine à quitter son hamac ou son banc ombragé,. il n’y a guère d’autres personnes à qui parler.
Et puis, durant les semaines d’été sans nuages, les choses de la nature nous jouent à l’envi des « représentations d’amateurs. » Elles revêtent alors l’aspect le plus inattendu : elles se costument, prennent un sens allégorique étrange, incompréhensible, nous présentent l’énigme inexpliquée de cette perpétuelle et silencieuse charade des arbres, des fleurs, des animaux, des maisons et du clair de lune.
La lune, surtout, est toujours en scène, comme pour tenir le rôle des lucioles, qui durent le temps que le blé est dans l’épi, puis s’éteignent peu à peu, humbles phalènes sans forces, errantes çà et là, traînant la lueur pâlie de leur queue phosphorescente dans l’herbe ou dans les rideaux. La lune prend leur place ; et, dans l’été italien, il semble qu’il y ait pleine lune trois semaines sur quatre.
Un soir, la représentation fut donnée par la lune et des gerbes de blé, assistées d’acteurs de second ordre, tels que grillons, chouettes duvetées et vignes en guirlande. Dans le pré, au-delà de notre jardin, l’avoine, – naguère d’un vert si délicat, – venait d’être fauchée, et maintenant on la mettait en meules. Me doutant qu’une de ces représentations habituelles allait avoir lieu, je montai après dîner jusqu’à la grille du jardin et je regardai à travers les barreaux. Oui, c’était bien là la féerie coutumière des éléments… La lune était presque dans son plein, effaçant l’éclat des étoiles, imprégnant le ciel et la terre d’une brume bleu-pâle, qui semblait être en quelque sorte une pluie visible de rosée. Elle laissait une couleur verte sur le large sentier herbeux, un jaune atténué sur le blé encore debout, et jetait sur les gerbes d’avoine l’ombre festonnée des guirlandes de vigne. Ces gerbes, – qui en pourra décrire la métamorphose ? Du jaune le plus pâle sur le pâle chaume, elles étaient comme glacées par les rayons de lune, avec la barbe fragile et légère de leurs épis et les pailles luisantes de leurs tiges qui s’échappaient çà et là. De la paille ? des épis ? Vous n’auriez jamais deviné que c’étaient choses si terre-à-terre. Elles se tenaient là, appuyées contre les arbres, entre les flaques de lumière et les ombres, tandis que vibrait la chanson aiguë et stridente des grillons. Elles siégeaient solennelles, avec un air d’attendre ; elles m’appelaient, elles me faisaient peur. Et l’une d’elles, avec une grosse gerbe en plus sur sa tête et une bande d’ombre en travers, semblait baroque, inconcevable et terrible. Une minute après, je retournai au jardin, m’esquivant comme un intrus.
III
Il y a aussi des représentations en « matinée, » et les humains y sont admis alors, comme comparses. Telle fut certaine foire aux bestiaux dans la vallée de Mugnone.
Le marché se tenait sur une pièce de terrain fraîchement fauchée, comprise entre la grand-route et le lit de la rivière à sec, où des herbes jaunes à senteur de myrrhe croissaient parmi les cailloux. Les bœufs étaient presque tous de la blanche race de Toscane (ceux de la Romagne sont plus petits, mais plus ardents et d’un gris délicat) ; seules, leurs croupes étaient légèrement brunies. Le drap écarlate de leurs colliers à franges, comme une guirlande de géraniums, tranchait sur la blancheur laiteuse de leur échine et de leur col. En vérité, ces gigantesques créatures semblaient moulées en crème fouettée ou en fromage à la crème. Leur peau lisse, plissée çà et là de rides minuscules, exactement comme les petits fromages « stracchini, » ne donnait aucune impression de solidité, ni même de résistance au toucher. L’invraisemblable blancheur de ces bêtes seyait à leur parfaite docilité. Avec une douceur passive, elles se laissaient mener, à grandes enjambées silencieuses, par-dessus les sillons chaumés, les talus escarpés, se poussant l’une l’autre, flanc contre flanc, cornes enchevêtrées, sans même un son, sans un mouvement d’étonnement ou de désobéissance. Jamais un mugissement ni un beuglement ; jamais un regard détourné de leurs grands yeux d’un brun bleuâtre, frangés de longs cils. Leurs larges mâchoires remuent comme des meules qui broient ; leurs longues queues touffues oscillent avec la monotonie d’un pendule.
Autour d’elles, un cercle de paysans, qui les mesurent de l’œil, les palpent du doigt, les tirent par les cornes. Et, de temps à autre, l’un des hommes à face rouge – des intermédiaires, bouchers pour la plupart – jette dramatiquement ses bras autour du cou d’un acheteur ou vendeur récalcitrant, l’attire à l’écart, chuchotant, avec des lèvres allongées comme pour un baiser de Judas ; ou bien il joint ensemble les mains et les bras rouges des parties contractantes, fait taire leurs objections, les force à conclure l’affaire. Quel contraste entre ces créatures humaines, surexcitées, échauffées, qui hurlent, se bousculent, dont les vociférations : « Dio Canes ! » et « Dio Ladros ! » sont dominées par le cri monotone du marchand d’eau glacée ; – et les bœufs blancs, impassibles et silencieux, presque irréels, si paisibles, accroupis, et si largement étalés, que, vus de haut, ils semblent des tentes déployées et leurs flancs de neige autant de toiles blanches étendues au soleil. Et à petite distance, contre le versant de la colline, au-delà de la rivière, des couples de bœufs déjà vendus, attachés à un bouquet de cyprès, font songer à quelque vieille allégorie médiévale, une allégorie dont personne ne sait le sens… comme toujours.
IV
Une autre représentation fut celle des bois de Lecceto et de l’ermitage de ce nom. Vous les trouverez sur la carte de Sienne ; mais je doute fort que vous les découvriez sur la surface du monde réel, car je les soupçonne de n’être qu’une scène de cette féerie du plein été – et rien de plus. Pendant des années, ils avaient été pour moi comme une de ces visions coutumières et pourtant irréelles (nous en avons tous de semblables) – ou plutôt de ces choses inaccessibles, on ne sait pourquoi, qui n’existent pour nous que parce qu’elles sont inaccessibles.
Parfois, de l’une ou l’autre colline, on entrevoit la tour rouge et carrée, avec sa silhouette massive et ses créneaux. Elle s’élève parmi les chênes grisâtres : on dirait qu’elle nous fait signe par-dessus les crêtes et les vallées ; elle s’efface ensuite dans la forêt de chênes, verte en été, couleur de cuivre en hiver. Puis voici que du côté où on les attend le moins, quand on contourne les vignobles haut perchés et les bouquets de pins parasols qui frangent le sommet des collines, surgissent encore le panache des chênes et les créneaux de la tour. Les voici… et, une minute après, tout s’évanouit.
Par une de ces interminables après-midi de juillet, nous nous sommes mis en route, résolus à les atteindre, ces bois, et à ne plus être bernés par Lecceto.
Après bien des détours au flanc des collines et le long des vallées, nous arrivons enfin dans une contrée si étrange qu’elle pouvait recéler même Lecceto. Dans une vallée étroite, une senteur chaude, délicieuse, bien connue, nous accueille et (comme les parfums que l’on ne peut définir) elle nous inspire des pensées indécises, trop claires cependant pour ne pas être absurdes ici : jardinets de villages anglais, armoires à linge de vieilles maisons, salons vieillots remplis de « pots-pourris »… et, voyez ! devant nous, une colline toute couverte de lavande en fleurs, qui pousse comme la bruyère sur les collines lointaines des pays de fées. Derrière la colline lilas et parfumée, chauffée par le soleil, commencent les bois de chênes verts : des arbres, jeunes pour la plupart, qui portent, au-dessus de leurs vieilles feuilles bruissantes, un frais vêtement de vert feuillage ; des arbres, étroitement serrés comme une haie, entre lesquels se presse partout une autre verdure : arbousier et charme, fougère et bruyère, plant serré qui semble regorger de fraîcheur et de solitude.
Ce devaient être les bois de Lecceto, cachant dans leurs profonds taillis la tour rouge et crénelée de l’ermitage. Car, j’ai oublié de vous le dire, de saints personnages se sont succédé dans cette tour, il y a quelque mille années ; tous également saints et semblables les uns aux autres à tel point qu’ils parurent s’incarner en un seul : un ermite immortel, à qui papes et empereurs venaient, dit-on, demander sa bénédiction et ses conseils. Nous nous enfoncions toujours plus avant à travers l’humide et verte fraîcheur, dans les ineffables délices des jeunes feuilles et des fougères qui se déroulent. Mais le fourré nous sembla, à la fin, devenir impénétrable ; et il nous vint à l’idée que Lecceto, comme d’habitude, s’était moqué de nous, qu’il allait nous apparaître d’un tout autre côté si nous revenions sur nos pas. Soudain, au-dessus des arbres, surgit la tour de briques rouges, carrée et crénelée. Et, au détour du sentier rude et étroit, le site tout entier se découvre : la tour, une église, un clocher, quelques bâtiments à demi fortifiés, dans une large clairière plantée d’oliviers. Nous attachons notre petit cheval à un chêne vert et nous explorons l’ermitage. Mais le bâtiment est clos tout à l’entour de murs et de haies ; on n’y peut entrer que par une seule porte massive, munie d’un marteau ; derrière, se trouvent sans doute une cour extérieure et une haute muraille avec un balcon de fer forgé. Nous frappons.
Mais ce marteau n’était fait que pour les papes et les empereurs qui se promènent avec leurs tiares, leurs couronnes et leurs sceptres, comme le font les papes et les empereurs authentiques des contes populaires italiens et des fresques de Pinturicchio. Nos coups répétés, nos appels bruyants n’obtenaient point de réponse. Ne serait-il pas plus simple d’entrer d’un autre côté ? Il devait bien y avoir par là des paysans au travail… en admettant même que le saint ermite ait cessé d’exister. Mais c’est en vain que nous escaladons murailles et claies, que nous nous glissons à travers les troncs serrés des chênes ; nous nous heurtons à d’autres murs, que domine – comme elle dominait naguère les bois d’yeuses – l’inaccessible tour crénelée. Une petite bergère, avec son chapeau de paille aux ailes retombantes et son troupeau de petits porcs blancs et noirs qui paissaient à l’ombre des oliviers sur le chaume du voisinage, ne sut pas mieux que nous rompre le charme de l’ermitage. Et, tout à l’entour, à plusieurs lieues à la ronde, ondulaient les frondaisons serrées des forêts de chênes verts.
Le soleil couchant colorait d’orange le chaume où paissaient les porcs, et les collines lointaines de la Maremma devenaient très bleues derrière les oliviers. De crainte d’être surpris par la nuit, nous tournons du côté de la ville la tête de notre cheval, et nous voici traversant les bois de chênes et longeant la colline fleurie de lavande. Nous sommes près de douter de la réalité du lieu que nous venons de quitter, quand la tour émerge une fois encore pour nous narguer, site inaccessible et invraisemblable ! L’air était embaumé par la lavande des collines et par la résine des pins, dont les branches formaient en noir des dessins japonais sur la laque d’or du ciel. Bientôt la lune se leva, large et jaune, éclairant peu à peu la route obscure, où l’on entrevoyait vaguement dans l’ombre des couples de bœufs blancs revenant du labour. Au moment où nous atteignions la colline qui porte la ville, tout était baigné d’une pâle lumière blafarde, traversée d’étranges ombres jaunâtres, et les hautes tanneries, agrandies par ces lueurs, étincelaient, démesurées, effrayantes, avec les contreforts surplombants de leurs terrasses. Après avoir gravi, au clair de la lune, la pente escarpée de Fontes Branda et avoir traversé une voûte sombre, nous nous trouvons sous la lumière des becs de gaz, au cœur de la populeuse cité. C’est une autre planète sur laquelle nous sommes jetés comme par un coup de canon ; et nous sentons cette fois que l’ermitage de Lecceto est vraiment un mythe.
V
Cet enchantement, d’où vient-il ? – car il existe, et qui oserait le nier parmi les descendants des Goths, des Vandales et de tous les amants primitifs de l’Italie ? – D’où vient-il ? voilà où s’arrête ma philosophie.
Pour exprimer ce phénomène, je ne trouve qu’un seul mot, un mot allemand intraduisible : Bescheerung, c’est-à-dire cadeaux distribués à profusion, pommes dorées, bougies allumées, étalage de choses merveilleuses, réalisation de tout ce qui est possible et impossible, bref, l’Arbre de Noël. Et l’Italie, qui ne connaît point les Arbres de Noël, célèbre sa Bescheerung en plein été. Elle se débarrasse des vulgarités chères aux touristes, dissimule les traits qui caractérisent notre siècle trivial, se revêt de fleurs de magnolia et de pastèques, de tentes et de baraques, de mandolines et de guitares ; en guise de paillettes, elle a l’étincellement de ses pompes religieuses et de ses fêtes locales ; en guise de bougies de cire et de lanternes chinoises, elle allume, le jour, son grand soleil d’or et, la nuit, sa plus grosse lune d’argent… et tout cela pour quelques minuscules descendants des Goths ou des Vandales.
Plaisanterie à part, j’inclinerais à croire que ce charme particulier de l’Italie existe seulement durant les mois les plus chauds, ce charme qui nous fait tressaillir parfois, et nous arrache ce cri : « C’est bien l’Italie ! »
Ce coup au cœur, – dont j’avais oublié l’impression, – voilà que je l’ai ressenti de nouveau au commencement de cet été vécu en Toscane, où se déploya la magie du plein été italien. J’avais passé la journée dans un petit monastère bénédictin très ancien (il était déjà vieux d’un siècle, quand saint Pierre Igneus, selon la chronique, traversa sa mémorable épreuve du feu), monastère transformé en ferme aujourd’hui, et qui cache ses murs crénelés et les tours de sa grande porte, parmi des champs de blé, non loin de l’Arno. Tandis que j’étais assise sous une haie de roses, en face du hangar du moulin enguirlandé de branches de pois chiches, tandis que, sous les voûtes froides au relent de vieilles futailles, je flânais, passant soudain du plein soleil à l’ombre crue des préaux cloîtrés, – un sentiment irrésistible, la réminiscence d’une impression depuis longtemps oubliée s’empara de moi et s’imposa à mon esprit par ces quelques mots, toujours les mêmes : « C’est bien l’Italie ! »
L’Italie ! Ce parfum me la rappelait mystérieusement : odeur de cuves à vin mêlée, j’imagine (sans d’ailleurs savoir pourquoi), à l’odeur douce et furtive des vieilles boiseries et du plâtre qui s’effrite. Une nuit, pour profiter de quelques heures entre deux trains, nous nous promenions en voiture dans les rues de Bologne, à travers la brume bleue de la lune et les ombres profondes de la cité aux noirs portiques : le même parfum monta jusqu’à mes narines, apportant avec lui comme une bouffée des années passées, des années où me fut donnée la révélation première de la féerie italienne. Chose étrange : Rome, où j’ai passé une grande partie de mon enfance, Rome, l’objet de ma naïve et tragique adoration, occupe dans mon esprit une place à part ; pour moi, ce n’est pas l’Italie. Mais l’Apennin de Lucques et de Pistoïa, avec la brusque apparition des champs et des prés italiens, avec les fleurs sur les murailles et le long des talus, et les cloches sonnant dans le ciel d’été, et les paysans travaillant aux champs, et les métiers, et les fuseaux : voilà l’Italie.
Mais combien plus italienne – et pour cela même plus aimée ! – était Lucques, la ville de la plaine, avec sa cathédrale et ses palais ! et, plus encore, quelques-uns de ces hameaux de montagne où rien n’est moderne, où les cyprès se dressent, effilés et noirs, contre les briques lézardées et les murs noircis, où les treilles d’un vert éclatant s’accrochent et grimpent jusqu’au haut de la colline ! L’enfance passée, jamais plus on ne peut ressentir une joie pareille à celle que j’éprouvai – trop rarement – en visitant ces lieux privilégiés. Et cette ferme, avec des cyprès au coin de la terrasse et un grand laurier-rose dépassant le mur, elle aussi était l’Italie, avant même qu’elle ne devînt ma demeure pour bien des années. Mais plus que tout, elles symbolisaient l’Italie, ces villes comme Bologne, Padoue, Vicence et Sienne où j’ai vécu, surtout en été.
Comme nos associations d’idées se modifient : c’est étrange ! Aujourd’hui, ce mot d’Italie exprime, surtout pour moi, certains effets familiers de lumière et de nuages, la délicatesse exquise du couchant aux lueurs d’ambre contre l’outremer des collines, des brumes d’hiver parmi les oliviers brumeux, des plis et des replis de montagnes bleu-pâle ; c’est un pays qui n’est d’aucun temps, et bien plus beau que toutes les imaginations des peintres et des littérateurs. Mais c’est là une jouissance vague, à demi-indifférente. Et, de temps en temps, lorsque la magie d’été est dans son plein, l’autre… la vieille et enfantine signification du mot me revient : comme le jour où j’étais parmi les roses du cloître bénédictin, à l’ombre fraîche des figuiers de la cour, où je respirais les bouffées de cette odeur étrange, lourde, d’une douceur romanesque, odeur de chêne saturé de vin, et de plâtre qui s’effrite… Et je sens avec un tressaillement de joie que « c’est bien l’Italie. »

–––––
(Vernon Lee, « Tuscan Midsummer Magic, » traduit de l’anglais par Mlle Hélène de Diesbach, in Revue de Fribourg, trente-quatrième année, deuxième série, n° 2, mars-avril 1903. Le texte de Vernon Lee est d’abord paru sous le titre : « Midsummer Magic » dans le MacMillan’s Magazine, volume 66, n° 393, juillet 1892, avant d’être repris dans le recueil Limbo and Other Essays, London: Grant Richards, 1897. Giovanni Costa, « Jeune Fille toscane, » huile sur toile, 1874 ; « Cavalcata dei Magi » [Le Cortège des Mages], fresque de Benozzo Gozzoli, c. 1459)
–––––
VERNON LEE : MIDSUMMER MAGIC
–––––