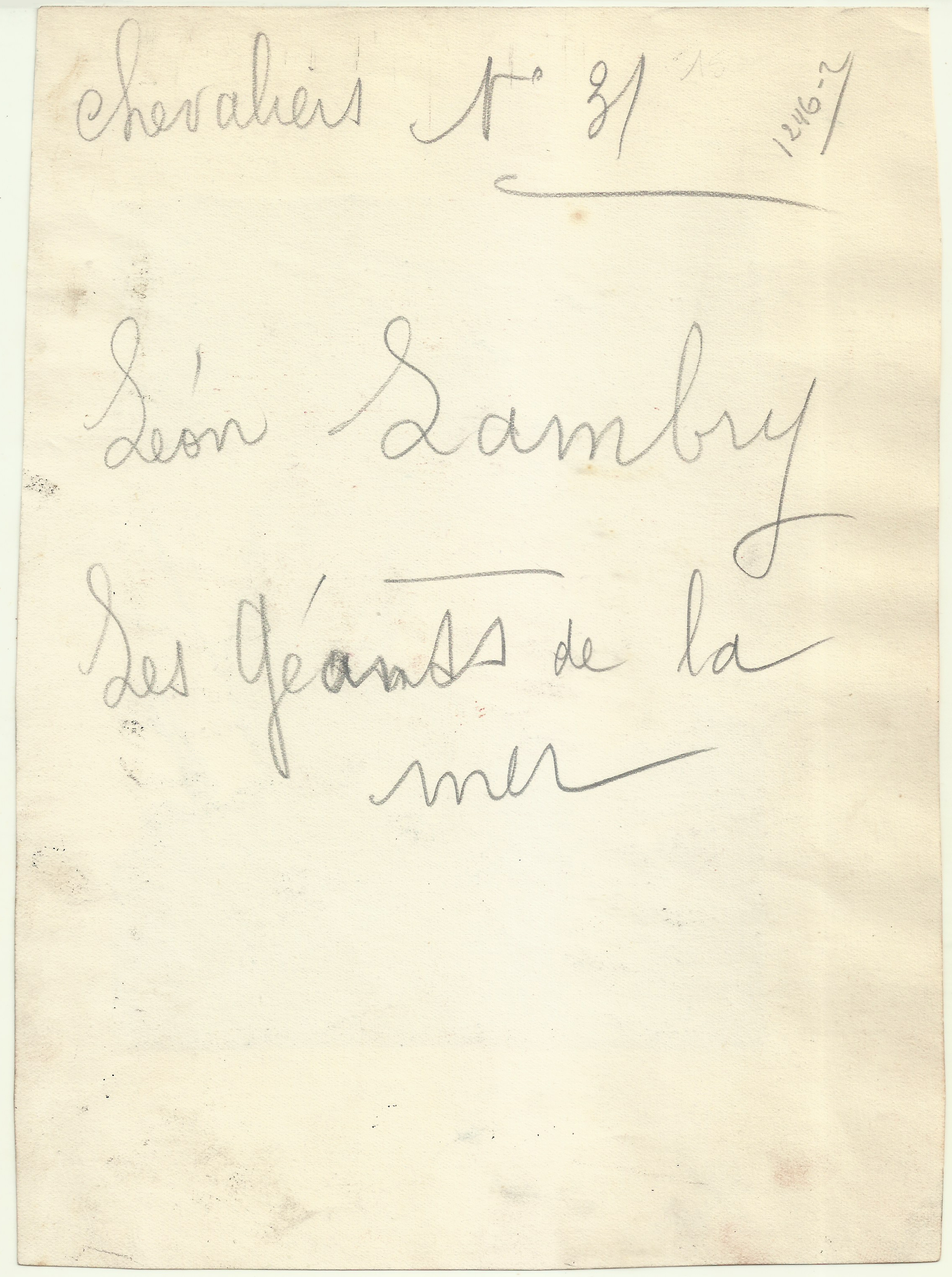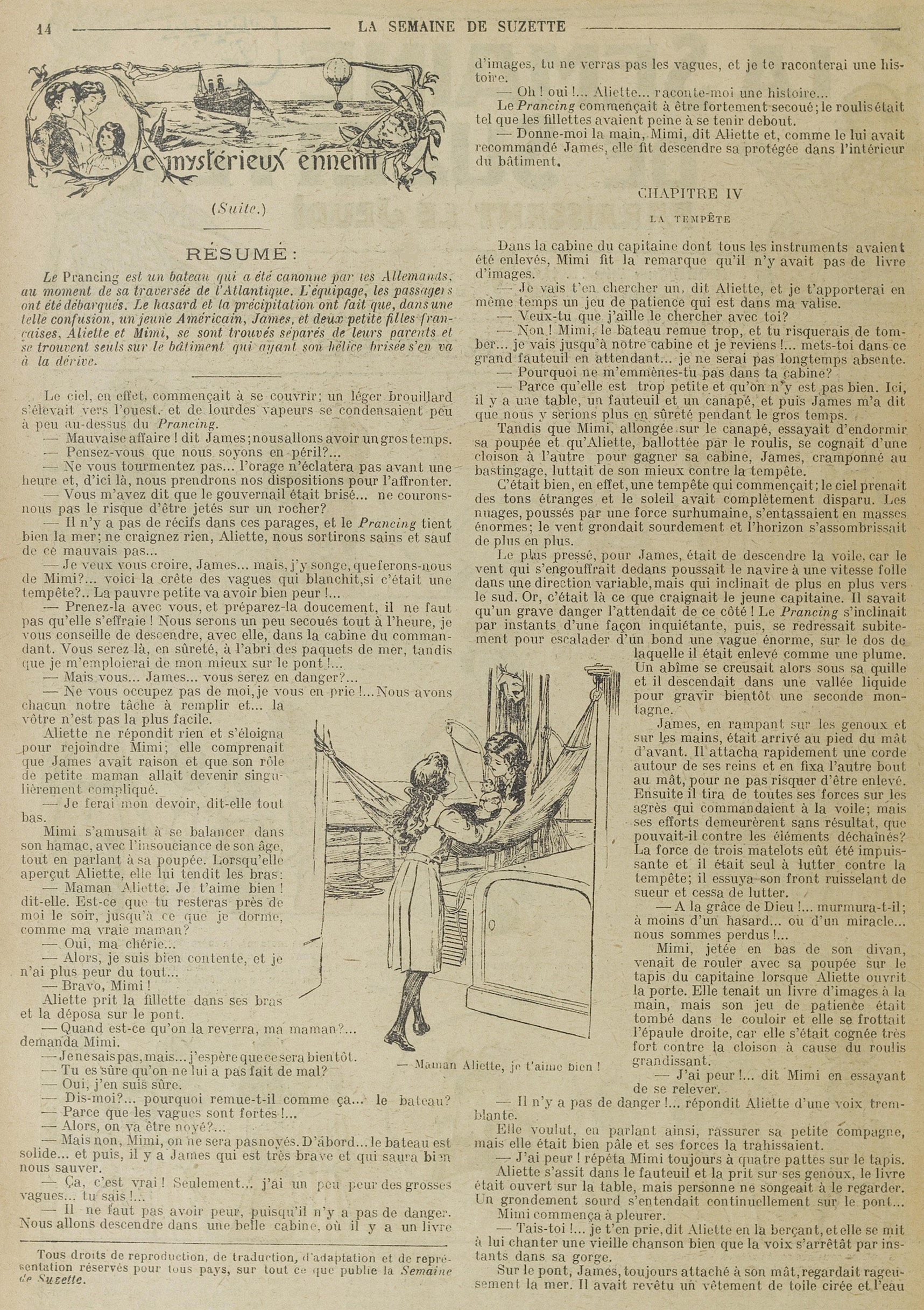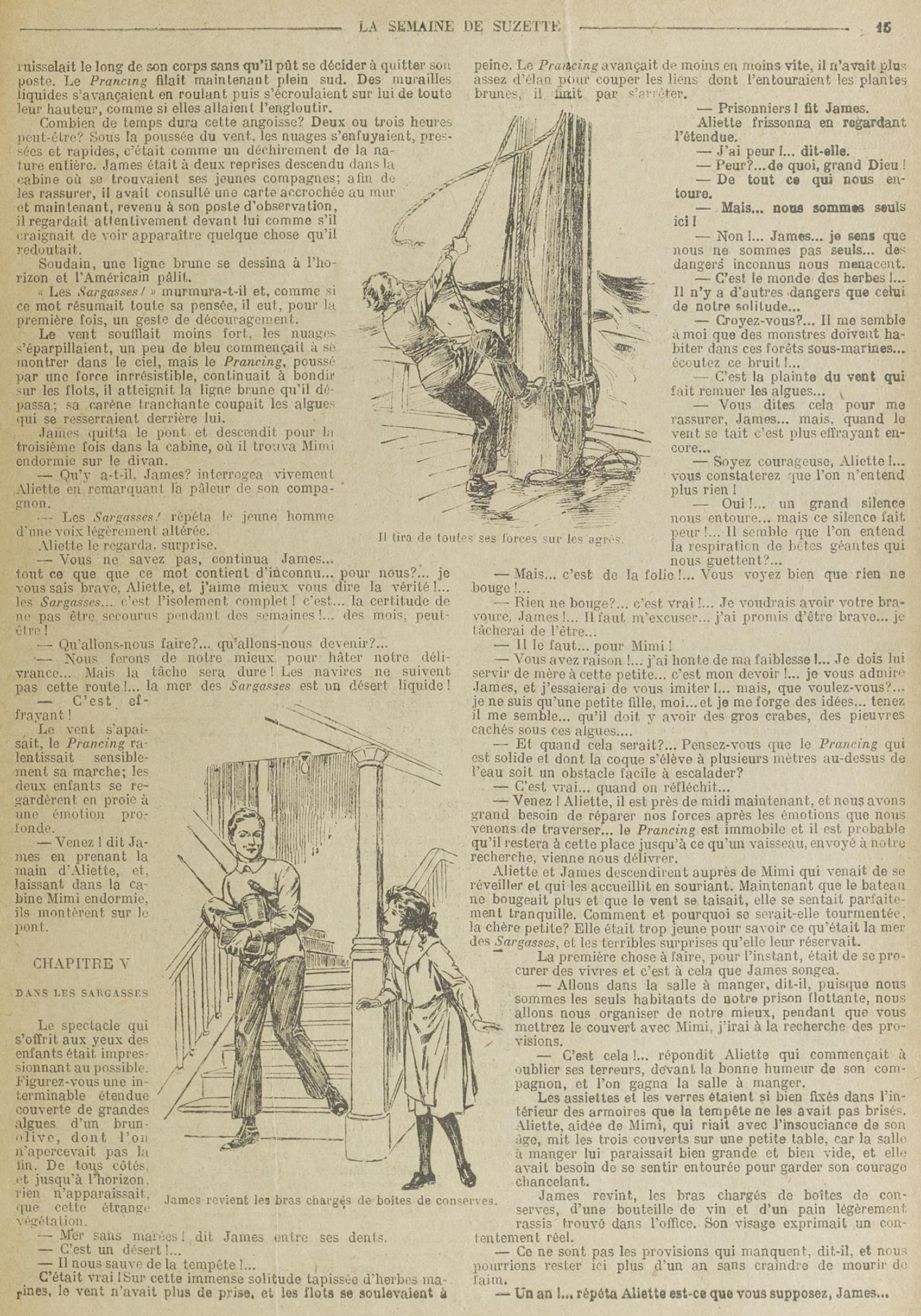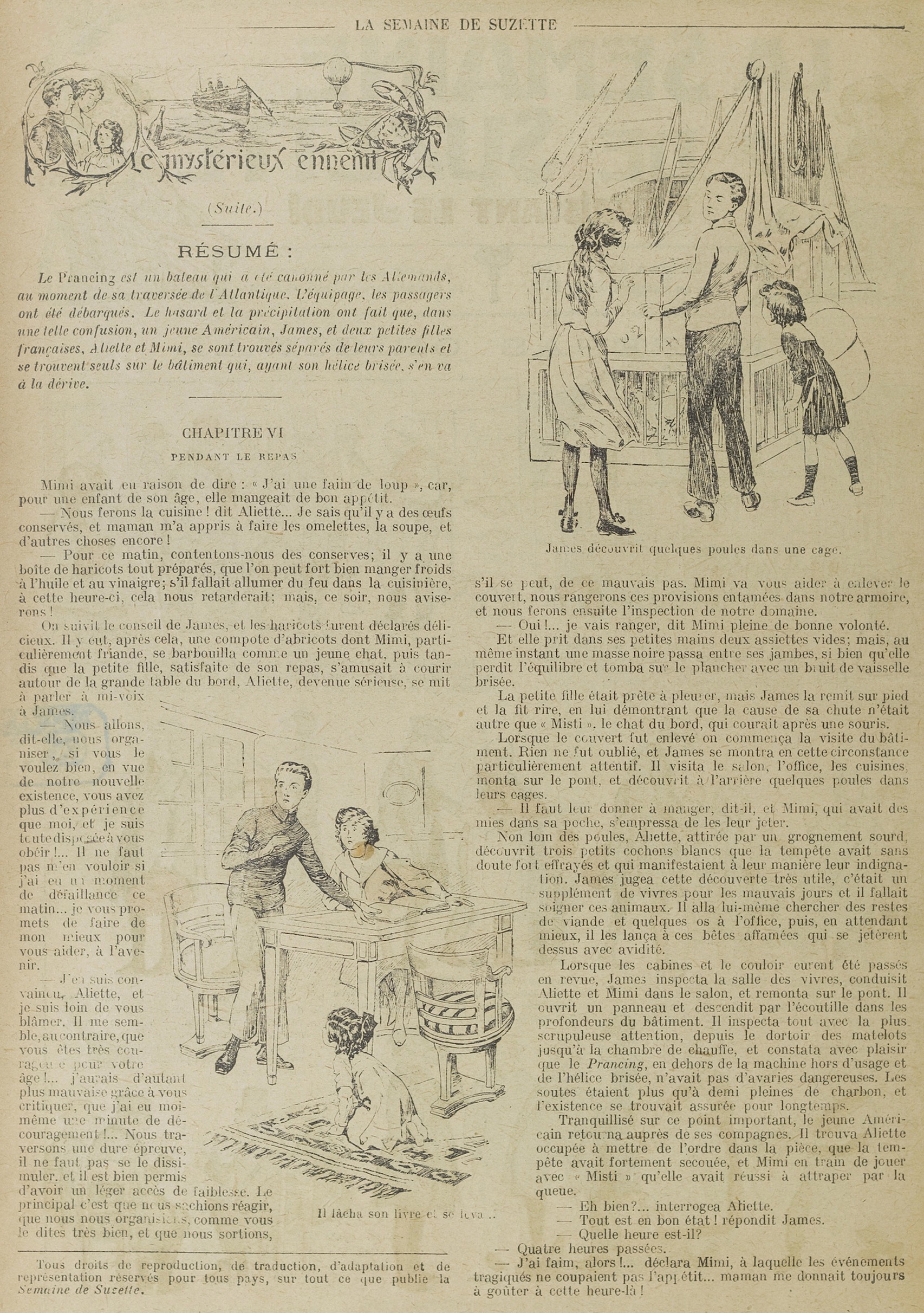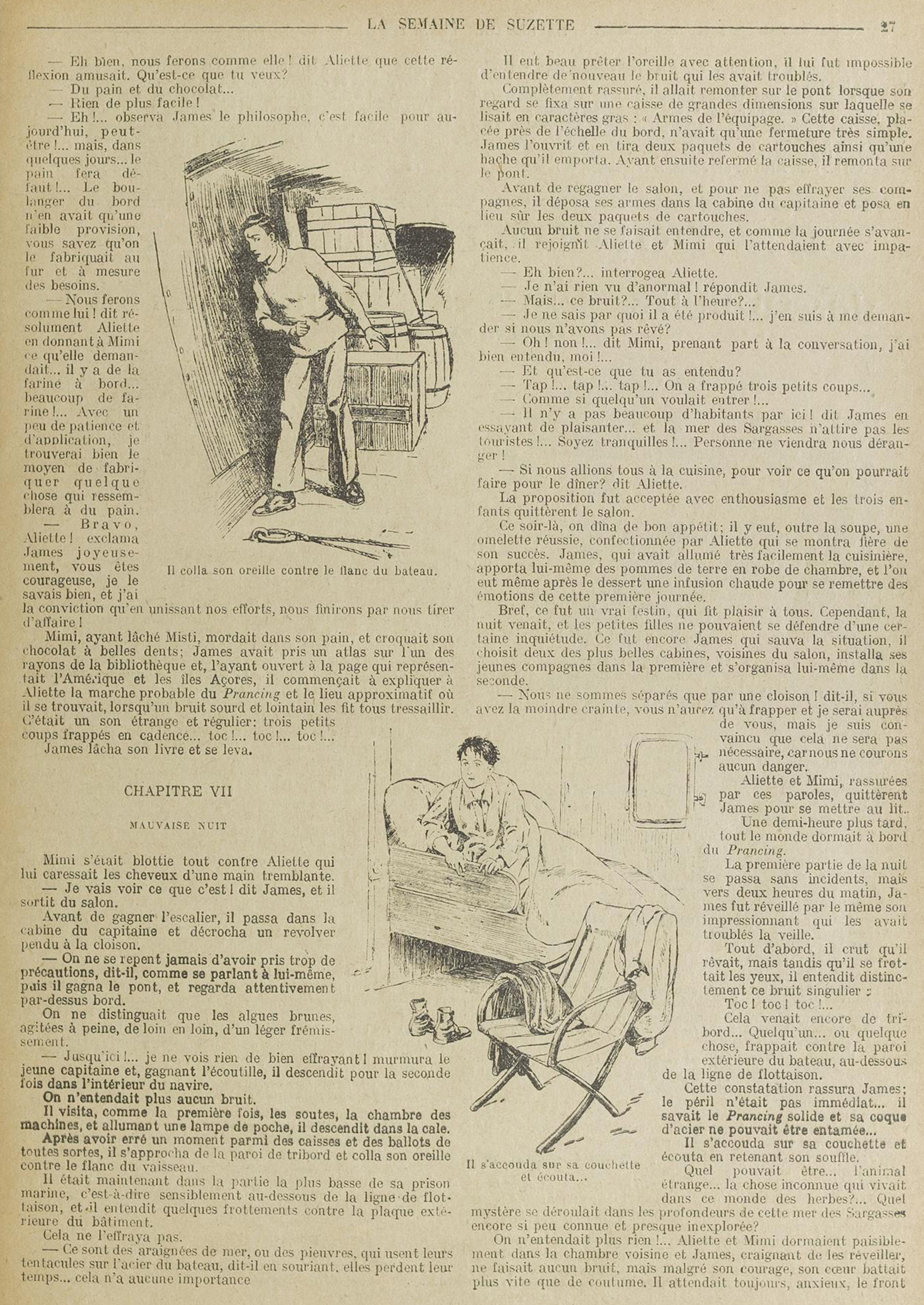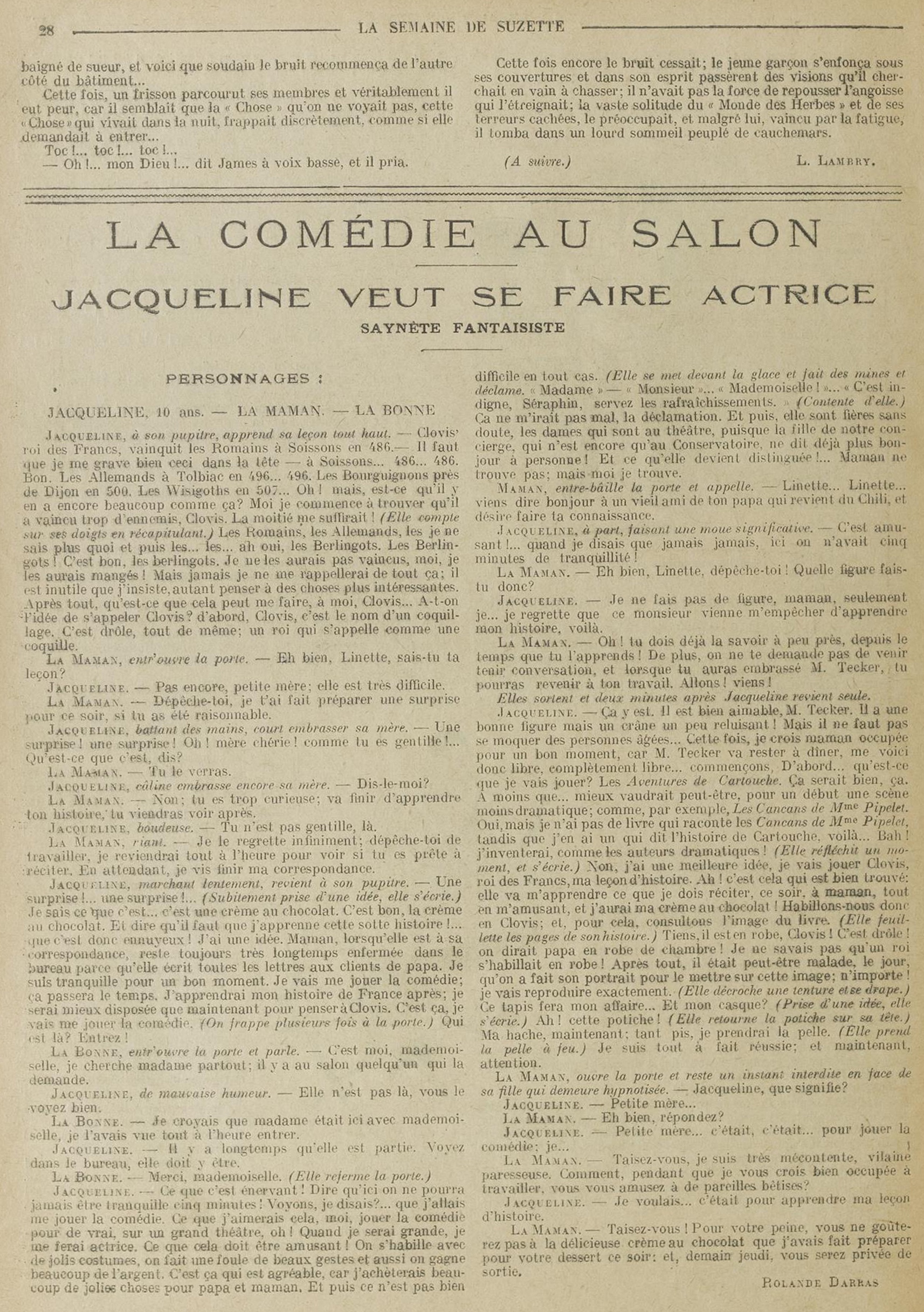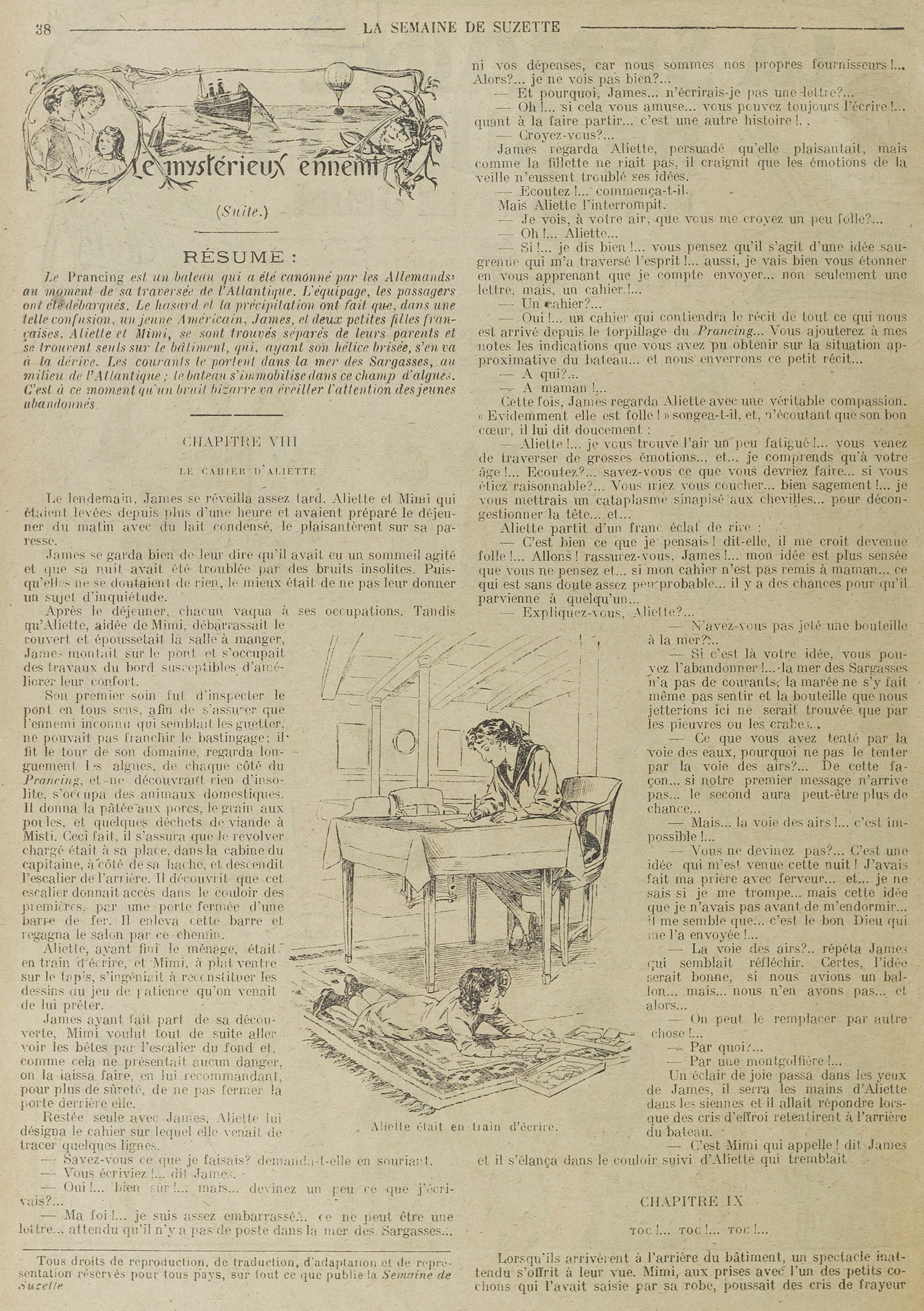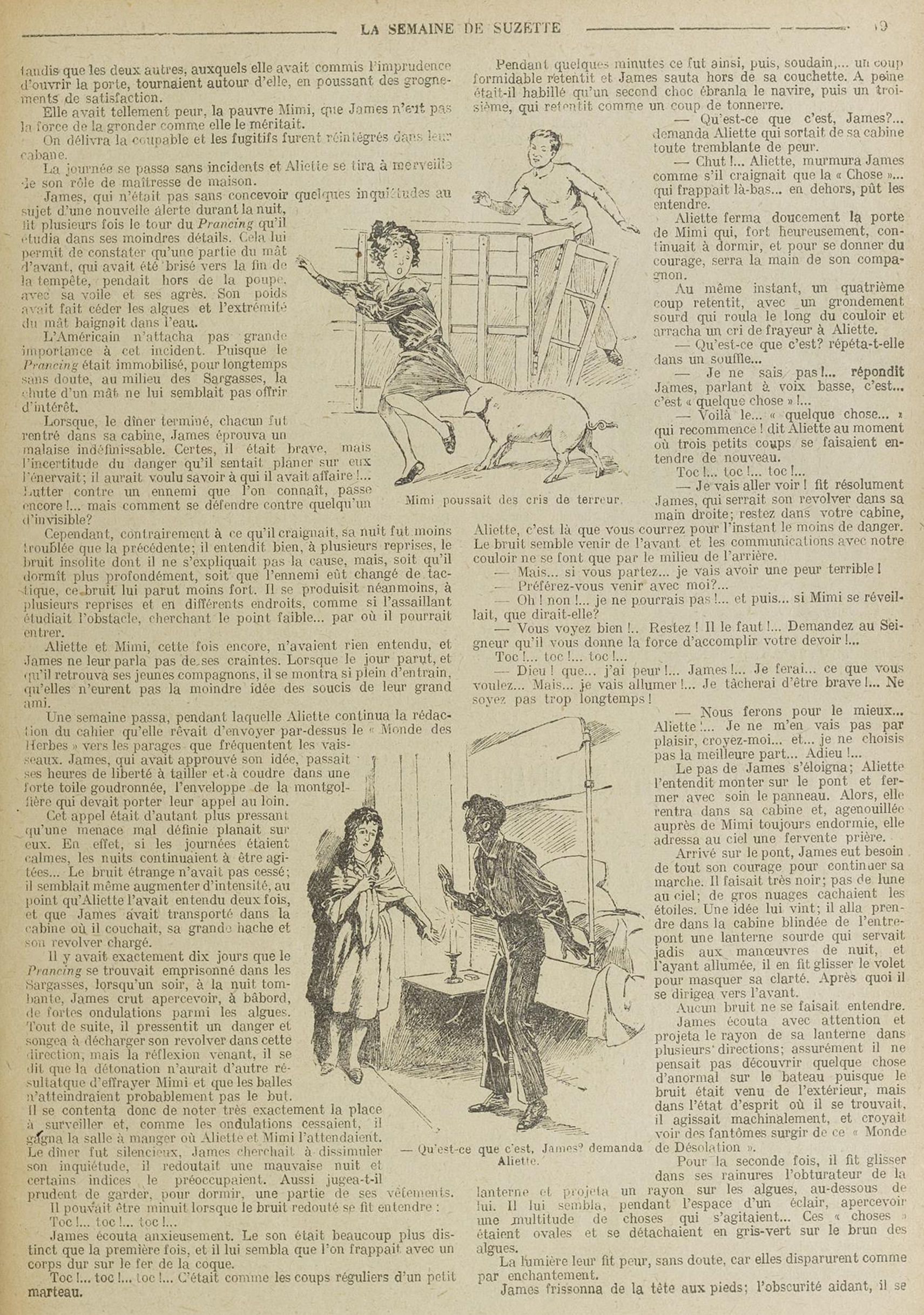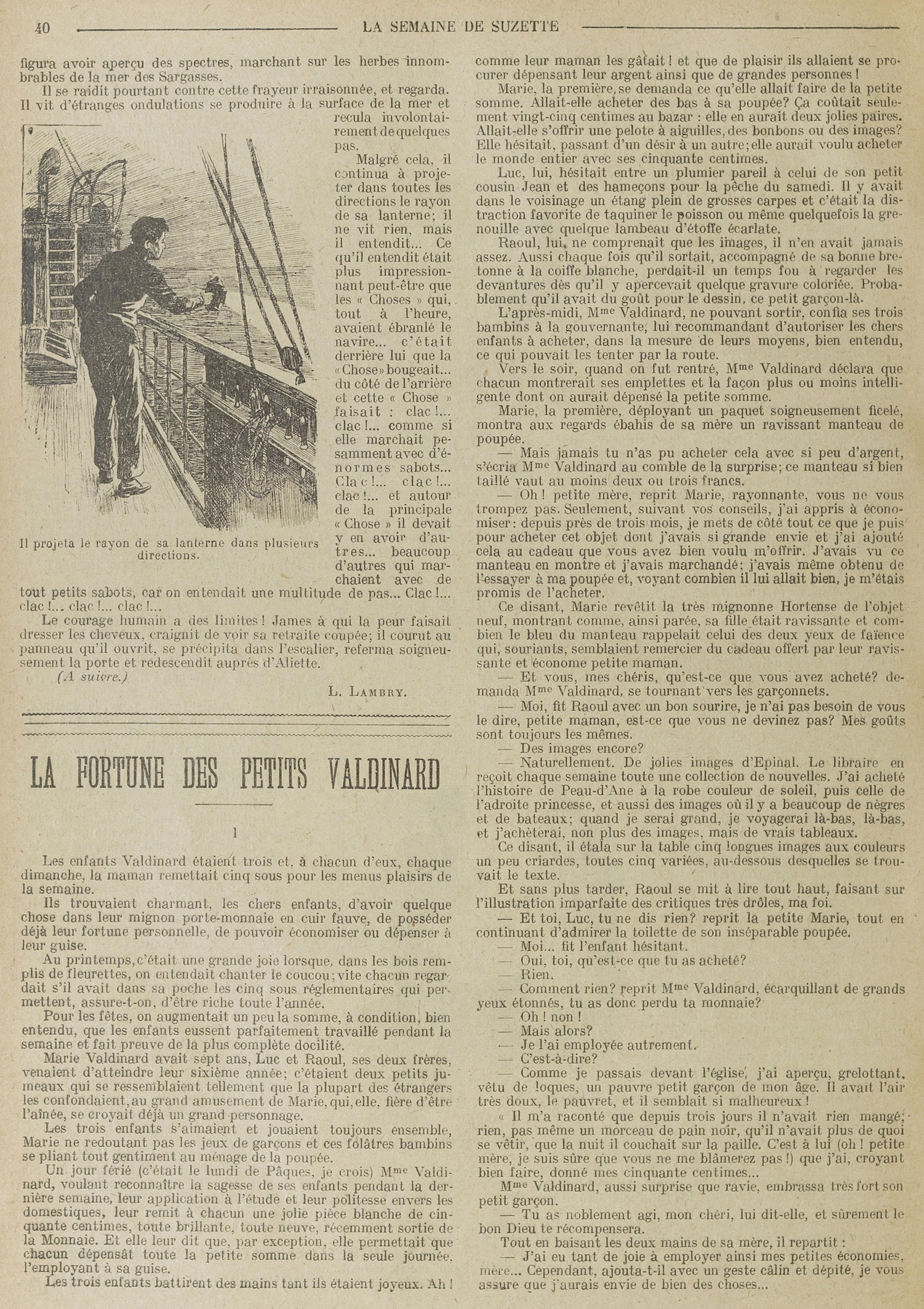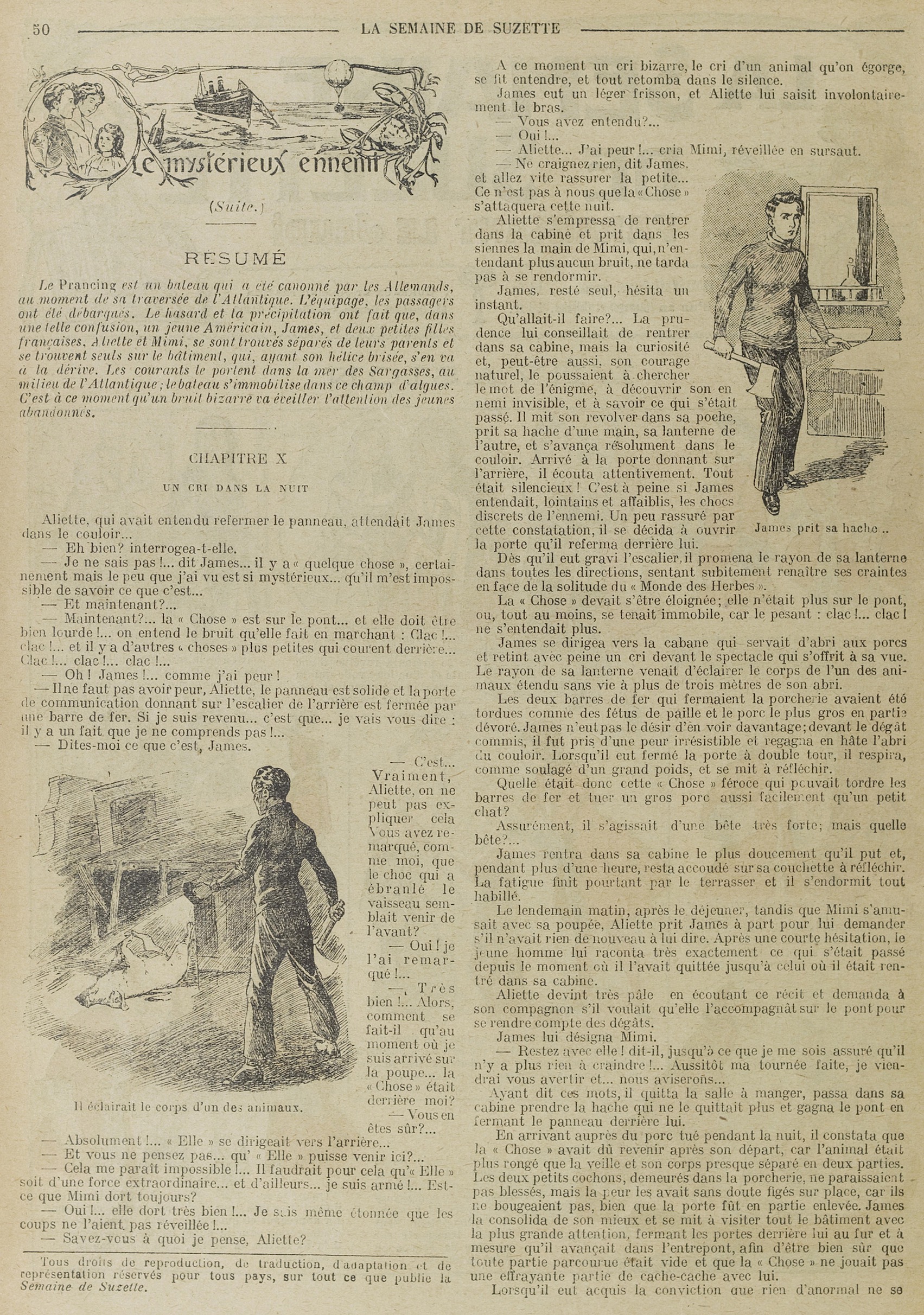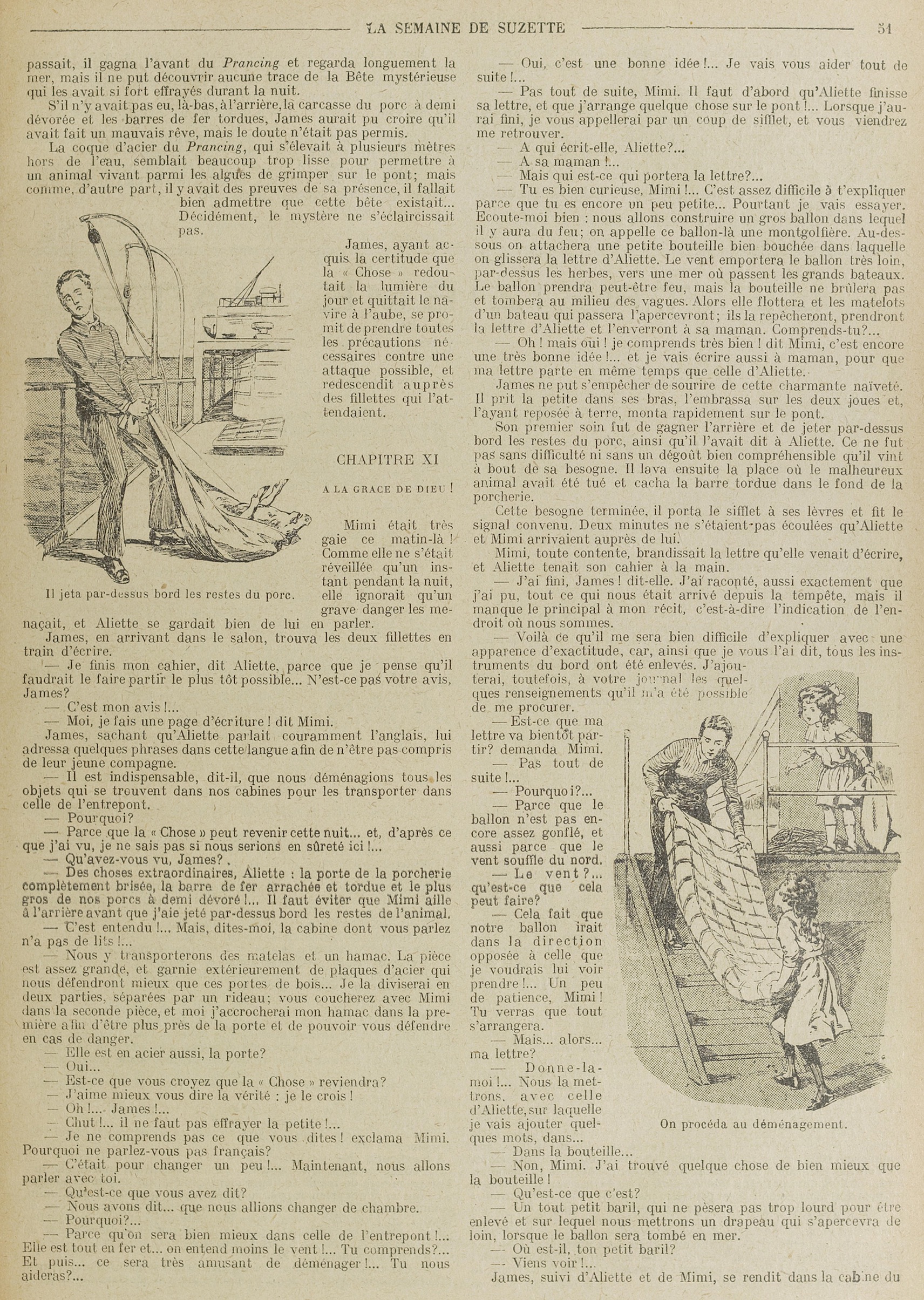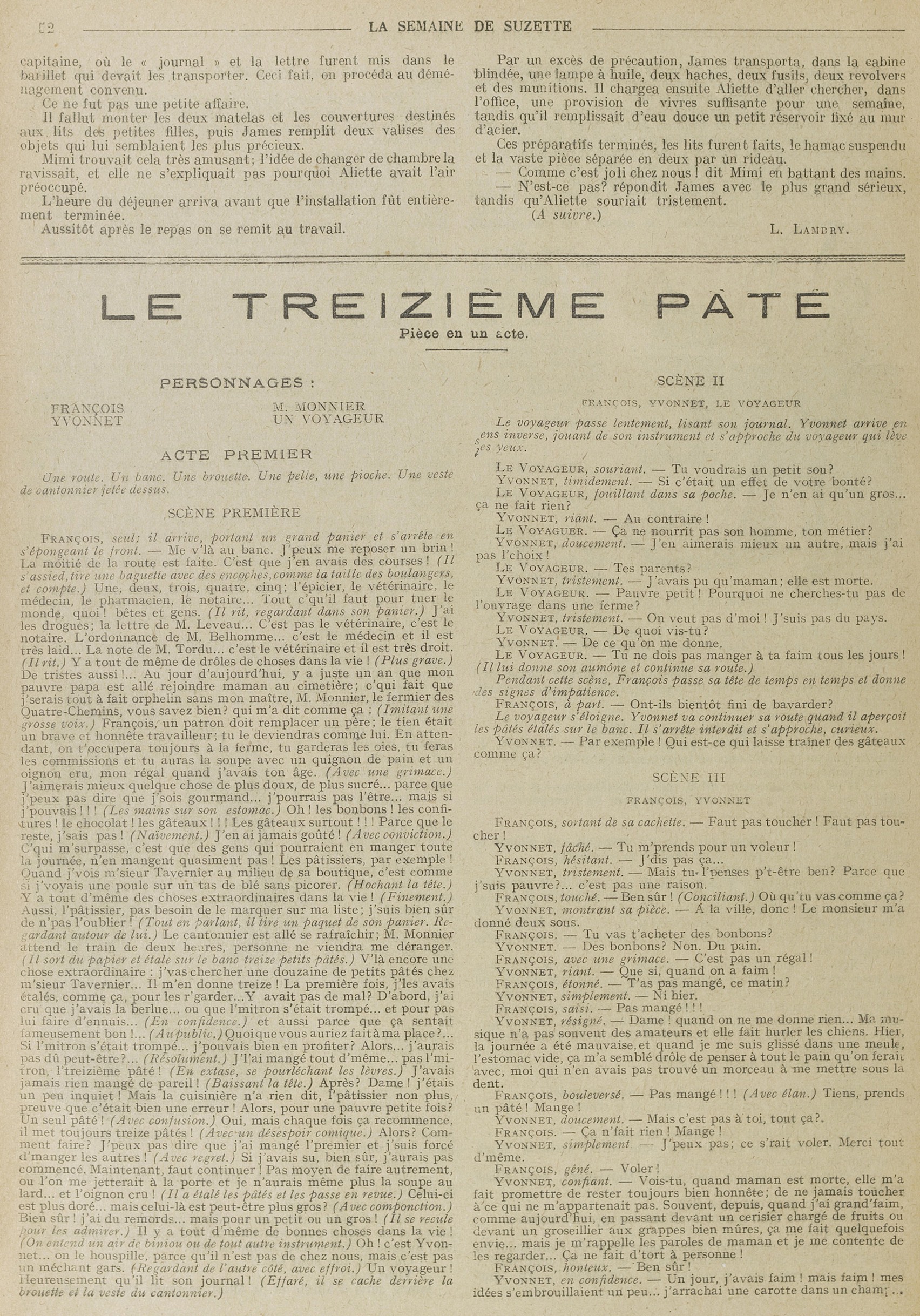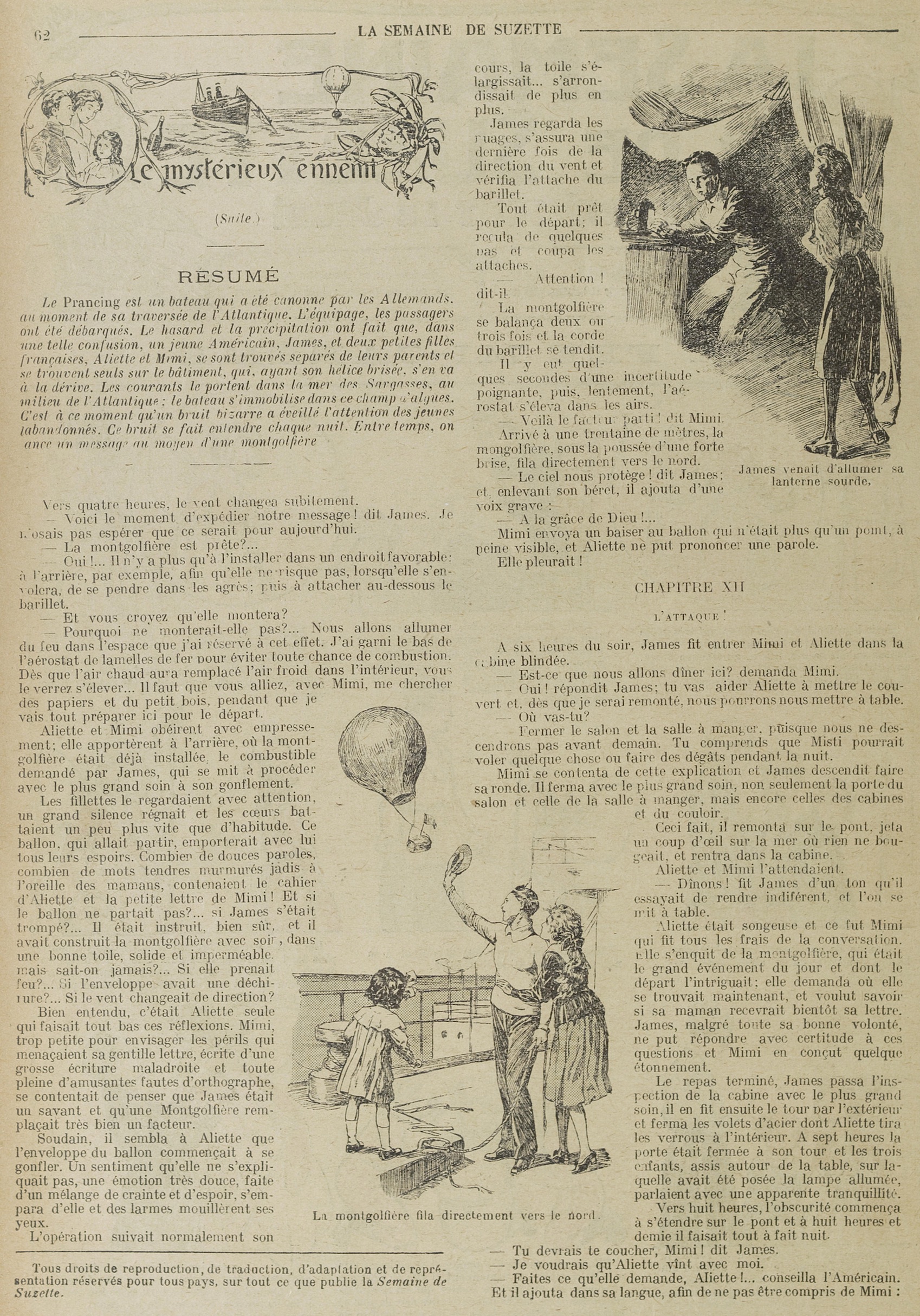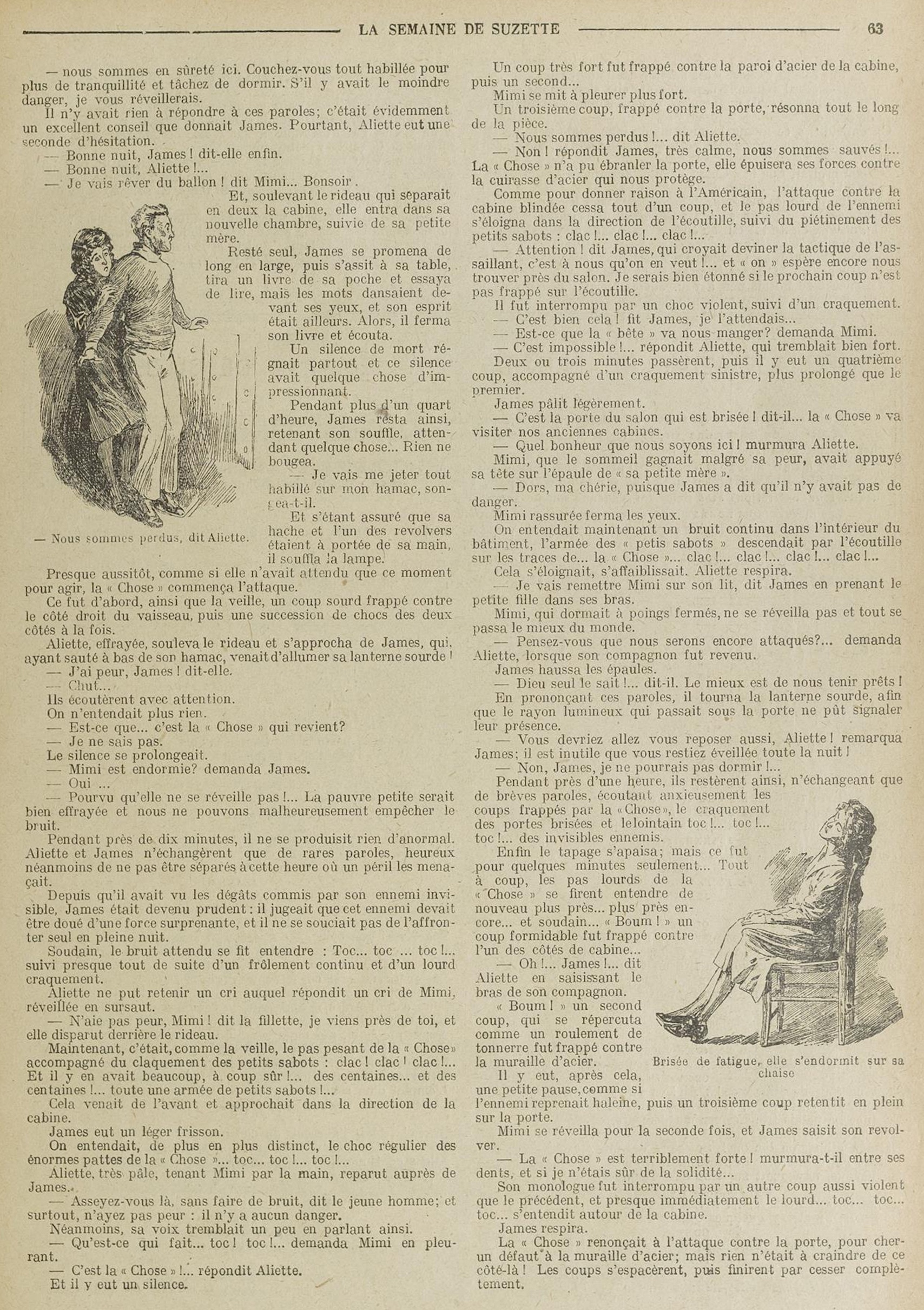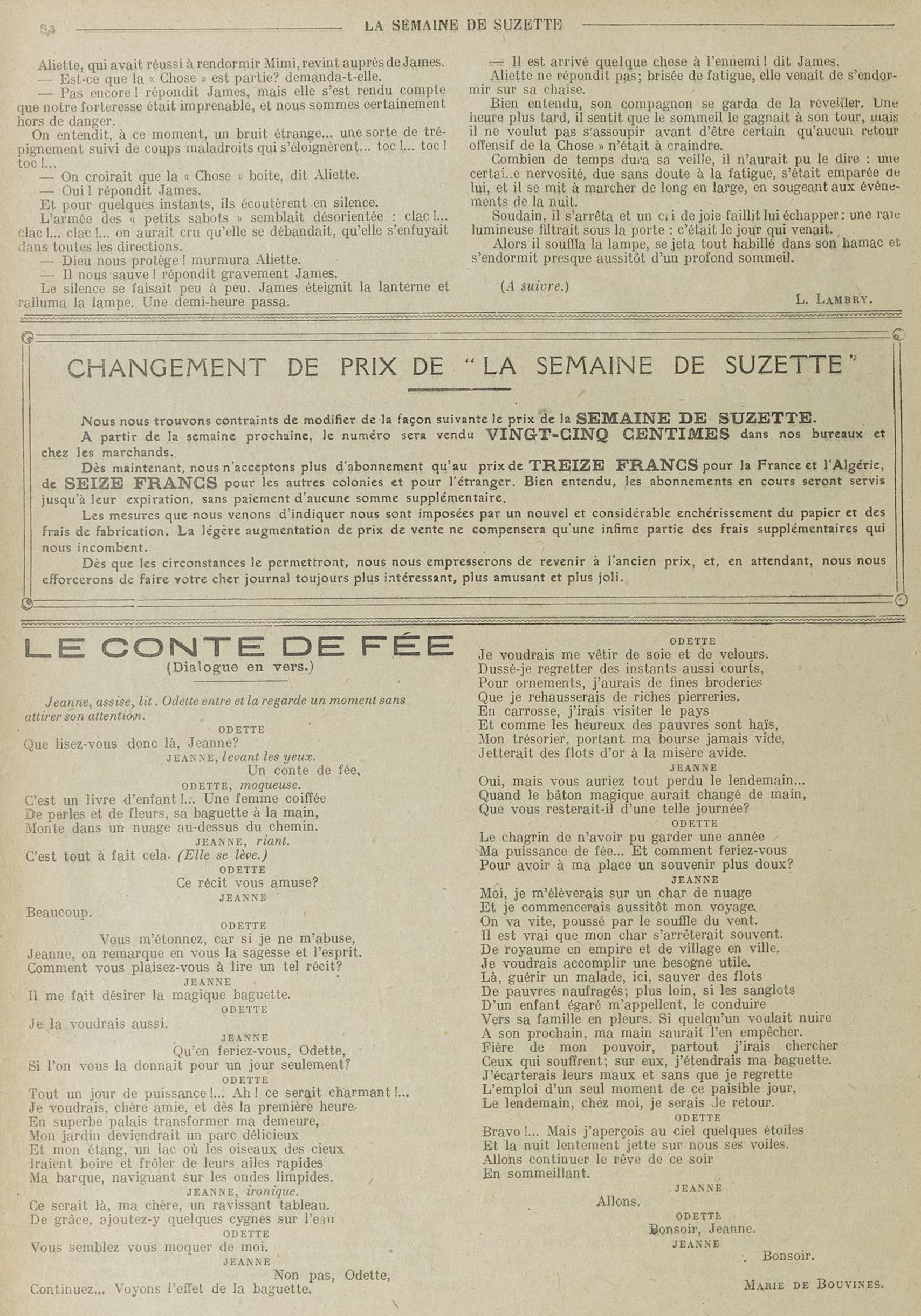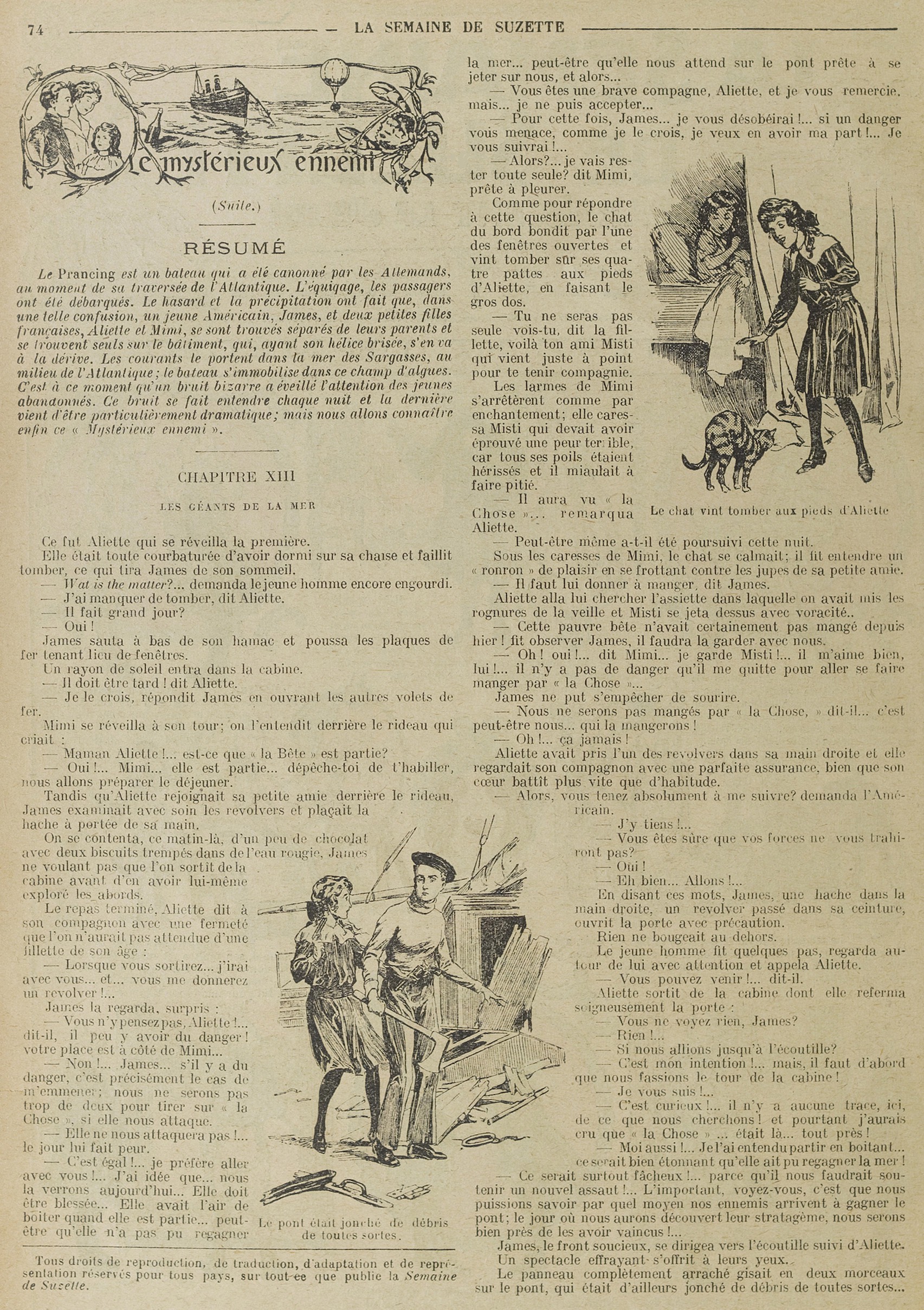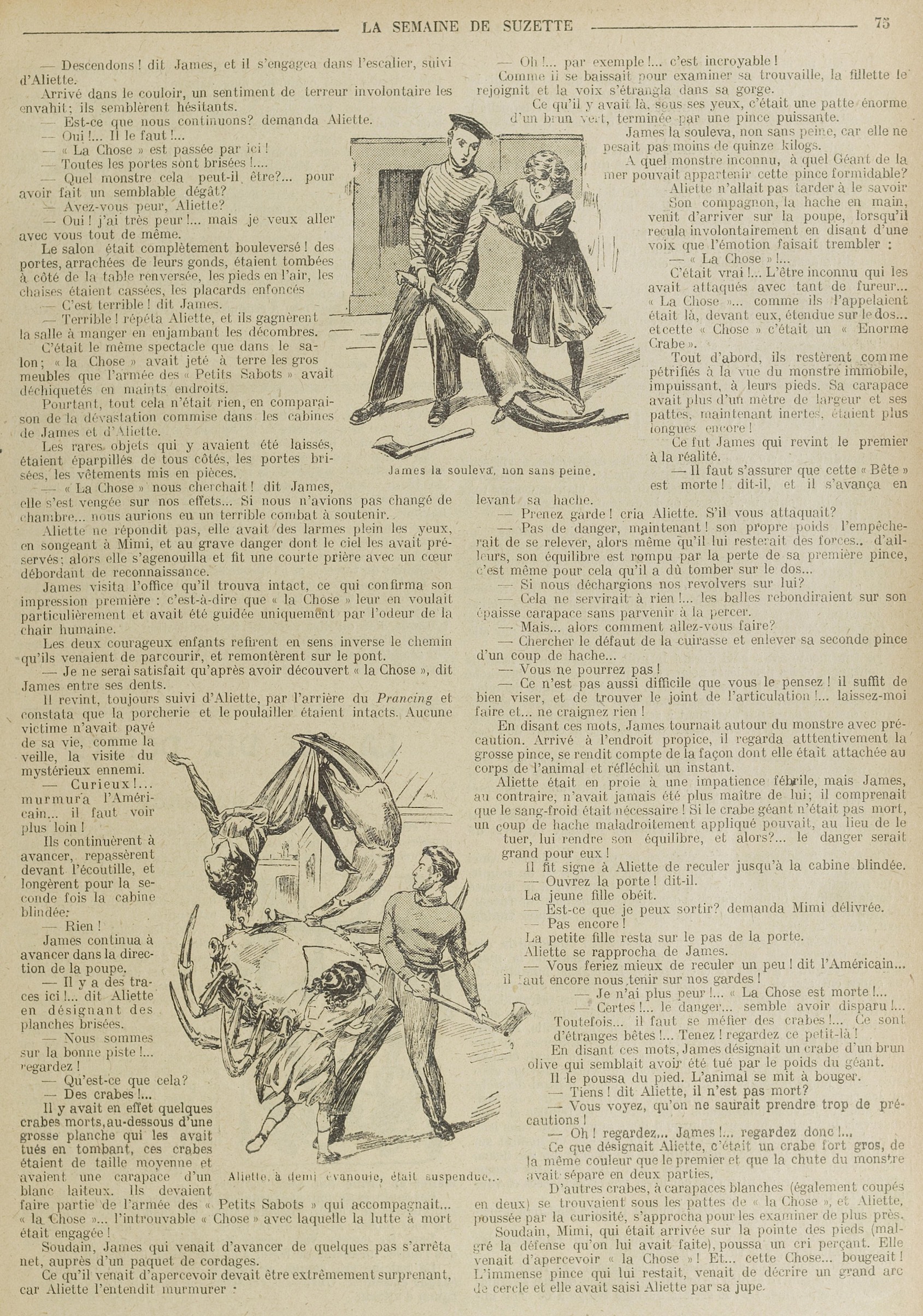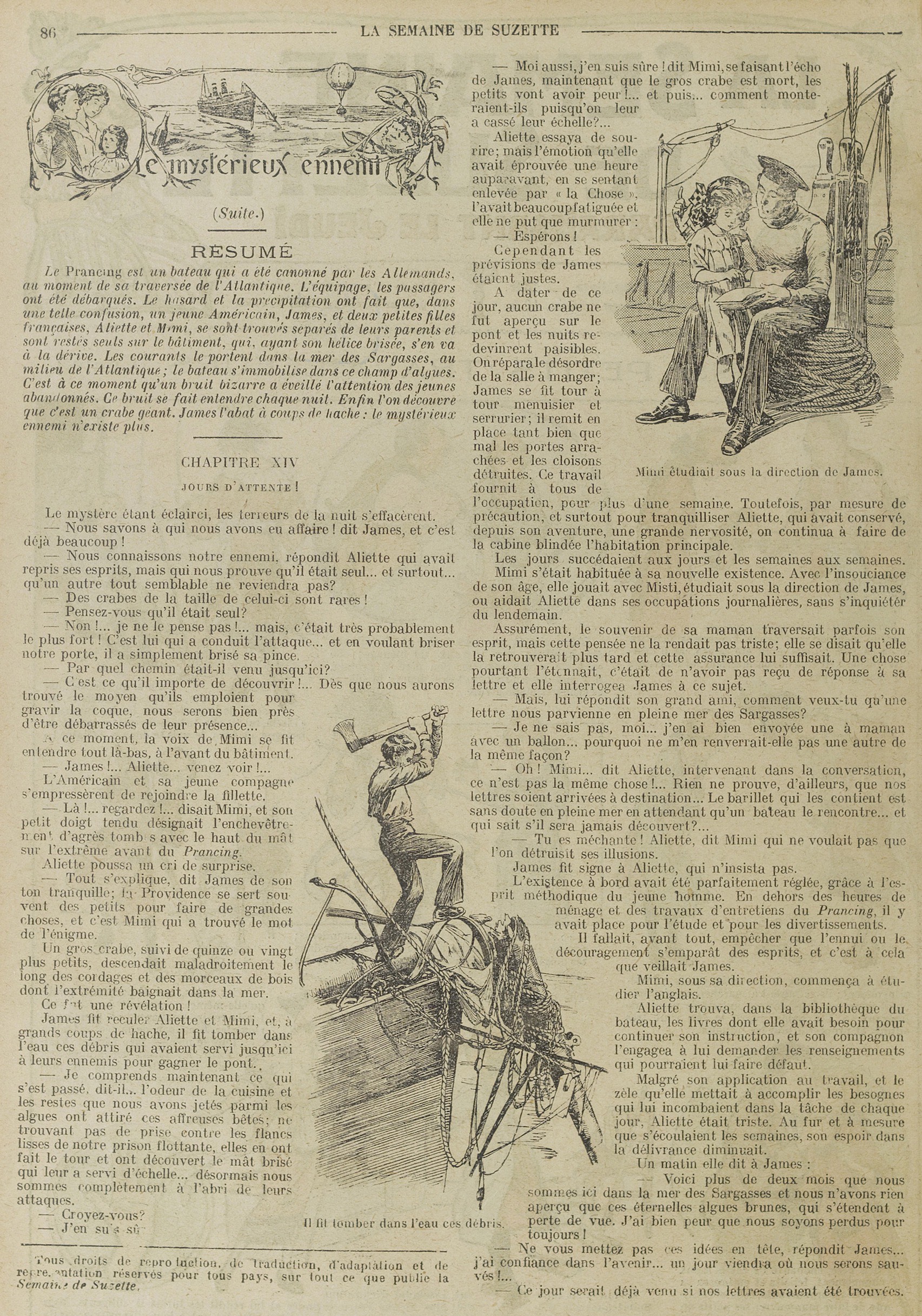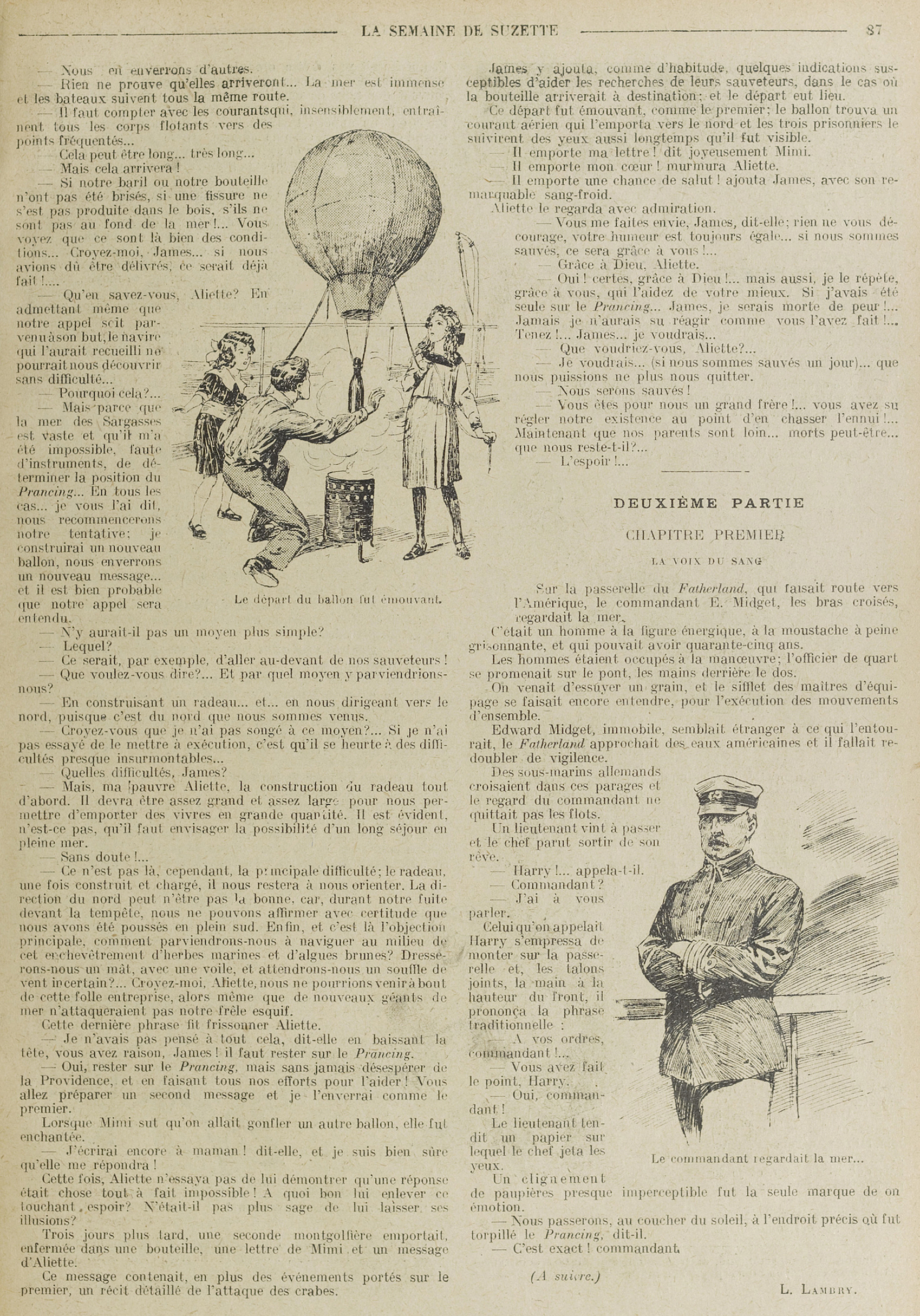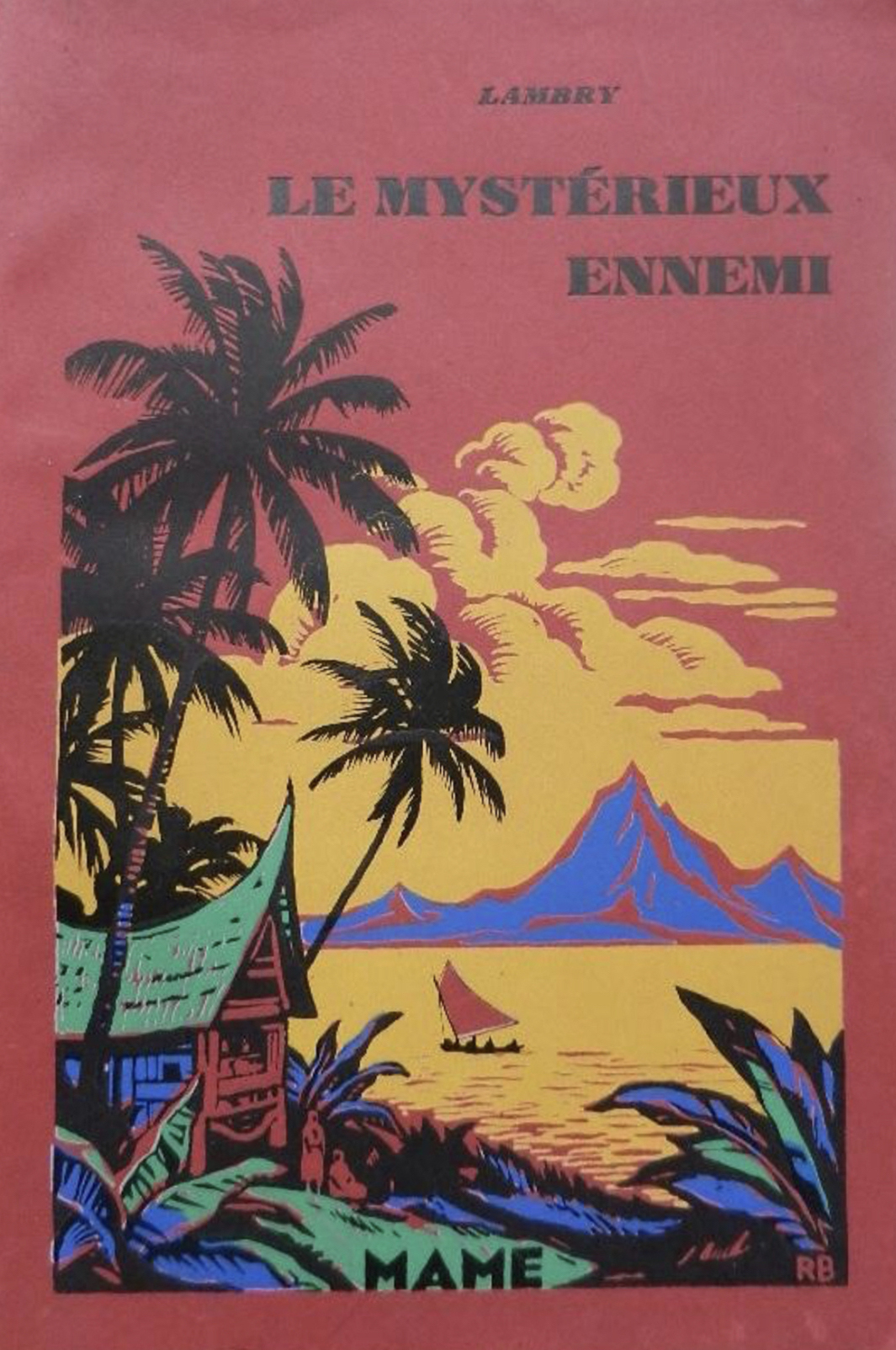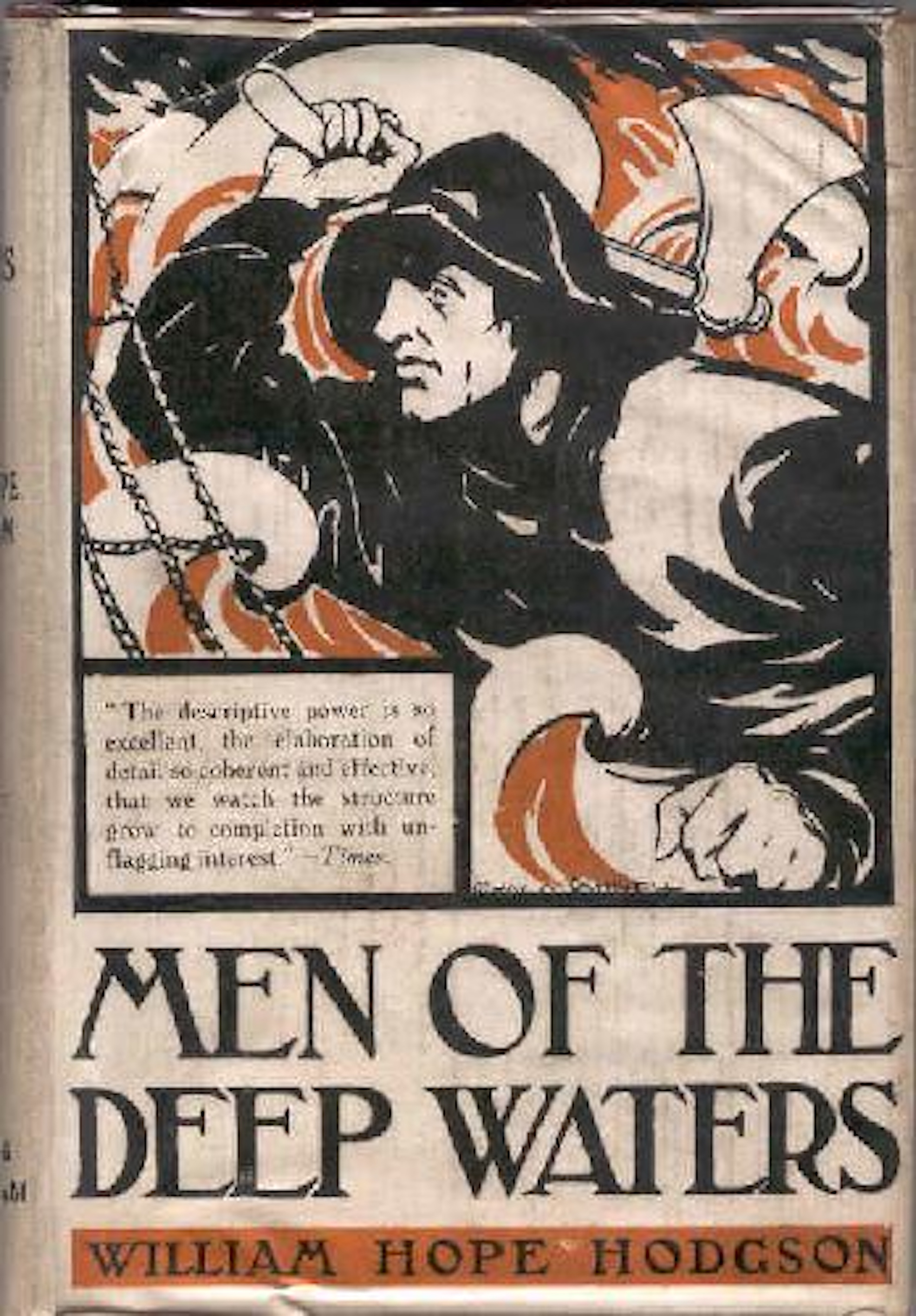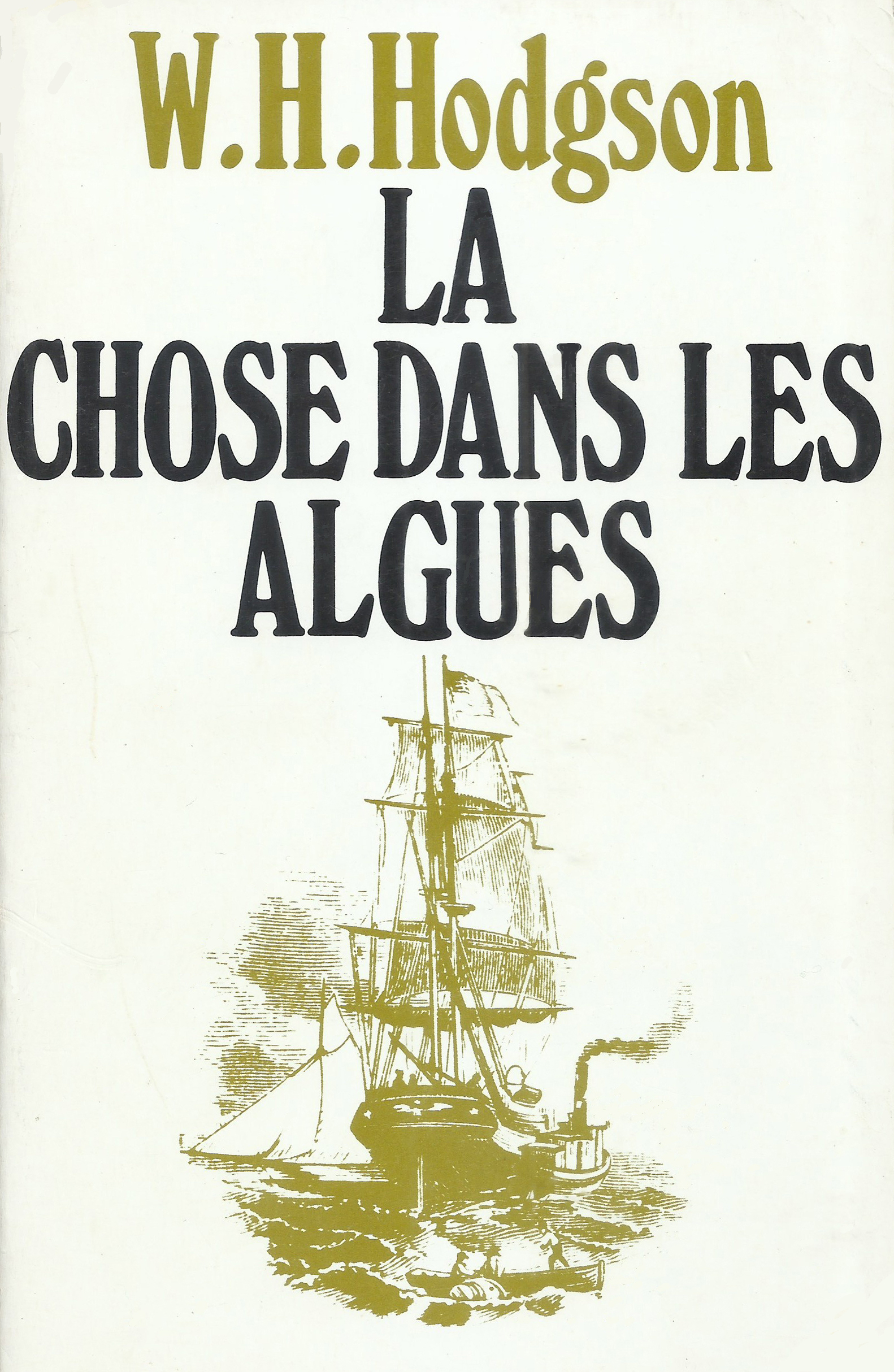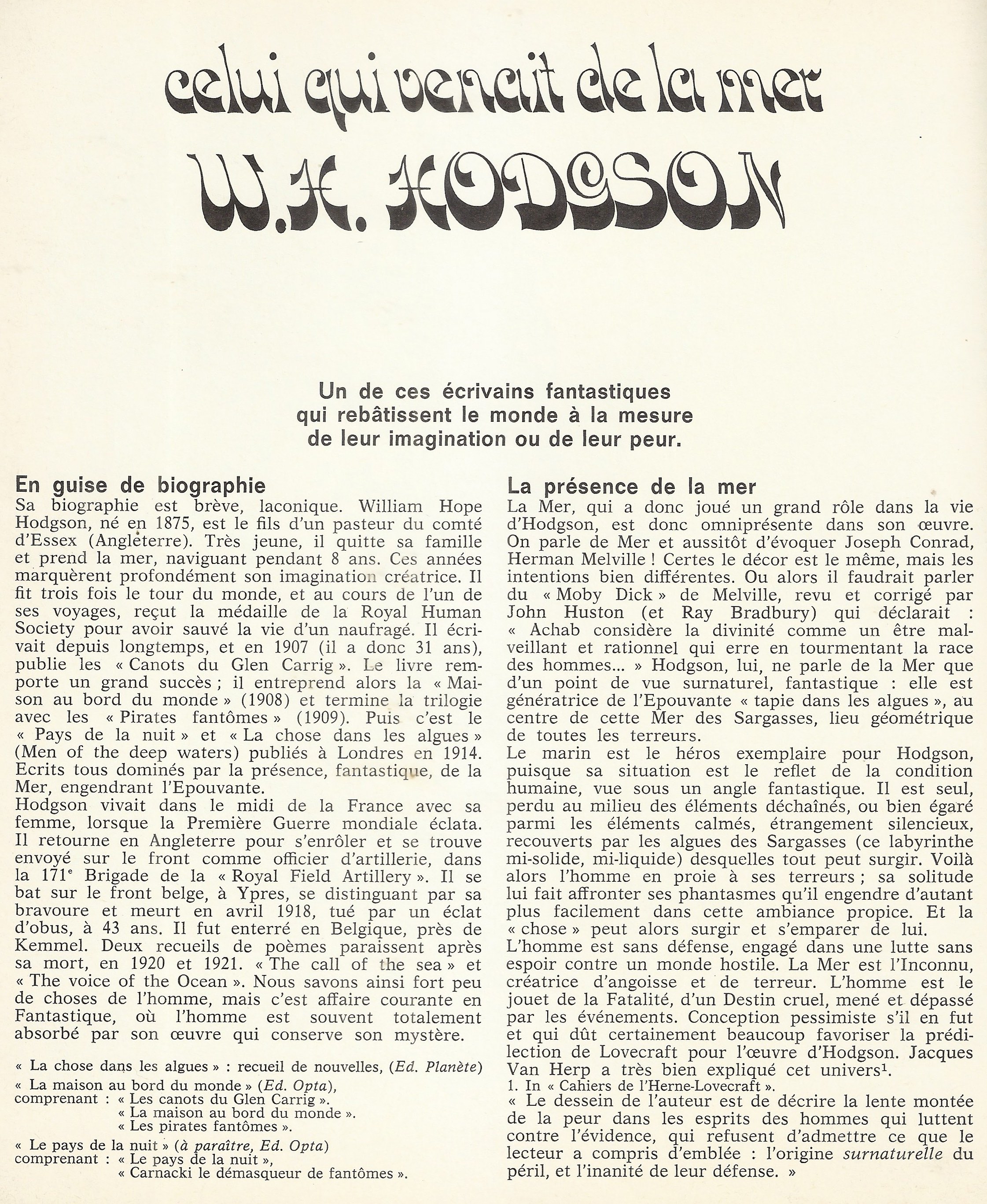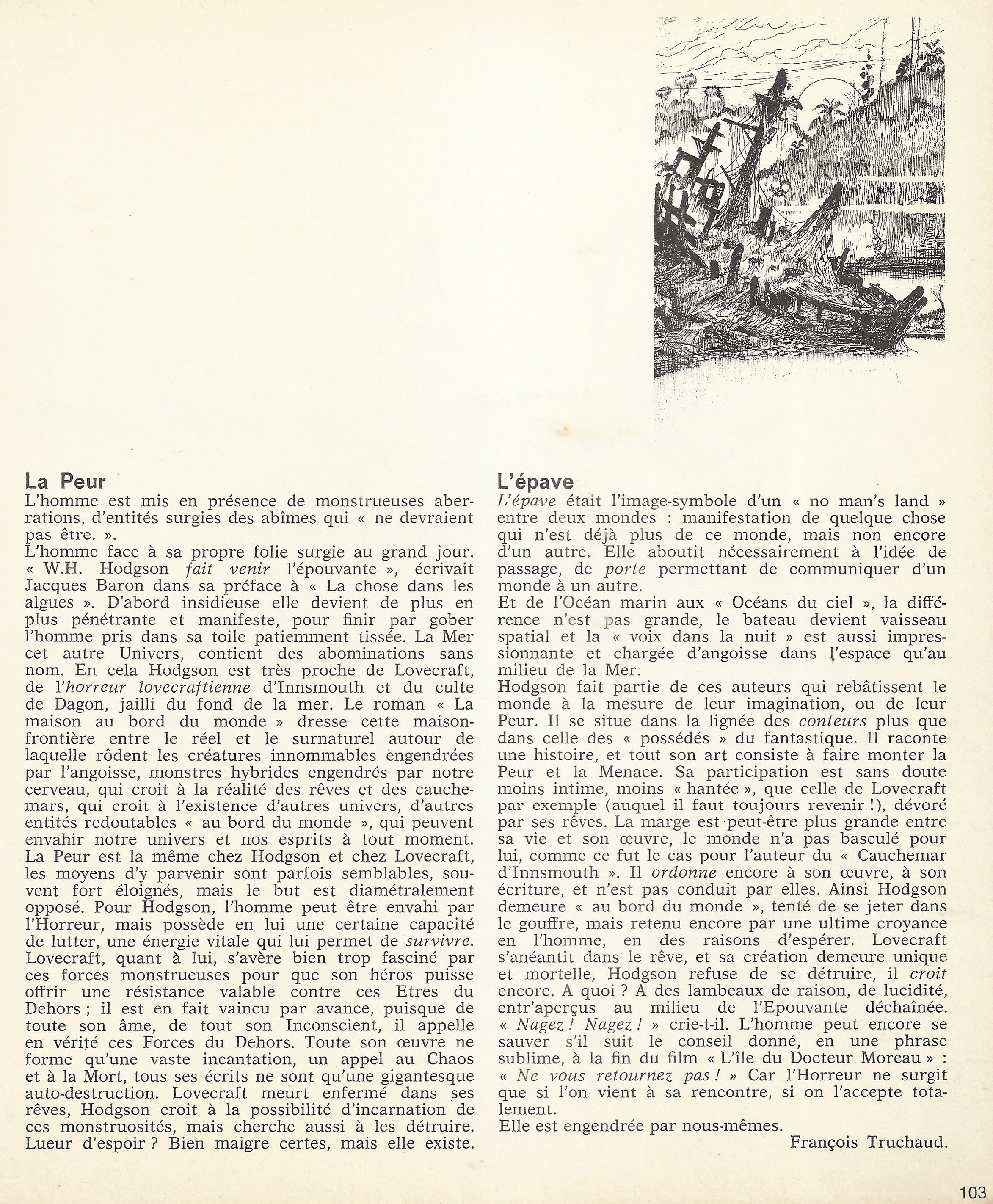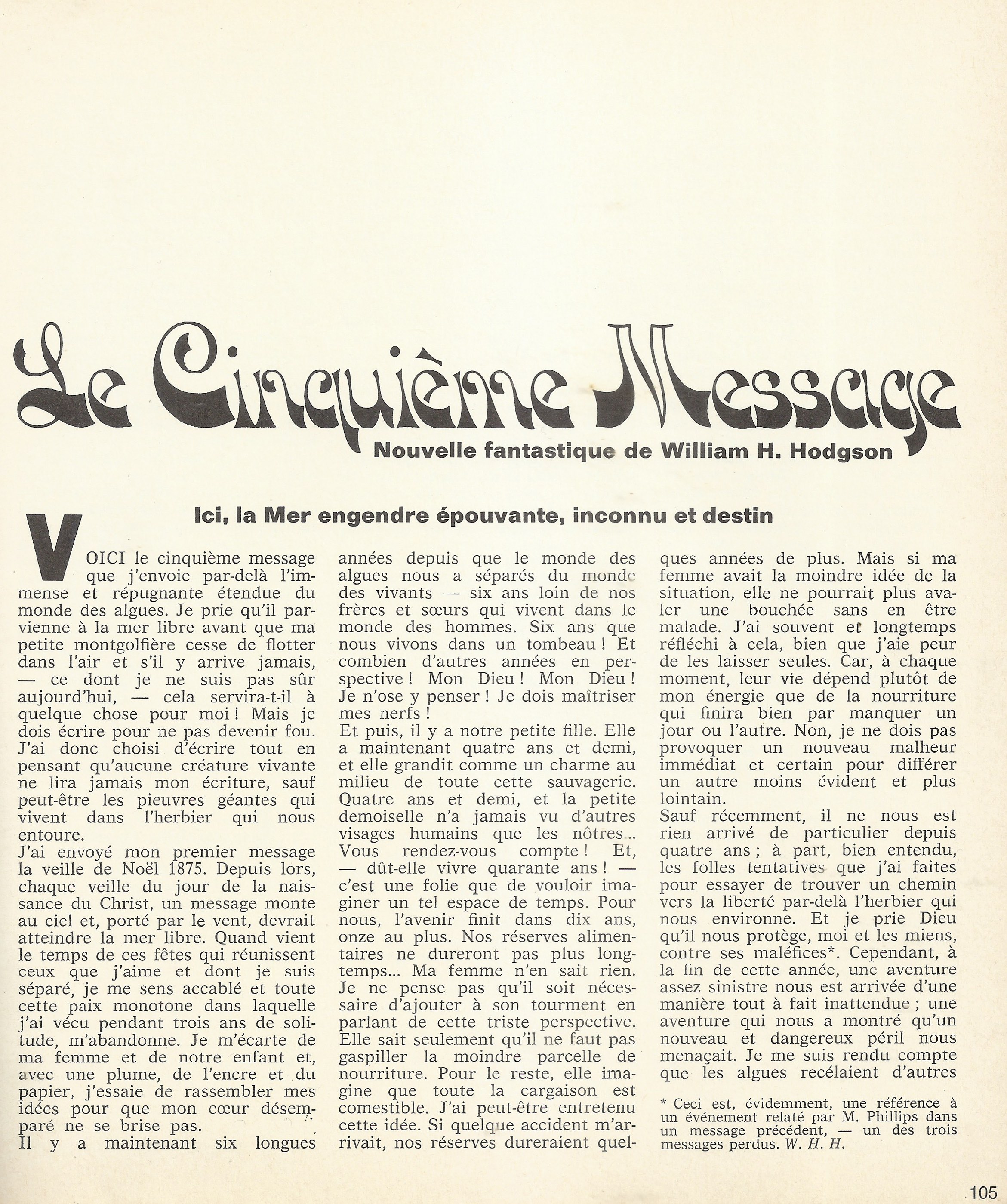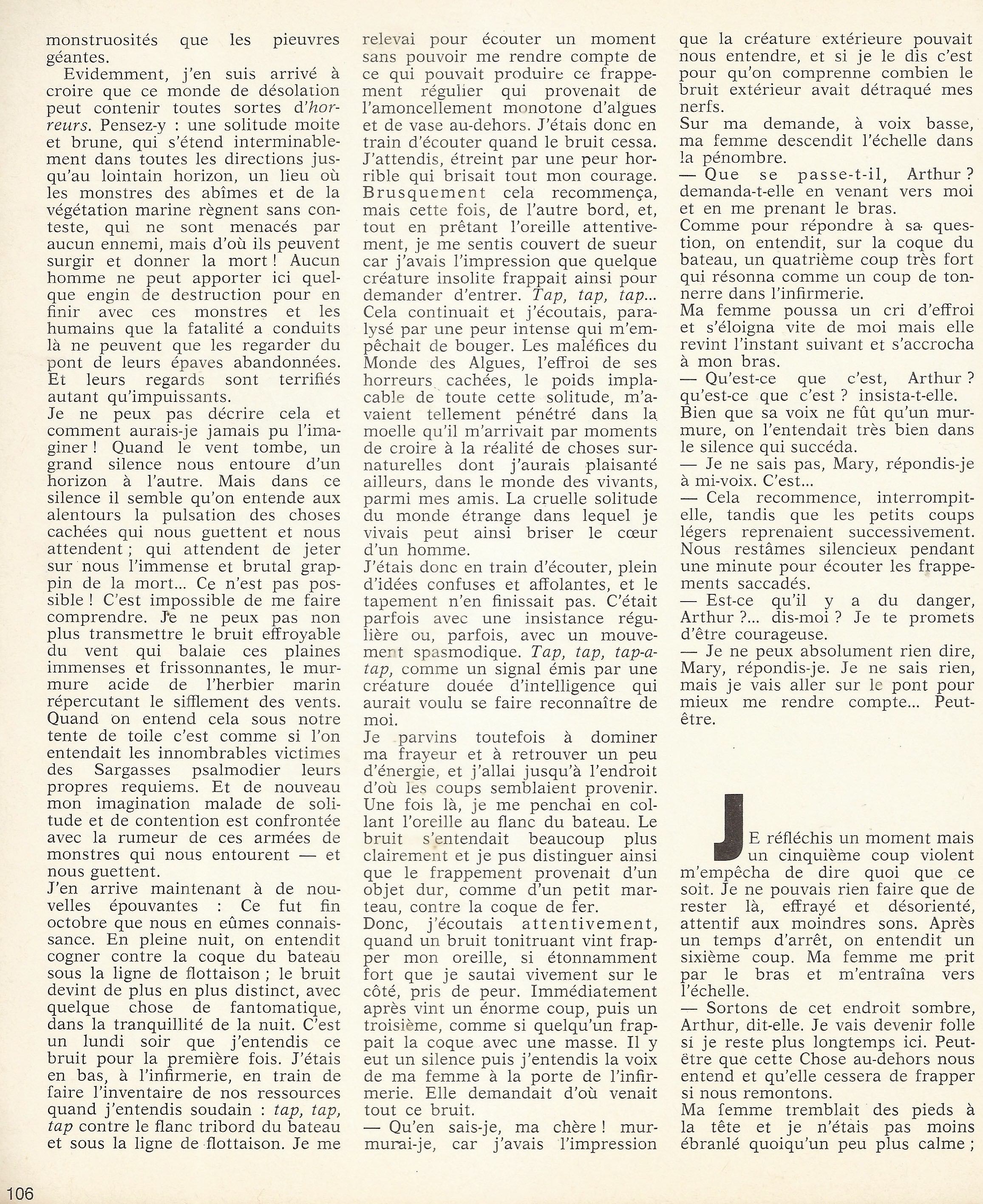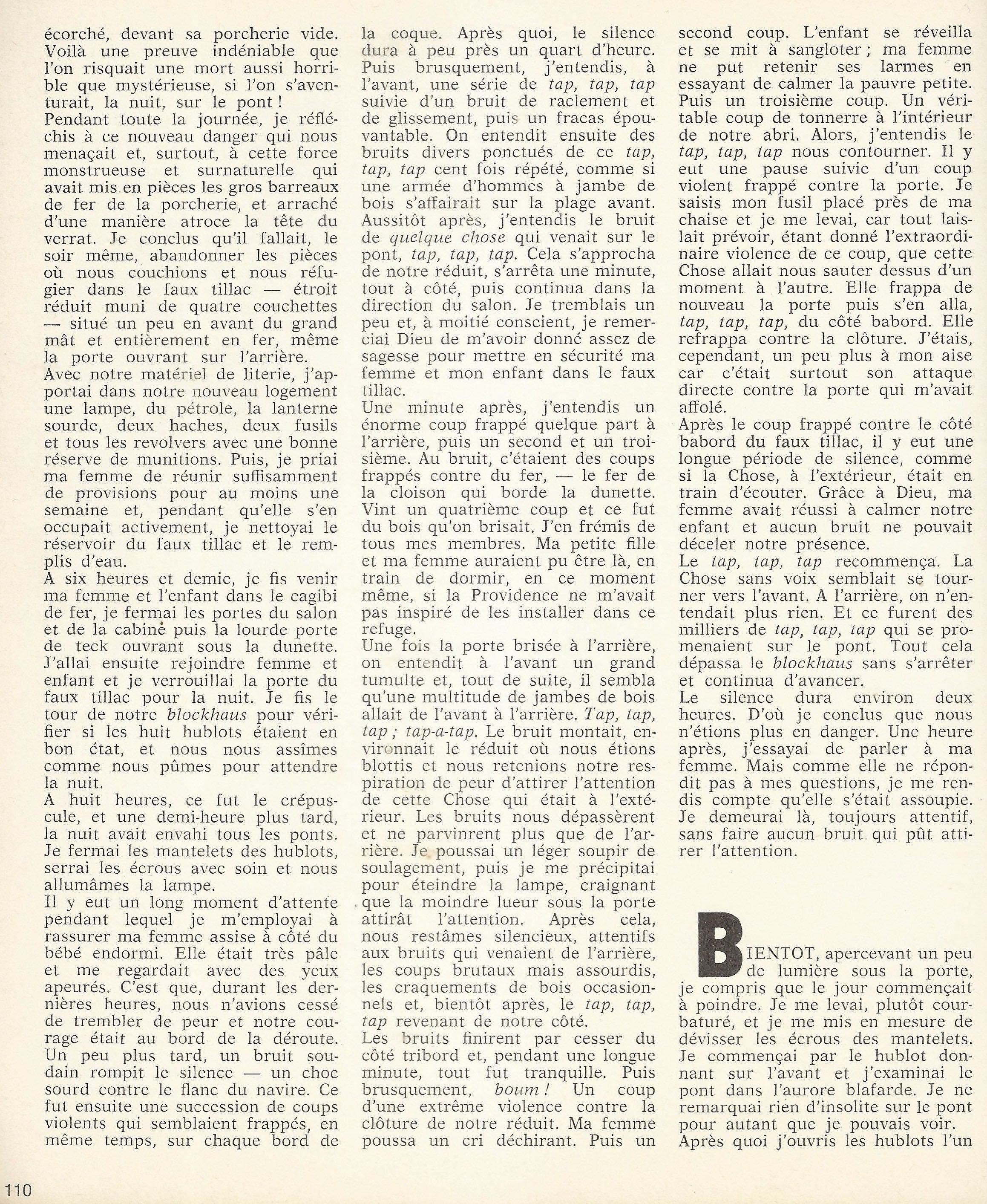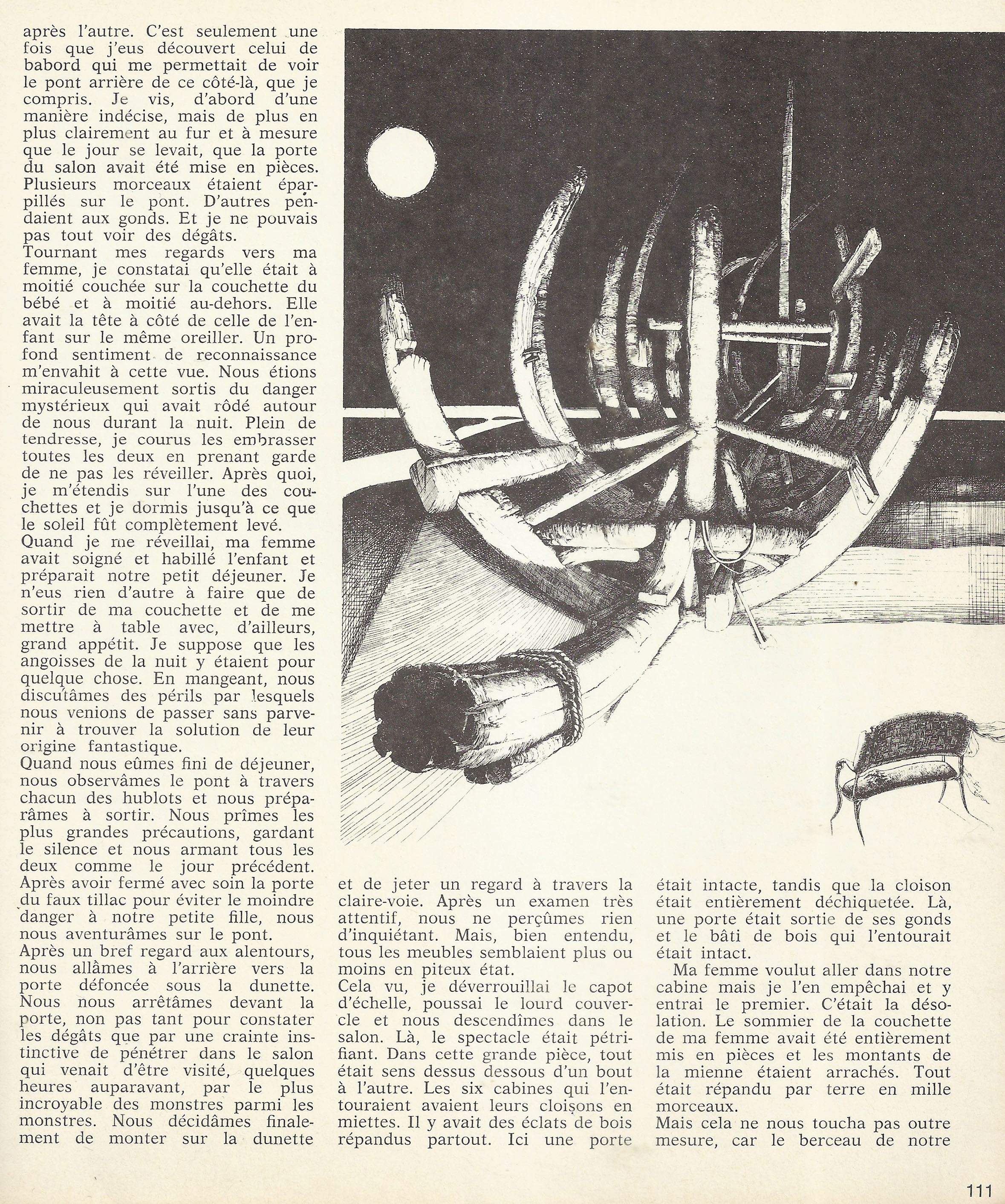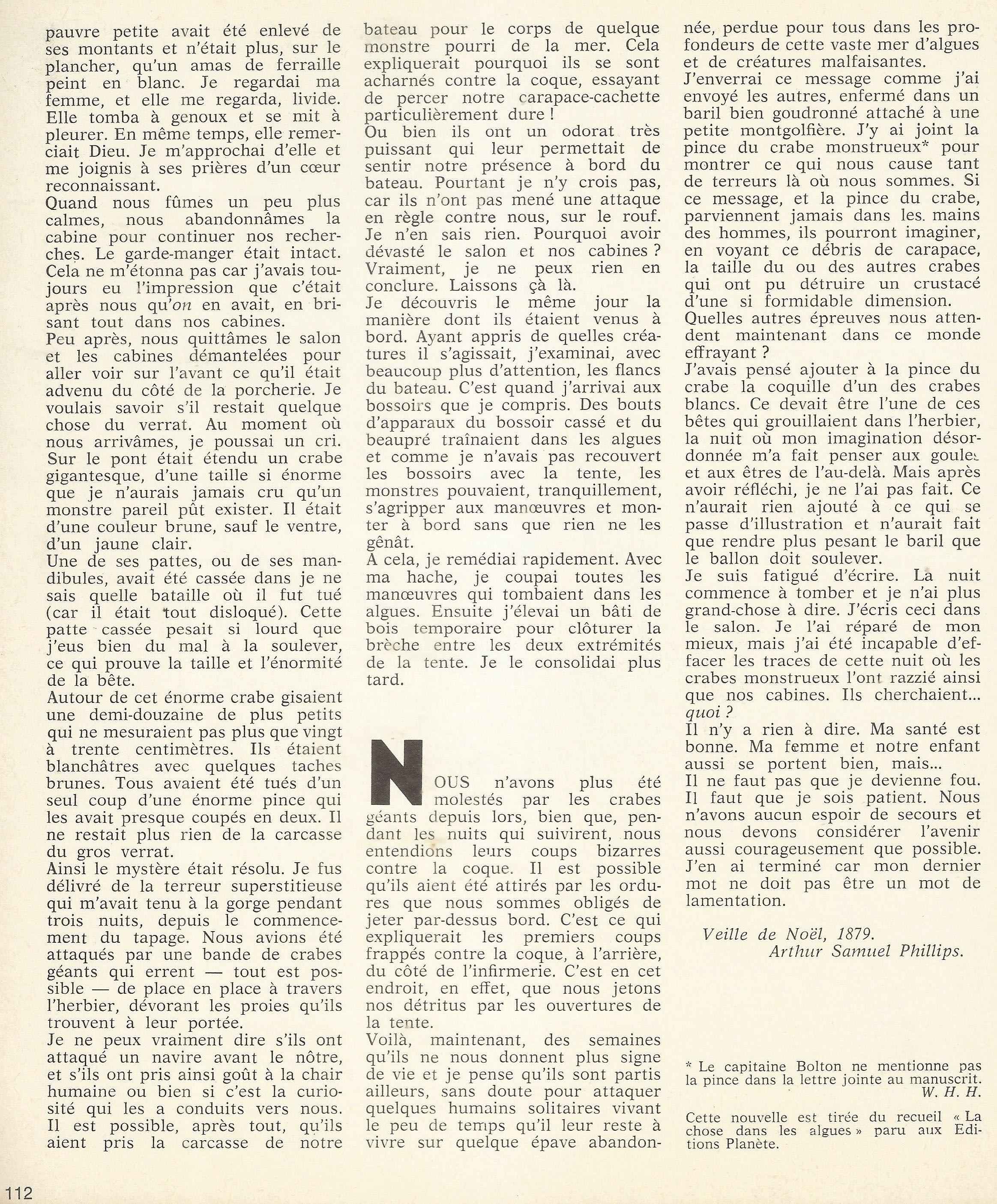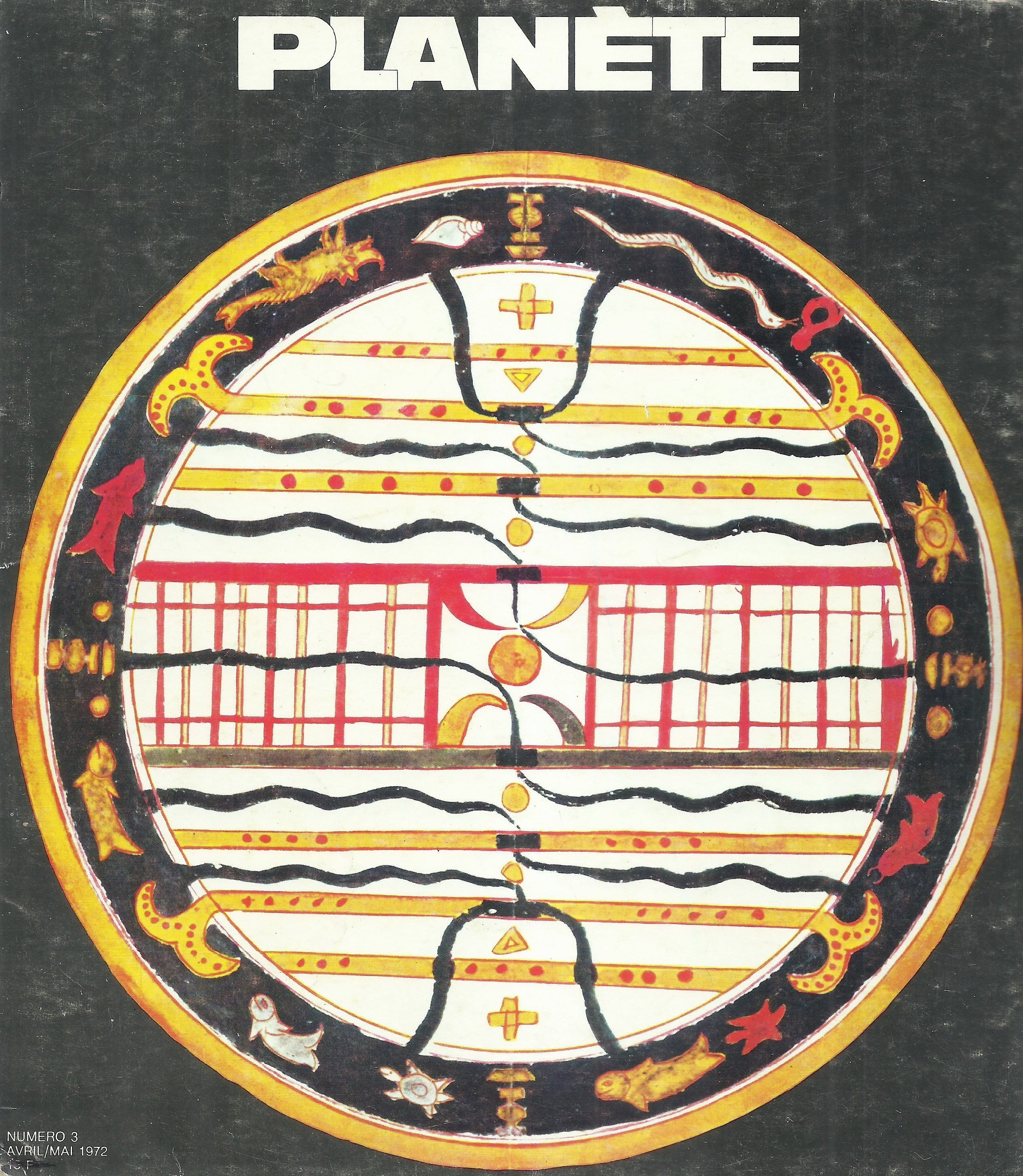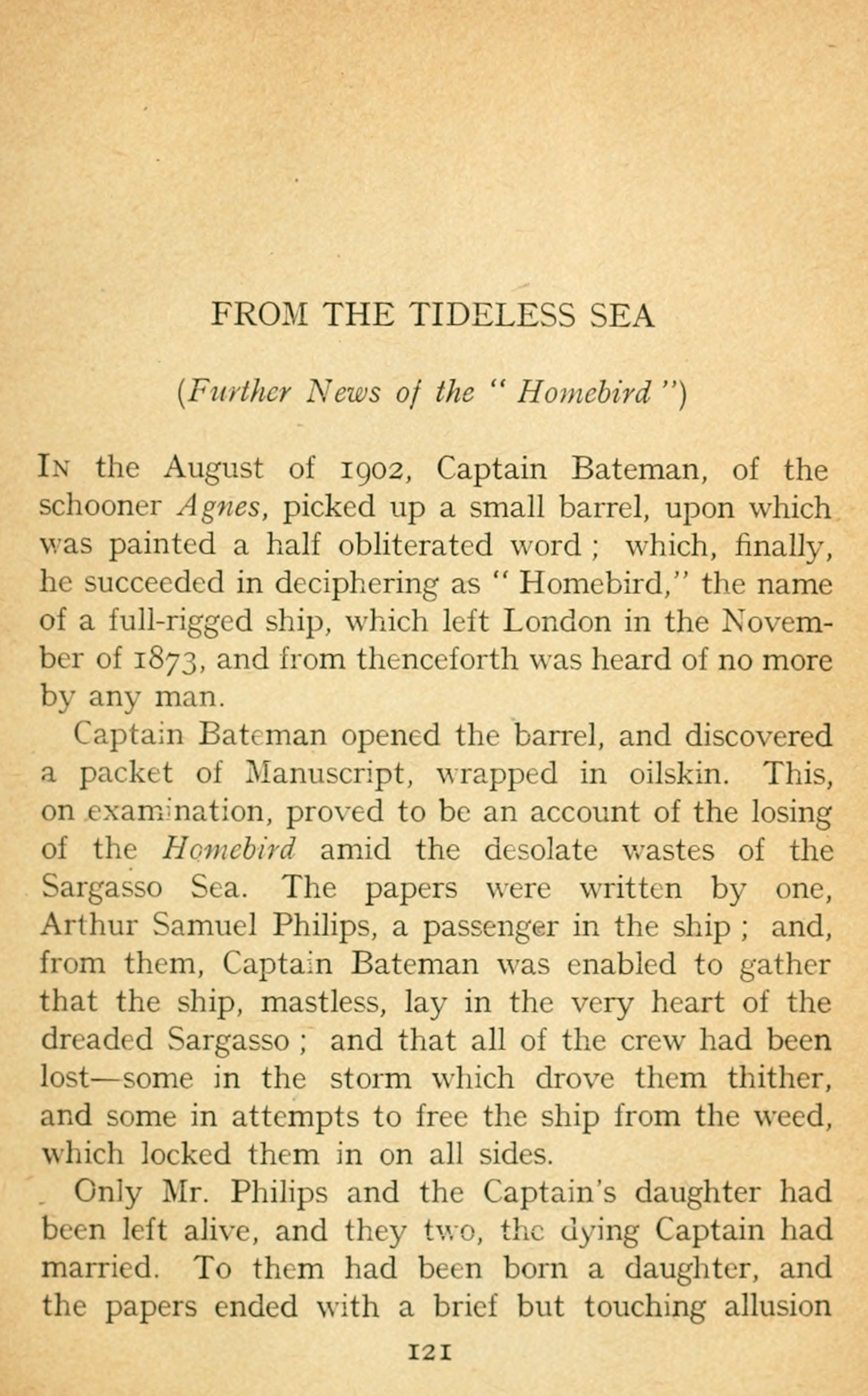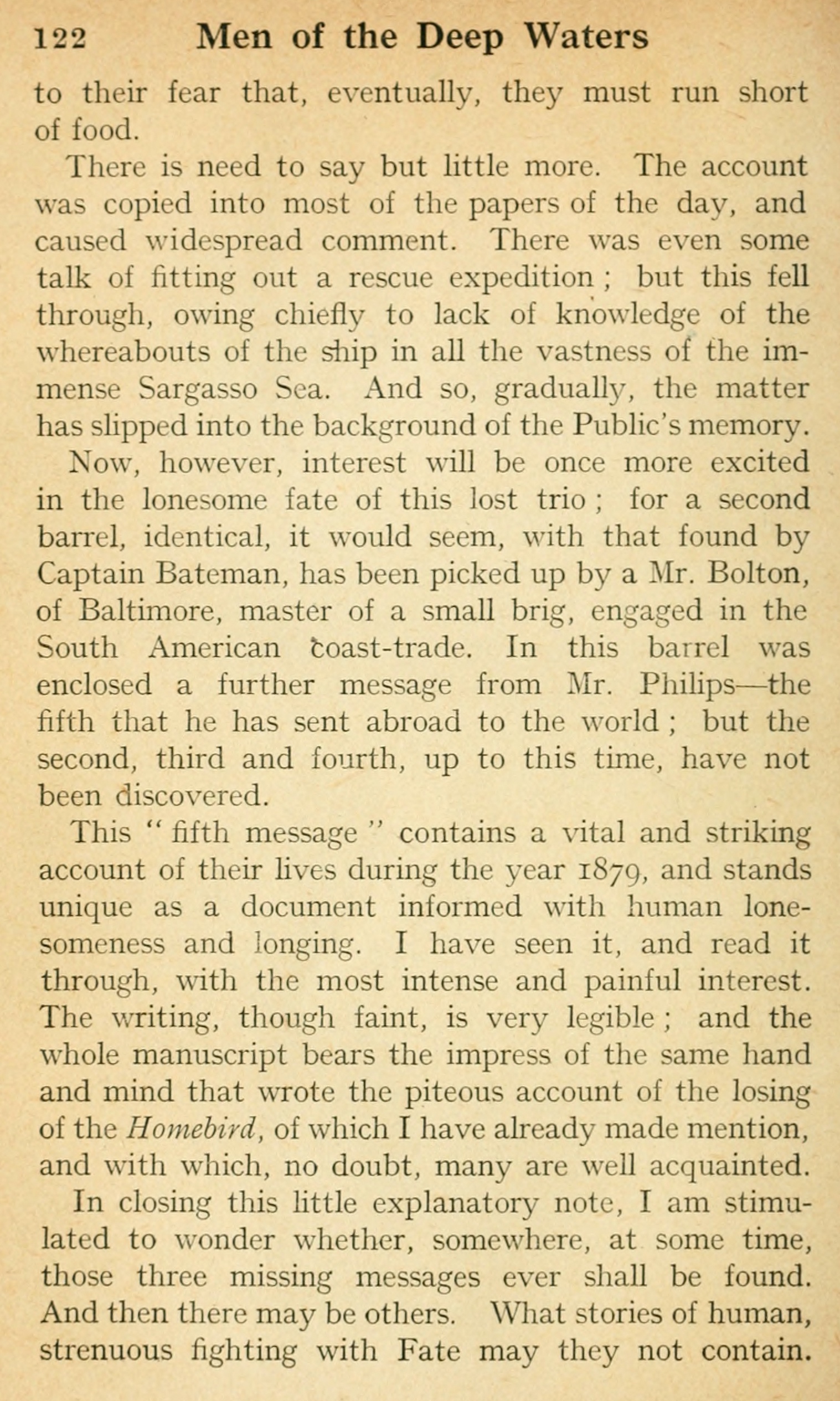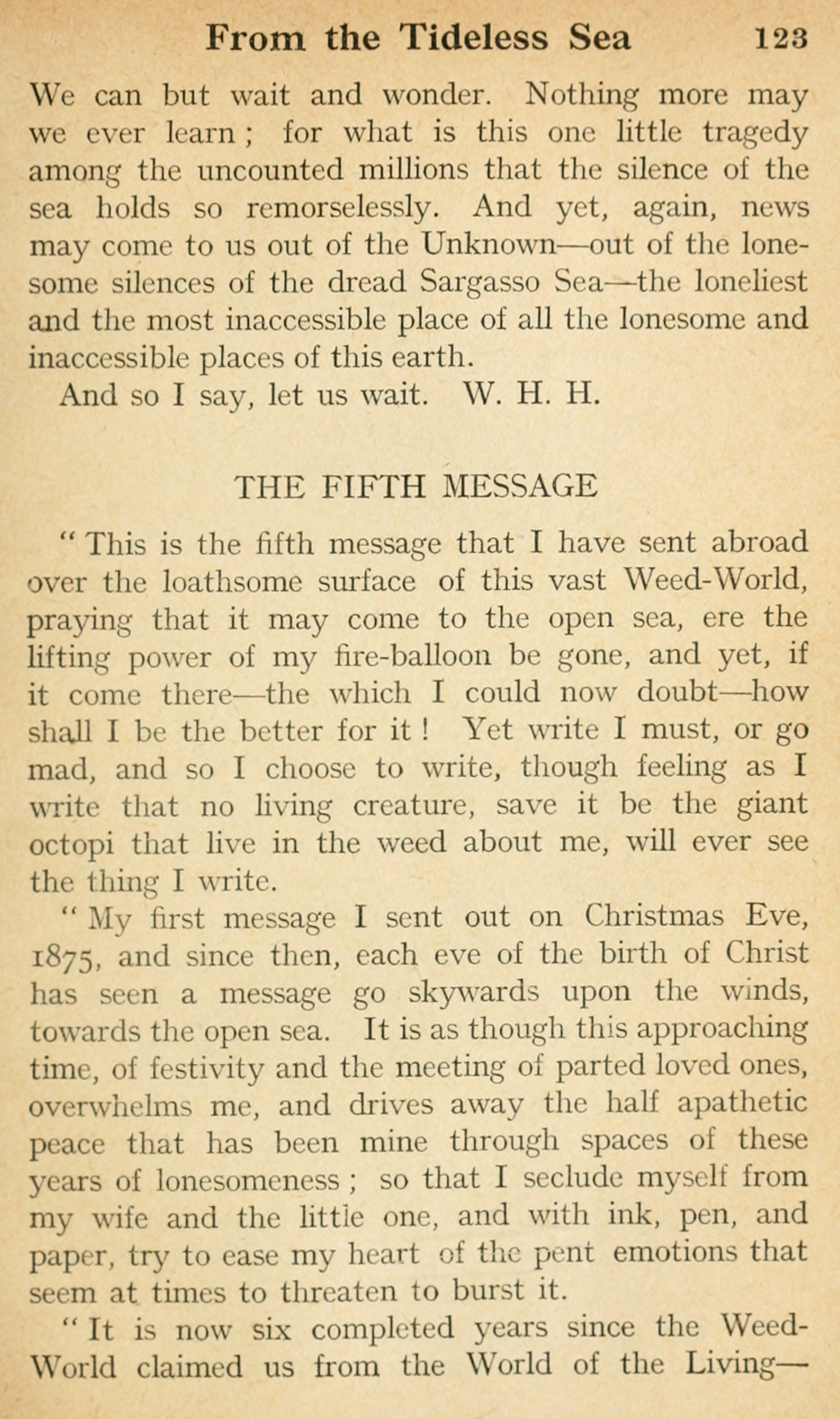Le Mystérieux Ennemi est un roman pour la jeunesse de Léon Lambry publié en préoriginale dans l’hebdomadaire La Semaine de Suzette, seizième année, du jeudi 5 février (n° 1) au jeudi 15 avril (n° 11) 1920. Il est d’abord paru en volume sous le titre : Les Géants de la mer, Paris : Jules Tallandier, Le Livre national, « Bibliothèque des Grandes aventures, » n° 78, [1925] ; puis Paris : Jules Tallandier, section bleue, « Les Chevaliers de l’aventure, » n° 31, 1932. Sous son titre original, Le Mystérieux Ennemi, il a été également repris chez Alfred Mame et fils en 1929, et a connu par la suite plusieurs réimpressions jusqu’en 1937, sous au moins cinq couvertures différentes.
La première partie du roman de Lambry s’avère être en réalité le plagiat d’une nouvelle d’horreur maritime de William Hope Hodgson, ayant pour cadre la mer des Sargasses et ses innombrables épouvantes, « The Fifth Message from the Tideless Sea » [Le Cinquième Message], qui constitue la suite de « From the Tideless Sea » [De la Mer immobile]. Nous renvoyons nos lecteurs à l’article que lui a consacré Marc Madouraud : Léon Lambry, plagiaire de William Hope Hodgson, à propos de « Les Géants de la mer » alias « Le Mystérieux Ennemi, » de Léon Lambry, dans le Bulletin des Amateurs de Science-Fiction Ancienne et de Fantastique, n° 13 bis, février-avril 1994.
La nouvelle de Hodgson est parue dans The Monthly Story Magazine [The Blue Book], en août 1907, sous le titre : « More News of The Homebird. » Elle a ensuite été reprise sous le titre : « Fifth Message from the Tideless Sea » dans The London Magazine, en mai 1911, avant sa publication dans une version révisée par l’auteur dans le recueil Men of the Deep Waters, London: Eveleigh Nash, 1914, sous le titre « From the Tideless Sea : Second Part. »
Il nous a donc paru intéressant de reprendre des extraits de la publication originale du Mystérieux Ennemi, avec ses illustrations, ainsi que la nouvelle de W. H. Hodgson dont Léon Lambry s’est très largement inspiré.
MONSIEUR N
–––––
–––––
Gouache originale de Maurice Toussaint pour la couverture des Géants de la mer de Léon Lambry, Jules Tallandier, « Les Chevaliers de l’aventure, » n° 31, 1932.
Merci à la librairie Ultime Razzia…
–––––
LÉON LAMBRY : LE MYSTÉRIEUX ENNEMI
–––––
RÉSUMÉ :
Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petite filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et se trouvent seuls sur le bâtiment qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive.
–––––
Le ciel, en effet, commençait à se couvrir ; un léger brouillard s’élevait vers l’ouest, et de lourdes vapeurs se condensaient peu à peu au-dessus du Prancing.
« Mauvaise affaire ! dit James ; nous allons avoir un gros temps.
– Pensez-vous que nous soyons en péril ?…
– Ne vous tourmentez pas… l’orage n’éclatera pas avant une heure et, d’ici là, nous prendrons nos dispositions pour l’affronter.
– Vous m’avez dit que le gouvernail était brisé… ne courons- nous pas le risque d’être jetés sur un rocher ?
– Il n’y a pas de récifs dans ces parages, et le Prancing tient bien la mer ; ne craignez rien, Aliette, nous sortirons sains et sauf de ce mauvais pas…
– Je veux vous croire, James… mais, j’y songe, que ferons-nous de Mimi ?… voici la crête des vagues qui blanchit ; si c’était une tempête ?.. La pauvre petite va avoir bien peur !…
– Prenez-la avec vous, et préparez-la doucement, il ne faut pas qu’elle s’effraie ! Nous serons un peu secoués tout à l’heure ; je vous conseille de descendre, avec elle, dans la cabine du commandant. Vous serez là, en sûreté, à l’abri des paquets de mer, tandis que je m’emploierai de mon mieux sur le pont !…
– Mais vous… James… vous serez en danger ?…
– Ne vous occupez pas de moi, je vous en prie. Nous avons chacun notre tâche à remplir et… la vôtre n’est pas la plus facile. »
Aliette ne répondit rien et s’éloigna pour rejoindre Mimi ; elle comprenait que James avait raison et que son rôle de petite maman allait devenir singulièrement compliqué.
« Je ferai mon devoir, » dit-elle tout bas.
Mimi s’amusait à se balancer dans son hamac, avec l’insouciance de son âge, tout en parlant à sa poupée. Lorsqu’elle aperçut Aliette, elle lui tendit les bras :
« Maman Aliette, je t’aime bien ! dit-elle. Est-ce que tu resteras près de moi le soir, jusqu’à ce que je dorme, comme ma vraie maman ?
– Oui, ma chérie…
– Alors, je suis bien contente, et je n’ai plus peur du tout…
– Bravo, Mimi ! »
Aliette prit la fillette dans ses bras et la déposa sur le pont.
« Quand est-ce qu’on la reverra, ma maman ?… demanda Mimi.
– Je ne sais pas, mais… j’espère que ce sera bientôt.
– Tu es sûre qu’on ne lui a pas fait de mal ?
– Oui, j’en suis sûre.
– Dis-moi ?… pourquoi remue-t-il comme ça… le bateau ?
– Parce que les vagues sont fortes !…
– Alors, on va être noyé ?…
– Mais non, Mimi, on ne sera pas noyés. D’abord… le bateau est solide… et puis, il y a James qui est très brave et qui saura bien nous sauver.
– Ça, c’est vrai ! Seulement… j’ai un peu peur des grosses vagues… tu sais !…
– Il ne faut pas avoir peur, puisqu’il n’y a pas de danger. Nous allons descendre dans une belle cabine, où il y a un livre d’images ; tu ne verras pas les vagues, et je te raconterai une histoire.
– Oh ! oui !… Aliette… raconte-moi une histoire… »
Le Prancing commençait à être fortement secoué ; le roulis était tel que les fillettes avaient peine à se tenir debout.
« Donne-moi la main, Mimi, » dit Aliette et, comme le lui avait recommandé James, elle fit descendre sa protégée dans l’intérieur du bâtiment.
CHAPITRE IV
LA TEMPÊTE
Dans la cabine du capitaine dont tous les instruments avaient été enlevés, Mimi fit la remarque qu’il n’y avait pas de livre d’images.
« Je vais t’en chercher un, dit Aliette, et je t’apporterai en même temps un jeu de patience qui est dans ma valise.
– Veux-tu que j’aille le chercher avec toi ?
– Non ! Mimi, le bateau remue trop, et tu risquerais de tomber… je vais jusqu’à notre cabine et je reviens !… mets-toi dans ce grand fauteuil en attendant… je ne serai pas longtemps absente.
– Pourquoi ne m’emmènes-tu pas dans ta cabine ?
– Parce qu’elle est trop petite et qu’on n’y est pas bien. Ici, il y a une table, un fauteuil et un canapé, et puis James m’a dit que nous y serions plus en sûreté pendant le gros temps. »
Tandis que Mimi, allongée sur le canapé, essayait d’endormir sa poupée et qu’Aliette, ballottée par le roulis, se cognait d’une cloison à l’autre pour gagner sa cabine, James, cramponné au bastingage, luttait de son mieux contre la tempête. C’était bien, en effet, une tempête qui commençait ; le ciel prenait des tons étranges et le soleil avait complètement disparu. Les nuages, poussés par une force surhumaine, s’entassaient en masses énormes ; le vent grondait sourdement et l’horizon s’assombrissait de plus en plus.
Le plus pressé, pour James, était de descendre la voile, car le vent qui s’engouffrait dedans poussait le navire à une vitesse folle dans une direction variable, mais qui inclinait de plus en plus vers le sud. Or, c’était là ce que craignait le jeune capitaine. Il savait qu’un grave danger l’attendait de ce côté ! Le Prancing s’inclinait par instants d’une façon inquiétante, puis se redressait subitement pour escalader d’un bond une vague énorme, sur le dos de laquelle il était enlevé comme une plume. Un abîme se creusait alors sous sa quille et il descendait dans une vallée liquide pour gravir bientôt une seconde montagne.
James, en rampant sur les genoux et sur les mains, était arrivé au pied du mât d’avant. Il attacha rapidement une corde autour de ses reins et en fixa l’autre bout au mât, pour ne pas risquer d’être enlevé. Ensuite, il tira de toutes ses forces sur les agrès qui commandaient à la voile ; mais ses efforts demeurèrent sans résultat ; que pouvait-il contre les éléments déchaînés ? La force de trois matelots eût été impuissante et il était seul à lutter contre la tempête ; il essuya son front ruisselant de sueur et cessa de lutter.
« À la grâce de Dieu !… murmura-t-il ; à moins d’un hasard… ou d’un miracle… nous sommes perdus !… »
Mimi, jetée en bas de son divan, venait de rouler avec sa poupée sur le tapis du capitaine lorsque Aliette ouvrit la porte. Elle tenait un livre d’images à la main, mais son jeu de patience était tombé dans le couloir et elle se frottait l’épaule droite, car elle s’était cognée très fort contre la cloison à cause du roulis grandissant.
« J’ai peur !… dit Mimi, en essayant de se relever.
– Il n’y a pas de danger !… » répondit Aliette d’une voix tremblante.
Elle voulut, en parlant ainsi, rassurer sa petite compagne, mais elle était bien pâle et ses forces la trahissaient.
« J’ai peur ! » répéta Mimi, toujours à quatre pattes sur le tapis.
Aliette s’assit dans le fauteuil et la prit sur ses genoux ; le livre était ouvert sur la table, mais personne ne songeait à le regarder. Un grondement sourd s’entendait continuellement sur le pont…
Mimi commença à pleurer.
« Tais-toi !… je t’en prie, » dit Aliette en la berçant, et elle se mit à lui chanter une vieille chanson, bien que la voix s’arrêtât par instants dans sa gorge.
Sur le pont, James, toujours attaché à son mât, regardait rageusement la mer. Il avait revêtu un vêtement de toile cirée et l’eau ruisselait le long de son corps sans qu’il pût se décider à quitter son poste. Le Prancing filait maintenant plein sud. Des murailles liquides s’avançaient en roulant puis s’écroulaient sur lui de toute leur hauteur, comme si elles allaient l’engloutir.
Combien de temps dura cette angoisse ? Deux ou trois heures peut-être ? Sous la poussée du vent, les nuages s’enfuyaient, pressées et rapides ; c’était comme un déchirement de la nature entière. James était à deux reprises descendu dans la cabine où se trouvaient ses jeunes compagnes ; afin, les rassurer, il avait consulté une carte accrochée au mur et maintenant, revenu à son poste d’observation, il regardait attentivement devant lui comme s’il craignait de voir apparaître quelque chose qu’il redoutait.
Soudain, une ligne brune se dessina à l’horizon et l’Américain pâlit.
« Les Sargasses ! » murmura-t-il et, comme si ce mot résumait toute sa pensée, il eut, pour la première fois, un geste de découragement.
Le vent soufflait moins fort ; les nuages s’éparpillaient, un peu de bleu commençait à se montrer dans le ciel, mais le Prancing, poussé par une force irrésistible, continuait à bondir sur les flots ; il atteignit la ligne brune qu’il dépassa ; sa carène tranchante coupait les algues qui se resserraient derrière lui.
James quitta le pont et descendit pour la troisième fois dans la cabine, où il trouva Mimi endormie sur le divan.
« Qu’y a-t-il, James ? interrogea vivement Aliette en remarquant la pâleur de son compagnon.
– Les Sargasses ! » répéta le jeune homme d’une voix légèrement altérée.
Aliette le regarda, surprise.
« Vous ne savez pas, continua James… tout ce que que ce mot contient d’inconnu… pour nous ?… je vous sais brave, Aliette, et j’aime mieux vous dire la vérité !… les Sargasses… c’est l’isolement complet ! c’est… la certitude de ne pas être secourus pendant des semaines !… des mois, peut- être !
– Qu’allons-nous faire ?… qu’allons-nous devenir ?…
– Nous ferons de notre mieux pour hâter notre délivrance… Mais la tâche sera dure ! Les navires ne suivent pas cette route !… la mer des Sargasses est un désert liquide !
– C’est effrayant ! »
Le vent s’apaisait, le Prancing ralentissait sensiblement sa marche ; les deux enfants se regardèrent, en proie à une émotion profonde.
« Venez ! » dit James en prenant la main d’Aliette, et, laissant dans la cabine Mimi endormie, ils montèrent sur le pont.
CHAPITRE V
DANS LES SARGASSES
Le spectacle qui s’offrit aux yeux des enfants était impressionnant au possible. Figurez-vous une interminable étendue couverte de grandes algues d’un brun-olive, dont l’on n’apercevait pas la fin. De tous côtés, et jusqu’à l’horizon, rien n’apparaissait, que cette étrange végétation.
« Mer sans marées ! dit James entre ses dents.
– C’est un désert!…
– Il nous sauve de la tempête !… »
C’était vrai ! Sur cette immense solitude tapissée d’herbes marines, le vent n’avait plus de prise, et les flots se soulevaient à peine. Le Prancing avançait de moins en moins vite ; il n’avait plus assez d’élan pour couper les liens dont l’entouraient les plantes brunes ; il finit par s’arrêter.
« Prisonniers ! » fit James.
Aliette frissonna en regardant l’étendue.
« J’ai peur !… dit-elle.
– Peur ?… de quoi, grand Dieu !
– De tout ce qui nous entoure.
– Mais… nous sommes seuls ici !
– Non !… James… je sens que nous ne sommes pas seuls… des dangers inconnus nous menacent.
– C’est le monde des herbes !… Il n’y a d’autres dangers que celui de notre solitude…
– Croyez-vous ?… Il me semble à moi que des monstres doivent habiter dans ces forêts sous-marines… écoutez ce bruit !…
– C’est la plainte du vent qui fait remuer les algues…
– Vous dites cela pour me rassurer, James… mais, quand le vent se tait, c’est plus effrayant encore…
– Soyez courageuse, Aliette !… vous constaterez que l’on n’entend plus rien !
– Oui !… un grand silence nous entoure… mais ce silence fait peur !… Il semble que l’on entend la respiration de bêtes géantes qui nous guettent…
– Mais… c’est de la folie !… Vous voyez bien que rien ne bouge !…
– Rien ne bouge ?… c’est vrai !… Je voudrais avoir votre bravoure, James !… Il faut m’excuser… j’ai promis d’être brave… je lâcherai de l’être…
– Il le faut… pour Mimi !
– Vous avez raison !… j’ai honte de ma faiblesse !… Je dois lui servir de mère, à cette petite… c’est mon devoir !… je vous admire, James, et j’essaierai de vous imiter !… mais, que voulez-vous ?… je ne suis qu’une petite fille, moi… et je me forge des idées… tenez, il me semble… qu’il doit y avoir des gros crabes, des pieuvres cachés sous ces algues….
– Et quand cela serait ?… Pensez-vous que le Prancing, qui est solide et dont la coque s’élève à plusieurs mètres au-dessus de l’eau, soit un obstacle facile à escalader ?
– C’est vrai… quand on réfléchit…
– Venez ! Aliette, il est près de midi maintenant, et nous avons grand besoin de réparer nos forces après les émotions que nous venons de traverser… Le Prancing est immobile et il est probable qu’il restera à cette place jusqu’à ce qu’un vaisseau, envoyé à notre recherche, vienne nous délivrer. »
Aliette et James descendirent auprès de Mimi qui venait de se réveiller et qui les accueillit en souriant. Maintenant que le bateau ne bougeait plus et que le vent se taisait, elle se sentait parfaitement tranquille. Comment et pourquoi se serait-elle tourmentée, la chère petite ? Elle était trop jeune pour savoir ce qu’était la mer des Sargasses, et les terribles surprises qu’elle leur réservait. La première chose à faire, pour l’instant, était de se procurer des vivres, et c’est à cela que James songea.
« Allons dans la salle à manger, dit-il ; puisque nous sommes les seuls habitants de notre prison flottante, nous allons nous organiser de notre mieux ; pendant que vous mettrez le couvert avec Mimi, j’irai à la recherche des provisions.
– C’est cela !… » répondit Aliette qui commençait à oublier ses terreurs, devant la bonne humeur de son compagnon, et l’on gagna la salle à manger.
Les assiettes et les verres étaient si bien fixés dans l’intérieur des armoires que la tempête ne les avait pas brisés. Aliette, aidée de Mimi, qui riait avec l’insouciance de son âge, mit les trois couverts sur une petite table, car la salle à manger lui paraissait bien grande et bien vide, et elle avait besoin de se sentir entourée pour garder son courage chancelant.
James revint, les bras chargés de boîtes de conserves, d’une bouteille de vin et d’un pain légèrement rassis trouvé dans l’office. Son visage exprimait un contentement réel.
« Ce ne sont pas les provisions qui manquent, dit-il, et nous pourrions rester ici plus d’un an sans craindre de mourir de faim.
– Un an !… répéta Aliette ; est-ce que vous supposez, James ?…
– Oh ! je ne suppose rien… se hâta de répondre le jeune garçon… j’ai même le ferme espoir de sortir bientôt de notre désert, mais… je vous l’ai dit, la sagesse la plus élémentaire nous commande d’agir comme si nous étions ici pour longtemps !… Je n’ai pas attendu, d’ailleurs, que le Prancing fût entouré par les algues pour tenter quelque chose, et il n’est pas impossible… que l’on apprenne où nous sommes.
– Qui cela ?…
– Les passagers d’un bateau quelconque… suivant la route habituelle… qui mène d’Europe en Amérique.
– Mais… ne m’avez-vous pas dit que nous étions tout à fait en dehors de cette route, et que les vaisseaux ne s’aventuraient pas, à moins d’y être forcés, dans la mer des Sargasses ?
– Je vous ai dit cela, ma chère Aliette… et je le maintiens… c’est pourquoi… j’ai pris mes précautions avant d’être jeté au milieu de ces herbes brunes… seulement… j’ai une faim de loup, voyez-vous !… et j’aimerais mieux vous raconter cela tout en déjeunant.
– Moi aussi !… j’ai une faim de loup ! » dit Mimi.
Cette réflexion fit rire tout le monde et l’on se mit à table. James ouvrit l’une des boîtes qu’il avait apportées et qui contenait du saumon conservé.
« Fameux ! » dit-il après y avoir goûté.
Aliette trouva également cela très bon, mais Mimi, qui n’aimait pas le poisson, fit la grimace ; alors, sa petite mère lui coupa en petites bouchées une belle tranche de veau, sortie d’une autre boîte.
« On est comme des princesses ! » dit Mimi, dont les yeux brillaient de plaisir.
James coupa le pain et remplit les verres.
« Je bois à notre prochaine délivrance ! » dit-il, et ses petites amies burent en même temps que lui.
« Maintenant que nous sommes à table, commença Aliette, je voudrais bien que vous me disiez quelle précaution vous avez prise et comment les passagers d’un autre bateau pourront savoir que nous sommes ici…
– Oh !… c’est bien simple !… quand j’ai compris que nous quittions le courant du Gulf-Stream et que la tempête nous poussait vers le sud, j’ai tout de suite pensé à la mer des Sargasses…
– Et comment saviez-vous ?…
– Que la mer des Sargasses nous guettait ?… mais… parce que la carte du bord me l’indiquait… et puis… mon père m’a souvent parlé de ses voyages… des courants sous-marins… bref… je redoutais ce qui est arrivé !… alors… j’ai employé un moyen bien connu… dont beaucoup de naufragés ont usé avant nous !… J’ai pris dans la cabine du capitaine une feuille de papier blanc, sur laquelle j’ai écrit ces quelques lignes :
Le vapeur Prancing, désemparé, ayant trois enfants à bord, fuit devant la tempête… le vent nous pousse irrésistiblement vers les Sargasses.
JAMES MIDGET
Ce papier, roulé, a été mis par moi dans une bouteille vide… que j’ai soigneusement bouchée et cachetée… puis, je suis remonté sur le pont et, lorsque la ligne brune des Sargasses est apparue à l’horizon… j’ai jeté la bouteille à la mer…
– Ça !… c’est bon !… dit à ce moment Mimi, la bouche pleine.
– Pensez-vous qu’elle puisse être découverte ?… » demanda Aliette.
James eut un geste d’incertitude.
« Dieu seul le sait !… » dit-il.
–––––
RÉSUMÉ :
Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petite filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et se trouvent seuls sur le bâtiment qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive.
–––––
CHAPITRE VI
PENDANT LE REPAS
Mimi avait eu raison de dire : « J’ai une faim de loup, » car, pour une enfant de son âge, elle mangeait de bon appétit.
« Nous ferons la cuisine ! dit Aliette… Je sais qu’il y a des œufs conservés, et maman m’a appris à faire les omelettes, la soupe, et d’autres choses encore !
– Pour ce matin, contentons-nous des conserves ; il y a une boîte de haricots tout préparés, que l’on peut fort bien manger froids à l’huile et au vinaigre ; s’il fallait allumer du feu dans la cuisinière, à cette heure-ci, cela nous retarderait ; mais, ce soir, nous aviserons ! »
On suivit le conseil de James, et les haricots furent déclarés délicieux. Il y eut, après cela, une compote d’abricots dont Mimi, particulièrement friande, se barbouilla comme un jeune chat, puis tandis que la petite fille, satisfaite de son repas, s’amusait à courir autour de la grande table du bord, Aliette, devenue sérieuse, se mit à parler à mi-voix à James.
« Nous allons, dit-elle, nous organiser, si vous le voulez bien, en vue de notre nouvelle existence ; vous avez plus d’expérience que moi, et je suis toute disposée à vous obéir !… Il ne faut pas m’en vouloir si j’ai eu un moment de défaillance ce matin… je vous promets de faire de mon mieux pour vous aider, à l’avenir.
– J’en suis convaincu, Aliette, et je suis loin de vous blâmer. Il me semble, au contraire, que vous êtes très courageuse pour votre âge !… J’aurais d’autant plus mauvaise grâce à vous critiquer, que j’ai eu moi-même une minute de découragement !… Nous traversons une dure épreuve, il ne faut pas se le dissimuler, et il est bien permis d’avoir un léger accès de faiblesse. Le principal, c’est que nous sachions réagir, que nous nous organisions, comme vous le dites très bien, et que nous sortions, s’il se peut, de ce mauvais pas. Mimi va vous aider à enlever le couvert ; nous rangerons ces provisions entamées dans notre armoire, et nous ferons ensuite l’inspection de notre domaine.
– Oui !… je vais ranger, » dit Mimi, pleine de bonne volonté.
Et elle prit dans ses petites mains deux assiettes vides ; mais, au même instant, une masse noire passa entre ses jambes, si bien qu’elle perdit l’équilibre et tomba sur le plancher avec un bruit de vaisselle brisée.
La petite fille était prête à pleurer, mais James la remit sur pied et la fit rire, en lui démontrant que la cause de sa chute n’était autre que « Misti, » le chat du bord, qui courait après une souris.
Lorsque le couvert fut enlevé, on commença la visite du bâtiment. Rien ne fut oublié, et James se montra en cette circonstance particulièrement attentif. Il visita le salon, l’office, les cuisines, monta sur le pont, et découvrit à l’arrière quelques poules dans leurs cages.
« Il faut leur donner à manger, » dit-il, et Mimi, qui avait des mies dans sa poche, s’empressa de les leur jeter.
Non loin des poules, Aliette, attirée par un grognement sourd, découvrit trois petits cochons blancs que la tempête avait sans doute fort effrayés et qui manifestaient à leur manière leur indignation. James jugea cette découverte très utile ; c’était un supplément de vivres pour les mauvais jours et il fallait soigner ces animaux. Il alla lui-mème chercher des restes de viande et quelques os à l’office, puis, en attendant mieux, il les lança à ces bêtes affamées qui se jetèrent dessus avec avidité.
Lorsque les cabines et le couloir eurent été passés en revue, James inspecta la salle des vivres, conduisit Miette et Mimi dans le salon, et remonta sur le pont. Il ouvrit un panneau et descendit par l’écoutille dans les profondeurs du bâtiment. Il inspecta tout avec la plus scrupuleuse attention, depuis le dortoir des matelots jusqu’à la chambre de chauffe, et constata avec plaisir que le Prancing, en dehors de la machine hors d’usage et de l’hélice brisée, n’avait pas d’avaries dangereuses. Les soutes étaient plus qu’à demi pleines de charbon, et l’existence se trouvait assurée pour longtemps.
Tranquillisé sur ce point important, le jeune Américain retourna auprès de ses compagnes ; il trouva Aliette occupée à mettre de l’ordre dans la pièce, que la tempête avait fortement secouée, et Mimi en train de jouer avec « Misti » qu’elle avait réussi à attraper par la queue.
« Eh bien ?… interrogea Aliette.
– Tout est en bon état ! répondit James.
– Quelle heure est-il ?
– Quatre heures passées.
– J’ai faim, alors !… déclara Mimi, à laquelle les événements tragiques ne coupaient pas l’appétit… maman me donnait toujours à goûter à cette heure-là !
– Eh bien, nous ferons comme elle ! dit Aliette, que cette réflexion amusait. Qu’est-ce que tu veux ?
– Du pain et du chocolat…
– Rien de plus facile !
– Eh !… observa James le philosophe, c’est facile pour aujourd’hui, peut-être !… mais, dans quelques jours… le pain fera défaut !… Le boulanger du bord n’en avait qu’une faible provision ; vous savez qu’on le fabriquait au fur et à mesure des besoins.
– Nous ferons comme lui ! dit résolument Aliette en donnant à Mimi ce qu’elle demandait… il y a de la farine à bord… beaucoup de farine !… Avec un peu de patience et d’application, je trouverai bien le moyen de fabriquer quelque chose qui ressemblera à du pain.
– Bravo, Aliette ! s’exclama James joyeusement, vous êtes courageuse, je le savais bien, et j’ai la conviction qu’en unissant nos efforts, nous finirons par nous tirer d’affaire ! »
Mimi, ayant lâché Misti, mordait dans son pain, et croquait son chocolat à belles dents ; James avait pris un atlas sur l’un des rayons de la bibliothèque et, l’ayant ouvert à la page qui représentait l’Amérique et les îles Açores, il commençait à expliquer à Aliette la marche probable du Prancing et le lieu approximatif où il se trouvait, lorsqu’un bruit sourd et lointain les fit tous tressaillir. C’était un son étrange et régulier ; trois petits coups frappés en cadence… toc !… toc !… toc !…
James lâcha son livre et se leva.
CHAPITRE VII
MAUVAISE NUIT
Mimi s’était blottie tout contre Aliette qui lui caressait les cheveux d’une main tremblante.
« Je vais voir ce que c’est ! » dit James, et il sortit du salon.
Avant de gagner l’escalier, il passa dans la cabine du capitaine et décrocha un revolver pendu à la cloison.
« On ne se repent jamais d’avoir pris trop de précautions, » dit-il, comme se parlant à lui-même, puis il gagna le pont, et regarda attentivement par-dessus bord.
On ne distinguait que les algues brunes, agitées à peine, de loin en loin, d’un léger frémissement.
« Jusqu’ici, je ne vois rien de bien effrayant ! » murmura le jeune capitaine et, gagnant l’écoutille, il descendit pour la seconde fois dans l’intérieur du navire.
On n’entendait plus aucun bruit.
Il visita, comme la première fois, les soutes, la chambre des machines, et, allumant une lampe de poche, il descendit dans la cale.
Après avoir erré un moment parmi des caisses et des ballots de toutes sortes, il s’approcha de la paroi de tribord et colla son oreille contre le flanc du vaisseau.
Il était maintenant dans la partie la plus basse de sa prison marine, c’est-à-dire sensiblement au-dessous de la ligne de flottaison, et il entendit quelques frottements contre la plaque extérieure du bâtiment. Cela ne l’effraya pas.
« Ce sont des araignées de mer, ou des pieuvres, qui usent leurs tentacules sur l’acier du bateau, dit-il en souriant ; elles perdent leur temps… cela n’a aucune importance. »
Il eut beau prêter l’oreille avec attention, il lui fut impossible d’entendre de nouveau le bruit qui les avait troublés.
Complètement rassuré, il allait remonter sur le pont lorsque son regard se fixa sur une caisse de grandes dimensions sur laquelle se lisait en caractères gras : « Armes de l’équipage. » Cette caisse, placée près de l’échelle du bord, n’avait qu’une fermeture très simple. James l’ouvrit et en tira deux paquets de cartouches, ainsi qu’une hache qu’il emporta. Ayant ensuite refermé la caisse, il remonta sur le pont.
Avant de regagner le salon, et pour ne pas effrayer ses compagnes, il déposa ses armes dans la cabine du capitaine et posa en lieu sûr les deux paquets de cartouches.
Aucun bruit ne se faisait entendre, et comme la journée s’avançait, il rejoignit Aliette et Mimi qui l’attendaient avec impatience.
« Eh bien ?… interrogea Aliette.
– Je n’ai rien vu d’anormal ! répondit James.
– Mais… ce bruit ?… Tout à l’heure ?…
– Je ne sais par quoi il a été produit !… j’en suis à me demander si nous n’avons pas rêvé.
– Oh ! non !… dit Mimi, prenant part à la conversation ; j’ai bien entendu, moi !…
– Et qu’est-ce que tu as entendu ?
– Tap !… tap !… tap !… On a frappé trois petits coups…
– Comme si quelqu’un voulait entrer !…
– Il n’y a pas beaucoup d’habitants par ici ! dit James, en essayant de plaisanter… et la mer des Sargasses n’attire pas les touristes !… Soyez tranquilles !… Personne ne viendra nous déranger !
– Si nous allions tous à la cuisine, pour voir ce qu’on pourrait faire pour le dîner ? » dit Aliette.
La proposition fut acceptée avec enthousiasme et les trois enfants quittèrent le salon.
Ce soir-là, on dîna de bon appétit ; il y eut, outre la soupe, une omelette réussie, confectionnée par Aliette qui se montra fière de son succès. James, qui avait allumé très facilement la cuisinière, apporta lui-même des pommes de terre en robe de chambre, et l’on eut même, après le dessert, une infusion chaude pour se remettre des émotions de cette première journée.
Bref, ce fut un vrai festin, qui fit plaisir à tous. Cependant, la nuit venait, et les petites filles ne pouvaient se défendre d’une certaine inquiétude. Ce fut encore James qui sauva la situation ; il choisit deux des plus belles cabines, voisines du salon, installa ses jeunes compagnes dans la première et s’organisa lui-même dans la seconde.
« Nous ne sommes séparés que par une cloison ! dit-il ; si vous avez la moindre crainte, vous n’aurez qu’à frapper et je serai auprès de vous, mais je suis convaincu que cela ne sera pas nécessaire, car nous ne courons aucun danger. »
Aliette et Mimi, rassurées par ces paroles, quittèrent James pour se mettre au lit.
Une demi-heure plus tard, tout le monde dormait à bord du Prancing.
La première partie de la nuit se passa sans incidents, mais, vers deux heures du matin, James fut réveillé par le même son impressionnant qui les avait troublés la veille.
Tout d’abord, il crut qu’il rêvait, mais, tandis qu’il se frottait les yeux, il entendit distinctement ce bruit singulier :
Toc ! toc ! toc !…
Cela venait encore de tribord… Quelqu’un… ou quelque chose, frappait contre la paroi extérieure du bateau, au-dessous de la ligne de flottaison.
Cette constatation rassura James ; le péril n’était pas immédiat… il savait le Prancing solide et sa coque d’acier ne pouvait être entamée…
Il s’accouda sur sa couchette et écouta en retenant son souffle. Quel pouvait être… l’animal étrange… la chose inconnue qui vivait dans ce monde des herbes ?… Quel mystère se déroulait dans les profondeurs de cette mer des Sargasses, encore si peu connue et presque inexplorée ?
On n’entendait plus rien !… Aliette et Mimi dormaient paisiblement dans la chambre voisine et James, craignant de les réveiller, ne faisait aucun bruit, mais, malgré son courage, son cœur battait plus vite que de coutume. Il attendait toujours, anxieux, le front baigné de sueur, et voici que soudain le bruit recommença de l’autre côté du bâtiment…
Cette fois, un frisson parcourut ses membres et véritablement il eut peur, car il semblait que la « Chose » qu’on ne voyait pas, cette « Chose » qui vivait dans la nuit, frappait discrètement, comme si elle demandait à entrer…
Toc !… toc !… toc !…
« Oh !… mon Dieu !… » dit James à voix basse, et il pria.
Cette fois encore, le bruit cessa ; le jeune garçon s’enfonça sous ses couvertures et dans son esprit passèrent des visions qu’il cherchait en vain à chasser ; il n’avait pas la force de repousser l’angoisse qui l’étreignait ; la vaste solitude du « Monde des Herbes » et de ses terreurs cachées le préoccupait, et malgré lui, vaincu par la fatigue, il tomba dans un lourd sommeil peuplé de cauchemars.
–––––
RÉSUMÉ :
Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petite filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et se trouvent seuls sur le bâtiment qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive. Les courants le portent dans la mer des Sargasses, au milieu de l’Atlantique ; le bateau s’immobilise dans un champ d’algues. C’est à ce moment qu’un bruit bizarre va éveiller l’attention des jeunes abandonnés.
–––––
CHAPITRE VIII
LE CAHIER D’ALIETTE
Le lendemain, James se réveilla assez tard. Aliette et Mimi qui, levées depuis plus d’une heure, avaient préparé le déjeuner du matin avec du lait condensé, le plaisantèrent sur sa paresse.
James se garda bien de leur dire qu’il avait eu un sommeil agité et que sa nuit avait été troublée par des bruits insolites. Puisqu’elles ne se doutaient de rien, le mieux était de ne pas leur donner un sujet d’inquiétude.
Après le déjeuner, chacun vaqua à ses occupations. Tandis qu’Aliette, aidée de Mimi, débarrassait le couvert et époussetait la salle à manger, James montait sur le pont et s’occupait des travaux du bord susceptibles d’améliorer leur confort.
Son premier soin fut d’inspecter le pont en tous sens, afin de s’assurer que l’ennemi inconnu qui semblait les guetter, ne pouvait pas franchir le bastingage ; il fit le tour de son domaine, regarda longuement les algues, de chaque côté du Prancing, et, ne découvrant rien d’insolite, s’occupa des animaux domestiques. Il donna la pâtée aux porcs, le grain aux poules, et quelques déchets de viande à Misti. Ceci fait, il s’assura que le revolver chargé était à sa place, dans la cabine du capitaine, à côté de sa hache, et descendit l’escalier de l’arrière. Il découvrit que cet escalier donnait accès dans le couloir des premières, par une porte fermée d’une barre de fer. Il enleva cette barre et regagna le salon par ce chemin.
Aliette, ayant fini le ménage, était en train d’écrire, et Mimi, à plat ventre sur le tapis, s’ingéniait à reconstituer les dessins du jeu de patience qu’on venait de lui prêter.
James ayant fait part de sa découverte, Mimi voulut tout de suite aller voir les bêtes par l’escalier du fond et, comme cela ne présentait aucun danger, on la laissa faire, en lui recommandant, pour plus de sûreté, de ne pas fermer la porte derrière elle.
Restée seule avec James, Aliette lui désigna le cahier sur lequel elle venait de tracer quelques lignes.
« Savez-vous ce que je faisais ? demanda-t-elle en souriant.
– Vous écriviez !… dit James.
– Oui !… bien sûr !… mais… devinez un peu ce que j’écrivais ?…
– Ma foi !… je suis assez embarrassé… ce ne peut être une lettre… attendu qu’il n’y a pas de poste dans la mer des Sargasses… ni vos dépenses, car nous sommes nos propres fournisseurs !… Alors ?… je ne vois pas bien…
– Et pourquoi, James… n’écrirais-je pas une lettre ?…
– Oh !… si cela vous amuse… vous pouvez toujours l’écrire !… quant à la faire partir… c’est une autre histoire !…
– Croyez-vous ?… »
James regarda Aliette, persuadé qu’elle plaisantait, mais, comme la fillette ne riait pas, il craignit que les émotions de la veille n’eussent troublé ses idées.
« Écoutez !… » commença-t-il.
Mais Aliette l’interrompit.
« Je vois, à votre air, que vous me croyez un peu folle…
– Oh !… Aliette…
– Si !… je dis bien !… vous pensez qu’il s’agit d’une idée saugrenue qui m’a traversé l’esprit !… aussi, je vais bien vous étonner en vous apprenant que je compte envoyer… non seulement une lettre, mais, un cahier !…
– Un cahier ?…
– Oui !… un cahier qui contiendra le récit de tout ce qui nous est arrivé depuis le torpillage du Prancing... Vous ajouterez à mes notes les indications que vous avez pu obtenir sur la situation approximative du bateau… et nous enverrons ce petit récit…
– À qui ?…
– À maman !… »
Cette fois, James regarda Aliette avec une véritable compassion.
« Évidemment, elle est folle ! » songea-t-il, et, n’écoutant que son bon cœur, il lui dit doucement :
« Aliette !… je vous trouve l’air un peu fatigué !… vous venez de traverser de grosses émotions… et… je comprends qu’à votre âge !… Écoutez !… savez-vous ce que vous devriez faire… si vous étiez raisonnable ?… Vous iriez vous coucher… bien sagement !… je vous mettrais un cataplasme sinapisé aux chevilles… pour décongestionner la tête… et… »
Aliette partit d’un franc éclat de rire :
« C’est bien ce que je pensais ! dit-elle ; il me croit devenue folle !… Allons ! rassurez-vous, James !… mon idée est plus sensée que vous ne pensez et… si mon cahier n’est pas remis à maman… ce qui est sans doute assez peu probable… il y a des chances pour qu’il parvienne à quelqu’un…
– Expliquez-vous, Aliette…
– N’avez-vous pas jeté une bouteille à la mer ?…
– Si c’est là votre idée, vous pouvez l’abandonner !… la mer des Sargasses n’a pas de courants ; la marée ne s’y fait même pas sentir et la bouteille que nous jetterions ici ne serait trouvée que par les pieuvres ou les crabes…
– Ce que vous avez tenté par la voie des eaux, pourquoi ne pas le tenter par la voie des airs ?… De cette façon… si notre premier message n’arrive pas… le second aura peut-être plus de chance…
– Mais… la voie des airs !… c’est impossible !…
– Vous ne devinez pas ?… C’est une idée qui m’est venue cette nuit ! J’avais fait ma prière avec ferveur… et… je ne sais si je me trompe… mais cette idée que je n’avais pas avant de m’endormir… il me semble que… c’est le bon Dieu qui me l’a envoyée !…
– La voie des airs ?… répéta James, qui semblait réfléchir. Certes, l’idée serait bonne, si nous avions un ballon… mais… nous n’en avons pas… et alors…
– On peut le remplacer par autre chose !…
– Par quoi ?…
– Par une montgolfière !… »
Un éclair de joie passa dans les yeux de James ; il serra les mains d’Aliette dans les siennes et il allait répondre lorsque des cris d’effroi retentirent à l’arrière du bateau.
« C’est Mimi qui appelle ! » dit James et il s’élança dans le couloir, suivi d’Aliette qui tremblait.
CHAPITRE IX
TOC !… TOC !… TOC !…
Lorsqu’ils arrivèrent à l’arrière du bâtiment, un spectacle inattendu s’offrit à leur vue. Mimi, aux prises avec l’un des petits cochons qui l’avait saisie par sa robe, poussait des cris de frayeur, tandis que les deux autres, auxquels elle avait commis l’imprudence d’ouvrir la porte, tournaient autour d’elle, en poussant des grognements de satisfaction.
Elle avait tellement peur, la pauvre Mimi, que James n’eut pas la force de la gronder comme elle le méritait.
On délivra la coupable et les fugitifs furent réintégrés dans leur cabane.
La journée se passa sans incidents et Aliette se tira à merveille de son rôle de maîtresse de maison.
James, qui n’était pas sans concevoir quelques inquiétudes au sujet d’une nouvelle alerte durant la nuit, fit plusieurs fois le tour du Prancing qu’il étudia dans ses moindres détails. Cela lui permit de constater qu’une partie du mât d’avant, qui avait été brisé vers la fin de la tempête, pendait hors de la poupe, avec sa voile et ses agrès. Son poids avait fait céder les algues et l’extrémité du mât baignait dans l’eau.
L’Américain n’attacha pas grande importance à cet incident. Puisque le Prancing était immobilisé, pour longtemps sans doute, au milieu des Sargasses, la chute d’un mât ne lui semblait pas offrir d’intérêt.
Lorsque, le dîner terminé, chacun fut rentré dans sa cabine, James éprouva un malaise indéfinissable. Certes, il était brave, mais l’incertitude du danger qu’il sentait planer sur eux l’énervait ; il aurait voulu savoir à qui il avait affaire !… Lutter contre un ennemi que l’on connaît, passe encore !… mais comment se défendre contre quelqu’un d’invisible ?
Cependant, contrairement à ce qu’il craignait, sa nuit fut moins troublée que la précédente ; il entendit bien, à plusieurs reprises, le bruit insolite dont il ne s’expliquait pas la cause, mais, soit qu’il dormît plus profondément, soit que l’ennemi eût changé de tactique, ce bruit lui parut moins fort. Il se produisit néanmoins, à plusieurs reprises et en différents endroits, comme si l’assaillant étudiait l’obstacle, cherchant le point faible… par où il pourrait entrer.
Aliette et Mimi, cette fois encore, n’avaient rien entendu, et James ne leur parla pas de ses craintes. Lorsque le jour parut, et qu’il retrouva ses jeunes compagnons, il se montra si plein d’entrain, qu’elles n’eurent pas la moindre idée des soucis de leur grand ami.
Une semaine passa, pendant laquelle Aliette continua la rédaction du cahier qu’elle rêvait d’envoyer, par-dessus le « Monde des Herbes, » vers les parages que fréquentent les vaisseaux. James, qui avait approuvé son idée, passait ses heures de liberté à tailler et à coudre, dans une forte toile goudronnée, l’enveloppe de la montgolfière qui devait porter leur appel au loin.
Cet appel était d’autant plus pressant qu’une menace mal définie planait sur eux. En effet, si les journées étaient calmes, les nuits continuaient à être agitées… Le bruit étrange n’avait pas cessé ; il semblait même augmenter d’intensité, au point qu’Aliette l’avait entendu deux fois, et que James avait transporté dans la cabine où il couchait, sa grande hache et son revolver chargé.
Il y avait exactement dix jours que le Prancing se trouvait emprisonné dans les Sargasses, lorsqu’un soir, à la nuit tombante, James crut apercevoir, à bâbord, de fortes ondulations parmi les algues. Tout de suite, il pressentit un danger et songea à décharger son revolver dans cette direction, mais, la réflexion venant, il se dit que la détonation n’aurait d’autre résultat que d’effrayer Mimi et que les balles n’atteindraient probablement pas le but. II se contenta donc de noter très exactement la place à surveiller et, comme les ondulations cessaient, il gagna la salle à manger où Aliette et Mimi l’attendaient. Le dîner fut silencieux ; James cherchait à dissimuler son inquiétude, il redoutait une mauvaise nuit et certains indices le préoccupaient. Aussi jugea-t-il prudent de garder, pour dormir, une partie de ses vêtements.
Il pouvait être minuit lorsque le bruit redouté se fit entendre :
Toc !… toc !… toc !…
James écouta anxieusement. Le son était beaucoup plus distinct que la première fois, et il lui sembla que l’on frappait avec un corps dur sur le fer de la coque.
Toc !… toc !… toc !… C’était comme les coups réguliers d’un petit marteau.
Pendant quelques minutes, ce fut ainsi, puis, soudain… un coup formidable retentit et James sauta hors de sa couchette. À peine était-il habillé qu’un second choc ébranla le navire, puis un troisième, qui retentit comme un coup de tonnerre.
« Qu’est-ce que c’est, James ?… demanda Aliette qui sortait de sa cabine, toute tremblante de peur.
– Chut !… Aliette, » murmura James comme s’il craignait que la « Chose »… qui frappait là-bas… en dehors, pût les entendre.
Aliette ferma doucement la porte de Mimi qui, fort heureusement, continuait à dormir, et, pour se donner du courage, serra la main de son compagnon. Au même instant, un quatrième coup retentit, avec un grondement sourd qui roula le long du couloir et arracha un cri de frayeur à Aliette.
« Qu’est-ce que c’est ? répéta-t-elle dans un souffle…
– Je ne sais pas !… répondit James, parlant à voix basse, c’est… c’est « quelque chose » !…
– Voilà le… « quelque chose… » qui recommence ! » dit Aliette, au moment où trois petits coups se faisaient entendre de nouveau.
Toc !… toc !… toc !…
« Je vais aller voir ! fit résolument James, qui serrait son revolver dans sa main droite ; restez dans votre cabine, Aliette ; c’est là que vous courrez pour l’instant le moins de danger. Le bruit semble venir de l’avant et les communications avec notre couloir ne se font que par le milieu de l’arrière.
– Mais… si vous partez… je vais avoir une peur terrible !
– Préférez-vous venir avec moi ?…
– Oh ! non !… je ne pourrais pas !… et puis… si Mimi se réveillait, que dirait-elle ?
– Vous voyez bien !.. Restez ! Il le faut !… Demandez au Seigneur qu’il vous donne la force d’accomplir votre devoir !… »
Toc !… toc !… toc !…
« Dieu ! que… j’ai peur !… James !… Je ferai… ce que vous voulez… Mais… je vais allumer !… Je tâcherai d’être brave !… Ne soyez pas trop longtemps !
– Nous ferons pour le mieux… Aliette !… Je ne m’en vais pas par plaisir, croyez-moi… et… je ne choisis pas la meilleure part… Adieu !… »
Le pas de James s’éloigna ; Aliette l’entendit monter sur le pont et fermer avec soin le panneau. Alors, elle rentra dans sa cabine et, agenouillée auprès de Mimi toujours endormie, elle adressa au ciel une fervente prière.
Arrivé sur le pont, James eut besoin de tout son courage pour continuer sa marche. Il faisait très noir ; pas de lune au ciel ; de gros nuages cachaient les étoiles. Une idée lui vint ; il alla prendre, dans la cabine blindée de l’entrepont, une lanterne sourde qui servait jadis aux manœuvres de nuit, et, l’ayant allumée, il en fit glisser le volet pour masquer sa clarté. Après quoi, il se dirigea vers l’avant.
Aucun bruit ne se faisait entendre.
James écouta avec attention et projeta le rayon de sa lanterne dans plusieurs directions ; assurément, il ne pensait pas découvrir quelque chose d’anormal sur le bateau puisque le bruit était venu de l’extérieur, mais dans l’état d’esprit où il se trouvait, il agissait machinalement, et croyait voir des fantômes surgir de ce « Monde de Désolation. »
Pour la seconde fois, il fit glisser dans ses rainures l’obturateur de la lanterne et projeta un rayon sur les algues, au-dessous de lui. Il lui sembla, pendant l’espace d’un éclair, apercevoir une multitude de choses qui s’agitaient… Ces « choses » étaient ovales et se détachaient en gris-vert sur le brun des algues.
La lumière leur fit peur, sans doute, car elles disparurent comme par enchantement.
James frissonna de la tête aux pieds ; l’obscurité aidant, il se figura avoir aperçu des spectres, marchant sur les herbes innombrables de la mer des Sargasses.
Il se raidit pourtant contre cette frayeur irraisonnée, et regarda. Il vit d’étranges ondulations se produire à la surface de la mer et recula involontairement de quelques pas. Malgré cela, il continua à projeter dans toutes les directions le rayon de sa lanterne ; il ne vit rien, mais il entendit… Ce qu’il entendit était plus impressionnant peut-être que les « Choses » qui, tout à l’heure, avaient ébranlé le navire… c’était derrière lui que la « Chose » bougeait… du côté de l’arrière, et cette « Chose » faisait : clac !… clac !… comme si elle marchait pesamment avec d’énormes sabots… Clac !… clac !… clac !… et, autour de la principale « Chose, » il devait y en avoir d’autres… beaucoup d’autres qui marchaient avec de tout petits sabots, car on entendait une multitude de pas… Clac !… clac !… clac !… clac !…
Le courage humain a des limites ! James, à qui la peur faisait dresser les cheveux, craignit de voir sa retraite coupée ; il courut au panneau qu’il ouvrit, se précipita dans l’escalier, referma soigneusement la porte et redescendit auprès d’Aliette.
–––––
RÉSUMÉ :
Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petite filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et se trouvent seuls sur le bâtiment qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive. Les courants le portent dans la mer des Sargasses, au milieu de l’Atlantique ; le bateau s’immobilise dans un champ d’algues. C’est à ce moment qu’un bruit bizarre va éveiller l’attention des jeunes abandonnés.
–––––
CHAPITRE X
UN CRI DANS LA NUIT
Aliette, qui avait entendu refermer le panneau, attendait James dans le couloir…
« Eh bien ? interrogea-t-elle.
– Je ne sais pas !… dit James… il y a « quelque chose, » certainement, mais le peu que j’ai vu est si mystérieux… qu’il m’est impossible de savoir ce que c’est…
– Et maintenant ?…
– Maintenant ?… la « Chose » est sur le pont… et elle doit être bien lourde !… on entend le bruit qu’elle fait en marchant : Clac !… clac !… et il y a d’autres « choses » plus petites qui courent derrière… Clac !… clac !… clac !…
– Oh ! James !… comme j’ai peur !
– Il ne faut pas avoir peur, Aliette ; le panneau est solide et la porte de communication donnant sur l’escalier de l’arrière est fermée par une barre de fer. Si je suis revenu… c’est que… je vais vous dire : il y a un fait que je ne comprends pas !…
– Dites-moi ce que c’est, James.
– C’est… vraiment, Aliette, on ne peut pas expliquer cela. Vous avez remarqué, comme moi, que le choc qui a ébranlé le vaisseau semblait venir de l’avant ?
– Oui ! je l’ai remarqué !…
– Très bien !… Alors, comment se fait-il qu’au moment où je suis arrivé sur la poupe… la « Chose » était derrière moi ?
– Vous en êtes sûr ?…
– Absolument !… « Elle » se dirigeait vers l’arrière…
– Et vous ne pensez pas… qu’« Elle » puisse venir ici ?…
– Cela me paraît impossible !… Il faudrait pour cela qu’« Elle » soit d’une force extraordinaire… et d’ailleurs… je suis armé !… Est- ce que Mimi dort toujours ?
– Oui !… elle dort très bien !… Je suis même étonnée que les coups ne l’aient pas réveillée !…
– Savez-vous à quoi je pense, Aliette ? »
À ce moment, un cri bizarre, le cri d’un animal qu’on égorge, se fit entendre, et tout retomba dans le silence. James eut un léger frisson, et Aliette lui saisit involontairement le bras.
« Vous avez entendu ?…
– Oui !…
– Aliette… J’ai peur !… cria Mimi, réveillée en sursaut.
– Ne craignez rien, dit James, et allez vite rassurer la petite… Ce n’est pas à nous que la « Chose » s’attaquera cette nuit. »
Aliette s’empressa de rentrer dans la cabine et prit dans les siennes la main de Mimi, qui, n’entendant plus aucun bruit, ne tarda pas à se rendormir.
James, resté seul, hésita un instant.
Qu’allait-il faire ?… La prudence lui conseillait de rentrer dans sa cabine, mais la curiosité et, peut-être aussi, son courage naturel, le poussaient à chercher le mot de l’énigme, à découvrir son ennemi invisible, et à savoir ce qui s’était passé. Il mit son revolver dans sa poche, prit sa hache d’une main, sa lanterne de l’autre, et s’avança résolument dans le couloir. Arrivé à la porte donnant sur l’arrière, il écouta attentivement. Tout était silencieux ! C’est à peine si James entendait, lointains et affaiblis, les chocs discrets de l’ennemi. Un peu rassuré par cette constatation, il se décida à ouvrir la porte qu’il referma derrière lui.
Dès qu’il eut gravi l’escalier, il promena le rayon de sa lanterne dans toutes les directions, sentant subitement renaître ses craintes en face de la solitude du « Monde des Herbes. »
La « Chose » devait s’être éloignée ; elle n’était plus sur le pont, ou, tout au moins, se tenait immobile, car le pesant : Clac !… clac !… ne s’entendait plus.
James se dirigea vers la cabane qui servait d’abri aux porcs et retint avec peine un cri devant le spectacle qui s’offrit à sa vue. Le rayon de sa lanterne venait d’éclairer le corps de l’un des animaux étendu sans vie, à plus de trois mètres de son abri.
Les deux barres de fer qui fermaient la porcherie avaient été tordues comme des fétus de paille et le porc le plus gros en partie dévoré. James n’eut pas le désir d’en voir davantage ; devant le dégât commis, il fut pris d’une peur irrésistible et regagna en hâte l’abri du couloir. Lorsqu’il eut fermé la porte à double tour, il respira, comme soulagé d’un grand poids, et se mit à réfléchir.
Quelle était donc cette « Chose » féroce qui pouvait tordre les barres de fer et tuer un gros porc aussi facilement qu’un petit chat ? Assurément, il s’agissait d’une bête très forte ; mais quelle bête ?…
James rentra dans sa cabine le plus doucement qu’il put et, pendant plus d’une heure, resta accoudé sur sa couchette à réfléchir. La fatigue finit pourtant par le terrasser et il s’endormit tout habillé.
Le lendemain matin, après le déjeuner, tandis que Mimi s’amusait avec sa poupée, Aliette prit James à part pour lui demander s’il n’avait rien de nouveau à lui dire. Après une courte hésitation, le jeune homme lui raconta très exactement ce qui s’était passé depuis le moment où il l’avait quittée jusqu’à celui où il était rentré dans sa cabine.
Aliette devint très pâle en écoutant ce récit et demanda à son compagnon s’il voulait qu’elle l’accompagnât sur le pont pour se rendre compte des dégâts. James lui désigna Mimi.
« Restez avec elle ! dit-il, jusqu’à ce que je me sois assuré qu’il n’y a plus rien à craindre !… Aussitôt ma tournée faite, je viendrai vous avertir et… nous aviserons… »
Ayant dit ces mots, il quitta la salle à manger, passa dans sa cabine prendre la hache qui ne le quittait plus et gagna le pont en fermant le panneau derrière lui.
En arrivant auprès du porc tué pendant la nuit, il constata que la « Chose » avait dû revenir après son départ, car l’animal était plus rongé que la veille et son corps presque séparé en deux parties. Les deux petits cochons, demeurés dans la porcherie, ne paraissaient pas blessés, mais la peur les avait sans doute figés sur place, car ils ne bougeaient pas, bien que la porte fût en partie enlevée. James la consolida de son mieux et se mit à visiter tout le bâtiment avec la plus grande attention, fermant les portes derrière lui au fur et à mesure qu’il avançait dans l’entrepont, afin d’être bien sûr que toute la partie parcourue était vide et que la « Chose » ne jouait pas une effrayante partie de cache-cache avec lui.
Lorsqu’il eut acquis la conviction une rien d’anormal ne se passait, il gagna l’avant du Prancing et regarda longuement la mer, mais il ne put découvrir aucune trace de la Bête mystérieuse qui les avait si fort effrayés durant la nuit.
S’il n’y avait pas eu, là-bas, à l’arrière, la carcasse du porc à demi dévorée et les barres de fer tordues, James aurait pu croire qu’il avait fait un mauvais rêve, mais le doute n’était pas permis.
La coque d’acier du Prancing, qui s’élevait à plusieurs mètres hors de l’eau, semblait beaucoup trop lisse pour permettre à un animal vivant parmi les algues de grimper sur le pont ; mais comme, d’autre part, il y avait des preuves de sa présence, il fallait bien admettre que cette bête existait… Décidément, le mystère ne s’éclaircissait pas.
James, ayant acquis la certitude que la « Chose » redoutait la lumière du jour et quittait le navire à l’aube, se promit de prendre toutes les précautions nécessaires contre une attaque possible, et redescendit auprès des fillettes qui l’attendaient.
CHAPITRE XI
À LA GRACE DE DIEU !
Mimi était très gaie, ce matin-là ! Comme elle ne s’était réveillée qu’un instant pendant la nuit, elle ignorait qu’un grave danger les menaçait, et Aliette se gardait bien de lui en parler.
James, en arrivant dans le salon, trouva les deux fillettes en train d’écrire.
« Je finis mon cahier, dit Aliette. parce que je pense qu’il faudrait le faire partir le plus tôt possible… N’est-ce pas votre avis, James ?
– C’est mon avis !…
– Moi, je fais une page d’écriture ! » dit Mimi.
James, sachant qu’Aliette parlait couramment l’anglais, lui adressa quelques phrases dans cette langue afin de n’être pas compris de leur jeune compagne.
« Il est indispensable, dit-il, que nous déménagions tous les objets qui se trouvent dans nos cabines pour les transporter dans celle de l’entrepont.
– Pourquoi ?
– Parce que la « Chose » peut revenir cette nuit… et, d’après ce que j’ai vu, je ne sais pas si nous serions en sûreté ici !…
– Qu’avez-vous vu, James ?
– Des choses extraordinaires, Aliette : la porte de la porcherie complètement brisée, la barre de fer arrachée et tordue, et le plus gros de nos porcs à demi dévoré !… Il faut éviter que Mimi aille à l’arrière avant que j’aie jeté par-dessus bord les restes de l’animal.
– C’est entendu !… Mais, dites-moi, la cabine dont vous parlez n’a pas de lits !…
– Nous y transporterons des matelas et un hamac. La pièce est assez grande, et garnie extérieurement de plaques d’acier qui nous défendront mieux que ces portes de bois… Je la diviserai en deux parties, séparées par un rideau ; vous coucherez avec Mimi dans la seconde pièce, et moi j’accrocherai mon hamac dans la première, afin d’être plus près de la porte et de pouvoir vous défendre en cas de danger.
– Elle est en acier aussi, la porte ?
– Oui…
– Est-ce que vous croyez que la « Chose » reviendra ?
– J’aime mieux vous dire la vérité : je le crois !
– Oh !… James !…
– Chut !… il ne faut pas effrayer la petite !…
– Je ne comprends pas ce que vous dites ! s’exclama Mimi. Pourquoi ne parlez-vous pas français ?
– C’était pour changer un peu !… Maintenant, nous allons parler avec toi.
– Qu’est-ce que vous avez dit ?
– Nous avons dit… que nous allions changer de chambre.
– Pourquoi ?…
– Parce qu’on sera bien mieux dans celle de l’entrepont !… Elle est tout en fer et… on entend moins le vent !… Tu comprends ?… Et puis… ce sera très amusant de déménager !… Tu nous aideras ?…
– Oui, c’est une bonne idée !… Je vais vous aider tout de suite !…
– Pas tout de suite, Mimi. Il faut d’abord qu’Aliette finisse sa lettre, et que j’arrange quelque chose sur le pont !… Lorsque j’aurai fini, je vous appellerai par un coup de sifflet, et vous viendrez me retrouver.
– À qui écrit-elle, Aliette ?…
– À sa maman !…
– Mais qui est-ce qui portera la lettre ?…
– Tu es bien curieuse, Mimi !… C’est assez difficile à t’expliquer parce que tu es encore un peu petite… Pourtant, je vais essayer. Écoute-moi bien : nous allons construire un gros ballon dans lequel il y aura du feu ; on appelle ce ballon-là une montgolfière. Au-dessous, on attachera une petite bouteille bien bouchée dans laquelle on glissera la lettre d’Aliette. Le vent emportera le ballon très loin, par-dessus les herbes, vers une mer où passent les grands bateaux. Le ballon prendra peut-être feu, mais la bouteille ne brûlera pas et tombera au milieu des vagues. Alors, elle flottera et les matelots d’un bateau qui passera l’apercevront ; ils la repêcheront, prendront la lettre d’Aliette et l’enverront à sa maman. Comprends-tu ?…
– Oh ! mais oui ! je comprends très bien ! dit Mimi ; c’est encore une très bonne idée !… et je vais écrire aussi à maman, pour que ma lettre parte en même temps que celle d’Aliette. »
James ne put s’empêcher de sourire de cette charmante naïveté. Il prit la petite dans ses bras, l’embrassa sur les deux joues et, l’ayant reposée à terre, monta rapidement sur le pont.
Son premier soin fut de gagner l’arrière et de jeter par-dessus bord les restes du porc, ainsi qu’il l’avait dit à Aliette. Ce ne fut pas sans difficulté ni sans un dégoût bien compréhensible qu’il vint à bout de sa besogne. Il lava ensuite la place où le malheureux animal avait été tué et cacha la barre tordue dans le fond de la porcherie.
Cette besogne terminée, il porta le sifflet à ses lèvres et fit le signal convenu. Deux minutes ne s’étaient pas écoulées qu’Aliette et Mimi arrivaient auprès de lui.
Mimi, toute contente, brandissait la lettre qu’elle venait d’écrire, et Aliette tenait son cahier à la main.
« J’ai fini, James ! dit-elle. J’ai raconté, aussi exactement que j’ai pu, tout ce qui nous était arrivé depuis la tempête, mais il manque le principal à mon récit, c’est-à-dire l’indication de l’endroit où nous sommes.
– Voilà ce qu’il me sera bien difficile d’expliquer avec une apparence d’exactitude, car, ainsi que je vous l’ai dit, tous les instruments du bord ont été enlevés. J’ajouterai, toutefois, à votre journal les quelques renseignements qu’il m’a été possible de me procurer.
– Est-ce que ma lettre va bientôt partir ? demanda Mimi.
– Pas tout de suite !…
– Pourquoi ?…
– Parce que le ballon n’est pas encore assez gonflé, et aussi parce que le vent souffle du nord.
– Le vent ?… Qu’est-ce ce que cela peut faire ?
– Cela fait que notre ballon irait dans la direction opposée à celle que je voudrais lui voir prendre !… Un peu de patience, Mimi ! Tu verras que tout s’arrangera.
– Mais… alors… ma lettre ?
– Donne-la-moi !… Nous la mettrons avec celle d’Aliette, sur laquelle je vais ajouter quelques mots, dans…
– Dans la bouteille…
– Non, Mimi. J’ai trouvé quelque chose de bien mieux que la bouteille !
– Qu’est-ce que c’est ?
– Un tout petit baril, qui ne pèsera pas trop lourd pour être enlevé et sur lequel nous mettrons un drapeau qui s’apercevra de loin, lorsque le ballon sera tombé en mer.
– Où est-il, ton petit baril ?
– Viens voir !… »
James, suivi d’Aliette et de Mimi, se rendit dans la cabine du capitaine, où le « journal » et la lettre furent mis dans le barillet qui devait les transporter. Ceci fait, on procéda au déménagement convenu.
Ce ne fut pas une petite affaire.
Il fallut monter les deux matelas et les couvertures destinés aux lits des petites filles, puis James remplit deux valises des objets qui lui semblaient les plus précieux.
Mimi trouvait cela très amusant ; l’idée de changer de chambre la ravissait, et elle ne s’expliquait pas pourquoi Aliette avait l’air préoccupé.
L’heure du déjeuner arriva avant que l’installation fût entièrement terminée.
Aussitôt après le repas, on se remit au travail.
Par un excès de précaution, James transporta, dans la cabine blindée, une lampe à huile, deux haches, deux fusils, deux revolvers et des munitions. Il chargea ensuite Aliette d’aller chercher, dans l’office, une provision de vivres suffisante pour une semaine, tandis qu’il remplissait d’eau douce un petit réservoir fixé au mur d’acier.
Ces préparatifs terminés, les lits furent faits, le hamac suspendu et la vaste pièce séparée en deux par un rideau.
« Comme c’est joli chez nous ! dit Mimi en battant des mains.
– N’est-ce pas ? » répondit James avec le plus grand sérieux, tandis qu’Aliette souriait tristement.
–––––
RÉSUMÉ :
Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petite filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et se trouvent seuls sur le bâtiment qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive. Les courants le portent dans la mer des Sargasses, au milieu de l’Atlantique ; le bateau s’immobilise dans un champ d’algues. C’est à ce moment qu’un bruit bizarre va éveiller l’attention des jeunes abandonnés. Ce bruit se fait entendre chaque nuit. Entre temps, on lance un message au moyen d’une montgolfière.
–––––
Vers quatre heures, le vent changea subitement.
« Voici le moment d’expédier notre message ! dit James. Je n’osais pas espérer que ce serait pour aujourd’hui.
– La montgolfière est prête ?…
– Oui !… Il n’y a plus qu’à l’installer dans un endroit favorable : à l’arrière, par exemple, afin qu’elle ne risque pas, lorsqu’elle s’envolera, de se pendre dans les agrès ; puis à attacher au-dessous le barillet.
– Et vous croyez qu’elle montera ?
– Pourquoi ne monterait-elle pas ?… Nous allons allumer du feu dans l’espace que j’ai réservé à cet effet. J’ai garni le bas de l’aérostat de lamelles de fer pour éviter tout risque de combustion. Dès que l’air chaud aura remplacé l’air froid dans l’intérieur, vous le verrez s’élever… Il faut que vous alliez, avec Mimi, me chercher des papiers et du petit bois, pendant que je vais tout préparer ici pour le départ. »
Aliette et Mimi obéirent avec empressement ; elle apportèrent à l’arrière, où la montgolfière était déjà installée, le combustible demandé par James, qui se mit à procéder avec le plus grand soin à son gonflement.
Les fillettes le regardaient avec attention ; un grand silence régnait et les cœurs battaient un peu plus vite que d’habitude. Ce ballon, qui allait partir, emporterait avec lui tous leurs espoirs. Combien de douces paroles, combien de mots tendres murmurés jadis à l’oreille des mamans, contenaient le cahier d’Aliette et la petite lettre de Mimi ! Et si le ballon ne partait pas ?… si James s’était trompé ?… Il était instruit, bien sûr, et il avait construit la montgolfière avec soin, dans une bonne toile, solide et imperméable, mais sait-on jamais ?… Si elle prenait feu ?… Si l’enveloppe avait une déchirure ?… Si le vent changeait de direction ?
Bien entendu, c’était Aliette seule qui faisait tout bas ces réflexions. Mimi, trop petite pour envisager les périls qui menaçaient sa gentille lettre, écrite d’une grosse écriture maladroite et toute pleine d’amusantes fautes d’orthographe, se contentait de penser que James était un savant et qu’une montgolfière remplaçait très bien un facteur.
Soudain, il sembla à Aliette que l’enveloppe du ballon commençait à se gonfler. Un sentiment qu’elle ne s’expliquait pas, une émotion très douce, faite d’un mélange de crainte et d’espoir, s’empara d’elle et des larmes mouillèrent ses yeux.
L’opération suivait normalement son cours ; la toile s’élargissait… s’arrondissait de plus en plus.
James regarda les nuages, s’assura une dernière fois de la direction du vent et vérifia l’attache du barillet.
Tout était prêt pour le départ ; il recula de quelques pas et coupa les attaches.
« Attention ! » dit-il.
La montgolfière se balança deux ou trois fois et la corde du barillet se tendit. Il y eut quelques secondes d’une incertitude poignante, puis, lentement, l’aérostat s’éleva dans les airs.
« Voilà le facteur parti ! » dit Mimi. Arrivé à une trentaine de mètres, la montgolfière, sous la poussée d’une forte brise, fila directement vers le nord.
« Le ciel nous protège ! » dit James ; et, enlevant son béret, il ajouta d’une voix grave :
« À la grâce de Dieu !… »
Mimi envoya un baiser au ballon qui n’était plus qu’un point à peine visible, et Aliette ne put prononcer une parole. Elle pleurait !
CHAPITRE XII
L’ATTAQUE
À six heures du soir, James fit entrer Mimi et Aliette dans la cabine blindée.
« Est-ce que nous allons dîner ici ? demanda Mimi.
– Oui ! répondit James ; tu vas aider Aliette à mettre le couvert et, dès que je serai remonté, nous pourrons nous mettre à table.
– Où vas-tu ?
– Fermer le salon et la salle à manger, puisque nous ne descendrons pas avant demain. Tu comprends que Misti pourrait voler quelque chose ou faire des dégâts pendant la nuit. »
Mimi se contenta de cette explication et James descendit faire sa ronde. Il ferma avec le plus grand soin, non seulement la porte du salon et celle de la salle à manger, mais encore celles des cabines et du couloir.
Ceci fait, il remonta sur le pont, jeta un coup d’œil sur la mer où rien ne bougeait, et rentra dans la cabine. Aliette et Mimi l’attendaient.
« Dînons ! » fit James d’un ton qu’il essayait de rendre indifférent, et l’on se mit à table.
Aliette était songeuse et ce fut Mimi qui fit tous les frais de la conversation ; elle s’enquit de la montgolfière, qui était le grand événement du jour et dont le départ l’intriguait : elle demanda où elle se trouvait maintenant, et voulut savoir si sa maman recevrait bientôt sa lettre. James, malgré toute sa bonne volonté, ne put répondre avec certitude à ces questions et Mimi en conçut quelque étonnement.
Le repas terminé, James passa l’inspection de la cabine avec le plus grand soin ; il en fit ensuite le tour par l’extérieur et ferma les volets d’acier dont Aliette tira les verrous à l’intérieur. À sept heures, la porte était fermée à son tour et les trois enfants, assis autour de la table sur laquelle avait été posée la lampe allumée, parlaient avec une apparente tranquillité.
Vers huit heures, l’obscurité commença à s’étendre sur le pont, et à huit heures et demie il faisait tout à fait nuit.
« Tu devrais te coucher, Mimi ! dit James.
– Je voudrais qu’Aliette vînt avec moi.
– Faites ce qu’elle demande, Aliette !… » conseilla l’Américain. Et il ajouta dans sa langue, afin de ne pas être compris de Mimi :
« Nous sommes en sûreté ici. Couchez-vous tout habillée pour plus de tranquillité et tâchez de dormir. S’il y avait le moindre danger, je vous réveillerais. »
Il n’y avait rien à répondre à ces paroles ; c’était évidemment un excellent conseil que donnait James. Pourtant, Aliette eut une seconde d’hésitation.
« Bonne nuit, James ! dit-elle enfin.
– Bonne nuit, Aliette !…
– Je vais rêver du ballon ! dit Mimi… Bonsoir. »
Et, soulevant le rideau qui séparait en deux la cabine, elle entra dans sa nouvelle chambre, suivie de sa petite mère.
Resté seul, James se promena de long en large, puis s’assit à sa table, tira un livre de sa poche et essaya de lire, mais les mots dansaient devant ses yeux et son esprit était ailleurs. Alors, il ferma son livre et écouta.
Un silence de mort régnait partout et ce silence avait quelque chose d’impressionnant. Pendant plus d’un quart d’heure, James resta ainsi, retenant son souffle, attendant quelque chose… Rien ne bougea.
« Je vais me jeter tout habillé sur mon hamac, » songea-t-il.
Et, s’étant assuré que sa hache et l’un des revolvers étaient à portée de sa main, il souffla la lampe.
Presque aussitôt, comme si elle n’avait attendu que ce moment pour agir, la « Chose » commença l’attaque.
Ce fut d’abord, ainsi que la veille, un coup sourd frappé contre le côté droit du vaisseau, puis une succession de chocs des deux côtés à la fois.
Aliette, effrayée, souleva le rideau et s’approcha de James, qui, ayant sauté à bas de son hamac, venait d’allumer sa lanterne sourde.
« J’ai peur, James ! dit-elle.
– Nous sommes perdus, dit Aliette.
– Chut… »
Ils écoutèrent avec attention.
On n’entendait plus rien.
« Est-ce que… c’est la « Chose » qui revient ?
– Je ne sais pas. »
Le silence se prolongeait.
« Mimi est endormie ? demanda James.
– Oui …
– Pourvu qu’elle ne se réveille pas !… La pauvre petite serait bien effrayée et nous ne pouvons malheureusement empêcher le bruit. »
Pendant près de dix minutes, il ne se produisit rien d’anormal. Aliette et James n’échangèrent que de rares paroles, heureux néanmoins de ne pas être séparés à cette heure où un péril les menaçait.
Depuis qu’il avait vu les dégâts commis par son ennemi invisible, James était devenu prudent ; il jugeait que cet ennemi devait être doué d’une force surprenante, et il ne se souciait pas de l’affronter seul en pleine nuit.
Soudain, le bruit attendu se fit entendre : Toc… toc … toc !… suivi presque tout de suite d’un frôlement continu et d’un lourd craquement.
Aliette ne put retenir un cri, auquel répondit un cri de Mimi, réveillée en sursaut.
« N’aie pas peur, Mimi ! dit la fillette ; je viens près de toi, » et elle disparut derrière le rideau.
Maintenant, c’était, comme la veille, le pas pesant de la « Chose » accompagné du claquement des petits sabots : Clac ! clac ! clac !… Et il y en avait beaucoup, à coup sûr !… des centaines… et des centaines !… toute une armée de petits sabots !…
Cela venait de l’avant et approchait dans la direction de la cabine.
James eut un léger frisson.
On entendait, de plus en plus distinct, le choc régulier des énormes pattes de la « Chose »… toc… toc !… toc !…
Aliette, très pâle, tenant Mimi par la main, reparut auprès de James.
« Asseyez-vous là, sans faire de bruit, dit le jeune homme ; et surtout, n’ayez pas peur : il n’y a aucun danger. »
Néanmoins, sa voix tremblait un peu en parlant ainsi.
« Qu’est-ce qui fait.. toc ! toc !… demanda Mimi en pleurant.
– C’est la « Chose » !… » répondit Aliette.
Et il y eut un silence.
Un coup très fort fut frappé contre la paroi d’acier de la cabine, puis un second…
Mimi se mit à pleurer plus fort.
Un troisième coup, frappé contre la porte, résonna tout le long de la pièce.
« Nous sommes perdus !… dit Aliette.
– Non ! répondit James, très calme ; nous sommes sauvés !… La « Chose » n’a pu ébranler la porte ; elle épuisera ses forces contre la cuirasse d’acier qui nous protège. »
Comme pour donner raison à l’Américain, l’attaque contre la cabine blindée cessa tout d’un coup, et le pas lourd de l’ennemi s’éloigna dans la direction de l’écoutille, suivi du piétinement des petits sabots : Clac !… clac !… clac !…
« Attention ! dit James, qui croyait deviner la tactique de l’assaillant, c’est à nous qu’on en veut !… et « on » espère encore nous trouver près du salon. Je serais bien étonné si le prochain coup n’est pas frappé sur l’écoutille. »
Il fut interrompu par un choc violent, suivi d’un craquement.
« C’est bien cela ! fit James ; je l’attendais…
– Est-ce que la « bête » va nous manger ? demanda Mimi.
– C’est impossible !… » répondit Aliette, qui tremblait bien fort.
Deux ou trois minutes passèrent, puis il y eut un quatrième coup, accompagné d’un craquement sinistre, plus prolongé que le premier.
James pâlit légèrement.
« C’est la porte du salon qui est brisée ! dit-il… la « Chose » va visiter nos anciennes cabines.
– Quel bonheur que nous soyons ici ! » murmura Aliette.
Mimi, que le sommeil gagnait malgré sa peur, avait appuyé sa tète sur l’épaule de « sa petite mère. »
« Dors, ma chérie, puisque James a dit qu’il n’y avait pas de danger. »
Mimi, rassurée, ferma les yeux.
On entendait maintenant un bruit continu dans l’intérieur du bâtiment ; l’armée des « petis sabots » descendait par l’écoutille sur les traces de… la « Chose »… Clac !… clac !… clac !… clac !…
Cela s’éloignait, s’affaiblissait. Aliette respira.
« Je vais remettre Mimi sur son lit, » dit James en prenant le petite fille dans ses bras.
Mimi, qui dormait à poings fermés, ne se réveilla pas et tout se passa le mieux du monde.
« Pensez-vous que nous serons encore attaqués ?… » demanda Aliette, lorsque son compagnon fut revenu. James haussa les épaules.
« Dieu seul le sait !… dit-il. Le mieux est de nous tenir prêts ! »
En prononçant ces paroles, il tourna la lanterne sourde, afin que le rayon lumineux qui passait sous la porte ne pût signaler leur présence.
« Vous devriez allez vous reposer aussi, Aliette ! remarqua James ; il est inutile que vous restiez éveillée toute la nuit !
– Non, James, je ne pourrais pas dormir !… »
Pendant près d’une heure, ils restèrent ainsi, n’échangeant que de brèves paroles, écoutant anxieusement les coups frappés par la « Chose, » le craquement des portes brisées et le lointain toc !… toc !… toc !… des invisibles ennemis.
Enfin, le tapage s’apaisa ; mais ce fut pour quelques minutes seulement… Tout à coup, les pas lourds de la « Chose » se firent entendre de nouveau plus près… plus près encore… et soudain… « Boum ! » un coup formidable fut frappé contre l’un des côtés de cabine…
« Oh !… James !… » dit Aliette, en saisissant le bras de son compagnon.
« Boum ! » un second coup, qui se répercuta comme un roulement de tonnerre, fut frappé sur la muraille d’acier.
Il y eut, après cela, une petite pause, comme si l’ennemi reprenait haleine, puis un troisième coup retentit en plein sur la porte.
Mimi se réveilla pour la seconde fois, et James saisit son revolver.
« La « Chose » est terriblement forte ! murmura-t-il entre ses dents, et si je n’étais sûr de la solidité… »
Son monologue fut interrompu par un autre coup aussi violent que le précédent, et presque immédiatement le lourd… toc… toc… toc… s’entendit autour de la cabine.
James respira.
La « Chose » renonçait à l’attaque contre la porte, pour chercher un défaut à la muraille d’acier ; mais rien n’était à craindre de ce côté-là ! Les coups s’espacèrent, puis finirent par cesser complètement.
Aliette, qui avait réussi à rendormir Mimi, revint auprès de James.
« Est-ce que la « Chose » est partie ? demanda-t-elle.
– Pas encore ! répondit James, mais elle s’est rendu compte que notre forteresse était imprenable, et nous sommes certainement hors de danger. »
On entendit, à ce moment, un bruit étrange… une sorte de trépignement suivi de coups maladroits qui s’éloignèrent… toc !… toc ! toc !…
« On croirait que la « Chose » boite, dit Aliette.
– Oui ! » répondit James.
Et pour quelques instants, ils écoutèrent en silence.
L’armée des « petits sabots » semblait désorientée : Clac !… clac !… clac !… on aurait cru qu’elle se débandait, qu’elle s’enfuyait dans toutes les directions.
« Dieu nous protège ! murmura Aliette.
– Il nous sauve ! » répondit gravement James.
Le silence se faisait peu à peu. James éteignit la lanterne et ralluma la lampe. Une demi-heure passa.
« Il est arrivé quelque chose à l’ennemi ! » dit James.
Aliette ne répondit pas ; brisée de fatigue, elle venait de s’endormir sur sa chaise.
Bien entendu, son compagnon se garda de la réveiller. Une heure plus tard, il sentit que le sommeil le gagnait à son tour, mais il ne voulut pas s’assoupir avant d’être certain qu’aucun retour offensif de la « Chose » n’était à craindre.
Combien de temps dura sa veille, il n’aurait pu le dire : une certaine nervosité, due sans doute à la fatigue, s’était emparée de lui, et il se mit à marcher de long en large, en songeant aux événements de la nuit.
Soudain, il s’arrêta et un cri de joie faillit lui échapper : une raie lumineuse filtrait sous la porte ; c’était le jour qui venait.
Alors, il souffla la lampe, se jeta tout habillé dans son hamac et s’endormit presque aussitôt d’un profond sommeil.
–––––
RÉSUMÉ :
Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petite filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et se trouvent seuls sur le bâtiment qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive. Les courants le portent dans la mer des Sargasses, au milieu de l’Atlantique ; le bateau s’immobilise dans un champ d’algues. C’est à ce moment qu’un bruit bizarre va éveiller l’attention des jeunes abandonnés. Ce bruit se fait entendre chaque nuit et la dernière vient d’être particulièrement dramatique ; mais nous allons connaître enfin ce « Mystérieux ennemi. »
–––––
CHAPITRE XIII
LES GÉANTS DE LA MER
Ce fut Aliette qui se réveilla la première.
Elle était toute courbaturée d’avoir dormi sur sa chaise et faillit tomber, ce qui tira James de son sommeil.
« What is the matter?… demanda le jeune homme encore engourdi.
– J’ai manqué de tomber, dit Aliette.
– Il fait grand jour ?
– Oui ! »
James sauta à bas de son hamac et poussa les plaques de fer tenant lieu de fenêtres.
Un rayon de soleil entra dans la cabine.
« Il doit être tard ! dit Aliette.
– Je le crois, » répondit James en ouvrant les autres volets de fer.
Mimi se réveilla à son tour ; on l’entendit derrière le rideau qui criait :
« Maman Aliette !… est-ce que « la Bête » est partie ?
– Oui !… Mimi… elle est partie… dépêche-toi de t’habiller ; nous allons préparer le déjeuner. »
Tandis qu’Aliette rejoignait sa petite amie derrière le rideau, James examinait avec soin les revolvers et plaçait la hache à portée de sa main.
On se contenta, ce matin-là, d’un peu de chocolat avec deux biscuits trempés dans de l’eau rougie, James ne voulant pas que l’on sortît de la cabine avant d’en avoir lui-même exploré les abords.
Le repas terminé, Aliette dit à son compagnon avec une fermeté que l’on n’aurait pas attendue d’une fillette de son âge :
« Lorsque vous sortirez… j’irai avec vous… et… vous me donnerez un revolver !… »
James la regarda, surpris.
« Vous n’y pensez pas, Aliette !… dit-il ; il peut y avoir du danger ! votre place est à côté de Mimi…
– Non !… James… s’il y a du danger, c’est précisément le cas de m’emmener ; nous ne serons pas trop de deux pour tirer sur « la Chose, » si elle nous attaque.
– Elle ne nous attaquera pas !… le jour lui fait peur.
– C’est égal !… je préfère aller avec vous !… J’ai idée que… nous la verrons aujourd’hui… Elle doit être blessée… Elle avait l’air de boiter quand elle est partie… peut- être qu’elle m’a pas pu regagner la mer… peut-être qu’elle nous attend sur le pont, prête à se jeter sur nous, et alors…
– Vous êtes une brave compagne, Aliette, et je vous remercie, mais… je ne puis accepter…
– Pour cette fois, James… je vous désobéirai !… Si un danger vous menace, comme je le crois, je veux en avoir ma part !… Je vous suivrai !…
– Alors ?… je vais rester toute seule ? » dit Mimi, prête à pleurer.
Comme pour répondre à cette question, le chat du bord bondit par l’une des fenêtres ouvertes et vint tomber sur ses quatre pattes aux pieds d’Aliette, en faisant le gros dos.
« Tu ne seras pas seule, vois-tu, dit la fillette ; voilà ton ami Misti qui vient juste à point pour te tenir compagnie. »
Les larmes de Mimi s’arrêtèrent comme par enchantement ; elle caressa Misti qui devait avoir éprouvé une peur terrible, car tous ses poils étaient hérissés et il miaulait à faire pitié.
« Il aura vu « la Chose »… remarqua Aliette.
– Peut-être même a-t-il été poursuivi cette nuit. »
Sous les caresses de Mimi, le chat se calmait ; il fit entendre un « ronron » de plaisir en se frottant contre les jupes de sa petite amie.
« Il faut lui donner à manger, » dit James.
Aliette alla lui chercher l’assiette dans laquelle on avait mis les rognures de la veille et Misti se jeta dessus avec voracité.
« Cette pauvre bête n’avait certainement pas mangé depuis hier ! fit observer James ; il faudra la garder avec nous.
– Oh ! oui !… dit Mimi… je garde Misti !… il m’aime bien, lui !… il n’y a pas de danger qu’il me quitte pour aller se faire manger par « la Chose »…
James ne put s’empêcher de sourire.
« Nous ne serons pas mangés par « la Chose, » dit-il… C’est peut-être nous… qui la mangerons !
– Oh !… ça, jamais ! »
Aliette avait pris l’un des revolvers dans sa main droite et elle regardait son compagnon avec une parfaite assurance, bien que son cœur battît plus vite que d’habitude.
« Alors, vous tenez absolument à me suivre ? demanda l’Américain.
– J’y tiens !…
– Vous êtes sûre que vos forces ne vous trahiront pas ?
– Oui !
– Eh bien… Allons !… »
En disant ces mots, James, une hache dans la main droite, un revolver passé dans sa ceinture, ouvrit la porte avec précaution.
Rien ne bougeait au-dehors.
Le jeune homme fit quelques pas, regarda autour de lui avec attention et appela Aliette.
« Vous pouvez venir !… » dit-il.
Aliette sortit de la cabine dont elle referma soigneusement la porte.
« Vous ne voyez rien, James ?
– Rien !…
– Si nous allions jusqu’à l’écoutille ?
– C’est mon intention !… mais il faut d’abord que nous fassions le tour de la cabine !
– Je vous suis !…
– C’est curieux !… il n’y a aucune trace, ici, de ce que nous cherchons ! et pourtant, j’aurais cru que « la Chose »… était là… tout près !
– Moi aussi !… Je l’ai entendue partir en boitant… ce serait bien étonnant qu’elle ait pu regagner la mer !
– Ce serait surtout fâcheux !… parce qu’il nous faudrait soutenir un nouvel assaut !… L’important, voyez-vous, c’est que nous puissions savoir par quel moyen nos ennemis arrivent à gagner le pont ; le jour où nous aurons découvert leur stratagème, nous serons bien près de les avoir vaincus !… »
James, le front soucieux, se dirigea vers l’écoutille, suivi d’Aliette.
Un spectacle effrayant s’offrit à leurs yeux.
Le panneau complètement arraché gisait en deux morceaux sur le pont, qui était d’ailleurs jonché de débris de toutes sortes…
« Descendons ! » dit James, et il s’engagea dans l’escalier, suivi d’Aliette.
Arrivé dans le couloir, un sentiment de terreur involontaire les envahit ; ils semblèrent hésitants.
« Est-ce que nous continuons ? demanda Aliette.
– Oui !… Il le faut !…
– « La Chose » est passée par ici ! Toutes les portes sont brisées !…. Quel monstre cela peut-il être ?… pour avoir fait un semblable dégât ?
– Avez-vous peur, Aliette ?
– Oui ! j’ai très peur !… mais je veux aller avec vous tout de même. »
Le salon était complètement bouleversé ! Des portes, arrachées de leurs gonds, étaient tombées à côté de la table renversée, les pieds en l’air ; les chaises étaient cassées, les placards enfoncés.
« C’est terrible ! dit James.
– Terrible ! » répéta Aliette, et ils gagnèrent la salle à manger en enjambant les décombres.
C’était le même spectacle que dans le salon ; « la Chose » avait jeté à terre les gros meubles que l’armée des « Petits Sabots » avait déchiquetés en maints endroits.
Pourtant, tout cela n’était rien, en comparaison de la dévastation commise dans les cabines de James et d’Aliette.
Les rares, objets qui y avaient été laissés, étaient éparpillés de tous côtés, les portes brisées, les vêtements mis en pièces.
« La Chose » nous cherchait ! dit James ; elle s’est vengée sur nos effets… Si nous n’avions pas changé de chambre… nous aurions eu un terrible combat à soutenir. »
Aliette ne répondit pas ; elle avait des larmes plein les yeux, en songeant à Mimi, et au grave danger dont le ciel les avait préservés ; alors, elle s’agenouilla et fit une courte prière avec un cœur débordant de reconnaissance.
James visita l’office qu’il trouva intact, ce qui confirma son impression première : c’est-à-dire que « la Chose » leur en voulait particulièrement et avait été guidée uniquement par l’odeur de la chair humaine.
Les deux courageux enfants refirent en sens inverse le chemin qu’ils venaient de parcourir, et remontèrent sur le pont.
« Je ne serai satisfait qu’après avoir découvert « la Chose, » dit James entre ses dents.
Il revint, toujours suivi d’Aliette, par l’arrière du Prancing et constata que la porcherie et le poulailler étaient intacts. Aucune victime n’avait payé de sa vie, comme la veille, la visite du mystérieux ennemi.
« Curieux !… murmura l’Américain… il faut voir plus loin ! »
Ils continuèrent à avancer, repassèrent devant l’écoutille et longèrent pour la seconde fois la cabine blindée.
« Rien ! »
James continua à avancer dans la direction de la poupe.
« Il y a des traces ici !… dit Aliette, en désignant des planches brisées.
– Nous sommes sur la bonne piste !… regardez !
– Qu’est-ce que cela ?
– Des crabes !… »
Il y avait en effet quelques crabes morts, au-dessous d’une grosse planche qui les avait tués en tombant ; ces crabes étaient de taille moyenne et avaient une carapace d’un blanc laiteux. Ils devaient faire partie de l’armée des « Petits Sabots » qui accompagnait… « la Chose »… l’introuvable « Chose » avec laquelle la lutte à mort était engagée !
Soudain, James, qui venait d’avancer de quelques pas, s’arrêta net, auprès d’un paquet de cordages.
Ce qu’il venait d’apercevoir devait être extrêmement surprenant, car Aliette l’entendit murmurer :
« Oh !… par exemple !… c’est incroyable ! »
Comme il se baissait pour examiner sa trouvaille, la fillette le rejoignit et la voix s’étrangla dans sa gorge.
Ce qu’il y avait là, sous ses yeux, c’était une patte énorme d’un brun vert, terminée par une pince puissante.
James la souleva, non sans peine, car elle ne pesait pas moins de quinze kilos.
À quel monstre inconnu, à quel Géant de la mer pouvait appartenir cette pince formidable ?
Aliette n’allait pas tarder à le savoir.
Son compagnon, la hache en main, venait d’arriver sur la poupe, lorsqu’il recula involontairement en disant d’une voix que l’émotion faisait trembler :
« La Chose » !…
C’était vrai !… L’être inconnu qui les avait attaqués avec tant de fureur… « La Chose »… comme ils l’appelaient, était là, devant eux, étendue sur le dos… et cette « Chose, » c’était un « Énorme Crabe. »
Tout d’abord, ils restèrent comme pétrifiés à la vue du monstre immobile, impuissant, à leurs pieds. Sa carapace avait plus d’un mètre de largeur et ses pattes, maintenant inertes, étaient plus longues encore !
Ce fut James qui revint le premier à la réalité.
« Il faut s’assurer que cette « Bête » est morte ! » dit-il, et il s’avança en levant sa hache.
« Prenez garde ! cria Aliette. S’il vous attaquait ?
– Pas de danger, maintenant ! son propre poids l’empêcherait de se relever, alors même qu’il lui resterait des forces… d’ailleurs, son équilibre est rompu par la perte de sa première pince ; c’est même pour cela qu’il a dû tomber sur le dos…
– Si nous déchargions nos revolvers sur lui ?
– Cela ne servirait à rien !… les balles rebondiraient sur son épaisse carapace sans parvenir à la percer.
– Mais… alors, comment allez-vous faire ?
– Chercher le défaut de la cuirasse et enlever sa seconde pince d’un coup de hache…
– Vous ne pourrez pas !
– Ce n’est pas aussi difficile que vous le pensez ! il suffit de bien viser, et de trouver le joint de l’articulation !… laissez-moi faire et… ne craignez rien ! »
En disant ces mots, James tournait autour du monstre avec précaution. Arrivé à l’endroit propice, il regarda attentivement la grosse pince, se rendit compte de la façon dont elle était attachée au corps de l’animal et réfléchit un instant.
Aliette était en proie à une impatience fébrile, mais James, au contraire, n’avait jamais été plus maître de lui ; il comprenait que le sang-froid était nécessaire ! Si le crabe géant n’était pas mort, un coup de hache maladroitement appliqué pouvait, au lieu de le tuer, lui rendre son équilibre, et alors ?… le danger serait grand pour eux !
Il fit signe à Aliette de reculer jusqu’à la cabine blindée.
« Ouvrez la porte ! » dit-il.
La jeune fille obéit.
« Est-ce que je peux sortir ? demanda Mimi délivrée.
– Pas encore ! »
La petite fille resta sur le pas de la porte.
Aliette se rapprocha de James.
« Vous feriez mieux de reculer un peu ! dit l’Américain… il faut encore nous tenir sur nos gardes !
– Je n’ai plus peur !… « La Chose » est morte !…
– Certes !… le danger… semble avoir disparu !… Toutefois… il faut se méfier des crabes !… Ce sont d’étranges bêtes !… Tenez ! regardez ce petit-là ! »
En disant ces mots, James désignait un crabe d’un brun olive qui semblait avoir été tué par le poids du géant.
Il le poussa du pied. L’animal se mit à bouger.
« Tiens ! dit Aliette, il n’est pas mort ?
– Vous voyez qu’on ne saurait prendre trop de précautions !
– Oh ! regardez… James !… regardez donc !… »
Ce que désignait Aliette, c’était un crabe fort gros, de la même couleur que le premier et que la chute du monstre avait séparé en deux parties.
D’autres crabes à carapaces blanches (également coupés en deux) se trouvaient sous les pattes de « la Chose, » et Aliette, poussée par la curiosité, s’approcha pour les examiner de plus près.
Soudain, Mimi, qui était arrivée sur la pointe des pieds (malgré la défense qu’on lui avait faite), poussa un cri perçant. Elle venait d’apercevoir « la Chose » ! Et… cette Chose… bougeait ! L’immense pince qui lui restait, venait de décrire un grand arc de cercle et elle avait saisi Aliette par sa jupe.
Il y eut un moment critique !
Une terreur folle s’était emparée de Mimi qui se cachait les yeux… Aliette, à demi évanouie, était suspendue à plus d’un mètre du sol, au bout de cette pince monstrueuse, à l’aide de laquelle le géant allait, sans doute, la serrer contre sa carapace et la dévorer.
La fillette semblait perdue !
« J’ai peur ! dit Mimi… Aliette va être mangée !…
– Tais-toi ! » ordonna James, qui, en face du danger, n’avait pas perdu sa présence d’esprit.
Il s’approcha de deux pas, calcula sa distance et attendit.
La patte du monstre se repliait lentement, découvrant la jointure ; James leva sa hache.
« J’ai peur !… j’ai peur, » répéta Mimi.
Cette fois, l’Américain ne répondit pas ! L’œil fixé sur l’articulation du monstre, il calculait ses chances.
« Attention ! cria-t-il.
– Aliette !… maman Aliette ! » murmura Mimi.
L’instant d’agir était arrivé.
Le fer de la hache lança un éclair ; un sifflement se fit entendre. James frappa !
Un craquement sinistre, suivi d’un bruit sourd, tira Mimi de sa torpeur ; elle rouvrit les yeux et regarda.
La pince, séparée du corps de la bête, venait de rebondir sur le pont. Aliette était évanouie, mais sauvée !…
James, après avoir épongé son front, s’empressa de secourir sa jeune amie. Elle n’avait aucune blessure et son évanouissement était dû à la frayeur encore plus qu’à l’étourdissement causé par sa chute.
Quelques gouttes d’eau fraîche sur les tempes et un petit verre de rhum, que Mimi alla chercher, sur l’ordre de James, suffirent pour la rappeler à la vie.
Dès qu’elle put se tenir debout, le jeune homme la fit asseoir, à côté de Mimi, sur le paquet de cordages près duquel se trouvait la première pince, et il revint vers le crabe. Pendant plus de dix minutes, il s’ingénia à séparer à coups de hache les attaches de la carapace et finit non sans peine à obtenir ce résultat. Alors, à l’aide d’une barre de fer, dont il se fit un levier, il souleva l’un des côtés de cette énorme cuirasse et déchargea ensuite son revolver dans le corps même de l’animal.
Il n’y avait plus rien à redouter du « Géant de la mer. » Aliette et Mimi pouvaient venir !…
Cette fois, « la Chose » était bien morte !
–––––
RÉSUMÉ :
Le Prancing est un bateau qui a été canonné par les Allemands, au moment de sa traversée de l’Atlantique. L’équipage, les passagers ont été débarqués. Le hasard et la précipitation ont fait que, dans une telle confusion, un jeune Américain, James, et deux petites filles françaises, Aliette et Mimi, se sont trouvés séparés de leurs parents et sont restés seuls sur le bâtiment, qui, ayant son hélice brisée, s’en va à la dérive. Les courants le portent dans la mer des Sargasses, au milieu de l’Atlantique ; le bateau s’immobilise dans ce champ d’algues. C’est à ce moment qu’un bruit bizarre a éveillé l’attention des jeunes abandonnés. Ce bruit se fait entendre chaque nuit. Enfin, l’on découvre que c’est un crabe géant. James l’abat à coups de hache : le mystérieux ennemi n’existe plus.
–––––
CHAPITRE XIV
JOURS D’ATTENTE !
Le mystère étant éclairci, les terreurs de la nuit s’effacèrent.
« Nous savons à qui nous avons eu affaire ! dit James, et c’est déjà beaucoup !
– Nous connaissons notre ennemi, répondit Aliette qui avait repris ses esprits, mais qui nous prouve qu’il était seul ?… et surtout… qu’un autre tout semblable ne reviendra pas ?
– Des crabes de la taille de celui-ci sont rares !
– Pensez-vous qu’il était seul ?
– Non !… je ne le pense pas !… mais, c’était très probablement le plus fort ! C’est lui qui a conduit l’attaque… et en voulant briser notre porte, il a simplement brisé sa pince.
– Par quel chemin était-il venu jusqu’ici ?
– C’est ce qu’il importe de découvrir !… Dès que nous aurons trouvé le moyen qu’ils emploient pour gravir la coque, nous serons bien près d’être débarrassés de leur présence… »
À ce moment, la voix de Mimi se fit entendre tout là-bas, à l’avant du bâtiment.
« James !… Aliette… venez voir !… »
L’Américain et sa jeune compagne s’empressèrent de rejoindre la fillette.
« Là !… regardez !… disait Mimi, et son petit doigt tendu désignait l’enchevêtrement d’agrès tombés avec le haut du mât sur l’extrême avant du Prancing.
Aliette poussa un cri de surprise.
« Tout s’explique, dit James de son ton tranquille ; la Providence se sert souvent des petits pour faire de grandes choses, et c’est Mimi qui a trouvé le mot de l’énigme. »
Un gros crabe, suivi de quinze ou vingt plus petits, descendait maladroitement le long des cordages et des morceaux de bois dont l’extrémité baignait dans la mer.
Ce fut une révélation !
James fit reculer Aliette et Mimi, et, à grands coups de hache, il fit tomber dans l’eau ces débris qui avaient servi jusqu’ici à leurs ennemis pour gagner le pont.
« Je comprends maintenant ce qui s’est passé, dit-il… L’odeur de la cuisine et les restes que nous avons jetés parmi les algues ont attiré ces affreuses bêtes ; ne trouvant pas de prise contre les flancs lisses de notre prison flottante, elles en ont fait le tour et ont découvert le mât brisé qui leur a servi d’échelle… Désormais, nous sommes complètement à l’abri de leurs attaques.
– Croyez-vous ?
– J’en suis sûr.
– Moi aussi, j’en suis sûre ! dit Mimi, se faisant l’écho de James ; maintenant que le gros crabe est mort, les petits vont avoir peur !… et puis… comment monteraient-ils puisqu’on leur a cassé leur échelle ?… »
Aliette essaya de sourire ; mais l’émotion qu’elle avait éprouvée une heure auparavant, en se sentant enlevée par « la Chose, » l’avait beaucoup fatiguée et elle ne put que murmurer :
« Espérons ! »
Cependant, les prévisions de James étaient justes. À dater de ce jour, aucun crabe ne fut aperçu sur le pont et les nuits redevinrent paisibles. On répara le désordre de la salle à manger ; James se fit tour à tour menuisier et serrurier ; il remit en place tant bien que mal les portes arrachées et les cloisons détruites. Ce travail fournit à tous de l’occupation, pour plus d’une semaine. Toutefois, par mesure de précaution, et surtout pour tranquilliser Aliette, qui avait conservé, depuis son aventure, une grande nervosité, on continua à faire de la cabine blindée l’habitation principale.
Les jours succédaient aux jours et les semaines aux semaines.
Mimi s’était habituée à sa nouvelle existence. Avec l’insouciance de son âge, elle jouait avec Misti, étudiait sous la direction de James ou aidait Aliette dans ses occupations journalières, sans s’inquiéter du lendemain.
Assurément, le souvenir de sa maman traversait parfois son esprit, mais cette pensée ne la rendait pas triste ; elle se disait qu’elle la retrouverait plus tard et cette assurance lui suffisait. Une chose pourtant l’étonnait, c’était de n’avoir pas reçu de réponse à sa lettre et elle interrogea James à ce sujet.
« Mais, lui répondit son grand ami, comment veux-tu qu’une lettre nous parvienne en pleine mer des Sargasses ?
– Je ne sais pas, moi… J’en ai bien envoyée une à maman avec un ballon… pourquoi ne m’en renverrait-elle pas une autre de la même façon ?
– Oh ! Mimi… dit Aliette, intervenant dans la conversation, ce n’est pas la même chose !… Rien ne prouve, d’ailleurs, que nos lettres soient arrivées à destination… Le barillet qui les contient est sans doute en pleine mer, en attendant qu’un bateau le rencontre… et qui sait s’il sera jamais découvert ?…
– Tu es méchante ! Aliette, » dit Mimi, qui ne voulait pas que l’on détruisît ses illusions.
James fit signe à Aliette, qui n’insista pas.
L’existence à bord avait été parfaitement réglée, grâce à l’esprit méthodique du jeune homme. En dehors des heures de ménage et des travaux d’entretiens du Prancing, il y avait place pour l’étude et pour les divertissements.
Il fallait, avant tout, empêcher que l’ennui ou le découragement s’emparât des esprits, et c’est à cela que veillait James.
Mimi, sous sa direction, commença à étudier l’anglais.
Aliette trouva, dans la bibliothèque du bateau, les livres dont elle avait besoin pour continuer son instruction, et son compagnon l’engagea à lui demander les renseignements qui pourraient lui faire défaut.
Malgré son application au travail, et le zèle qu’elle mettait à accomplir les besognes qui lui incombaient dans la tâche de chaque jour, Aliette était triste. Au fur et à mesure que s’écoulaient les semaines, son espoir dans la délivrance diminuait. Un matin, elle dit à James :
« Voici plus de deux mois que nous sommes ici dans la mer des Sargasses et nous n’avons rien aperçu que ces éternelles algues brunes, qui s’étendent à perte de vue. J’ai bien peur que nous soyons perdus pour toujours !
– Ne vous mettez pas ces idées en tête, répondit James… J’ai confiance dans l’avenir… un jour viendra où nous serons sauvés !…
– Ce jour serait déjà venu si nos lettres avaient été trouvées.
– Nous en enverrons d’autres.
– Rien ne prouve qu’elles arriveront… La mer est immense et les bateaux suivent tous la même route.
– Il faut compter avec les courants qui, insensiblement, entraînent tous les corps flottants vers des points fréquentés…
– Cela peut être long… très long…
– Mais cela arrivera !
– Si notre baril ou notre bouteille n’ont pas été brisés, si une fissure ne s’est pas produite dans le bois, s’ils ne sont pas au fond de la mer !… Vous voyez que ce sont là bien des conditions… Croyez-moi, James… si nous avions dû être délivrés, ce serait déjà fait !….
– Qu’en savez-vous, Aliette ? En admettant même que notre appel soit parvenu à son but, le navire qui l’aurait recueilli ne pourrait nous découvrir sans difficulté…
– Pourquoi cela ?…
– Mais parce que la mer des Sargasses est vaste et qu’il m’a été impossible, faute d’instruments, de déterminer la position du Prancing… En tous les cas… je vous l’ai dit, nous recommencerons notre tentative ; je construirai un nouveau ballon, nous enverrons un nouveau message… et il est bien probable que notre appel sera entendu.
– N’y aurait-il pas un moyen plus simple ?
– Lequel ?
– Ce serait, par exemple, d’aller au-devant de nos sauveteurs !
– Que voulez-vous dire ?… Et par quel moyen y parviendrions- nous ?
– En construisant un radeau… et… en nous dirigeant vers le nord, puisque c’est du nord que nous sommes venus.
– Croyez-vous que je n’ai pas songé à ce moyen ?… Si je n’ai pas essayé de le mettre à exécution, c’est qu’il se heurte à des difficultés presque insurmontables…
– Quelles difficultés, James ?
– Mais, ma pauvre Aliette, la construction du radeau tout d’abord. Il devra être assez grand et assez large pour nous permettre d’emporter des vivres en grande quantité. Il est évident, n’est-ce pas, qu’il faut envisager la possibilité d’un long séjour en pleine mer.
– Sans doute !…
– Ce n’est pas là, cependant, la principale difficulté ; le radeau une fois construit et chargé, il nous restera à nous orienter. La direction du nord peut n’être pas la bonne, car, durant notre fuite devant la tempête, nous ne pouvons affirmer avec certitude que nous avons été poussés en plein sud. Enfin, et c’est là l’objection principale, comment parviendrons-nous à naviguer au milieu de cet enchevêtrement d’herbes marines et d’algues brunes ? Dresserons-nous un mât, avec une voile, et attendrons-nous un souffle de vent incertain ?… Croyez-moi, Aliette, nous ne pourrions venir à bon de cette folle entreprise, alors même que de nouveaux Géants de la mer n’attaqueraient pas notre frêle esquif. »
Cette dernière phrase fit frissonner Aliette.
« Je n’avais pas pensé à tout cela, dit-elle en baissant la tête ; vous avez raison, James ! il faut rester sur le Prancing.
– Oui, rester sur le Prancing, mais sans jamais désespérer de la Providence, et en faisant tous nos efforts pour l’aider ! Vous allez préparer un second message et je l’enverrai comme le premier. »
Lorsque Mimi sut qu’on allait gonfler un autre ballon, elle fut enchantée.
« J’écrirai encore à maman ! dit-elle, et je suis bien sûr qu’elle me répondra ! »
Cette fois, Aliette n’essaya pas de lui démontrer qu’une réponse était chose tout à fait impossible ! À quoi bon lui enlever ce touchant espoir ? N’était-il pas plus sage de lui laisser ses illusions ?
Trois jours plus tard, une seconde montgolfière emportait, enfermée dans une bouteille, une lettre de Mimi et un message d’Aliette.
Ce message contenait, en plus des événements portés sur le premier, un récit détaillé de l’attaque des crabes.
James y ajouta, comme d’habitude, quelques indications susceptibles d’aider les recherches de leurs sauveteurs, dans le cas où la bouteille arriverait à destination ; et le départ eut lieu.
Ce départ fut émouvant, comme le premier ; le ballon trouva un courant aérien qui l’emporta vers le nord et les trois prisonniers le suivirent des yeux aussi longtemps qu’il fut visible.
« Il emporte ma lettre ! dit joyeusement Mimi.
– Il emporte mon cœur ! murmura Aliette.
– Il emporte une chance de salut ! » ajouta James, avec son remarquable sang-froid.
Aliette le regarda avec admiration.
« Vous me faites envie, James, dit-elle ; rien ne vous décourage, votre humeur est toujours égale… si nous sommes sauvés, ce sera grâce à vous !…
– Grâce à Dieu, Aliette.
– Oui ! certes, grâce à Dieu !… mais aussi, je le répète, grâce à vous, qui l’aidez de votre mieux. Si j’avais été seule sur le Prancing… James, je serais morte de peur !… Jamais je n’aurais su réagir comme vous l’avez fait !… Tenez !… James… je voudrais…
– Que voudriez-vous, Aliette ?…
– Je voudrais… (si nous sommes sauvés un jour)… que nous puissions ne plus nous quitter.
– Nous serons sauvés !
– Vous êtes pour nous un grand frère !… vous avez su régler notre existence au point d’en chasser l’ennui !… Maintenant que nos parents sont loin… morts peut-être… que nous reste-t-il ?…
– L’espoir !… »
–––––
–––––
–––––
–––––
Le Mystérieux Ennemi, Tours : Alfred Mame & fils, 1932. Couverture illustrée par Auguste Goichon
–––––
–––––
WILLIAM HOPE HODGSON : LE CINQUIÈME MESSAGE
–––––
Au mois d’août 1902, le capitaine Bateman, commandant la goélette Agnès, harponna un petit baril sur lequel se lisaient quelques lettres peintes, mais l’inscription était très détériorée. Il finit par déchiffrer le nom Homebird, celui d’un magnifique navire marchand qui quitta Londres en novembre 1873 et que personne n’avait jamais revu depuis.
Le commandant Bateman ouvrit le baril et découvrit un paquet de manuscrits enveloppés dans de la toile cirée. Après l’avoir examiné, il découvrit que c’était la relation de la perte du Homebird dans les étendues désolées de la mer des Sargasses. Le manuscrit était rédigé par un certain Samuel Phillips, passager à bord du bateau. De quoi le commandant Bateman finit par comprendre que le navire démâté se trouvait au cœur des terribles Sargasses et que tout l’équipage était perdu, – plusieurs hommes dans la tempête qui avait assailli le bateau auparavant et d’autres en essayant de haler le bateau hors des algues qui le retenaient prisonnier.
Seuls, Phillips et la fille du commandant avaient survécu. En mourant, le commandant les avait mariés. Une fille était née. Le document se terminait sur une courte mais émouvante allusion à la crainte, pour tous, de manquer de nourriture.
On ne pouvait rien dire de plus. Le message fut publié dans les journaux quotidiens et les commentaires allèrent leur train. On parla d’envoyer une expédition à la recherche du Homebird, mais cela n’alla pas plus loin. Il n’y avait aucun moyen de connaître la position du navire dans l’immensité de la mer des Sargasses. Peu à peu, on ne pensa plus à cette affaire.
Cependant, il y eut un sursaut d’intérêt pour le trio perdu. Un second baril, identique, semble-t-il, à celui qu’avait trouvé le commandant Bateman, fut ramené par un M. Bolton, de Baltimore, patron d’un petit brick qui cabotait sur la côte sud-américaine. Ce baril contenait un autre message de M. Phillips, le cinquième qu’il adressa au monde. Mais on n’a pas découvert, jusqu’à maintenant, le second, ni le troisième ni le quatrième.
Le « cinquième message » est le terrible compte rendu de la vie des naufragés pendant l’année 1879. C’est un document unique sur la solitude humaine et la désespérance. Je l’ai en main et je l’ai lu avec autant d’intérêt que de peine. Quoique l’écriture en fût un peu effacée, il était encore lisible. Il n’est pas douteux que ce manuscrit fût du même esprit et de la même main que celui dans lequel était contée la sinistre aventure du Homebird dont j’ai déjà fait mention et que, sans aucun doute, beaucoup connaissent.
Ayant donné ces quelques explications, je suis amené à me demander si les trois messages manquants seront jamais retrouvés : quand et où ? Et il y en a peut-être d’autres. Que n’apprendrions-nous pas d’eux sur ce combat résolu d’un homme avec le Destin. En attendant, on ne peut que se perdre en conjectures. Nous n’en saurons peut-être pas plus. Ce n’est qu’une pauvre tragédie parmi des millions d’autres dont la mer implacable conserve le secret. Des nouvelles nous parviendront peut-être de l’Inconnu, – des solitudes silencieuses de la terrible mer des Sargasses, – l’endroit le plus inaccessible et le plus solitaire de tous les endroits les plus inaccessibles et les plus solitaires du globe terrestre.
Alors, attendons.
W. H. H.
–––––
Voici le cinquième message que j’envoie par-delà l’immense et répugnante étendue du monde des algues. Je prie qu’il parvienne à la mer libre avant que ma petite montgolfière cesse de flotter dans l’air et s’il y arrive jamais, – ce dont je ne suis pas sûr aujourd’hui, – cela servira-t-il à quelque chose pour moi ! Mais je dois écrire pour ne pas devenir fou. J’ai donc choisi d’écrire tout en pensant qu’aucune créature vivante ne lira jamais mon écriture, sauf peut-être les pieuvres géantes qui vivent dans l’herbier qui nous entoure.
J’ai envoyé mon premier message la veille de Noël 1875. Depuis lors, chaque veille du jour de la naissance du Christ, un message monte au ciel et, porté par le vent, devrait atteindre la mer libre. Quand vient le temps de ces fêtes qui réunissent ceux que j’aime et dont je suis séparé, je me sens accablé et toute cette paix monotone dans laquelle j’ai vécu pendant trois ans de solitude, m’abandonne. Je m’écarte de ma femme et de notre enfant et, avec une plume, de l’encre et du papier, j’essaie de rassembler mes idées pour que mon cœur désemparé ne se brise pas.
Il y a maintenant six longues années depuis que le monde des algues nous a séparés du monde des vivants – six ans loin de nos frères et sœurs qui vivent dans le monde des hommes. Six ans que nous vivons dans un tombeau ! Et combien d’autres années en perspective ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Je n’ose y penser ! Je dois maîtriser mes nerfs !
Et puis, il y a notre petite fille. Elle a maintenant quatre ans et demi, et elle grandit comme un charme au milieu de toute cette sauvagerie. Quatre ans et demi, et la petite demoiselle n’a jamais vu d’autres visages humains que les nôtres… Vous rendez-vous compte ! Et – dût-elle vivre quarante ans ! – c’est une folie que de vouloir imaginer un tel espace de temps. Pour nous, l’avenir finit dans dix ans, onze au plus. Nos réserves alimentaires ne dureront pas plus longtemps… Ma femme n’en sait rien. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’ajouter à son tourment en parlant de cette triste perspective. Elle sait seulement qu’il ne faut pas gaspiller la moindre parcelle de nourriture. Pour le reste, elle imagine que toute la cargaison est comestible. J’ai peut-être entretenu cette idée. Si quelque accident m’arrivait, nos réserves dureraient quelques années de plus. Mais si ma femme avait la moindre idée de la situation, elle ne pourrait plus avaler une bouchée sans en être malade. J’ai souvent et longtemps réfléchi à cela, bien que j’aie peur de les laisser seules. Car, à chaque moment, leur vie dépend plutôt de mon énergie que de la nourriture qui finira bien par manquer un jour ou l’autre. Non, je ne dois pas provoquer un nouveau malheur immédiat et certain pour différer un autre moins évident et plus lointain.
Sauf récemment, il ne nous est rien arrivé de particulier depuis quatre ans ; à part, bien entendu, les folles tentatives que j’ai faites pour essayer de trouver un chemin vers la liberté par-delà l’herbier qui nous environne. Et je prie Dieu qu’il nous protège, moi et les miens, contre ses maléfices. (1) Cependant, à la fin de cette année, une aventure assez sinistre nous est arrivée d’une manière tout à fait inattendue ; une aventure qui nous a montré qu’un nouveau et dangereux péril nous menaçait. Je me suis rendu compte que les algues recélaient d’autres monstruosités que les pieuvres géantes.
Évidemment, j’en suis arrivé à croire que ce monde de désolation peut contenir toutes sortes d’horreurs. Pensez-y : une solitude moite et brune, qui s’étend interminablement dans toutes les directions jusqu’au lointain horizon, un lieu où les monstres des abîmes et de la végétation marine règnent sans conteste, qui ne sont menacés par aucun ennemi, mais d’où ils peuvent surgir et donner la mort ! Aucun homme ne peut apporter ici quelque engin de destruction pour en finir avec ces monstres et les humains que la fatalité a conduits là ne peuvent que les regarder du pont de leurs épaves abandonnées. Et leurs regards sont terrifiés autant qu’impuissants.
Je ne peux pas décrire cela, et comment aurais-je jamais pu l’imaginer ! Quand le vent tombe, un grand silence nous entoure d’un horizon à l’autre. Mais, dans ce silence, il semble qu’on entende aux alentours la pulsation des choses cachées qui nous guettent et nous attendent ; qui attendent de jeter sur nous l’immense et brutal grappin de la mort… Ce n’est pas possible ! C’est impossible de me faire comprendre. Je ne peux pas non plus transmettre le bruit effroyable du vent qui balaie ces plaines immenses et frissonnantes, le murmure acide de l’herbier marin répercutant le sifflement des vents. Quand on entend cela sous notre tente de toile, c’est comme si l’on entendait les innombrables victimes des Sargasses psalmodier leurs propres requiems. Et, de nouveau, mon imagination malade de solitude et de contention est confrontée avec la rumeur de ces armées de monstres qui nous entourent, – et nous guettent.
J’en arrive maintenant à de nouvelles épouvantes : ce fut fin octobre que nous en eûmes connaissance. En pleine nuit, on entendit cogner contre la coque du bateau sous la ligne de flottaison ; le bruit devint de plus en plus distinct, avec quelque chose de fantomatique, dans la tranquillité de la nuit. C’est un lundi soir que j’entendis ce bruit pour la première fois. J’étais en bas, à l’infirmerie, en train de faire l’inventaire de nos ressources quand j’entendis soudain : tap, tap, tap contre le flanc tribord du bateau et sous la ligne de flottaison. Je me relevai pour écouter un moment sans pouvoir me rendre compte de ce qui pouvait produire ce frappement régulier qui provenait de l’amoncellement monotone d’algues et de vase au-dehors. J’étais donc en train d’écouter quand le bruit cessa. J’attendis, étreint par une peur horrible qui brisait tout mon courage.
Brusquement, cela recommença, mais cette fois, de l’autre bord, et, tout en prêtant l’oreille attentivement, je me sentis couvert de sueur, car j’avais l’impression que quelque créature insolite frappait ainsi pour demander d’entrer. Tap, tap, tap… Cela continuait et j’écoutais, paralysé par une peur intense qui m’empêchait de bouger. Les maléfices du Monde des Algues, l’effroi de ses horreurs cachées, le poids implacable de toute cette solitude, m’avaient tellement pénétré dans la mœlle qu’il m’arrivait par moments de croire à la réalité de choses surnaturelles dont j’aurais plaisanté ailleurs, dans le monde des vivants, parmi mes amis. La cruelle solitude du monde étrange dans lequel je vivais peut ainsi briser le cœur d’un homme.
J’étais donc en train d’écouter, plein d’idées confuses et affolantes, et le tapement n’en finissait pas. C’était parfois avec une insistance régulière ou, parfois, avec un mouvement spasmodique. Tap, tap, tap-a-tap, comme un signal émis par une créature douée d’intelligence qui aurait voulu se faire reconnaître de moi.
Je parvins toutefois à dominer ma frayeur et à retrouver un peu d’énergie, et j’allai jusqu’à l’endroit d’où les coups semblaient provenir. Une fois là, je me penchai en collant l’oreille au flanc du bateau. Le bruit s’entendait beaucoup plus clairement et je pus distinguer ainsi que le frappement provenait d’un objet dur, comme d’un petit marteau, contre la coque de fer.
Donc, j’écoutais attentivement, quand un bruit tonitruant vint frapper mon oreille, si étonnamment fort que je sautai vivement sur le côté, pris de peur. Immédiatement après vint un énorme coup, puis un troisième, comme si quelqu’un frappait la coque avec une masse. Il y eut un silence, puis j’entendis la voix de ma femme à la porte de l’infirmerie. Elle demandait d’où venait tout ce bruit.
« Qu’en sais-je, ma chère ! » murmurai-je, car j’avais l’impression que la créature extérieure pouvait nous entendre, et si je le dis, c’est pour qu’on comprenne combien le bruit extérieur avait détraqué mes nerfs.
Sur ma demande, à voix basse, ma femme descendit l’échelle dans la pénombre.
« Que se passe-t-il, Arthur ? » demanda-t-elle, en venant vers moi et en me prenant le bras.
Comme pour répondre à sa question, on entendit, sur la coque du bateau, un quatrième coup très fort qui résonna comme un coup de tonnerre dans l’infirmerie.
Ma femme poussa un cri d’effroi et s’éloigna vite de moi, mais elle revint l’instant suivant et s’accrocha à mon bras,
« Qu’est-ce que c’est, Arthur ? qu’est-ce que c’est ? » insista-t-elle.
Bien que sa voix ne fût qu’un murmure, on l’entendait très bien dans le silence qui succéda.
« Je ne sais pas, Mary, répondis-je à mi-voix. C’est…
– Cela recommence, » interrompit-elle, tandis que les petits coups légers reprenaient successivement.
Nous restâmes silencieux pendant une minute pour écouter les frappements saccadés.
« Est-ce qu’il y a du danger, Arthur ?… dis-moi ? Je te promets d’être courageuse.
– Je ne peux absolument rien dire, Mary, répondis-je. Je ne sais rien, mais je vais aller sur le pont pour mieux me rendre compte… Peut-être… »
Je réfléchis un moment, mais un cinquième coup violent m’empêcha de dire quoi que ce soit. Je ne pouvais rien faire que de rester là, effrayé et désorienté, attentif aux moindres sons. Après un temps d’arrêt, on entendit un sixième coup. Ma femme me prit par le bras et m’entraîna vers l’échelle.
« Sortons de cet endroit sombre, Arthur, dit-elle. Je vais devenir folle si je reste plus longtemps ici. Peut-être que cette Chose au-dehors nous entend et qu’elle cessera de frapper si nous remontons. »
Ma femme tremblait des pieds à la tête et je n’étais pas moins ébranlé, quoiqu’un peu plus calme ; c’est pourquoi je fus heureux de la suivre et de sortir. Au haut de l’échelle, nous nous arrêtâmes, un instant, pour prêter l’oreille en nous penchant sur l’écoutille ouverte. Cinq minutes à peu près s’écoulèrent en silence, puis les frappements recommencèrent ; leur bruit était parfaitement distinct là où nous étions blottis. Ils cessèrent bientôt et l’on n’entendit plus rien pendant une dizaine de minutes. Quant aux heurts violents, ils avaient complètement cessé. J’éloignai bien vite ma femme de l’écoutille et je l’emmenai s’asseoir au salon. Je retournai ensuite fermer l’écoutille. Je retournai à notre cabine – qui avait été celle du Commandant, son père – et en rapportai un de nos revolvers. Je le chargeai soigneusement et le mis dans ma poche. J’allai à l’office, là où je rangeais à portée de main tout ce qui pouvait être utile, pris une lanterne sourde, celle qui avait servi, pendant les nuits noires, à dégager les amarres du pont. Je l’allumai et voilai la lumière avec le coulissant. J’ôtai mes bottes puis, non sans arrière-pensée, je m’armai d’une de ces haches américaines à long manche fixée au râtelier du mât de misaine. Ce sont des armes bien affilées et très efficaces.
Je dus calmer ma femme et l’assurer que je ne prendrais aucun risque inutile s’il y avait des risques à courir. Évidemment, comme on peut l’imaginer, je ne pouvais savoir quel nouveau danger nous menaçait. Alors, lanterne en main, je montai l’échelle du salon en silence et j’allais sortir sur le pont quand quelque chose me prit par le bras. Je pivotai sur moi-même et m’aperçus que ma femme m’avait suivi. Comme sa main tremblait sur mon bras, je me rendis compte qu’elle était dans un état d’agitation extrême.
« Oh ! cher, cher, n’y va pas ! n’y va pas ! me pressait-elle. Attends que le jour se lève. Reste en bas pour la nuit. On ne sait pas ce qui peut arriver dans cet horrible endroit. »
Je mis la hache et la lanterne sur le pont à la sortie de l’échelle, la pris dans mes bras, et lui caressai les cheveux pour l’apaiser, tout en examinant l’ombre aux alentours. Elle se remit un peu tandis que je la raisonnais. Elle serait mieux en bas, lui laissai-je entendre, et bientôt elle me quitta après m’avoir fait promettre d’être prudent.
Quand elle fut partie, je ramassai la lanterne et la hache et m’avançai avec précaution vers la lisse du bateau ; je m’arrêtai pour écouter très attentivement. J’étais juste au point qui dominait l’endroit à bâbord d’où j’avais entendu la plupart des frappements et tous les coups violents. Mais, pendant que j’étais à l’écoute, comme je l’ai dit, aucun son ne me parvint.
Je me relevai donc et me rendis sur la dunette. Là, en me penchant par-dessus la rambarde, je guettai le moindre bruit qui pouvait venir du pont dans l’obscurité. Mais je ne vis ni n’entendis rien. Il n’y avait d’ailleurs aucune raison de voir ou d’entendre quelque chose d’inaccoutumé à bord. Tous les bruits venaient du dehors et, bien plus, d’en dessous la ligne de flottaison. Mais, dans l’état d’esprit où je me trouvais, la raison avait moins de part que l’imagination. Ces coups et ces bruits si étranges, dans notre monde solitaire, me laissaient vaguement imaginer toutes sortes d’épouvantes qui pouvaient surgir de n’importe quel coin d’ombre sur le pont enténébré.
Toujours attentif, mais hésitant à descendre sur le pont et déçu du résultat de mes investigations, j’entendis, assez faiblement mais distinctement, dans le calme de la nuit, le frappement qui recommençait.
Je quittai la rambarde, tout en tendant l’oreille ; le bruit cessa. Je m’appuyai de nouveau tout en jetant un coup d’œil sur le pont. Immédiatement, les coups recommencèrent. Je compris qu’ils étaient transmis par les montants de fer qui fixent la rambarde au bateau.
Là-dessus, je gagnai l’arrière de la poupe, le plus silencieusement possible et avec les plus grandes précautions. Je m’arrêtai à l’endroit d’où m’étaient venus d’abord les plus gros coups et je posai l’oreille sur la filière. Les sons me parvenaient très distinctement.
J’écoutai un moment, puis me relevai, et je soulevai le morceau de toile qui servait de portière à la tente protectrice. Il y en avait une de chaque bord. Je le fis le plus silencieusement possible et je me penchai par l’ouverture pour examiner l’amas des algues dans la pénombre. J’entendis, au même moment, et très clairement, au-dessous de moi, contre la coque, un fort coup assourdi parce qu’il venait d’en dessous la surface de l’eau. Il me sembla qu’il y avait une certaine agitation dans le sombre herbier marin. J’ouvris le capot de ma lanterne et jetai un éclatant rayon de lumière dans l’obscurité. Dans un bref instant, j’eus l’impression de voir une multitude de choses grouiller. À part le fait que ces choses paraissaient de forme ovale et d’une couleur blanchâtre dans la masse herbeuse, je ne pouvais guère me faire une idée de ce que c’était. La lumière fit tout disparaître et il n’y eut plus que la masse brune et obscure des algues, hypocritement tranquille. Mais une impression se fixa dans mon imagination surexcitée – sans doute était-elle due à l’état morbide où me plongeait une trop grande solitude. Néanmoins, j’eus l’impression d’avoir aperçu, pendant un moment, une multitude de visages morts, parfaitement livides, qui se retournaient vers moi dans leur linceul d’herbes marines.
Je restai là, un moment, à contempler le cercle illuminé des algues, mais avec mon esprit torturé par le doute et qui se perdait en conjectures ; mes yeux ne pouvaient me servir à grand-chose devant ce magma. Dans ma pensée chaotique s’éleva un mystérieux souvenir : les goules, les morts en sursis. Rien ne pouvait m’empêcher, sur le moment, d’associer ce mot goule à l’effroi qui m’assaillait de toutes parts. Aucun homme ne peut dire toutes les épouvantes que ce monde recèle jusqu’à ce qu’il ait perdu ses frères humains et qu’il se trouve abandonné au milieu de l’insupportable désolation qu’est l’herbier boueux de la mer des Sargasses.
J’étais donc là, penché sur la rambarde, follement exposé à ces dangers dont je savais pourtant bien qu’ils n’étaient que trop véritables, et mon regard surprit inconsciemment l’étrange et subtile ondulation qui annonçait toujours l’approche d’une pieuvre géante. Je sautai en arrière aussi vite que possible et fermai la portière de toile que j’attachai solidement. Je restai là, dans l’obscurité la plus totale, lançant de tous côtés des regards effrayés. Le rayon de ma lampe traçait, ici et là sur le pont, des taches mouvantes de lumière. Et j’écoutais, j’écoutais toujours… avec l’impression qu’une quelconque Terreur méditait son coup dans la nuit et pouvait nous surprendre à tout moment sous une forme impossible à imaginer.
Alors, au milieu du silence, il y eut un murmure et je me retournai rapidement vers l’entrée du salon. C’était ma femme qui, les bras tendus, m’implorait de descendre me mettre à l’abri. Dans un rayon de lumière que je projetai dans sa direction, je vis qu’elle tenait un revolver dans sa main droite. Je lui en demandai la raison. Elle répondit qu’elle avait veillé sur moi pendant tout le temps que j’étais resté sur le pont, sauf pendant le court instant où elle était allée chercher l’arme et l’avait chargée.
Comme on peut le penser, je la pris dans mes bras et l’embrassai très tendrement pour l’amour dont témoignait son geste et pour sa promptitude d’esprit. Nous eûmes ensuite une rapide conversation à voix basse. Elle me demandait avec insistance de descendre et de fermer la porte du salon. Je m’entêtai, lui disant que j’étais trop inquiet pour pouvoir dormir et que je préférais faire le guet sur la poupe encore un moment.
Tout en parlant, je lui faisais signe de se tranquilliser. Au moment où nous cessions de parler, elle l’entendit en même temps que moi : Tap ! tap ! tap ! Cela provenait régulièrement du pont obscur. Je fus pris d’une peur atroce et ma femme s’accrocha à moi avec beaucoup de fermeté, bien qu’en tremblant un peu. Je retirai mon bras de son étreinte et fis quelques pas vers l’échelle de poupe, mais elle me suivit aussitôt, me suppliant de ne pas bouger d’où j’étais si je ne voulais pas descendre.
Je la priai assez durement de me lâcher et de retourner au salon, bien que je fusse infiniment touché de sa sollicitude. Mais elle ne voulut pas m’obéir, déclarant avec résolution, mais toujours à voix basse, que si je devais courir un danger, elle resterait avec moi. Je commençais à hésiter et, réflexion faite, je décidai de ne pas descendre sur le pont.
J’allai silencieusement jusqu’au bord de la dunette et ma femme me suivit. De là, j’éclairai le pont avec ma lanterne, mais je ne pus rien voir ni entendre. Les coups avaient cessé. Puis le tintamarre recommença, semblant venir de bâbord, assez près du tronçon du grand mât. Je tournai ma lanterne de ce côté et, pendant un bref moment, il me sembla voir quelque chose de blafard dans mon rayon de lumière. Je sortis mon revolver et tirai. Ma femme en fit autant sans que je lui aie rien dit. Le bruit de la double explosion fit un tapage assourdissant en se répercutant sur le pont du bateau. Quand les échos en furent éteints, nous eûmes tous les deux l’impression que le tapement recommençait, mais sur l’avant.
Après cela, nous attendîmes un moment, toujours attentifs, mais tout était tranquille et je consentis à descendre et à fermer solidement la porte du salon comme ma femme le désirait. Au fond, elle avait raison et c’était ridicule, de ma part, de rester dehors.
La nuit fut assez calme et, le lendemain matin, j’examinai tout très minutieusement. Je scrutai les ponts dans tous les coins et recoins, j’examinai attentivement les algues autour de la coque et la coque elle-même. Cela fait, j’ôtai les écoutilles et descendis dans les cales. Mais je ne découvris rien d’insolite.
La nuit suivante, au moment où nous finissions de dîner, nous entendîmes trois coups violents frappés contre la coque à tribord. Je fus debout à l’instant même ; j’agrippai et allumai la lanterne sourde que j’avais laissée à portée de main, et remontai en courant, sans faire de bruit, sur le pont. J’avais toujours mon revolver dans ma poche et, comme j’étais déjà en pantoufles, je ne perdis pas de temps à retirer mes bottes. J’avais laissé ma hache à la porte du salon et je n’avais qu’à la prendre au bord de l’échelle.
Une fois sur le pont, j’allai sans bruit à tribord et soulevai la portière de la tente. Je me penchai et décapotai ma lanterne en dirigeant la lumière sur les algues, dans la direction de l’endroit d’où les coups semblaient provenir. Mais il n’y avait rien nulle part, et les algues ne donnaient aucune apparence de remue-ménage. Aussi, peu après, je rentrai la tête et fermai la portière. Ç’aurait été une folie stupide que de rester exposé longtemps à l’attaque d’une pieuvre géante, qui pouvait rôder par là en se dissimulant sous les algues.
Jusqu’à minuit, je restai sur la poupe, parlant à voix basse à ma femme qui m’avait suivi jusqu’à l’entrée du salon. De temps en temps, nous entendions les frappements tantôt d’un bord, tantôt de l’autre. Dans l’intervalle des coups brutalement assenés et comme y faisant suite, on entendait les petits tap, tap, tap-a-tap que j’avais remarqués au début.
Vers minuit, sentant que je ne pouvais rien faire et pensant que rien d’apparemment dangereux ne proviendrait de ces choses invisibles qui paraissaient nous encercler, ma femme et moi descendîmes nous reposer, non sans avoir soigneusement barricadé derrière nous la porte du salon.
Il était à peu près deux heures du matin quand je fus réveillé, d’un sommeil d’ailleurs peu confortable, par le cri d’agonie de notre gros verrat, tout à fait sur l’avant. Je me levai sur les coudes pour mieux entendre et, du même coup, je me réveillai complètement. Je glissai de ma couchette sur le plancher. Ma femme, dont j’entendais la respiration régulière, dormait tranquillement. Je pouvais prendre mes affaires et m’habiller sans la déranger.
J’allumai ma lanterne sourde et dissimulai la lumière. De l’autre main, je pris la hache et me hâtai vers la porte du salon qui donne directement sur le pont, sous le couvert de la dunette. J’avais fermé cette porte avant de rentrer et je pris d’infinies précautions pour l’ouvrir sans faire de bruit. Je scrutai attentivement toute l’étendue du pont, mais n’aperçus rien de particulier. Puis, je découvris la lumière et projetai son faisceau dans tous les coins sans remarquer quoi que ce fût d’inhabituel.
Sur l’avant, le silence le plus absolu avait succédé au cri du porc. On n’entendait aucun bruit nulle part sauf, occasionnellement, le bizarre tap, tap-tap-tap qui semblait provenir du flanc du navire. Rassemblant tout mon courage, j’avançai sur le pont, aussi lentement que possible, jetant un rayon de lumière ici et là.
Soudain, j’entendis, provenant des bossoirs, une multitude de petits coups, de raclements, de glissements. Le bruit était si proche et si fort que je fis un demi-tour sur moi-même. Et pendant peut-être une minute, je restai là hésitant, projetant ma lumière de tous les côtés sans me préoccuper de savoir si quelque ignoble créature n’allait pas se jeter sur moi dans l’ombre.
Je me rappelai brusquement que j’avais laissé la porte du salon ouverte derrière moi, et si quelque porteur de mort rôdait sur le pont, il aurait pu sauter à l’improviste sur ma femme et mon enfant endormies. J’y retournai précipitamment et j’allai jusqu’à la porte de ma cabine. Je m’assurai que tout était en ordre autour des dormeuses et je retournai sur le pont en fermant soigneusement la porte derrière moi.
Je me sentis alors vraiment seul dans l’obscurité et, d’une certaine manière, coupé de toute retraite. J’avais besoin de rassembler tout mon courage pour aller à l’avant, afin de savoir pourquoi le verrat avait crié et quelle était la cause de tout ce tapage. J’avançai tout de même et j’ai de quoi être fier de cet acte de courage. La détresse morale et l’effroi du monde des algues oppressent d’une façon atroce le caractère le mieux trempé.
En approchant du gaillard d’avant, je prenais de plus en plus de précautions, éclairant tous les recoins et tenant en main, bien solidement, ma hache. Mon cœur fondait en eau tant j’avais peur. J’arrivai enfin à la porcherie et découvris un spectacle affreux. Le porc, un beau verrat pesant près d’une quinzaine de kilos, avait été traîné sur le pont et était étendu devant son étable, éventré et sans vie. Les barreaux de fer de la porcherie – et des barreaux solides – avaient été brisés comme des fétus de paille. Et partout, le sang répandu en abondance.
Je ne voulais pas en voir plus. Je compris bien vite que c’était l’œuvre d’une créature monstrueuse qui pouvait, à l’instant même, m’assaillir. Pris d’une panique démentielle, je courus vers l’abri du salon et je ne m’arrêtai qu’après avoir fermé la porte ; je me sentis protégé contre cette Chose qui avait dépecé le verrat. J’étais là, tout tremblant de peur, me demandant quelle pouvait être une créature à ce point sauvage et brutale pour briser de grosses barres de fer et ôter la vie à un gros porc comme s’il n’avait été qu’un pauvre petit chat.
Des questions plus vitales m’assaillaient : « Comment était-il (ou : elle ?) monté à bord ? Où s’était-il (ou : elle) caché ? » Et toujours : « Qu’est-ce que c’était ? » Je restai dans cet état un bon moment, jusqu’à ce que j’eusse recouvré un peu l’esprit.
Mais je ne pus fermer l’œil le reste de la nuit. Quand ma femme se réveilla le lendemain matin, je lui racontai ce qui s’était passé. Elle devint toute pâle et me reprocha amèrement d’être sorti sur le pont et d’avoir couru un danger inutile. J’aurais au moins dû ne pas la laisser seule, ne pas la laisser dormir dans l’ignorance. Cela dit, elle eut une crise de larmes et je fis de mon mieux pour la consoler. Quand elle eut retrouvé un peu de calme, elle se déclara prête à m’accompagner dehors pour voir, à la lumière du jour, ce qui était arrivé pendant la nuit. Je ne pus la détourner de cette décision, lui laissant entendre que je ne lui aurais rien dit si ce n’était pour la prévenir de ne pas aller et venir entre le salon et la cuisine avant que j’aie passé l’inspection des ponts. Mais je ne pus la détourner de son idée. Elle voulait venir avec moi et je fus bien forcé, à contrecœur, de lui céder.
Nous sortîmes du salon par la porte donnant sur la dunette. Ma femme tenait à deux mains, assez maladroitement, son revolver chargé. J’avais le mien dans la main gauche et la hache dans la droite, prêt à toute éventualité.
Une fois sur le pont, nous fermâmes la porte derrière nous en laissant la clef dans la serrure, car nous pensions à notre enfant endormie. En allant lentement vers l’avant, nous ne cessions de regarder de tous côtés avec méfiance. À l’approche de la porcherie, ma femme vit la bête étendue morte. Elle poussa un cri d’horreur et frissonna en apercevant le verrat mutilé. Et il y avait de quoi.
Pour ma part, je ne dis rien, mais, plein d’appréhension, j’examinai attentivement les alentours. Une nouvelle frayeur m’envahit, car il m’apparut évident que le porc avait été terriblement molesté depuis que j’avais vu son cadavre pour la première fois. La tête était arrachée du corps, et il avait fallu pour cela déployer une force gigantesque. Il portait aussi de nouvelles et féroces blessures. Une entaille allait presque jusqu’à séparer en deux parties le corps de la pauvre bête. Tout cela prouvait, une fois de plus, le caractère formidable du monstre, ou de la monstruosité, qui avait attaqué l’animal.
Je ne voulais pas perdre mon temps avec le porc et n’essayai pas d’y toucher, mais je fis signe à ma femme de venir avec moi sur le gaillard d’avant. Là, je soulevai le prélart protégeant la petite claire-voie qui éclairait l’intérieur du poste d’équipage. Je soulevai ensuite le lourd couvercle pour éclairer cet endroit obscur. Je me penchai sur l’ouverture et regardai attentivement, mais ne découvris rien de suspect. Je retournai donc sur le pont et pénétrai dans le poste par la porte de tribord. J’examinai tout très attentivement sans rien découvrir. Il n’y avait que les tristes vêtements et les coffres qui avaient appartenu aux membres de l’équipage disparu.
Mes recherches terminées, je me hâtai de sortir de ce lugubre endroit et de revenir au jour. Après avoir bien fermé la porte et vérifié que celle de bâbord était également close, je remontai sur le gaillard, refermai la claire-voie et la recouvris de son prélart, amarrant proprement le tout.
C’est avec une attention incroyablement minutieuse que je continuai l’inspection du bateau, clôturant soigneusement toutes les ouvertures derrière moi pour être certain qu’aucune créature ne jouait avec nous une terrible partie de cache-cache.
Puisque je n’avais rien trouvé, à part l’évidence du cadavre mutilé de notre verrat, j’aurais pu penser que tous les événements lugubres de la nuit précédente n’étaient qu’un cauchemar dû à une imagination délirante.
C’est embarrassant, même si l’on me fait confiance, de faire comprendre qu’ayant examiné chaque couture de l’écran goudronné que j’avais établi tout autour du bateau pour nous protéger des tentacules rapides des pieuvres géantes, je n’ai pu découvrir aucune déchirure ni rien qui puisse permettre de comprendre comment un monstre quelconque avait pu, depuis l’herbier, monter à bord. Il faut aussi se rappeler que la coque du bateau s’élevait de plus d’un mètre au-dessus des algues et que ses flancs métalliques glissant ne permettaient guère l’escalade.
Il y avait quand même le cochon mort, gisant, monstrueusement écorché, devant sa porcherie vide. Voilà une preuve indéniable que l’on risquait une mort aussi horrible que mystérieuse, si l’on s’aventurait, la nuit, sur le pont !
Pendant toute la journée, je réfléchis à ce nouveau danger qui nous menaçait et, surtout, à cette force monstrueuse et surnaturelle qui avait mis en pièces les gros barreaux de fer de la porcherie, et arraché d’une manière atroce la tête du verrat. Je conclus qu’il fallait, le soir même, abandonner les pièces où nous couchions et nous réfugier dans le faux tillac – étroit réduit muni de quatre couchettes – situé un peu en avant du grand mât et entièrement en fer, même la porte ouvrant sur l’arrière.
Avec notre matériel de literie, j’apportai dans notre nouveau logement une lampe, du pétrole, la lanterne sourde, deux haches, deux fusils et tous les revolvers avec une bonne réserve de munitions. Puis, je priai ma femme de réunir suffisamment de provisions pour au moins une semaine et, pendant qu’elle s’en occupait activement, je nettoyai le réservoir du faux tillac et le remplis d’eau.
À six heures et demie, je fis venir ma femme et l’enfant dans le cagibi de fer, je fermai les portes du salon et de la cabine, puis la lourde porte de teck ouvrant sous la dunette.
J’allai ensuite rejoindre femme et enfant et je verrouillai la porte du faux tillac pour la nuit. Je fis le tour de notre blockhaus pour vérifier si les huit hublots étaient en bon état, et nous nous assîmes comme nous pûmes pour attendre la nuit.
À huit heures, ce fut le crépuscule, et une demi-heure plus tard, la nuit avait envahi tous les ponts. Je fermai les mantelets des hublots, serrai les écrous avec soin et nous allumâmes la lampe.
Il y eut un long moment d’attente pendant lequel je m’employai à rassurer ma femme assise à côté du bébé endormi. Elle était très pâle et me regardait avec des yeux apeurés. C’est que, durant les dernières heures, nous n’avions cessé de trembler de peur et notre courage était au bord de la déroute.
Un peu plus tard, un bruit soudain rompit le silence – un choc sourd contre le flanc du navire. Ce fut ensuite une succession de coups violents qui semblaient frappés, en même temps, sur chaque bord de la coque. Après quoi, le silence dura à peu près un quart d’heure.
Puis brusquement, j’entendis, à l’avant, une série de tap, tap, tap suivie d’un bruit de raclement et de glissement, puis un fracas épouvantable. On entendit ensuite des bruits divers ponctués de ce tap, tap, tap cent fois répété, comme si une armée d’hommes à jambe de bois s’affairait sur la plage avant.
Aussitôt après, j’entendis le bruit de quelque chose qui venait sur le pont, tap, tap, tap. Cela s’approcha de notre réduit, s’arrêta une minute, tout à côté, puis continua dans la direction du salon. Je tremblais un peu et, à moitié conscient, je remerciai Dieu de m’avoir donné assez de sagesse pour mettre en sécurité ma femme et mon enfant dans le faux tillac.
Une minute après, j’entendis un énorme coup frappé quelque part à l’arrière, puis un second et un troisième. Au bruit, c’étaient des coups frappés contre du fer, – le fer de la cloison qui borde la dunette. Vint un quatrième coup, et ce fut du bois qu’on brisait. J’en frémis de tous mes membres. Ma petite fille et ma femme auraient pu être là, en train de dormir, en ce moment même, si la Providence ne m’avait pas inspiré de les installer dans ce refuge.
Une fois la porte brisée à l’arrière, on entendit à l’avant un grand tumulte et, tout de suite, il sembla qu’une multitude de jambes de bois allait de l’avant à l’arrière. Tap, tap, tap ; tap-a-tap. Le bruit montait, environnait le réduit où nous étions blottis, et nous retenions notre respiration de peur d’attirer l’attention de cette Chose qui était à l’extérieur. Les bruits nous dépassèrent et ne parvinrent plus que de l’arrière. Je poussai un léger soupir de soulagement, puis je me précipitai pour éteindre la lampe, craignant que la moindre lueur sous la porte attirât l’attention. Après cela, nous restâmes silencieux, attentifs aux bruits qui venaient de l’arrière, les coups brutaux mais assourdis, les craquements de bois occasionnels et, bientôt après, le tap, tap, tap revenant de notre côté.
Les bruits finirent par cesser du côté tribord et, pendant une longue minute, tout fut tranquille. Puis brusquement, boum ! un coup d’une extrême violence contre la clôture de notre réduit. Ma femme poussa un cri déchirant. Puis un second coup. L’enfant se réveilla et se mit à sangloter ; ma femme ne put retenir ses larmes en essayant de calmer la pauvre petite.
Puis un troisième coup. Un véritable coup de tonnerre à l’intérieur de notre abri. Alors, j’entendis le tap, tap, tap nous contourner. Il y eut une pause, suivie d’un coup violent frappé contre la porte. Je saisis mon fusil placé près de ma chaise et je me levai, car tout laissait prévoir, étant donné l’extraordinaire violence de ce coup, que cette Chose allait nous sauter dessus d’un moment à l’autre. Elle frappa de nouveau la porte, puis s’en alla, tap, tap, tap, du côté bâbord. Elle refrappa contre la clôture. J’étais, cependant, un peu plus à mon aise, car c’était surtout son attaque directe contre la porte qui m’avait affolé.
Après le coup frappé contre le côté bâbord du faux tillac, il y eut une longue période de silence, comme si la Chose, à l’extérieur, était en train d’écouter. Grâce à Dieu, ma femme avait réussi à calmer notre enfant et aucun bruit ne pouvait déceler notre présence.
Le tap, tap, tap recommença. La Chose sans voix semblait se tourner vers l’avant. À l’arrière, on n’entendait plus rien. Et ce furent des milliers de tap, tap, tap qui se promenaient sur le pont. Tout cela dépassa le blockhaus sans s’arrêter et continua d’avancer.
Le silence dura environ deux heures. D’où je conclus que nous n’étions plus en danger. Une heure après, j’essayai de parler à ma femme. Mais comme elle ne répondit pas à mes questions, je me rendis compte qu’elle s’était assoupie. Je demeurai là, toujours attentif, sans faire aucun bruit qui pût attirer l’attention.
Bientôt, apercevant un peu de lumière sous la porte, je compris que le jour commençait à poindre. Je me levai, plutôt courbaturé, et je me mis en mesure de dévisser les écrous des mantelets. Je commençai par le hublot donnant sur l’avant et j’examinai le pont dans l’aurore blafarde. Je n’y remarquai rien d’insolite, pour autant que je pouvais voir.
Après quoi, j’ouvris les hublots l’un après l’autre. C’est seulement une fois que j’eus découvert celui de bâbord qui me permettait de voir le pont arrière de ce côté-là, que je compris. Je vis, d’abord d’une manière indécise, mais de plus en plus clairement au fur et à mesure que le jour se levait, que la porte du salon avait été mise en pièces. Plusieurs morceaux étaient éparpillés sur le pont. D’autres pendaient aux gonds. Et je ne pouvais pas tout voir des dégâts.
Tournant mes regards vers ma femme, je constatai qu’elle était à moitié couchée sur la couchette du bébé et à moitié au-dehors. Elle avait la tête à côté de celle de l’enfant sur le même oreiller. Un profond sentiment de reconnaissance m’envahit à cette vue. Nous étions miraculeusement sortis du danger mystérieux qui avait rôdé autour de nous durant la nuit. Plein de tendresse, je courus les embrasser toutes les deux en prenant garde de ne pas les réveiller. Après quoi, je m’étendis sur l’une des couchettes et je dormis jusqu’à ce que le soleil fût complètement levé.
Quand je me réveillai, ma femme avait soigné et habillé l’enfant et préparait notre petit déjeuner. Je n’eus rien d’autre à faire que de sortir de ma couchette et de me mettre à table avec, d’ailleurs, grand appétit. Je suppose que les angoisses de la nuit y étaient pour quelque chose. En mangeant, nous discutâmes des périls par lesquels nous venions de passer, sans parvenir à trouver la solution de leur origine fantastique.
Quand nous eûmes fini de déjeuner, nous observâmes le pont à travers chacun des hublots et nous nous préparâmes à sortir. Nous prîmes les plus grandes précautions, gardant le silence et nous armant tous les deux comme le jour précédent. Après avoir fermé avec soin la porte du faux tillac pour éviter le moindre danger à notre petite fille, nous nous aventurâmes sur le pont.
Après un bref regard aux alentours, nous allâmes à l’arrière vers la porte défoncée sous la dunette. Nous nous arrêtâmes devant la porte, non pas tant pour constater les dégâts que par une crainte instinctive de pénétrer dans le salon qui venait d’être visité, quelques heures auparavant, par le plus incroyable des monstres parmi les monstres. Nous décidâmes finalement de monter sur la dunette et de jeter un regard à travers la claire-voie. Après un examen très attentif, nous ne perçûmes rien d’inquiétant. Mais, bien entendu, tous les meubles semblaient plus ou moins en piteux état.
Cela vu, je déverrouillai le capot d’échelle, poussai le lourd couvercle qui le recouvrait et nous descendîmes dans le salon. Là, le spectacle était pétrifiant. Dans cette grande pièce, tout était sens dessus dessous d’un bout à l’autre. Les six cabines qui l’entouraient avaient leurs cloisons en miettes. Il y avait des éclats de bois répandus partout. Ici une porte était intacte, tandis que la cloison était entièrement déchiquetée. Là, une porte était sortie de ses gonds et le bâti de bois qui l’entourait était intact.
Ma femme voulut aller dans notre cabine, mais je l’en empêchai et y entrai le premier. C’était la désolation. Le sommier de la couchette de ma femme avait été entièrement mis en pièces et les montants de la mienne étaient arrachés. Tout était répandu par terre en mille morceaux.
Mais cela ne nous toucha pas outre mesure, car le berceau de notre pauvre petite avait été enlevé de ses montants et n’était plus, sur le plancher, qu’un amas de ferraille peint en blanc. Je regardai ma femme, et elle me regarda, livide. Elle tomba à genoux et se mit à pleurer. En même temps, elle remerciait Dieu. Je m’approchai d’elle et me joignis à ses prières d’un cœur reconnaissant.
Quand nous fûmes un peu plus calmes, nous abandonnâmes la cabine pour continuer nos recherches. Le garde-manger était intact. Cela ne m’étonna pas, car j’avais toujours eu l’impression que c’était après nous qu’on en avait, en brisant tout dans nos cabines.
Peu après, nous quittâmes le salon et les cabines démantelées pour aller voir sur l’avant ce qu’il était advenu du côté de la porcherie. Je voulais savoir s’il restait quelque chose du verrat. Au moment où nous arrivâmes, je poussai un cri. Sur le pont était étendu un crabe gigantesque, d’une taille si énorme que je n’aurais jamais cru qu’un monstre pareil pût exister. Il était d’une couleur brune, sauf le ventre, d’un jaune clair.
Une de ses pattes, ou de ses mandibules, avait été cassée dans je ne sais quelle bataille où il fut tué (car il était tout disloqué). Cette patte cassée pesait si lourd que j’eus bien du mal à la soulever, ce qui prouve la taille et l’énormité de la bête.
Autour de cet énorme crabe gisaient une demi-douzaine de plus petits qui ne mesuraient pas plus que vingt à trente centimètres. Ils étaient blanchâtres avec quelques taches brunes. Tous avaient été tués d’un seul coup d’une énorme pince qui les avait presque coupés en deux. Il ne restait plus rien de la carcasse du gros verrat.
Ainsi, le mystère était résolu. Je fus délivré de la terreur superstitieuse qui m’avait tenu à la gorge pendant trois nuits, depuis le commencement du tapage. Nous avions été attaqués par une bande de crabes géants qui errent – tout est possible – de place en place à travers l’herbier, dévorant les proies qu’ils trouvent à leur portée.
Je ne peux vraiment dire s’ils ont attaqué un navire avant le nôtre, et s’ils ont pris ainsi goût à la chair humaine, ou bien si c’est la curiosité qui les a conduits vers nous. Il est possible, après tout, qu’ils aient pris la carcasse de notre bateau pour le corps de quelque monstre pourri de la mer. Cela expliquerait pourquoi ils se sont acharnés contre la coque, essayant de percer notre carapace-cachette particulièrement dure !
Ou bien ils ont un odorat très puissant qui leur permettait de sentir notre présence à bord du bateau. Pourtant, je n’y crois pas, car ils n’ont pas mené une attaque en règle contre nous, sur le rouf. Je n’en sais rien. Pourquoi avoir dévasté le salon et nos cabines ? Vraiment, je ne peux rien en conclure. Laissons ça là.
Je découvris le même jour la manière dont ils étaient venus à bord. Ayant appris de quelles créatures il s’agissait, j’examinai, avec beaucoup plus d’attention, les flancs du bateau. C’est quand j’arrivai aux bossoirs que je compris. Des bouts d’apparaux du bossoir cassé et du beaupré traînaient dans les algues et, comme je n’avais pas recouvert les bossoirs avec la tente, les monstres pouvaient, tranquillement, s’agripper aux manœuvres et monter à bord sans que rien ne les gênât.
À cela, je remédiai rapidement. Avec ma hache, je coupai toutes les manœuvres qui tombaient dans les algues. Ensuite, j’élevai un bâti de bois temporaire pour clôturer la brèche entre les deux extrémités de la tente. Je le consolidai plus tard.
Nous n’avons plus été molestés par les crabes géants depuis lors, bien que, pendant les nuits qui suivirent, nous entendions leurs coups bizarres contre la coque. Il est possible qu’ils aient été attirés par les ordures que nous sommes obligés de jeter par-dessus bord. C’est ce qui expliquerait les premiers coups frappés contre la coque, à l’arrière, du côté de l’infirmerie. C’est en cet endroit, en effet, que nous jetons nos détritus par les ouvertures de la tente.
Voilà, maintenant, des semaines qu’ils ne nous donnent plus signe de vie et je pense qu’ils sont partis ailleurs, sans doute pour attaquer quelques humains solitaires vivant le peu de temps qu’il leur reste à vivre sur quelque épave abandonnée, perdue pour tous dans les profondeurs de cette vaste mer d’algues et de créatures malfaisantes.
J’enverrai ce message comme j’ai envoyé les autres, enfermé dans un baril bien goudronné attaché à une petite montgolfière. J’y ai joint la pince du crabe monstrueux (2) pour montrer ce qui nous cause tant de terreurs là où nous sommes. Si ce message, et la pince du crabe, parviennent jamais dans les mains des hommes, ils pourront imaginer, en voyant ce débris de carapace, la taille du ou des autres crabes qui ont pu détruire un crustacé d’une si formidable dimension.
Quelles autres épouvantes nous attendent maintenant dans ce monde effrayant ?
J’avais pensé ajouter à la pince du crabe la coquille d’un des crabes blancs. Ce devait être l’une de ces bêtes qui grouillaient dans l’herbier, la nuit où mon imagination désordonnée m’a fait penser aux goules et aux êtres de l’au-delà. Mais après avoir réfléchi, je ne l’ai pas fait. Ce n’aurait rien ajouté à ce qui se passe d’illustration et n’aurait fait que rendre plus pesant le baril que le ballon doit soulever.
Je suis fatigué d’écrire. La nuit commence à tomber et je n’ai plus grand-chose à dire. J’écris ceci dans le salon. Je l’ai réparé de mon mieux, mais j’ai été incapable d’effacer les traces de cette nuit où les crabes monstrueux l’ont razzié ainsi que nos cabines. Ils cherchaient… quoi ?
Il n’y a plus rien à dire. Ma santé est bonne. Ma femme et notre enfant aussi se portent bien, mais…
Il ne faut pas que je devienne fou. Il faut que je sois patient. Nous n’avons aucun espoir de secours et nous devons considérer l’avenir aussi courageusement que possible. J’en ai terminé, car mon dernier mot ne doit pas être un mot de lamentation.
Veille de Noël, 1879.
Arthur Samuel Phillips.
–––––
(1) Ceci est, évidemment, une référence à un événement relaté par M. Phillips dans un message précédent, – un des trois messages perdus. W. H. H.
(2) Le capitaine Bolton ne mentionne pas la pince dans la lettre jointe au manuscrit. W. H H.
–––––
(William Hope Hodgson, traduit par Jacques Baron, La Chose dans les algues, Paris, Éditions Planète, 1969 ; la nouvelle de W. H. Hodgson a été reprise, sans l’introduction, dans la revue Planète, n° 3, avril 1972. Jaquette illustrée de la première « cheap edition » de Men of Deep Waters, London: Holden & Hardingham Ltd, 1921)
–––––