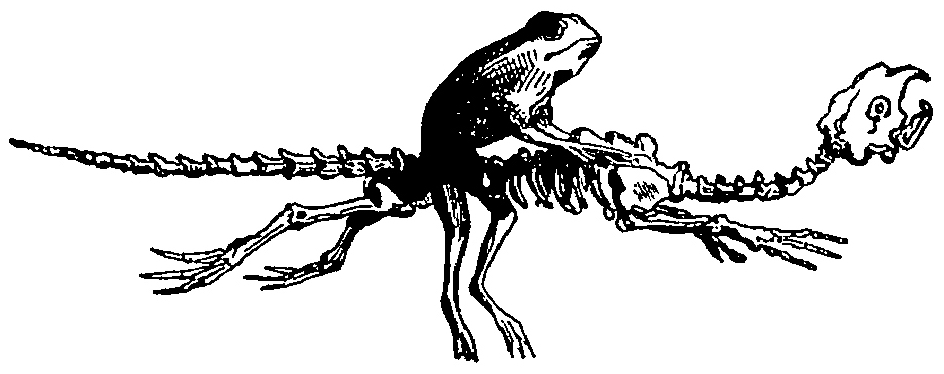Le médecin de la famille appela à son tour au chevet de notre petit malade un professeur de la Faculté de médecine voisine – et celui-ci gravement diagnostiqua : « Anémie dernier degré… chlorose… atonie générale du système vasculaire et vaso-moteur… »
Et notre petit Pierre s’éteignit ainsi… « de consomption, » – suivant l’analyse médicale du médecin des morts, – l’été suivant, vers la même époque où mon père était décédé. Ah ! ce fut un coup terrible, certes, quand nous entendîmes ce petit corps desséché, aux os trouant la peau parcheminée dans son dernier berceau, le cercueil… mais quel père, quelle maman ne comprendra notre douleur désespérée, effroyable, quand, l’année suivante, notre cadet mourut à son tour du même mal mystérieux et alla reposer auprès de son frère aîné, auprès de son grand-père, dans la funèbre crypte familiale.
Ces deux morts terribles avaient été si inattendues, si foudroyantes, que je n’avais pas même eu la pensée de me ressouvenir des paroles menaçantes de mon père, quand, quelque temps après, j’entrai dans la chambre qu’il avait habitée et où ma mère seule pénétrait pour procéder uniquement, avec un zèle pieux, aux soins de son entretien, comme au temps où il vivait…
Elle seule avait voulu en avoir la clef et elle la conservait sur elle précieusement. Elle avait transformé cette chambre en un sanctuaire, en un oratoire où elle allait souvent penser, pleurer et prier pour son cher disparu. Ce jour-là, un clerc du notaire de la famille était venu pour faire signer quelques pièces à ma mère.
Celle-ci, suivant son habitude, s’était retirée dans la chambre pour prier. Je dus l’appeler et la trouvai occupée à rechercher dans un secrétaire quelques notes acquittées jadis par mon père et dont elle avait besoin.
L’âge et nos deuils récents avaient affaibli sa vue.
Elle m’invita à chercher avec elle parmi les liasses de papier classées dans les tiroirs, et quelle ne fut pas ma surprise, mon émotion, ma crainte, de découvrir au cours de nos investigations un pli jauni et cacheté qui m’était destiné.
Sur l’enveloppe, je reconnus, tracée d’une main ferme, l’écriture de mon père et je lus : « À mon fils, à mon enfant bien-aimé. »
Je montrai l’enveloppe à ma mère, qui ne s’était jamais doutée qu’un testament particulier existât, se trouvait là, parmi des notes acquittées, des baux depuis longtemps expirés, d’antiques papiers inutiles, et je décachetai cet écrit posthume en tremblant.
Dès les premières lignes, je compris…
Mon père, durant sa vie, ayant craint de ne pouvoir par suite d’une circonstance fortuite, un accident mortel, me révéler le terrible secret de notre famille, l’avait couché sur le papier et me conjurait de me soumettre à ses ordres in extremis, qui étaient ceux qu’il m’avait donnés de vive voix, à son lit de mort.
Alors soudain, en une seconde, devant mes yeux obscurcis par des larmes amères de regret, se déroula le passé, le passé maudit : l’agonie de mon père, sa révélation, sa fin, la mort horrible de mes enfants, notre désespoir, notre deuil, notre vie brisée, inutile, sans but, et je compris enfin jusqu’à quel point ma confiance en des théories matérialistes, scientifiques, avait causé notre malheur…
Mais il était temps encore, le destin ne s’était accompli qu’à demi, le mal n’était pas entièrement consommé, je vivais… et mon dernier-né, une fillette, notre suprême joie, nos rêves et notre souci de toute heure, nos extases quotidiennes, vivait aussi.
Oui, il en était temps encore… mais il fallait agir… agir sans retard. Je n’hésitai plus… Il fallait sauver notre enfant ! Comprenez-vous cela, juges et aliénistes, bourreaux qui m’avez condamné… Sauver mon enfant, mon enfant !…
Tout fut prêt en une heure… Une échelle pliante pour pénétrer de nuit au cimetière ; un levier de fer pour soulever la pierre du caveau ; des clés anglaises pour dévisser les écrous du cercueil, un marteau et des ciseaux à froid pour, au besoin, l’éventrer, enfin un coutelas, un bienheureux coutelas !…
Le soir même, à l’heure du repas, ô mortel souvenir ! un frisson glacé s’empara soudain de ma pauvre femme, et je reconnus avec effroi les premières atteintes du mal caché ; du mal terrible !…
Horreur ! le vampire invisible, mais près de nous, aspirait la vie de cette malheureuse !…
Oh ! savoir… savoir cela et ne rien pouvoir, rien, rien… Rien ?! Si, pourtant !.. Obéir aux ordres de mon père… commettre le sacrilège !…
Réunissant alors toute mon énergie, tout mon sang-froid, j’eus la force de sourire, de plaisanter, de donner du courage à ma pauvre femme, qui se sentait déjà irrémédiablement atteinte…
Je l’aidai à se mettre au lit, puis, sous prétexte d’aller quérir notre ami, le docteur, je sortis de la maison avec mes outils. La nuit était d’une merveilleuse pureté, d’une douceur infinie… et c’est ce qui nous perdit !
Ah ! pourquoi Dieu permit-il que l’atmosphère fût paisible et embaumée cette nuit-là, que le ciel immense contemplât par les innumérables yeux d’or de ses étoiles mon œuvre de délivrance !
Comme un insensé, trébuchant dans l’ombre, les dents serrées, les yeux fous, une sueur glacée au front, pliant sous le poids de mes outils, je me dirigeai, d’un pas rapide, saccadé, vers le cimetière.
(À suivre)
_____
(Léon Combes, in Le Fraterniste, organe de l’Institut général psychotique, quatrième année, n° 183, vendredi 29 mai 1914 ; ce texte est précédemment paru en trois livraisons dans L’Initiation, revue philosophique des Hautes Études, volumes 72 et 73, vingtième et vingt-et-unième années, n° 11, 12, et 2, août, septembre et novembre 1906. Alfred Rudolfovich Eberling, « Tamara et le Démon, » illustration pour le poème de Lermontov, « Le Démon, » St Petersburg: M. O. Volf, 1910)