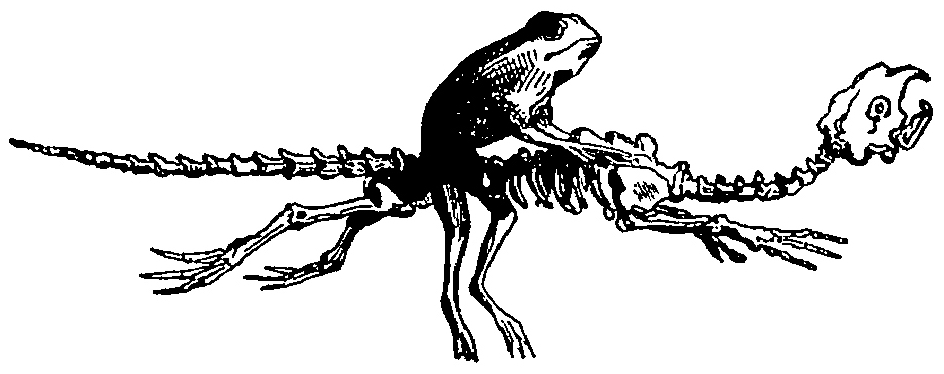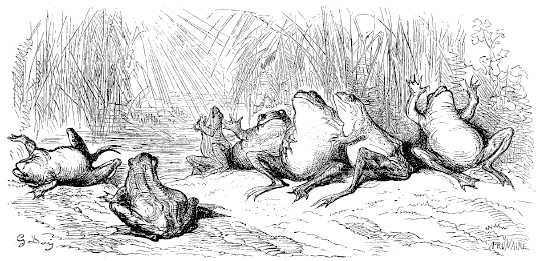Plus on étudie les grands écrivains de langue anglaise, mieux on aperçoit quel intérêt passionnant donne à leurs livres un emploi convaincu de l’élément surnaturel.
Les spectres sont enfants du Nord. Sans doute, la Grèce ne les a point ignorés, non plus que l’Italie ou l’Espagne, et c’est l’Orient surtout qui croit aux vampires. Sans doute, même dans les pays de lumière, où les arêtes nettement dessinées des objets ne permettent pas l’illusion qui engendre la peur, même sous les climats où l’air ensoleillé, que les cigales font vibrer de leur crécelle, inspire la joie superficielle et l’insouciance, les superstitions viennent se greffer sur une foi plus virile et plus ferme, et trouvent leur expression raffinée dans le roman ou le drame, leur expression populaire dans la légende ou la chanson.
Mais combien plus suggestif de l’invisible et de l’inexplicable nous apparaît l’opaque brouillard aux tons de cire jaunâtre et de deuil qui, presque perpétuellement, revêt comme un suaire les solitudes des Hébrides, les Basses-Terres d’Écosse, les étendues vertes de l’Irlande ! Dans cette atmosphère impénétrable, toute silhouette s’agrandit, s’estompe et menace. L’océan ne se distingue pas de ses grèves. Un épais voile d’eau traîne sur la plage et la mer, et on ne reconnaît les flots qu’à leur plainte.
On dirait que cette rumeur marine, incessant cri d’angoisse et de mort, passe dans les syllabes de la langue anglaise. Browning, affirme un de ses commentateurs, est un grand poète parce qu’il emploie les mots d’origine anglo-saxonne de préférence aux mots d’origine latine. Or, ajoute le critique, c’est le mot anglo-saxon qui est pittoresque. Les langues dérivées du latin ont, comme le latin lui-même, des contours précis, une clarté didactique, des résonances limitées. Elles définissent, et, par conséquent, circonscrivent, l’objet ou la sensation qu’elles peignent. D’une physionomie plus fuyante, d’une harmonie plus âpre, le mot anglo-saxon se prolonge par des échos successifs qui vont roulant, aux profondeurs de l’âme, d’abîme en abîme.
Souvent, dans les récits fantastiques de l’Angleterre, le démon, le spectre, l’Errant épouvantable et monstrueux des nuits, s’appelle The Thing ; littéralement, la chose. Mais autant cette expression sous sa forme française est incolore et faible, autant, gonflée par la sève mystérieuse dont les mots anglais sont nourris, et rehaussée encore par cette majuscule qui achève de lui communiquer une sorte de vie fatidique et méchante, elle incarne toute la malfaisance des réprouvés.
De même, comment traduire adéquatement les substantifs ghost, wraith, les adjectifs weird, lurid, thrilling, ghastly, uncanny, et bien d’autres termes qui tous comportent une énorme puissance d’engendrer l’horreur ?
Quand un Shakespeare dispose d’un pareil vocabulaire, on conçoit que ses créations audacieuses gardent, sur la mémoire des hommes, une emprise éternelle : spectres justiciers, c’est toujours afin de venger un crime que les assassinés shakespeariens rejettent la pierre de leur tombe. Dans l’Orestie d’Eschyle, un serviteur proclame que les vivants périssent par la main des morts. On peut, et avec encore plus de raison, le répéter d’Hamlet, de Macbeth, de Richard III. Le spectre, ici, n’est pas un hors-d’œuvre, ou une « utilité, » comme les « songes » et les « confidents » des tragédies classiques. Dans Hamlet, le drame entier naît de lui. L’ombre de Banco tourmente Macbeth, la procession des fantômes terrorise Richard III, et le bouleversement où ces apparitions jettent les deux usurpateurs ne reste pas étranger à leur défaite. Dans Jules César aussi, la grande figure voilée qui, la veille de Philippes, se déploie devant Brutus, lui apporte le pressentiment de sa fin.
Les écrivains du XVIIIe siècle anglais, sans avoir l’imagination splendide et désordonnée des grands aventuriers de lettres que furent les dramaturges du temps d’Elisabeth, n’eurent pas l’esprit sec et géométrique des littérateurs français contemporains de Voltaire, pour qui rien n’est sérieux, pas même le sérieux formidable de la mort. Le Dr Johnson, le colérique et vertueux Johnson, qui joignait à une érudition si vaste, à un si robuste bon sens, la peur et l’attrait des choses funéraires, allait collectionnant et discutant toutes les histoires d’apparitions qu’il pouvait recueillir. Horace Walpole, maniaque sympathique, esprit souple, éveillé, brillant, talent aux mille irisations légères, écrivait son Château d’Otrante, où le pas d’un chevalier-fantôme, rigide en sa retentissante armure, sonne pesamment sous les voûtes féodales.
Walpole et Johnson ne se ressemblaient guère et ne s’aimaient pas. Mais l’un et l’autre s’intéressèrent vivement à l’absurde Cock Lane’s Ghost, spectre qu’une petite fille simulatrice ou hallucinée déclarait apercevoir chaque nuit, et qui fit accourir tout Londres, y compris les gens de lettres et les grands seigneurs.
George Selwyn, si répandu dans la société d’alors, si célèbre par ses bons mots, n’a pas laissé d’œuvre littéraire, mais survit dans la Correspondance de Walpole et les Mémoires du temps. Possédé par la malsaine et bien anglaise passion du macabre, il ne manquait pas une exécution capitale. Or, qu’elle fussent politiques ou de droit commun, Londres, à cette époque, ne les ménageait guère. Après l’immolation, sur l’échafaud de Tower Hill, des lords écossais qui avaient dirigé la rébellion jacobite de 1745, Selwyn ne se vantait-il pas d’avoir vu tomber la tête du comte de Kilmanorck, puis, par compensation, d’avoir été la voir recoudre ? Alors aussi fut décapité l’octogénaire lord Lovat, vieux bandit qui avait trahi tous les partis et que nul ne regretta, mais dont on aurait pu épargner les derniers jours, et qui mourut en héros. Cette exécution surtout frappa l’imagination populaire, et des gens prétendirent avoir rencontré le fantôme de lord Lovat errant, la nuit, sa tête à la main, par les rues de Londres.
À mesure que le siècle avance, le Spectre envahit davantage les esprits et les livres. Johnson et quelques philologues contestent l’authenticité des chants attribués à Ossian par Macpherson, mais le grand public les dévore. Leur poésie est funèbre autant qu’élevée. Formes nébuleuses, les rois, les bardes, les vierges, montent lentement du fond des palais écroulés ou des tombes, pour se mêler aux vivants, leur apporter un conseil, un reproche ou une prière. Et les vivants eux-mêmes ont le flottement incertain des fantômes. Les silhouettes des guerriers ne se détachent pas, sculpturales, d’un immense pan d’azur, comme les corps en marbre blanc des héros homériques. Elles transparaissent à peine dans l’amoncellement des nues. Et ce sont les ombres irritées des morts, non les Olympiens éclatant de lumière, qui versent en eux la frénésie du combat.
Puis, la grande vague du romantisme déferle. Le Château d’Otrante trouve partout des imitateurs. Mathurin, Monk Lewis, Anne Radcliffe, publient leurs diableries à succès. Walter Scott, dans ses poèmes, dans ses romans, dans les notes si instructives et si touffues dont il les accompagne, et jusque dans sa conversation de merveilleux diseur d’anecdotes, dont aucun des contemporains qui l’approchèrent ne devait oublier la séduction, Walter Scott introduit largement les esprits, les fées, les revenants, les sorcières, toutes les superstitions de sa vieille Écosse. Et quand il fait au pédantisme des gens raisonnables la concession d’expliquer par des causes naturelles les épisodes abracadabrants de ses récits, comme on voit que son instinct d’artiste en souffre !
Les écrivains qui viendront ensuite ne seront pas obligés à ce sacrifice, que leur public n’exigera plus ; au contraire, il demandera qu’on lui fasse peur, car la peur est volupté. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de l’appréhension violente qu’inspirent la douleur physique et la mort. Cette peur-là torture et dégrade. Il s’agit de l’indéfinissable stupeur que nous communique le contact ou l’évocation de l’Au-Delà. Impression dont l’analyse psychologique serait hautement intéressante. Tel enfant tremblait dans les ténèbres, et on s’efforçait de calmer son agitation en lui prouvant qu’elles ne recelaient aucun danger. À quoi il répondait fort justement : « Ce n’est pas du danger que j’ai peur, c’est du noir ! » L’humanité entière, à toutes les étapes de son évolution, eut toujours peur du noir. Mais, en même temps, elle l’aima, pour son attrait terrible et son énigme, d’un farouche, d’un frissonnant amour ! Et le primitif comme le décadent, le simple comme le raffiné, l’enfant péruvien qu’une nourrice aymara fait frémir en lui décrivant les incantations de sa tribu, l’indigène du Mayombe qui croit aux revenants, le paysan de la Transylvanie qui croit aux broucolaques, le lettré blasé, compliqué, névrosé, qui, dans les jardins de la pensée, ne cueille plus que les fleurs en velours noir de l’Épouvante, tous, avec une égale voracité, se repaissent d’histoires à donner la chair de poule. Seulement, aux uns, il suffit qu’elles soient relatées par des conteurs naïfs et persuadés ; l’autre ne les apprécie qu’ingénieusement cuisinées par les maîtres du genre.
Car le genre n’admet pas la médiocrité, et seul un très grand écrivain peut produire un récit de cette espèce qui soit un chef-d’œuvre. Il n’importe pas outre mesure que le circonstances mystérieuses de l’histoire aient ou non pour agent une cause réellement surnaturelle. Mais il est indispensable que la sensation du surnaturel pénètre l’atmosphère du roman, de la nouvelle ou du conte.
Elle imprègne tout Dickens. Dans son œuvre colossale, grouillante, multitudinaire, le revenant proprement dit est assez rare. Qu’on se rappelle, pourtant, les douze jurés qui en se comptant se trouvaient toujours treize, parce qu’ils avaient au milieu d’eux l’esprit de l’homme qu’ils allaient venger ! Dans Barnaby Rudge, le mort dont les périodiques apparitions nocturnes affolent toute une région, n’est qu’un homme en chair et en os qui donne le change sur son identité. Mais on ne le saura qu’après avoir lu plusieurs centaines de pages, et, en attendant, quel grandiose et funèbre début d’histoire de revenant que le premier chapitre de Barnaby Rudge !
D’ailleurs, toute chose, dans les créations de Dickens, et jusqu’aux objets les plus prosaïques, les plus familiers, jusqu’aux façades, aux murs et aux meubles, palpite d’une vie surhumaine, grimaçante, presque démoniaque. Nul n’a mieux rendu l’inquiétante poésie des soirs que, solitaire, on passe dans une grande chambre à l’odeur sépulcrale, en quelque maison vétuste et qu’on dirait possédée. Des horloges de la mort s’évertuent dans les boiseries. Des êtres invisibles nous frôlent. On croit à chaque minute entendre quelqu’un remuer derrière la porte ou au fond des armoires. On jette vers la rue des regards qui implorent d’être rassurés, et que rien n’y rassure, car, solitaire elle aussi, mi-noyée par les ténèbres, la froide clarté d’un insuffisant réverbère ne fait qu’en souligner la menace, comme, de fois à autre, le pas croissant et bientôt décroissant d’un noctambule ne fait qu’en accentuer le silence. On sent fuir sa raison. Et on comprend que, par des nuits pareilles, en un moment de dépression morale où le remords achève de perturber tout leur être, Jonas Chuzzlewit, tressaillant au moindre bruit, se terre dans son lit comme une bête homicide, et Ralph Nickleby monte se pendre au crochet de son grenier.
Dickens, d’autre part, adore associer le cocasse au macabre ; Traddles, le petit condisciple de David Copperfield, consacrait, en classe, la plus grande partie de son temps à dessiner des squelettes. La nuit où David apprit la mort de sa mère, Traddles vint lui offrir son oreiller, et toute une collection de ses squelettes, parce que ces deux témoignages d’affection étaient les seuls que, dans sa bonne volonté désolée, il pût donner à son ami. Comme ce trait révèle Dickens, avec son sourire mouillé de larmes, mais aussi avec son humour saugrenu !
Dickens et son ami Wilkie Collins passaient, de leur vivant, pour les deux hommes d’Angleterre les plus capables de régaler, d’une bonne ghost story ou histoire de revenant, leur société habituelle. Nul fantôme n’intervient dans Edwin Drood, le chef-d’œuvre que Dickens en mourant laissa inachevé, et dont les plus brillantes intelligences de la Grande-Bretagne ne cessent de discuter l’énigme insoluble, de conjecturer quel eût été le dénouement. Mais une oppression de cauchemar écrase les personnages, leurs actes, le décor où ils se meuvent. On l’a dit avec raison, la fumée des bouges à opium où Jasper, le protagoniste effrayant du drame, va chercher la torpeur artificielle et l’oubli, est, par l’auteur, délibérément étendue sur l’ensemble du roman, où les types comiques ne manquent cependant pas, mais où le rire qu’ils suscitent reste inquiet, hagard, impuissant à percer le couvercle de brume et de plomb qui s’appesantit sur cette histoire, d’autant plus sinistre qu’on n’en saura jamais la fin.
De même, nul fantôme n’intervient dans la Femme en blanc, de Wilkie Collins, mais, depuis la minute où, au début de l’ouvrage, la folle qu’enveloppe un voile couleur de linceul, traverse, la nuit, certaine route de la banlieue de Londres, une terreur nerveuse, en même temps qu’une curiosité exaspérée, s’empare du lecteur impressionnable, et elles iront le faisant trépider comme une toupie jusqu’aux dernières pages de ce roman, pourtant copieux. Par contre, L’Hôtel hanté n’est pas un des meilleurs livres de Wilkie Collins, malgré l’emploi direct du fantastique et l’émoi légitime où les successives apparitions d’une tête coupée plongent la clientèle de cet établissement.
De même encore, le surnaturel ne se manifeste guère dans les romans des Brontë, ces sombres filles du Nord au talent ingénu et sauvage, mais on ne sait quel reflet d’outre-tombe illumine étrangement les pages de Jane Eyre, et surtout de ce formidable livre dont G.-K Chesterton dit qu’il aurait pu être écrit par un ange, ces Wuthering Heights, ces « hauteurs battues des vents, » où un drame de passion rugissante, dont le héros rappelle les damnés de Michel-Ange et le Sombreval de Barbey d’Aurevilly, se joue dans les marais du Yorkshire, au creux des fondrières où la neige s’entasse, parmi les clameurs de l’ouragan, sous les pluies nocturnes qui détrempent la terre molle des cimetières…
Les Brontë étaient irlandaises. Edgar Poe l’était aussi. Cette origine explique Poe comme elle explique les Brontë. La généalogie celtique de Poe, si importante pour la compréhension de sa psychologie, a été clairement reconstituée par Ingram, le plus averti et le mieux documenté de ses biographes. On a tout dit sur le poète somptueux d’Ulalume et d’Annie. On ne louera jamais assez l’éclat et la perfection de sa prose, le rythme incomparable de ses vers aériens. Son œuvre est tour à tour une chambre de torture, une cathédrale tendue de noir, un palais tapissé de pourpre, une crypte aux relents de putréfaction humaine et de roses pourries, un bois de cyprès et de cèdres où, farouches, égarées, pâles de la mortuaire pâleur des marbres blancs effleurés par la lune, glissent les tombales héroïnes, Lady Madeline de la Maison Usher, l’horrible et douce Bérénice, Rowena de Tremaine, la morte aux cheveux blonds, et Ligeia, la morte aux cheveux noirs…
Un romancier des États-Unis qui fut le contemporain de Poe, Nathaniel Hawthorne, a fait, notamment dans La Maison aux sept Gâbles, un habile usage du fantastique.
D’autres ont été moins heureux, et, même si nous écartons la tourbe des auteurs sans talent et sans nom, il faut signaler, chez plus d’un qui dut un certain succès à des récits de ce genre, le manque d’invention ou de dextérité. Il est si facile de forcer la note, comme on s’en aperçoit en lisant Dracula, de Bram Stoker, où il y a vraiment trop de vampires ! Seuls, un Shakespeare, un Edgar Poe, peuvent se permettre impunément d’accumuler « horreur sur horreur. » Quand des écrivains de faible envergure s’y risquent, ils dépassent le but et font rire au lieu de faire trembler.
Mais un conteur irlandais de l’ère victorienne, Sheridan Le Fanu, dans sa nouvelle intitulée Carmilla, place, au fond d’un vieux château perdu parmi les gorges et les bois de Styrie, une histoire de vampires plus poignante et en même temps plus sobre, d’ailleurs épouvantable à souhait, une de ces histoires dont on détourne les gens nerveux, ou qu’on les adjure de ne pas lire le soir, avec ce résultat infaillible que les gens nerveux les dévorent, et toujours quand vient le moment de se mettre au lit.
Une erreur qu’Edgar Poe lui-même n’a pas suffisamment évitée, c’est la description réaliste des mystères dégoûtants du tombeau. La nausée physique inséparable de tels détails n’a rien de commun avec la terreur intense, mais absolument immatérielle, que nous inspire l’approche d’êtres intelligents vivant sur un autre plan que le nôtre. « La mort est mauvais sculpteur, » disait Gœthe. Si elle attire et préoccupe les créatures destinées à mourir, cette fascination ne tient pas à sa laideur infecte, mais à sa majesté auguste, à sa beauté terrible. La raison de son prestige étrange n’est pas qu’elle fasse grimacer hideusement un noble visage, ou liquéfie un corps harmonieux au point de le transformer en ce je ne sais quoi dont la grande voix de Bossuet crie l’horreur, mais, bien plutôt, qu’elle ne puisse détruire la personnalité humaine, et que nous gardions, de l’être aimé dont elle a fait sa proie, « la forme et l’essence divines » qu’a chantées Baudelaire dans son poème le plus spiritualiste. Nous avons peur des morts, non pas, en vérité, parce qu’ils sont morts, mais parce qu’ils vivent, au contraire, d’une vie sans commune mesure avec la nôtre, d’une vie où ce qui reste de l’homme n’appartient qu’à Dieu.
Un autre écrivain des années dites « victoriennes, » Harrison Ainsworth, auteur de nombreux romans historiques, tombe souvent dans le travers d’insister sur les côtés répugnants des scènes macabres. De plus, quand il évoque les esprits mauvais, comme dans Les Sorcières du Lancashire, Guy Fawkes, La Tour de Londres et Le Château de Windsor, c’est avec tant de lourdeur et de gaucherie qu’on lui en veut positivement de gâcher d’aussi beaux sujets, dont, par contre, son illustrateur Cruikshank sut tirer grand parti : Herne, le Chasseur Fantôme, et The Death Warrant, sont deux des plus remarquables compositions de cet artiste célèbre. Ici, un démon à mufle de bête féroce effraie Marie Tudor sur le point de signer l’arrêt de mort de Jane Gray. Là, Herne the Hunter, le chasseur fantôme de la forêt de Windsor, ombre colossale glissant noire de créneau en créneau, apparaît, une nuit sillonnée d’éclairs, sur un terre-plain de forteresse féodale, à Henri VIII épouvanté, mais qui, dominant son effroi, tire aussitôt l’épée.
L’abondante littérature qu’a fait éclore la Society for Psychical Research, et qui étudie les cas de prémonition, d’hallucination, de télépathie, n’appartient pas à notre sujet parce qu’elle se contente de rapporter des faits réels et de les discuter avec la brièveté du langage scientifique, sortant ainsi du domaine de l’art. Toutefois, quelques-unes de ces anecdotes ont un caractère si dramatique et si intéressant, qu’entre les mains d’un vrai maître, elles pourraient devenir d’excellentes ghost stories.
Mgr Robert Hugh Benson, doublement autorisé par le talent et le sacerdoce, n’a pas craint d’aborder, dans ses Necromancers, le thème délicat du spiritisme, dont il a mis en scène, avec un relief extraordinaire et un jugement hautement impartial, les manifestations diverses et les troublants effets. Son Mirror of Shalott est un recueil de nouvelles et de contes qui tous font passer dans nos mœlles le vent froid du pays des morts, qui tous justifient le mot de M. Pol Demade : « L’écrivain catholique doit être un inquiéteur d’âmes. »
Les Ghost Stories of an Antiquary, de James, ne sont ni sans charme, ni sans valeur. Sir Arthur Conan Doyle, dont la fertilité d’invention ne connaît pas de bornes, a été conduit par son flair de fureteur, appliqué naguère avec tant de succès aux recherches policières, à conter quelques histoires nullement banales de jeunes filles qui se transforment en loups-garous, de momies qui se dégourdissent et courent les grand-routes, de fakirs et de brahmes qui viennent, en pleine Angleterre, mettre au service de leurs haines les grandes Forces que seuls les sages de l’Inde possèdent le secret de déchaîner.
Même les écrivains qui d’ordinaire ne traitent pas cette catégorie de sujets n’ont pas laissé d’y imprimer en passant leur marque. Oscar Wilde ne s’est pas fait une spécialité du surnaturel, mais il a écrit Le Spectre de Canterville. Stevenson ne s’est pas fait une spécialité du surnaturel, mais étant, après Walter Scott, le plus grand maître écossais du roman historique et du récit légendaire, comment le fantastique ne se serait-il pas dressé sur son chemin ? Certes, il n’a pas craint de le regarder en face. Il a enchâssé une histoire de sorcellerie dans Catriona, de même que Scott avait enchâssé dans Redgauntlet une histoire d’apparitions infernales. Et de même que Poe avait, dans Le Cas de M. Valdemar, exploité l’hypnotisme, de même Stevenson, dans Le Cas du Dr Jekyll et de M. Hyde, a utilisé certaines théories modernes sur le dédoublement de la personnalité. Rudyard Kipling ne s’est pas fait une spécialité du surnaturel, mais il a écrit Le Rickshaw Fantôme, et découvert je ne sais où cette épigraphe, exquise de clair-obscur et de mélancolie :
Quand la terre fut malade, que les cieux grisonnèrent, que les bois eurent pourri sous la pluie, l’homme mort vint à cheval, par un jour d’automne, revoir les lieux qu’il avait aimés.
Arnold Bennett ne s’est pas fait une spécialité du surnaturel, car il est surtout le peintre réaliste de la vie contemporaine, mais il a écrit Le Spectre ; et peut-être, sans Le Spectre, son tableau de la vie contemporaine n’eût-il pas été complet : le Spectre tient aujourd’hui dans le monde une aussi large place qu’au temps de Cagliostro, qu’au temps d’Apollonius de Thyane, qu’au temps de toutes les civilisations qui craquent, de toutes les sociétés qui meurent. (1)
À vrai dire, trouverait-on, dans l’histoire entière, une période où le monde ait cessé d’être superstitieux ? Notre époque tragique et décisive, en multipliant les catastrophes, en faisant perdre la boussole aux imaginations, en détraquant les sensibilités, donne plus que jamais à toutes les formes de la superstition un caractère universellement contagieux. Dans la Grande-Bretagne aussi, il y a recrudescence de cette épidémie depuis les grands événements qui ont bouleversé le monde et dont le contrecoup n’a pas épargné l’Angleterre, mais elle n’a jamais cessé d’y régner. L’Anglais, l’Écossais, sont des hommes pratiques, essentiellement habiles à gérer leurs intérêts matériels, mais non des matérialistes. Ils ont d’autres aspirations, que même la réussite en affaires ne pourrait combler. Ils ont le sens religieux de la mort, l’imagination poétique, ardente, volontiers funèbre. Et même leur physiologie, plus compliquée que chez les autres races occidentales, décèle plus fréquemment l’existence de cette réceptivité spéciale pour l’occulte qu’on désigne sous le nom de « sixième sens. » On a beaucoup discuté le don de seconde vue, ou faculté de pénétrer l’avenir, que posséderaient certains Highlanders. Deux dames écossaises affirment avoir aperçu, le 10 août 1910, le spectre de Marie-Antoinette dans les jardins de Trianon, et, pour exposer leur cas, elles ont écrit tout un livre. Au dire d’Adolphe Retté, une autre Écossaise, une jeune fille, aurait, il y a peu d’années, la nuit, dans la forêt de Fontainebleau, vu passer le Grand Veneur, dont l’apparition fut considérée comme un présage de la mort d’Henri IV. L’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, sont pleines de châteaux hantés. L’un a son ineffaçable tache de sang, l’autre son appartement où revient la victime d’un ancien crime, l’autre sa chambre où, la nuit, se diffuse une lumière dont nul ne connaît la source, l’autre sa Banshee, fantôme féminin, génie tutélaire ou vengeur attaché à une race noble, et qui pousse des cris aigus de détresse ou de joie quand un homme ou une femme de cette race va mourir. Dans les rues de Leith, ce « port de misère, » avec ses hautes maisons noires, humides, lépreuses, où des plaques de moisissure adhèrent, on dit que le spectre décapité de Marie Stuart se promène dans un carrosse tiré par des chevaux sans tête. En 1923, on s’est demandé très sérieusement si la mort du grand seigneur anglais qui exhuma Toutânkhamon, et qu’une maladie subite emporta peu après, n’était pas due à la vengeance posthume du pharaon déterré. Vers le même temps, les conservateurs du British Museum furent interrogés quant aux faits et gestes d’une momie sur laquelle courent de singuliers bruits, car elle vivrait d’une vie maléfique, sournoise, vindicative, et aurait déjà plus d’une fois causé malheur. Depuis bien des années, la maison qui porte, ou qui portait, à Londres, dans Berkeley Square, le numéro 50, donne lieu aux récits les plus effarants : elle renfermerait une chambre où tous ceux qui passèrent la nuit ont été trouvés agonisants le matin, tués par une apparition monstrueuse, sur laquelle aucun d’eux n’a pu ou voulu s’expliquer ! On croit aux fantômes comme on y croyait en plein Moyen-Âge. On se fait poursuiveur de fantômes comme, sous l’influence de Sherlock Holmes, on se ferait détective. O’ Donnell, encore un Irlandais, n’hésite pas à commencer des Mémoires, sans mérite littéraire, mais d’après lui authentiques, sur les hantises qui l’assaillent, par cette phrase : « Je suis surtout connu comme Ghost hunter (chasseur de spectres). Ce n’est pourtant pas en vue de cette carrière que mes parents m’ont envoyé à l’Université. » On le croira sans peine.
La notion même du spectre évolue. Aux âges romantiques, le lecteur naïf se contentait encore de la vague apparition dont le glissement sur les dalles étouffait la voix dans la gorge et retenait le cours du sang dans les veines, bien qu’elle passât occupée de ses propres affaires et ne parût point se soucier du contemplateur. Même les spectres shakespeariens, malgré mille bonnes raisons de haïr les personnages sur qui s’acharnait leur colère, ne pouvaient leur faire physiquement aucun mal. Mais le spectre des récits modernes s’est initié, Dieu sait où, à l’art de la matérialisation : il étrangle fort proprement son homme. Ainsi le conçoit William Hope Hodgson, dont nous avons traduit et publié ici même une nouvelle caractéristique : La Porte du Monstre (2). Ainsi le conçoit Marion Crawford, le brillant romancier des États-Unis, dans ses Uncanny Tales, série d’histoires que traverse une grande convulsion d’épouvante. Là aussi, le spectre blesse et tue. Et ce spectre qui blesse ou qui tue sort fréquemment de la mer. Car, surtout dans les régions de brume et de péril où les Pôles étendent leur ombre immense, la mer est le grand réceptacle des superstitions. Déjà aux temps byroniens, Coleridge publiait son curieux poème, The Ancient Mariner, dans lequel un albatros, ou plutôt son fantôme, s’attache implacablement au vaisseau d’où partit le coup de feu qui l’a tué. De même, aux profondeurs de l’Antarctique, et malgré l’intrépidité de son cœur, l’Arthur Gordon Pym d’Edgar Poe défaille dans son canot devant une grande figure blanche qui surgit des ténèbres, et dont l’identité reste inexpliquée.
Pour en revenir à Hodgson, tué en 1918, alors qu’il combattait sur le territoire belge, il avait vécu à la mer, comme Conrad, et, mieux que cet écrivain, selon nous passablement surfait, il suggère la magnificence des houles et leur irrésistible assaut. Dans ses Spectres-Pirates (The Ghost Pirates), il convient de louer non seulement l’art consommé avec lequel le romancier gradue la terreur et donne à l’invraisemblable les apparences du possible, mais encore le réalisme pittoresque et les dialogues savoureux des matelots. Les Spectres-Pirates, voilà un de ces volumes qu’on lit d’une traite, haletant de fièvre et de curiosité ! Car d’effroyables aventures, et une fin inouïe, attendent les marins du brick Le Mortzestus, embarqués à San Francisco dans la direction du cap Horn, où ils n’arriveront jamais. (3)
Tel est le chemin accompli depuis qu’Horace Walpole fit à son siècle la surprise de lui conter une histoire de revenant. Le genre qu’il a créé ainsi n’est pas près de perdre la vogue. Jamais il ne la perdra. Il y aura des revenants tant qu’il y aura des hommes, tant qu’il y aura des morts ! La machine, associée chaque jour davantage à tous les actes de la vie moderne, la rend chaque jour aussi plus antipathique et plus laide. Mais la laideur même ne déconcerte pas le spectre, accoutumé à effrayer autrui et à ne s’effrayer de rien. Il y aura des automobiles-fantômes et des avions-fantômes, comme il y eut des chevaux-fantômes et des vaisseaux-fantômes. On ne tue pas la poésie de la peur. Heureusement, car elle fait danser aux nerfs de bien jolies sarabandes ! Rien ne vaut l’émotion forte, la sensation bizarre. Tel qui, pendant des années, les aura cherchées, et parfois en vain, à travers les deux hémisphères, compte, au nombre de ses souvenirs les plus vivaces, de ses heures les plus inoubliables, des soirs passés, dans une chambre d’hôtel d’un grand port américain du Pacifique, à lire, en écoutant le vacarme nocturne de l’océan démonté, les récits bouleversants des maîtres anglais du fantastique. Et il devait, plus tard, en Écosse, assouvir mieux encore son appétit de lectures étranges, par des veillées d’hiver où l’antique Édimbourg s’enveloppait de brume froide et de nuit. La maison était immense. La salle, solitaire. Dans l’âtre ouvert à la mode écossaise, les bûches flambaient. Le vent accourait de la montagne et de la mer. Il avait soufflé sur Blair-Athol et Forfar, et sur les petites vagues ternes du Forth. Il était plein de menaces, de cris informes, de longs sanglots. Quels bourreaux et quels suppliciés invisibles emportait son remous ? Et là, dans cette grande salle de cette grande maison triste, aux parois de forteresse, à la décoration grave et sombre, là, à quelques mètres de l’esplanade où le major Weir fut exécuté comme sorcier en 1670, à quelques minutes d’Holyrood, le palais sépulcral où reviennent tant d’ombres sanglantes, tous les soirs, l’étranger lisait, pelotonné dans un fauteuil, au coin du brasier rouge, recueil après recueil d’histoires hantées. Et quand, par le hall et l’escalier pleins de silence morbide, de ténèbres suspectes, il regagnait sa chambre à coucher, la soudaine apparition de quelque silhouette phosphoreuse ne lui aurait pour ainsi dire pas semblé imprévue.
*
Il y a toujours des fantômes. Ils planent toujours dans le ciel gris. Ils sortent toujours de la mer grise. Ils s’enveloppent toujours du brouillard celte. Ils fascinent toujours l’âme anglaise. Ils sont la forme sensible des rêves que rêvaient les anciens bardes, des visions qui effarouchaient l’âme pourtant courageuse des carles de l’Heptarchie et des barons de la conquête normande. Tantôt, ils expriment le remords héréditaire d’une grande race demeurée consciente du crime lointain d’un ancêtre. Tantôt, ils se dégagent de l’inépuisable réservoir de poésie qu’est l’âme populaire, bien qu’ils naissent parfois de sa puérile ou dangereuse ignorance. Dans les rumeurs forestières, dans le vent qui dessèche les sillons ou secoue les flots, tour à tour le bûcheron, le laboureur, le marin, croient écouter leur voix. La littérature anglaise répercute leur myriadaire appel. Tant qu’elle ira prolongeant d’âge en âge ses orchestrations étouffées ou sonores, les trois sorcières dont la prédiction poussa Macbeth sur le chemin du crime continueront d’errer sur la bruyère d’Inverness, les goules d’Ulalume ne sortiront du lac d’Auber que pour aller boire le sang des enfants endormis, la Meg Merrilie de Guy Mannering, confidente des secrets de l’Égypte ancienne, que la tribu vagabonde des gipsies vint murmurer à l’Écosse de Walter Scott comme à l’Espagne de Mérimée, et la Norna du Pirate, dépositaire des traditions scandinaves, ne cesseront de confabuler dans l’ombre, l’une avec les génies des bois et des ruines, l’autre avec les Rois de la mer, dont l’esprit hante encore les eaux livides qui roulent des Faroër aux Orcades.
_____
(1) Rappelons au lecteur que le roman Le Spectre, traduit de l’anglais par M. Émile Chardome, a été publié dans la Revue Belge aux dates des 1er et 15 août, 1er et 15 septembre, 1er et 15 octobre, et 1er novembre 1924, et qu’il vient de paraître en volume aux éditions de la Nouvelle Revue Française.
(N. D. L. R.)
(2) Voir la Revue Belge du 1er juin 1924.
(3) Nous publierons prochainement, dans la Revue Belge, une traduction de ce roman.
_____
(Émile Chardome, in La Revue belge, troisième année, n° 4, 15 novembre 1926. Aquarelle de Frederick Smallfield, « The Ghost Story, » sd ; Robert William Buss, « The Ghost Story, » d’après une gravure Robert Graves, c. 1874)