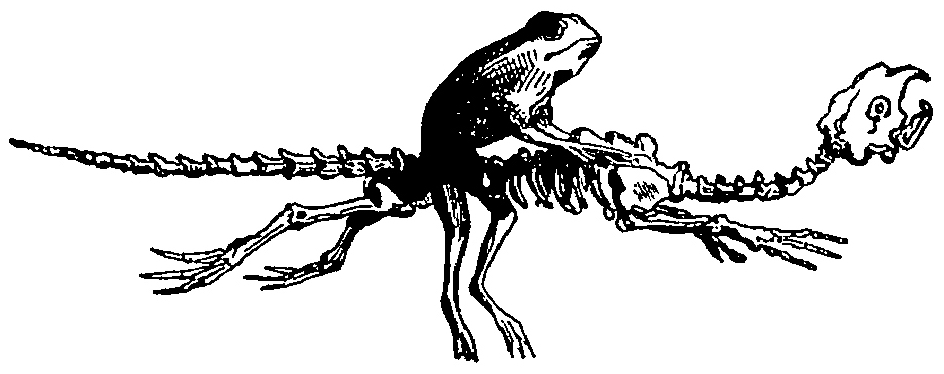Il y en avait sept. Je reconnus celle de mon père à ses ferrures encore nettes, non rouillées. Mais elle se trouvait à une certaine hauteur du sol, placée sur les madriers de fer supérieurs. Après de vains efforts pour l’atteindre, je dus me résoudre, pour exécuter mon dessein, pour ouvrir le cercueil, à le pousser, à le jeter sur le sol de la crypte. Sous mes efforts désespérés, la lourde boîte oblongue céda, glissa peu à peu sur ses supports, oscilla sinistrement un instant, puis plongea toute droite, dans le vide.
Le bruit de sa chute fut horrible.
J’entends encore, – après tant de souvenirs d’épouvante, d’inexprimables terreurs, – j’entends le craquement lugubre, le coup sourd, terrifiant, inouï, que laissa échapper la caisse funèbre sous le poids du cadavre rebondissant en son intérieur.
Le cercueil était tombé sur son couvercle et je dus me cramponner à lui, peser de toute la force de mes genoux et de mes bras pour le retourner afin de l’ouvrir.
J’y parvins enfin dans un ahan suprême qui me rejeta épuisé, anéanti sur le coffre funèbre.
La terreur du vampire, du vampire si proche, me fit sursauter, mais halluciné par ma hantise, ne voyant plus que le but libérateur à atteindre, j’appliquai âprement mes clefs anglaises sur les écrous et essayai de les dévisser. Tremblant, affolé, je ne pus y parvenir… alors, saisi d’une rage aveugle, je frappai sur le cercueil, essayant de faire sauter le couvercle à l’aide du ciseau et du marteau.
Une heure s’écoula, mortelle…
Le coffre de chêne résistait sous sa triple armature de fer.
Une sueur abondante et glacée ruisselait le long de mes membres et tombait de mon front en larges gouttes sur mes mains crispées sur le marteau.
Plusieurs fois, je fus sur le point de renoncer à cette tâche macabre, de fuir, fuir éperdument, mais la vision de ma femme mourante, de ma fillette souriant dans son sommeil parmi les blanches dentelles de son berceau et vouée à une mort certaine, inéluctable, me rendait aussitôt mes forces, et, avec une fureur démente, en de farouches anhèlements, sourd au bruit formidable des coups résonnant dans la crypte, l’esprit trop troublé d’ailleurs dans le vent de folie qui emportait ma raison pour songer que le bruit de ma besogne pouvait me trahir, donner l’éveil, je frappais en désespéré sur le cercueil qui gémissait lugubrement à chaque coup de marteau.
Bientôt, le couvercle de chêne céda en partie et le corps de mon père m’apparut, rigide, entre les planches brisées du cercueil.
Détail curieux et qui ne me frappa que plus tard, lorsque j’analysai tous les souvenirs de cette nuit tragique, aucune odeur putride ne se dégageait de la bière… à peine un relent fade, écœurant, d’eau corrompue et violemment agitée…
Un voile blanc, déposé par ma mère sur le visage du défunt avant qu’on eût fermé le cercueil, cachait son visage…
Enfin, un dernier coup de marteau formidable, forcené, fit voler en éclats les planches à demi-brisées, et d’un geste rapide, en fermant les yeux, j’arrachai le voile de la face du cadavre…
Quelles furent les impressions que je ressentis alors ? Je ne saurais m’en souvenir… L’épouvante, l’horreur, toutes les sensations effrayantes déjà éprouvées étaient annihilées en moi par un vertige sans précédent.
Une pensée unique, intense, martelante, persistait seule dans l’effondrement de tout mon être : arracher le cœur du cadavre, trancher la tête du corps, puis m’enfuir, oh ! m’enfuir !…
Je rouvris cependant les yeux, non pour considérer ce visage que je supposais en complète putréfaction, et dont la seule idée de vision m’épouvantait, mais pour chercher le couteau qui devait se trouver sur le sol, près de la bière.
Ma main tâtonnante le chercha longuement dans l’ombre vacillante de la crypte, cependant qu’il me semblait sentir le regard des yeux du mort suivre mes investigations dans l’ombre et comme un frisson glacé, en une emprise lourde, persistante, insupportable, courir le long de mes membres, peser sur mes épaules.
Soudain, sans transition appréciable dans la corrélation de mes idées formidablement agitées par un vent de démence, un désir aigu, un désir fou, hallucinant, s’empara de moi. Je voulus voir… voir mon père, voir le vampire ! J’essayai de lutter contre cette délirante hantise, mais bientôt ma volonté désemparée, soumise, vaincue, sombra.
J’allongeai d’abord les doigts… mais la chair molle et froide du cadavre qui cédait sous mon toucher, m’horrifia.
Je retirai vivement la main et, dans ce mouvement instinctif, mes yeux tombèrent sur lui.
Ô terreur !
Ce cadavre était demeuré intact, ce cadavre semblait respirer, paraissait ricaner… d’un rire muet continu, atroce.
Et fasciné, sans volonté, sans force pour pouvoir maintenant détourner mon regard du cercueil, je considérai cet être effroyable, ce mort-vivant !
Les cheveux et la barbe, depuis six mois, avaient démesurément poussé et encadraient, de leur coulée gris sale, la face pâle mais intacte. Les yeux étaient clos, mais les ailes du nez fermes et presque charnues paraissaient se soulever comme pour respirer encore…
Un rictus macabre découvrait enfin les dents d’ivoire jaune du cadavre, visibles sous la moustache terreuse et tombante.
Les mains, croisées sur la poitrine, étaient entourées par les grains de buis d’un chapelet noir et retenaient un crucifix d’ébène… mais les ongles avaient étrangement poussé et ils se repliaient, livides, crochus, telle la serre d’un vautour.
Le vampire semblait dormir, blême et rigide… Et cependant, je n’en doutais plus, ce cadavre vivait !
Comment ? De quelle façon ? Par quelle horrible faculté parvenait-il, sans quitter ce cercueil, à se transformer en agent de malheur, de deuil, de mort ?
(À suivre)
_____
(Léon Combes, in Le Fraterniste, organe de l’Institut général psychotique, quatrième année, n° 185, vendredi 12 juin 1914 ; ce texte est précédemment paru en trois livraisons dans L’Initiation, revue philosophique des Hautes Études, volumes 72 et 73, vingtième et vingt-et-unième années, n° 11, 12, et 2, août, septembre et novembre 1906. Alfred Rudolfovich Eberling, « Tamara et le Démon, » illustration pour le poème de Lermontov, « Le Démon, » St Petersburg: M. O. Volf, 1910)