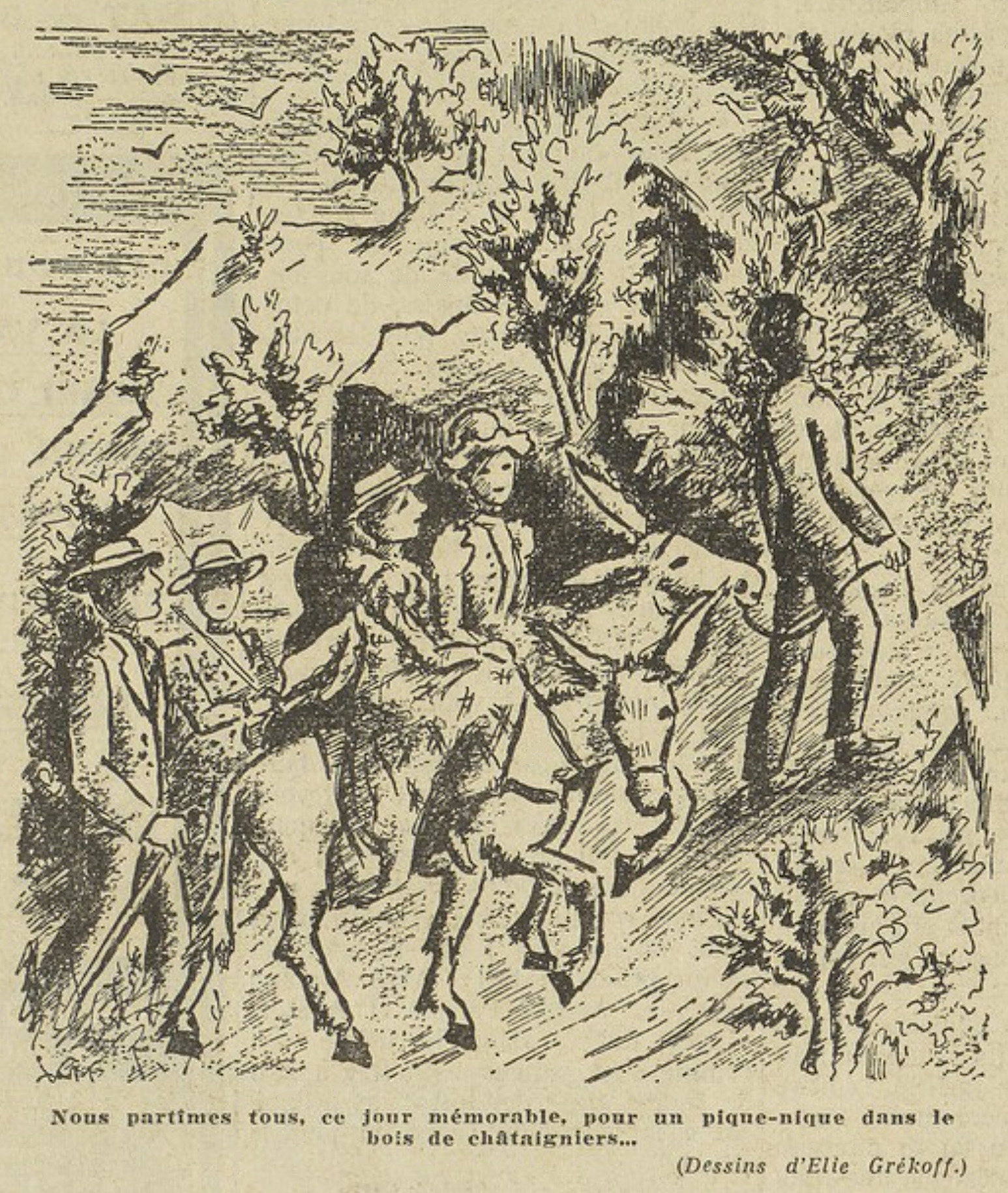Edward Morgan Forster qui, dans sa retraite de Cambridge, va atteindre sa soixante-treizième année, est pour la plupart des lettrés d’outre-Manche le meilleur romancier vivant d’Angleterre – ce qui peut, même chez un auteur, s’allier à un vif éloignement pour la popularité. Le public a pu lire de Forster, en traduction, « Route des Indes, » « Avec Vue sur l’Arno » et « Le legs de Mrs Wilcox. » Nous sommes heureux de publier aujourd’hui, dans la traduction de Charles Mauron, un récit inédit du grand romancier.
–––––
La « carrière » d’Eustache (si le mot peut être employé ici) date, à coup sûr, de cet après-midi que nous passâmes dans les bois de châtaigniers dominant Ravello. Je dois avouer aussitôt que je suis un homme simple, sans désirs ni prétentions littéraires. Cependant, je me flatte de savoir raconter une histoire sans exagération. J’ai résolu, par suite, de donner un récit objectif des événements extraordinaires qui eurent lieu voici huit années.
Ravello est un délicieux endroit avec un délicieux petit hôtel, où nous fîmes la connaissance de quelques personnes charmantes. Il y avait là les deux Misses Robinson, arrivées six semaines plus tôt avec Eustache, leur neveu, un garçon d’environ quatorze ans. Le séjour de Mr Sandbach durait aussi depuis quelque temps. L’état de sa santé l’avait contraint d’abandonner sa cure, au Nord de Angleterre, et pendant sa convalescence à Ravello, il avait pris en main le jeune Eustache (dont l’éducation laissait tristement à désirer), dans l’espoir de le préparer à l’une de nos grandes public-schools. Il y avait Mr Leyland, qui se disait artiste. Enfin, il y avait la sympathique propriétaire, Signora Scafetti, et son sympathique garçon d’hôtel (parlant anglais), Emmanuele – bien qu’à l’époque dont je parle Emmanuele fût en congé, auprès de son père malade.
Ce petit cercle vit arriver sans déplaisir, j’ose le croire, moi-même, ma femme et mes deux filles. Je trouvai, pour ma part, la compagnie agréable, à l’exception de deux personnes, qui me demeurèrent antipathiques : Leyland, l’artiste, et le neveu de Miss Robinson, Eustache. Leyland était tout simplement d’une vanité odieuse : mon histoire le montrera, je n’insiste donc pas ici. Eustache, lui, était davantage : antipathique jusqu’à la répulsion.
J’aime, en général, les jeunes garçons et j’étais disposé à me montrer amical envers celui-ci. Nous offrîmes, mes filles et moi, de l’emmener à la promenade : Oh non ! la marche était une telle corvée ! Je proposai un bain : Oh non ! il ne savait pas nager.
« Un jeune Anglais doit savoir nager, répondis-je ; je vais vous apprendre.
– Eh bien, mon chéri, dit Miss Robinson, voilà une occasion. »
Il répondit qu’il avait peur de l’eau ! – peur, un jeune garçon !
J’eusse été moins choqué s’il avait vécu plongé dans ses livres, mais il ne mettait pas plus de passion au travail qu’au jeu. Quand il ne se prélassait pas sur un fauteuil de la terrasse, il se traînait sur la grand-route, les pieds dans la poussière et les épaules en avant. Telles étaient ses occupations favorites. Rien d’étonnant qu’il eût un teint pâle, une poitrine étroite, des muscles non développés. Ses tantes le jugeaient délicat ; en fait, il avait besoin de discipline.
Nous partîmes tous, ce jour mémorable, pour un pique-nique dans le bois de châtaigniers – seule, Jeannette demeura pour achever son aquarelle de la cathédrale (qui ne valait pas cher, je le crains).
Si je m’égare dans ces détails peu nécessaires, c’est que mon souvenir voudrait en vain les séparer du reste ; j’en dirai autant des conversations pendant le pique-nique : tout s’est gravé en bloc dans mon esprit. Après une ascension d’environ deux heures, nous laissâmes les ânes, qui avaient porté les Misses Robinson et ma femme, et tout le monde poursuivit à pied le chemin qui menait au fond du vallon – Vallone Fontana Caroso en était, je me souviens, le nom correct.
J’avais vu déjà et j’ai vu depuis un grand nombre de beaux paysages ; j’en ai peu trouvé qui m’aient davantage séduit. Le vallon se terminait par un vaste creux en forme de coupe, vers lequel convergeaient des ravins plongeant du cercle des pentes abruptes. Le vallon, les ravins et les crêtes intermédiaires étaient également couverts de châtaigniers feuillus. Cela formait une sorte de main aux doigts multipliés, une main verte, la paume tournée vers le ciel et contractée convulsivement pour essayer de nous garder dans son étreinte. Très loin, à l’entrée du vallon, apparaissaient Ravello et la mer, uniques signes d’un autre monde.
« Exquis, cet endroit ! s’écria ma fille Rose. Quel tableau cela ferait !
– Certes, dit Mr Sandbach, un paysage dix fois moins beau ferait encore l’orgueil de plus d’un musée fameux en Europe.
– Erreur, dit Mr Leyland, ce paysage donnerait un tableau fort médiocre. Il est même impossible à peindre.
– Ah, pourquoi donc ? demanda Rose, avec beaucoup plus de respect que Mr Leyland n’en méritait.
– Voyez-moi tout d’abord cette ligne de crêtes sur le ciel ! répliqua-t-il. Elle est intolérablement droite. Il faudrait la briser, la varier. Du point où nous sommes, rien n’est en place dans sa juste perspective. Les couleurs, d’autre part, sont crues et monotones.
– Je ne suis pas connaisseur en peinture, dis-je alors, et je n’ai pas la prétention de l’être ; mais je reconnais la beauté quand je la vois, et ce paysage me satisfait pleinement.
– On serait satisfait à moins ! » dit l’aînée des Misses Robinson.
Mr Sandbach l’appuya.
« Ah ! dit Leyland, vous faites tous la même confusion. Un peintre ne voit pas la nature comme un photographe. »
Ma pauvre Rose ayant apporté son kodak, je trouvai la remarque parfaitement grossière. Mais je ne voulais pas d’esclandre. Je me détournai donc pour aider ma femme et Miss Mary Robinson à déballer les provisions – pas fameuses, ces provisions.
« Mon petit Eustache, dit sa tante, viens nous aider ; viens. »
L’humeur d’Eustache avait été, ce matin-là, particulièrement désagréable. Refusant de bouger, à l’ordinaire, il avait voulu rester à l’hôtel, où il n’eût rien fait qu’ennuyer Jeannette. Ses tantes étaient prêtes à céder. Avec leur permission, j’avais dit alors au jeune garçon quelques mots bien sentis sur la nécessité de l’exercice ; il était donc venu, mais plus boudeur et taciturne que jamais.
L’obéissance n’était pas son fort. Il discutait invariablement les ordres et ne s’exécutait qu’en grommelant. Une obéissance prompte et joyeuse dans tous les cas – voilà ce que j’exigerais de mon fils, si j’en avais un.
« Je viens… tante… Mary, » répondit-il enfin. Sur quoi, il s’absorba dans la taille d’un sifflet et attendit soigneusement que nous eussions fait le travail.
« Fort bien, mon petit monsieur, lui dis-je ; vous arrivez à la fin pour profiter de notre labeur. »
Il soupira : il ne supportait pas la raillerie. Miss Mary, fort peu sagement et en dépit de mes efforts, insista pour lui donner l’aile du poulet. J’éprouvai alors, je m’en souviens, un mouvement d’humeur : au lieu de jouir du soleil, de l’air et des arbres, voilà que nous nous querellions pour le régime d’un enfant gâté !
« Le grand Dieu Pan est mort ! »
Après le déjeuner, pourtant, Eustache cessa d’accaparer toute notre attention. Il s’était retiré au pied d’un arbre et détachait l’écorce de son sifflet. Pour une fois, il travaillait – à sa façon – et j’en remerciai le Ciel. Nous nous allongeâmes pour un dolce far niente.
Ces tendres châtaigniers du Sud ne sont que de frêles adolescents auprès de nos gaillards nordiques. Mais ils enveloppent de façon charmante les contours des collines et des vallons. Leur voile continu n’était ici déchiré que par deux clairières, dans l’une desquelles nous nous trouvions.

Ces quelques arbres abattus furent, pour Leyland, l’occasion d’un réquisitoire mesquin contre le propriétaire du bois.
« La Nature, s’écria-t-il, perd toute poésie ! On assèche ses lacs et ses marais, on endigue ses mers, on abat ses forêts. Partout gagne et s’étale à notre vue la vulgarité des dévastations. »
Je connais un peu les esthètes et je répliquai qu’il fallait éclaircir les bois pour la santé même des plus gros arbres. En outre, il paraissait déraisonnable d’attendre du propriétaire qu’il renonçât à tirer quelque revenu de sa terre.
« Si vous considérez le paysage d’un point de vue commercial, vous pouvez bien vous réjouir de l’exploitation qui en est faite. Pour moi, la seule idée de convertir un arbre en argent me dégoûte.
– Je ne vois pas pourquoi, observai-je poliment, nous mépriserions les dons de la nature parce qu’ils possèdent une valeur. »
Ma remarque ne l’arrêta pas.
« Peu importe, poursuivit-il ; le mal est sans espoir, la vulgarité nous imprègne tous. Je ne m’en excepte pas. C’est par notre faute, et pour notre honte, que les Néréides ont quitté nos eaux, les Oréades, nos montagnes, et que nos bois n’offrent plus un abri à Pan.
– Pan ! s’écria Mr Sandbach, dont la belle voix grave fit retentir soudain le vallon comme une verte nef de cathédrale. Pan est mort. Voilà pourquoi nos bois ne sauraient l’abriter. »
Et il nous rapporta l’étonnant récit de ces marins, qui, naviguant au long des côtes vers le temps où le Christ naquit, entendirent par trois fois une voix forte dire : « Le grand Dieu Pan est mort ! »
« Ah, oui ! Le grand Dieu Pan est mort, » répéta Leyland, en se laissant aller à ce cabotinage de douleur où se complaisent ceux qui cultivent le genre artiste. Son cigare s’éteignit : il dut me demander une allumette.
« C’est passionnant, dit Rose. J’aimerais tant connaître un peu l’histoire de l’Antiquité.
– Oh, vous me flattez, dit Mr Sandbach. Eh, Eustache ? »
Eustache achevait son sifflet. Il leva les yeux, de l’air irrité que ses tantes lui laissaient prendre, et ne fit aucune réponse.
La conversation aborda des sujets divers, puis tomba. C’était un après-midi de mai, sans nuages, et le vert pâle des feuilles de châtaigniers se détachait fort joliment sur le bleu foncé du ciel. Nous étions tous assis au bord de la petite clairière, afin de jouir de la vue, et l’ombrage des arbrisseaux, derrière nous, était manifestement insuffisant. Tous les bruits s’éteignirent – au moins dans ma propre version de l’histoire. Miss Robinson prétend qu’une clameur d’oiseaux fut, pour elle, le premier signe de malaise. Tous les bruits s’éteignirent – sauf un, très lointain : celui, que je pus percevoir, de deux grosses branches de châtaignier, qui frottaient l’une contre l’autre, cependant que l’arbre oscillait. Ces frottements devinrent de plus en plus brefs, puis s’éteignirent à leur tour. Quand je promenai mon regard sur les doigts verts de la vallée, tout y était immobile et muet, absolument ; et je me sentis envahi par cette impression de suspens qu’on éprouve si fréquemment devant la nature en repos.
Soudain, nous sursautâmes tous au bruit atroce qui sortit du sifflet d’Eustache. Je n’ai jamais entendu aucun instrument émettre une dissonance aussi déchirante.
« Eustache, mon chéri, dit Miss Mary Robinson, tu aurais pu penser à la tête de ta pauvre tante Julia. »
Leyland, qui, apparemment, somnolait, s’était dressé sur son séant.
« L’insensibilité d’un garçon à toute beauté ou à tout sublime a quelque chose d’effarant, remarqua-t-il. Jamais je n’aurais cru qu’il pût trouver ici de quoi gâcher notre jouissance à ce point. »
Puis le triple silence retomba sur nous. Debout, maintenant, je regardais un friselis de vent qui descendait d’une crête en face, fonçant sur son passage le vert tendre des frondaisons. Un pressentiment bizarre m’envahit ; et je me détournai pour découvrir avec stupéfaction que tous les autres étaient aussi debout et regardaient le même point. Ce qui arriva ensuite ne saurait être raconté logiquement : pour ma part, en tout cas, je n’ai pas honte d’avouer que, malgré l’azur calme au-dessus de ma tête, la forêt printanière et verte à mes pieds, et la présence, autour de moi, des amis les plus bienveillants, je me sentis épouvanté, d’une épouvante que je souhaite ne plus éprouver de ma vie et dont je n’ai jamais rencontré la pareille ni avant ni après ce jour. Dans le regard des autres, inexpressif et vide, je lus d’ailleurs la même terreur ; leurs lèvres essayaient en vain de parler, leurs mains de faire un geste. Autour de nous, cependant, tout n’était qu’abondance, beauté et paix. Rien ne bougeait, hormis le friselis de vent, qui, maintenant, gravissait la pente vers nous.
Qui fit le premier mouvement ? Le point n’a pu être fixé. Il suffit de dire qu’une seconde plus tard nous courions de toutes nos forces au flanc de la colline. Leyland courait en tête, suivi de Mr Sandbach et de ma femme. Mais je n’eus qu’un instant pour voir ; car, bondissant de la clairière dans le bois, puis sur les buissons et les roches, je plongeai dans le lit du torrent à sec vers la profondeur du vallon. Je n’aurais pu, pendant cette course, distinguer le jour de la nuit, les châtaigniers d’une herbe rase ou la pente d’une route plane. Je ne vis rien, n’entendis rien, ne sentis rien, toutes les voies des sens et de l’esprit étant bloquées. Ce n’était pas une peur mentale et que l’esprit pût reconnaître. C’était l’épouvante physique, brutale, irrépressible – celle qui bouche les oreilles, met un nuage sur les yeux et noie la bouche de goûts abominables. Et je ne devais pas garder, de cette expérience, l’humiliation ordinaire : la bête, en moi, avait eu peur, non l’homme.
« Hé là, jeune animal, debout ! »
La fin, pour nous, de cette aventure demeure aussi indescriptible que son début, car notre peur s’évanouit comme elle était venue, sans cause. Tout à coup, je me retrouvai capable de voir, d’entendre, de tousser, d’avaler. Jetant un regard derrière moi, je vis que les autres s’étaient arrêtés aussi ; et bientôt notre groupe se reforma, mais nous restâmes longtemps sans pouvoir parler, et plus longtemps encore sans oser le faire.
Aucun de nous n’était sérieusement blessé. Ma pauvre femme avait une cheville foulée ; Leyland s’était cassé un ongle contre un arbre ; moi-même, je m’étais égratigné et déchiré l’oreille. Je n’avais rien senti avant de m’arrêter.
Tous, nous restions muets ; chacun interrogeait le visage des autres. Soudain, Miss Mary Robinson poussa un cri terrible :
« Dieu de bonté ! Où est Eustache ? (Elle serait tombée si Mr Sandbach ne l’avait soutenue.)
– Retournons, retournons immédiatement, dit ma fille Rose, qui, de nous tous, avait conservé le plus de sang-froid. Mais j’espère… je sens qu’il n’est pas en danger. »
Leyland (ce pleutre !) éleva quelques objections. Mais, se voyant en minorité et craignant d’être laissé seul, il céda. Ma pauvre femme s’appuya sur Rose et sur moi, Mr Sandbach et Miss Robinson soutinrent Miss Mary ; et lentement, silencieusement, nous revînmes en arrière : il nous fallut quarante minutes pour regravir la pente que nous avions dévalée en dix.
La conversation resta décousue, car personne n’osait risquer une opinion sur ce qui venait d’arriver. Rose, la plus bavarde, nous surprit tous : elle avait bien failli rester sur place, nous dit-elle.
« Comment ? N’avez-vous pas eu… n’avez-vous pas été forcée de fuir ? demanda Mr Sandbach.
– Oh, bien sûr, j’ai eu peur (elle était la première a employer le mot), mais j’ai cru sentir que tout changerait, que je n’aurais plus besoin d’avoir peur, pour ainsi dire, si je parvenais à ne pas bouger. »
Rose n’a jamais su s’exprimer clairement ; en revanche, il faut porter à son crédit le fait qu’elle ait résisté si longtemps à cette terrible épreuve, elle, la plus jeune du groupe.
« Et je crois que je n’aurais pas bougé, poursuivit-elle, si je n’avais vu fuir maman. »
L’expérience de Rose nous rassura un peu sur le sort d’Eustache. Mais un affreux pressentiment nous envahit lorsque, au haut de la côte plantée de châtaigniers, nous atteignîmes la petite clairière. À peine y avions-nous pénétré que nos langues se délièrent. Sur le bord opposé, on pouvait voir les reliefs de notre pique-nique et, tout près d’eux, gisant sur le dos, immobile, Eustache.
Avec une certaine présence d’esprit, je criai sur-le-champ : « Hé là, jeune animal, debout ! » Il ne fit aucun signe et ne répondit pas davantage lorsque ses pauvres tantes lui parlèrent. Soudain, je fus saisi d’une indicible horreur : sortant du poignet de la chemise, un de ces affreux lézards verts venait de détaler à notre approche.
Immobiles, nous regardions ce corps gisant et silencieux ; l’explosion de lamentations et de pleurs était inévitable. Les oreilles me tintèrent.
Miss Mary, tombant à genoux, toucha la main crispée, les doigts entrelacés à l’herbe haute.
À ce contact, il ouvrit les yeux et sourit.
« Le Malin a été proche, très proche… »
J’ai souvent revu ce sourire depuis, tantôt sur le visage de son propriétaire, tantôt sur les photographies, qui commencent à paraître dans les journaux illustrés. Eustache, jusque-là, n’avait jamais offert qu’une grimace de bouderie hargneuse, et aucun d’entre nous n’était accoutumé à ce sourire inquiétant, apparemment toujours hors de propos.
Ses tantes le couvrirent de baisers qu’il ne rendit pas, et un silence gênant s’établit. Eustache, naturel, ne montrait pas le moindre trouble. Il fallait bien, pourtant, qu’il eût connu lui-même quelque expérience extraordinaire. Sinon, notre propre conduite l’eût étonné bien davantage. Ma femme, la première, avec un tact très prompt, fit comme si rien ne s’était passé.
« Eh bien, monsieur Eustache, dit-elle en s’asseyant pour détendre son pied foulé, vous êtes-vous diverti pendant notre absence ?
– Merci beaucoup, Mrs Tytler, j’ai été fort heureux.
– Et où êtes-vous allé ?
– Ici.
– Quoi, vous êtes resté couché tout ce temps, petit paresseux ?
– Non, pas tout le temps.
– Qu’avez-vous donc fait avant ?
– Oh, j’étais debout, ou assis.
– Debout ou assis sans rien faire ! Ne connaissez-vous pas le poème : Satan induit au mal même ceux qui…
– Oh, chère Madame, chut ! chut ! » jeta la voix de Mr Sandbach.
Ma femme, évidemment vexée, se tut et s’éloigna. À mon étonnement, Rose prit aussitôt sa place et, avec plus de liberté qu’elle n’en montre d’ordinaire, passa les doigts dans la chevelure ébouriffée du garçon.
« Eustache ! Eustache ! dit-elle précipitamment, dis-moi tout – absolument tout. »
Avec lenteur, il se releva. Jusqu’alors, il était resté couché sur le dos.
« Oh, Rose, » murmura-t-il.
Ma curiosité s’éveilla et je m’approchai pour mieux entendre. Pendant ce mouvement, j’aperçus des empreintes laissées par des sabots, dans la terre humide, au pied des arbres.
« Vous avez eu la visite de chèvres, apparemment ? fis-je observer. Je ne croyais pas qu’elles montent brouter jusqu’ici. »
Eustache, avec beaucoup de peine, se leva et vint voir ; quand il aperçut les empreintes, il se roula soudain sur elles, comme fait un chien sur l’ordure.
Alors, un grave silence tomba, qu’interrompit enfin le discours solennel de Mr Sandbach.
« Mes chers amis, dit-il, mieux vaut confesser courageusement la vérité. Je le sais : ce que je vais dire maintenant, c’est ce que, maintenant, vous pensez tous. Le Malin en personne a été proche, très proche de nous, sous une forme corporelle. Le temps peut encore nous révéler quelque œuvre néfaste qu’il aura forgée parmi nous. Mais, pour l’instant, en ce qui me concerne au moins, je veux rendre grâces au Ciel d’une miséricordieuse délivrance. »
Sur quoi, il s’agenouilla et, comme les autres s’agenouillaient, je m’agenouillai aussi, bien que je ne croie pas que le Malin soit autorisé à emprunter une forme visible pour nous donner assaut, ainsi que je le dis un peu plus tard à Mr Sandbach. Eustache vint aussi, assez paisiblement, s’agenouiller entre ses deux tantes, quand elles l’en eurent prié. Mais l’action de grâces terminée, il se leva aussitôt et se mit à chercher on ne sait quoi.
« Ah çà ! Quelqu’un a coupé mon sifflet en deux, dit-il. (J’avais surpris Leyland, un canif à la main – un acte superstitieux que je ne saurais approuver.)
Bon, peu importe, poursuivit le jeune garçon.
– Et pourquoi cela importe-t-il si peu ? demanda Mr Sandbach, qui n’a jamais cessé depuis cet instant de tendre des pièges à Eustache, pour tirer de lui un récit de cette heure mystérieuse.
– Parce que je n’en ai plus besoin.
– Pourquoi ? »
Le garçon répondit par un sourire ; et comme personne ne paraissait avoir plus rien à dire, je partis en toute hâte à travers les bois pêcher un âne quelque part, qui ramenât ma pauvre femme à la maison. Rien de nouveau ne survint pendant mon absence ; Rose ayant demandé une seconde fois à Eustache de lui dire ce qui était arrivé, il avait simplement détourné la tête, sans un mot.
« Pensez-vous que nous trouverons Gennaro ? »
Nous repartîmes tous aussitôt. Eustache marchait avec peine. Il paraissait même souffrir, et ses tantes, aux premiers ânes rencontrés, songèrent à en louer un pour ramener le garçon à l’hôtel. J’ai pour règle de ne jamais intervenir dans les relations familiales : mais, à ce coup, j’opposai mon veto. La suite me justifia pleinement. En effet, un sain exercice, semble-t-il, ne tarda pas à activer, en Eustache, une circulation léthargique et à lui déroidir les muscles. Pour la première fois dans sa vie, il avança d’un pas viril, la tête haute, avec de profondes aspirations qui lui dilataient la poitrine. Satisfait, je fis remarquer à Miss Mary Robinson qu’Eustache mettait enfin un certain orgueil dans son apparence personnelle.
Mr Sandbach soupira ; il faudrait, dit-il, surveiller étroitement Eustache, car aucun d’entre nous ne l’avait encore compris. Miss Mary Robinson, qui se laissait volontiers (trop volontiers, à mon sens) guider par lui, poussa un soupir à son tour.
« Allons, allons, Miss Robinson, lui dis-je, n’ayez pas d’inquiétude au sujet d’Eustache. Le mystère a été pour nous, non pour lui. Notre brusque départ l’a étonné : son attitude étrange, à notre retour, n’a pas d’autre cause. Il me semble tout à fait bien – amélioré, plutôt.
– Appelez-vous amélioration une religion de la gymnastique, un culte de l’automatisme musculaire ? jeta Leyland, en posant son regard élargi de tristesse sur un Eustache à quatre pattes qui escaladait un rocher pour y cueillir des cyclamens. Le désir effréné d’aller dépouiller la nature des rares beautés qu’on lui laisse encore – devons-nous le compter aussi pour une amélioration ? »
On perd son temps à relever de pareilles remarques, et singulièrement quand un artiste raté les avance après s’être meurtri le doigt. Je fis dévier la conversation : qu’allions-nous raconter à la pension ? Dire une vérité inopportune, capable seulement de jeter le trouble et l’angoisse dans l’esprit des auditeurs, constitue une erreur, à mon avis ; Mr Sandbach se rallia à mon opinion, après un long débat où je finis par le convaincre.
Eustache ne prit aucune part à notre conversation. Il courait, comme un vrai garçon, de çà de là, à travers le bois, sur la droite. Un étrange sentiment de honte nous retint de lui parler ouvertement de notre effroi. En fait, il paraissait raisonnable de conclure que l’impression avait été faible sur lui. Nous fûmes donc déconcertés lorsqu’il bondit soudain vers nous, une brassée d’acanthes en fleur sur la poitrine, et criant :
« Pensez-vous qu’à l’hôtel nous trouverons Gennaro tout de suite ? »
Gennaro était le bouche-trou, petit pêcheur impertinent et maladroit, qu’on avait fait monter de Minori pour remplacer, pendant son congé, le sympathique Emmanuele (parlant anglais). Nous lui devions notre déjeuner de rogatons. Pourquoi Eustache désirait-il le voir, sinon pour se gausser avec lui de notre conduite ?
« Bien sûr, il sera là, dit Miss Robinson. Pourquoi cette question, chéri ?
– Oh, j’ai pensé que j’aimerais le voir.
– Et pourquoi ? demanda sèchement Mr Sandbach.
– Parce que… parce que j’aimerais, parce que j’aimerais-rais-rais ! »
Dansant au rythme de ses mots, il plongea dans les bois, maintenant plus sombres.
« Voilà qui est très extraordinaire, dit Mr Sandbach. Aimait-il déjà Gennaro ?
– Gennaro n’est là que depuis deux jours, dit Rose ; ils n’ont pas échangé dix phrases, je le sais. »
De chaque plongée dans le bois, Eustache ressortait plus fou. Il contrefit le chien, puis le Sioux hurlant, fondit sur nous, enfin, surgit avec un lièvre au bras, un lièvre ahuri et cloué de peur. « Il devient chahuteur ! » pensai-je ; nous fûmes donc tous soulagés d’abandonner les bois pour le raidillon et ses escaliers, qui descendent vers Ravello. La nuit commençait à tomber et nous pressions le pas ; Eustache, devant nous, gambadait comme une chèvre.
« La tenue d’Eustache était intolérable. »
Au lieu précis où le raidillon débouche sur une route blanche, survint le nouveau fait extraordinaire de cette extraordinaire journée. Trois vieilles femmes se tenaient debout au bord de la chaussée. Descendues des bois, comme nous, elles avaient posé leurs lourdes charges de branchages sur le parapet de la route. Eustache s’arrêta en face d’elles, puis, après un instant de réflexion, fit un pas en avant… et posa un baiser sur la joue de la femme de gauche !
« Ah çà, mon garçon ! s’écria Mr Sandbach, êtes-vous complètement fou ? »
Eustache ne dit mot, mais offrit à la vieille femme une poignée de ses fleurs et partit en courant.

Comme il n’avait plus fait d’allusion à Gennaro, j’avais cru la chose oubliée. Or nous étions à peine sur la Piazza, devant la cathédrale, qu’Eustache, de sa voix la plus aiguë, hurla : « Gennaro ! Gennaro ! » et piqua au galop dans la ruelle de l’hôtel. Au bout de la ruelle, indubitablement, était Gennaro, ses longs bras et ses longues jambes pointant hors d’un habit, – celui du tout petit Emmanuele (parlant anglais), – mais le chef recouvert d’un ignoble béret de pêcheur ; car sa pauvre patronne avait beau veiller, comme elle le disait fort justement, il s’arrangeait toujours pour inclure dans sa toilette quelque nouvelle incongruité.
Eustache se précipita vers lui et, sautant dans ses bras, lui passa les siens autour du cou.
Par principe, je suis aimable, même avec ceux qui n’en sont guère dignes, mais la tenue d’Eustache était parfaitement intolérable. Cette promiscuité ne pouvait aboutir qu’à des vexations pour nous tous. Je pris à part Miss Robinson. « Permettez-moi, lui dis-je, de parler sérieusement à Eustache sur le genre de relations qu’on doit avoir avec ses inférieurs. » Elle permit, mais je résolus d’attendre pour intervenir que l’excitation de cette journée se fût un peu calmée chez l’absurde garçon. Gennaro, cependant, au lieu d’accueillir les dames américaines, emportait Eustache à son cou, de l’air le plus naturel du monde. Comme il passait auprès de moi, je l’entendis qui disait : « Ho capito. » En italien, « Ho capito » signifie « J’ai compris » ; mais comme Eustache n’avait rien dit lui-même, la valeur de cette remarque m’échappa. Nous n’en fûmes que plus désorientés, et notre compagnie se mit à table, sans force pour rien dire.
Je passe sur nos commentaires variés : si peu méritent d’être cités ! À sept, pendant trois ou quatre heures, nous déversâmes un flot continu d’exclamations, adéquates ou non, pour exprimer notre ahurissement. Entre notre propre conduite au cours de cet après-midi et l’actuel comportement d’Eustache, les uns voyaient un lien, d’autres n’en voyaient pas. Mr Sandbach maintenait sa thèse sur la possibilité d’influences démoniaques ; il conseillait aussi d’appeler un docteur. Leyland, dans notre histoire, dénonçait surtout « le jeune garçon, cet innommable Philistin. » À ma grande surprise, Rose voulut tout excuser. Je n’étais pas loin de croire, au contraire, que ce jeune monsieur avait besoin, surtout, d’une bonne raclée.
Le dîner s’acheva sans incident, malgré la bougeotte d’Eustache et un Gennaro égal à lui-même, qui laissait choir couteaux et cuillers, graillonnait en parlant et se raclait la gorge. Il connaissait à peine deux ou trois mots d’anglais. Pour nous faire servir, nous étions donc réduits à l’italien. Eustache, qui baragouinait un peu, réclama des oranges. Je fus consterné d’entendre Gennaro employer, dans sa réponse, la seconde personne du singulier, dont l’usage suppose à la fois intimité et parité. Eustache avait mérité cette impertinence ; mais l’affront nous atteignait tous. Je résolus d’intervenir.
Quand j’entendis Gennaro desservir la table, je rentrai et, rassemblant mon italien, ou plutôt mon napolitain, je dis :
« Gennaro ! Vous avez employé le « Tu » en parlant à Signor Eustache.
– C’est vrai.
– Vous avez eu tort. Vous devez employer « Lei » ou « Voi » – qui sont des formes plus polies. Et bien que Signor Eustache se conduise parfois sottement, – comme cet après-midi, par exemple, – n’oubliez pas que vous lui devez le respect, car il est un jeune gentleman, et vous n’êtes qu’un pauvre pêcheur. »
Si j’avais fait pareille remarque à un honnête citoyen anglais, j’aurais immédiatement reçu son poing dans l’œil, mais ces pauvres Italiens n’ont point d’orgueil. Gennaro se contenta de soupirer :
« C’est vrai.
– Parfaitement, » dis-je, en me détournant pour partir. Seulement, à ma grande indignation, il ajouta : « Mais quelquefois, c’est sans importance. »
Sur quoi, empoignant son plateau de vaisselle, il galopa hors de la pièce, et et j’entendis deux verres de plus atterrir sur le dallage de la cour.
Assez furieux, je m’en fus à grands pas interroger Eustache. Il était allé se coucher. La propriétaire, à qui je désirais aussi dire deux mots, était occupée. Après un nouvel et vague échange d’étonnements, exprimés cette fois à mots couverts, à cause de Jeannette et des deux dames américaines, nous montâmes tous nous coucher, comme Eustache, après cette journée aussi épuisante qu’extraordinaire.
« Je ne peux déchiffrer les hommes. »
J’avais dormi, je suppose, quatre heures quand je m’éveillai brusquement. Je crus entendre un bruit dans le jardin. Avant même d’ouvrir les yeux, je fus saisi par une peur horrible et froide – la peur, non point de ce qui arrivait (comme dans le bois), mais de ce qui pourrait arriver.
Notre chambre, au premier étage, donnait sur le jardin – ou la terrasse, – éperon massif, en forme de coin, couvert de rosiers et de treilles, et coupé en tous sens par des sentiers d’asphalte. La maison bordait la base. Sur ses deux longs côtés, courait un parapet d’un mètre à peine intérieurement, mais, à l’extérieur, de six bons mètres au-dessus de l’oliveraie, la pente du terrain étant des plus rapides.
Frissonnant de la tête aux pieds, je me glissai vers la fenêtre. Sur les sentiers d’asphalte, – là, – trottinait une forme blanche. La peur m’empêchait de voir clair, et, à la vague lueur des étoiles, cette forme prenait toutes sortes d’aspects – grand chien, énorme chauve-souris blanche, nuage emporté par un vent rapide. Elle sautait comme une balle, ou voletait comme un oiseau, ou glissait avec la lenteur d’un spectre. Aucun bruit – sinon ce trottinement, qui devait être, en somme, celui de pieds humains. Enfin, l’explication évidente s’imposa au désordre de mon esprit : Eustache était sorti de son lit ; les choses allaient encore se gâter.
Je m’habillai en hâte et descendis dans la salle à manger, qui donnait sur la terrasse. Quelqu’un en avait ouvert la porte. Ma terreur s’était presque dissipée, mais pendant cinq bonnes minutes je luttai contre une vague couardise : pourquoi ne pas demeurer spectateur, ne pas laisser le pauvre, l’étrange garçon poursuivre ses trottinements de spectre et veiller seulement derrière la fenêtre, pour qu’il ne lui arrive point de mal ?
De meilleurs sentiments l’emportèrent ; j’ouvris et j’appelai :
« Eustache ! Que faites-vous là ? Rentrez immédiatement. »
Il arrêta ses gambades.
« Je déteste ma chambre, dit-il. Impossible d’y rester ; elle est trop petite.
– Allons, allons, assez de simagrées ! Vous ne vous êtes jamais plaint de votre chambre.
– Je ne puis rien y regarder, d’ailleurs – ni fleurs, ni feuilles, ni ciel, rien qu’un mur de pierre. »
La chambre d’Eustache avait, à coup sûr, peu de vue ; mais, encore une fois, s’en était-il plaint auparavant ?
« Eustache, vous parlez comme un enfant. Rentrez. Obéissez immédiatement, je vous prie. »
Il ne bougea pas.
« Très bien : je vous ferai rentrer par force, » dis-je ; et je fis quelques pas dans sa direction. Mais il est vain de vouloir poursuivre un garçon dans un labyrinthe d’allées goudronnées ; renonçant à cette chimère, je rentrai, au contraire, pour appeler Mr Sandbach et Leyland à mon aide.
Quand je revins en leur compagnie, Eustache se montra plus impossible que jamais. Refusant même de nous répondre, il se mit à chanter et à bavarder pour lui-même de la façon la plus inquiétante.
« La parole est au médecin, maintenant, » dit Mr Sandbach, en se tapotant gravement le front.
Eustache avait cessé de courir pour chanter, à voix basse d’abord, puis forte : exercices pour les cinq doigts, gammes, hymnes ou bribes de Wagner – il chantait tout ce qui lui passait par la tête. Sa voix, fort peu harmonieuse, devint de plus en plus puissante. Enfin, Eustache fit éclater un cri prodigieux, qui se répercuta comme une détonation dans les montagnes, réveillant tous ceux qui dormaient encore dans l’hôtel. Ma pauvre femme et mes deux filles apparurent à leurs fenêtres respectives et l’on entendit résonner vigoureusement le timbre des deux dames américaines.
Nous appelâmes tous :
« Eustache ! Arrêtez, arrêtez, cher enfant ! Rentrez dans la maison. »
Il secoua la tête et repartit – en parlant, cette fois. Jamais discours plus extraordinaire. Il eût été grotesque en toute autre circonstance. Ce garçon, en effet, dénué de sens esthétique et puérilement gauche dans ses expressions, s’attaquait à des thèmes que les plus grands poètes ont jugé presque au-dessus de leurs forces. Eustache Robinson, âgé de quatorze ans, debout en chemise de nuit, saluait, louait, bénissait les grandes forces et les manifestations de la Nature.
Il évoqua d’abord la nuit, les étoiles et les planètes au-dessus de sa tête, puis les essaims de lucioles à ses pieds ; il évoqua la mer invisible, derrière le rideau de lucioles, et, dans les profondeurs de la mer invisible, les rochers qui dormaient, couverts d’anémones et de coquillages. Il évoqua les fleuves, les cascades, les grappes mûrissantes, le cône fumant du Vésuve et les secrètes galeries de feu d’où cette fumée s’échappait, les myriades de lézards tors dans les fissures d’une terre étouffante, et les averses de blancs pétales que les roses, à cet instant même, faisaient pleuvoir sur ses cheveux. Enfin, il évoqua la pluie, le vent, par qui tout change, l’air grâce à qui tout vit, les bois au sein de qui tout peut être caché.
L’ensemble était naturellement prétentieux jusqu’à l’absurde ; j’aurais volontiers giflé Leyland pour le jugement qu’il porta à haute voix : « Une caricature diabolique de tout ce qui existe de beau et de saint en ce monde. »
« Et puis… poursuivit Eustache dans le pitoyable style macaronique qui était son seul mode d’expression… et puis, il y a les hommes, mais je ne peux pas les déchiffrer aussi bien. »
S’agenouillant devant le parapet, il posa la tête sur ses bras.
« C’est le moment, » murmura Leyland.
Je déteste la ruse. Au pas de course, nous tentâmes pourtant de surprendre le jeune garçon par derrière. Il nous échappa d’un bond, mais se tourna presque aussitôt pour nous regarder. À la faible lumière des étoiles, il me sembla voir qu’il pleurait. Leyland fonça de nouveau vers lui, et nous essayâmes de le cerner parmi les sentiers d’asphalte sans la moindre apparence de succès.
Déconfits, hors d’haleine, il fallut retourner, laissant Eustache à sa folie, dans l’extrême pointe de la terrasse. Ma Rose, cependant, eut une inspiration.
« Papa, cria-t-elle de sa fenêtre, si l’on appelait Gennaro ? »
Je n’avais nulle envie de demander une faveur à l’Italien, mais puisque la propriétaire venait à son tour d’apparaître, je la priai d’agir avec autorité pour que Gennaro, émergeant de la charbonnière où il dormait, fit au moins une tentative.
Elle revint bientôt, suivie peu de temps après par Gennaro, vêtu d’un frac – sans gilet, chemise ou tricot – et d’un prétendu pantalon, en lambeaux, coupé au-dessus du genou pour mieux patauger dans la mer.
Je dis aussitôt d’une voix forte :
« Les tantes de Signor Eustache vous demandent de le ramener. »
Il ne répondit pas.
« Entendez-vous ? Eustache n’est pas bien. Je vous ordonne de le ramener dans la maison.
– Va le chercher ! Va le chercher ! dit la Signora Scafetti, en le secouant rudement par le bras.
– Eustazio est bien où il est.
– Va le chercher ! Va le chercher ! » hurla la Signora Scafetti.
L’échange de vociférations et de cris se prolongea dix bonnes minutes ; après quoi, Gennaro partit brusquement réintégrer sa charbonnière, tandis que la Signora Scafetti fondait en larmes, car ses hôtes anglais lui étaient précieux.
« Il dit que le Signor Eustache est bien où il est, reprit-elle en sanglotant, et qu’il n’ira pas le chercher. Je ne puis faire davantage. »
Mais je le pouvais, moi, ayant appris à connaître un peu le monde. Je rejoignis M. Gennaro en son lieu de repos et le découvris qui se recouchait sur un sac immonde.
« Je voudrais que vous me rameniez Signor Eustache, » commençai-je.
Il me jeta au visage une réponse inintelligible.
« Si vous le ramenez, je vous donne ceci. » (et je sortis de ma poche un billet de dix lires neuf.)
Cette fois, il ne répondit rien.
« Ce billet vaut dix lires en argent, ajoutai-je.
– Je sais. D’ailleurs, vous ne me le donneriez pas.
– Je suis Anglais. Les Anglais tiennent toujours leurs promesses.
– C’est vrai. »
Il est admirable de voir la confiance que met en nous l’étranger. Elle dépasse même celle que nous nous accordons entre nous. Gennaro se mit à genoux sur son sac. L’ombre ne me permettait pas de voir son visage, mais je percevais les bouffées d’une haleine chaude et parfumée d’ail. Je connus donc que l’éternelle avarice du Sud l’avait saisi.
« Je ne pourrai pas ramener Eustazio à la maison. Il y mourrait peut-être.
– Ce n’est pas nécessaire, dis-je patiemment. Il suffit que vous me l’ameniez, et je serai, moi, dans le jardin. »
Comme si cette réserve avait modifié quelque chose, le lamentable garçon accepta.
« Mais donnez-moi d’abord les dix lires.
– Non. (Je savais à qui j’avais affaire : traître une fois, toujours traître.)
« Au lieu de mourir, il vivra. »
Nous revînmes sur la terrasse. Gennaro, sans un mot, trotta vers le trottinement qu’on entendait à l’autre extrémité. Nous écartant un peu de la maison, Mr Sandbach, Leyland et moi-même nous nous postâmes dans l’ombre du rosier grimpant aux roses blanches.
On entendit appeler « Eustazio ! » et l’appel fut suivi par d’absurdes cris de joie. Les bruits de pas cessèrent ; on entendit une conversation. Les voix s’approchèrent et, soudain, je pus distinguer, à travers les branches, la silhouette grotesque du jeune homme et celle, plus petite et plus mince, du garçon en longue chemise blanche. Gennaro avait passé le bras autour du cou de son compagnon, qui bavardait dans son italien négligé et coulant.
« Je comprends presque tout, entendis-je. Arbres, eau, collines, étoiles – tout est clair. Mais c’est drôle, n’est-ce pas ? Les hommes ne sont pas clairs du tout. Tu me comprends ?
– Ho capito, » dit gravement Gennaro ; et son bras quitta l’épaule d’Eustache.
Cependant, je froissais le billet neuf dans ma poche, et il l’entendit. Il lança brusquement la main en avant. Eustache, sans soupçon, la serra dans la sienne.
« C’est drôle ! poursuivit Eustache (ils étaient maintenant tout près). On dirait presque… presque… »
Je bondis et je le saisis par un bras. Leyland empoigna l’autre bras et Mr Sandbach lui entoura les jambes. Il se mit à pousser des cris aigus, qui vous déchiraient le cœur ; et les roses blanches, qui, cette année-là, s’effeuillaient tôt, firent pleuvoir sur lui des averses de pétales, tandis que nous le traînions jusque dans la maison.
Aussitôt passé le seuil, il cessa de crier ; mais des flots de larmes jaillirent silencieusement de ses yeux.
« Pas dans ma chambre, implora-t-il ; elle est trop petite. »
Son regard, infiniment douloureux, m’emplit d’une pitié étrange, mais que pouvais-je faire ? D’ailleurs, sa fenêtre était la seule munie de barreaux.
« N’ayez crainte, cher enfant, dit le doux Mr Sandbach. Je vous tiendrai compagnie jusqu’au matin. »
À ces mots, les efforts d’Eustache pour fuir reprirent convulsivement.
« Oh ! pas cela, je vous en prie. Tout, mais pas cela. Je promets de rester couché sans pleurer, si je puis m’en empêcher, pourvu qu’on me laisse seul. »
L’ayant donc déposé sur le lit et bordé, nous le laissâmes secoué de sanglots et disant :
« Je voyais presque tout ; maintenant, je ne vois plus rien. »
Les Misses Robinson une fois informées, nous redescendîmes dans la salle à manger : Signora Scafetti et Gennaro s’y entretenaient à voix basse. Mr Sandbach, ayant pris papier et plume, se mit à écrire au médecin anglais de Naples. Pour ma part, je sortis de ma poche le billet de dix lires et le jetai sur la table devant Gennaro.
« Voilà votre salaire, dis-je sévèrement, car je songeais aux trente deniers d’argent.
– Merci beaucoup, Monsieur, » dit Gennaro, en raflant le billet.
Il allait partir lorsque Leyland, dont les curiosités étaient aussi hors de propos que les indifférences, lui demanda ce que signifiait la parole d’Eustache : « Les hommes ne sont pas clairs du tout. »
« Je ne sais pas ; Signor Eustazio (je notai au passage, non sans plaisir, cette déférence tardive), il a l’esprit subtil. Il comprend bien des choses.
– Mais vous avez dit que vous compreniez, insista Leyland.
– Je comprends, mais je ne peux pas expliquer. Je ne suis qu’un pauvre pêcheur. Écoutez pourtant ; je vais essayer. »
Je perçus avec inquiétude un changement dans ses manières et je tentai de l’arrêter. Mais il s’était assis sur le bord de la table et se lançait dans une suite de remarques incohérentes.
« C’est triste, fit-il observer enfin. Ce qui vient d’arriver est bien triste. Mais qu’y puis-je ? Je suis pauvre. Ce n’est pas moi. »
Je me détournai avec mépris. Leyland poursuivit ses questions. Qui donc visaient les paroles d’Eustache ?
« Cette réponse-là est facile, dit gravement Gennaro. C’est vous, c’est moi. C’est tout le monde dans cette maison et beaucoup d’hommes en dehors. S’il a de la gaieté, nous la lui ôtons. S’il désire être seul, nous le gênons. Il rêvait d’un ami et n’en a point trouvé pendant quinze ans. Enfin, il me trouve et, dès le premier soir, – moi qui suis allé dans les bois, moi qui ai compris aussi bien des choses, – je le trahis, je vous le livre pour que vous l’enfermiez et pour qu’il meure. Mais que pouvais-je faire ?
– Doucement, doucement, dis-je.
– Oh ! il mourra, c’est sûr. Il va rester couché toute la nuit dans la petite chambre, et au matin il sera mort. C’est tout à fait certain.
– Bon, cela suffit, dit Mr Sandbach. Je passerai la nuit à son chevet.
– Filoména Giusti a passé la nuit au chevet de Caterina, mais, au matin, Caterina était morte. Ils n’ont pas voulu la laisser sortir ; j’ai eu beau prier, supplier, jurer, taper à la porte, grimper au mur. Ils étaient ignorants et hôtes. Ils croyaient que je voulais l’enlever. Et, au matin, elle était morte.
– Quelle est cette histoire ? » demandai-je à Signora Scafetti.
À cet instant, de la chambre d’Eustache, un cri nous parvint – c’était un bruit faible mais continu, comme celui du vent qu’on perçoit dans un bois lointain, quand on est soi-même dans le silence.
« Voilà, dit Gennaro, la dernière plainte de Caterina. J’étais accroché à sa fenêtre et la plainte a frôlé mon oreille. »
Puis, levant une main soigneusement close sur mon billet neuf de dix lires, il maudit solennellement Mr Sandbach, et Leyland, et moi-même, et la Destinée parce qu’Eustache mourait dans la chambre du haut. Ainsi fonctionnent les cerveaux du Sud ; et je suis persuadé que Gennaro, même alors, n’eût pas fait un pas si Leyland, cet inconcevable idiot, n’avait pas heurté la lampe du coude. C’était une lampe brevetée, qui s’éteignait automatiquement et que Signora Scafetti avait achetée sur ma demande pour remplacer l’engin dangereux dont elle s’était servie jusque-là. Elle s’éteignit en effet ; et le simple changement physique de la lumière à la nuit agit plus efficacement sur la nature animale de Gennaro que tous les impératifs les plus indiscutables de la logique et de la raison.
Je ne vis pas, mais je sentis qu’il avait quitté la pièce et je criai à Mr Sandbach :
« Avez-vous la clef d’Eustache dans la poche ? »
Mais Mr Sandbach et Leyland gisaient tous deux sur le parquet, chacun ayant pris l’autre pour Gennaro, et l’on perdit encore un temps précieux à chercher une allumette. Mr Sandbach eut à peine le temps de dire qu’il avait laissé la clef à la porte, pour le cas où les Misses Robinson auraient voulu voir l’enfant, déjà un pas descendait l’escalier et Gennaro parut, portant Eustache.
Nous nous ruâmes pour barrer la sortie. Le courage leur manqua et ils battirent en retraite vers le premier étage.
« Les voilà pris, cria la Signora Scafetti. Il n’y a pas d’autre issue. »
Nous montions l’escalier avec précaution lorsqu’un hurlement terrifiant éclata dans la chambre de ma femme, suivi par le bruit mou d’une lourde chute sur l’asphalte de l’allée. Ils venaient de sauter par cette fenêtre.
J’atteignis la terrasse juste à temps pour voir Eustache bondir par-dessus le parapet du jardin. Cette fois, nous allions le trouver mort, j’en étais sûr. Mais un olivier l’arrêta. Il s’y posa comme un grand phalène blanc et glissa de là jusqu’au sol. Dès que ses pieds nus touchèrent les mottes de terre, il poussa un étrange cri, que j’aurais cru hors du registre de la voix humaine, et disparut parmi les arbres du verger.
« Il a compris ; il est sauvé, dit Gennaro, toujours assis au milieu de l’allée. Maintenant, au lieu de mourir, il vivra.
– Et vous, au lieu de garder les dix lires, vous allez me les rendre, répliquai-je, incapable de me contenir après sa tirade.
– Les dix lires sont à moi, » répondit-il d’une voix sifflante et à peine audible. Il joignit les mains sur sa poitrine pour protéger son bien mal acquis, oscilla en faisant ce geste et tomba, la face en avant. On ne sait quoi s’était cassé en lui, et il était mort.
Le vent de l’aube se leva, bien qu’elle fût lointaine encore, et de nouveau une pluie de pétales tomba sur nous quand nous portâmes Gennaro à l’intérieur. À la vue du cadavre, la Signora Scafetti éclata en lamentations, cependant que, très loin dans la vallée, du côté de la mer, résonnaient toujours les éclats de rire et les cris du garçon qui s’échappait.
–––––
(E. M. Forster, traduit de l’anglais par Charles Mauron, in Le Figaro littéraire, septième année, n° 304, samedi 16 février 1952 ; les dessins d’Élie Grékoff sont extraits de la publication. La nouvelle d’E. M. Forster, « The Story of a Panic, » est parue dans The Independent Review, volume III, août 1904 ; elle a été reprise en volume dans le recueil The Celestial Omnibus and Other Stories, London: Sidgwick & Jackson Ltd., 1911)