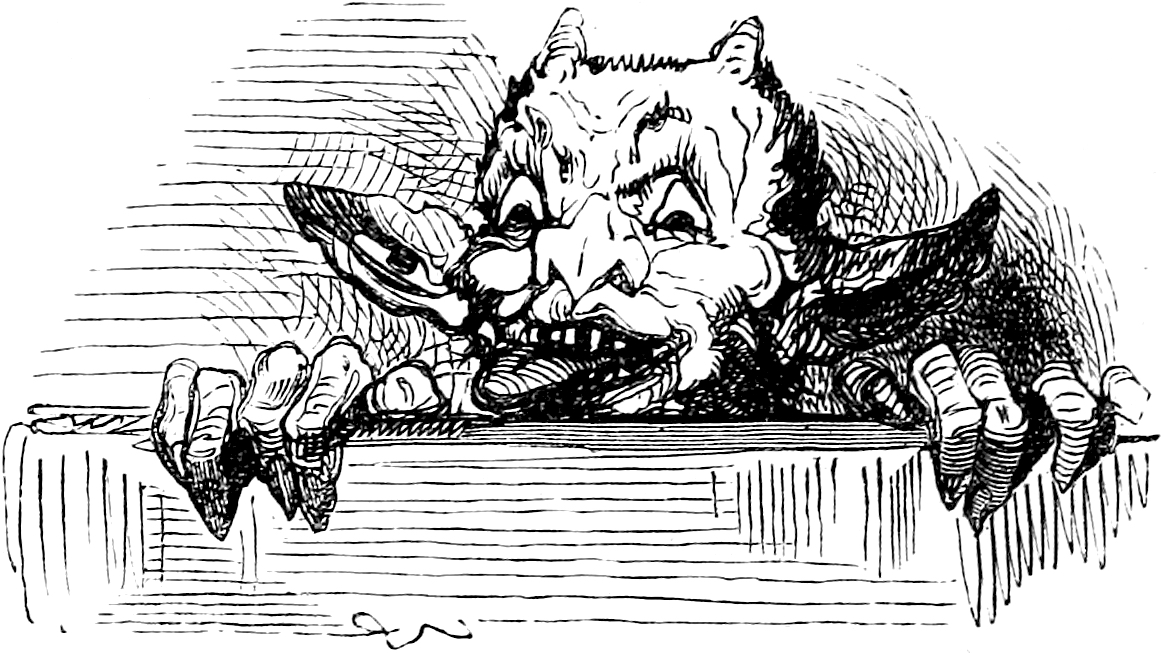I
Il y a une quinzaine d’années, au cours d’un long voyage en Italie, je dus m’arrêter pendant quelques mois à Florence, pour des recherches historiques, et je profitai des nombreux loisirs qui m’étaient laissés pour visiter à fond la ville, m’imprégner d’elle tout entier, et vivre un peu de sa vie.
Ce fut pour moi une suite de jours délicieux : les plus pures joies d’art que j’aie goûtées peut-être, au cours de mes multiples vagabondages.
Aussitôt installé, je divisai mon temps en deux parties : l’une – fort courte – consacrée au travail ; l’autre – la plus longue possible – employée à errer a travers la ville.
Et ma vie s’organisa.
Florence !
Ce nom n’évoque que des visions douces.
Ce sont les clairs soirs de mélancolie apaisante ; les eaux tranquilles de l’Arno rose, les tours de marbre sur le ciel d’or, les piazzas toutes pleines de soleil ; la lourde silhouette du dôme sombre, près de celle, fine et blanche, du Campanile ; la colline bleue de San Miniato ; puis la foule colorée et chantante, les lazaroni nonchalants allongés sur les marches de la Loggia de Lanzi ; les fleurs, la musique, les souvenirs, la poésie des vieilles pierres, toute la grâce intime et grave de cette cité mystérieuse, patrie de Dante, de Michel-Ange et du Fra Angelico.
À la parcourir en flâneries perpétuelles, j’eus bientôt fait de la fort bien connaître.
Et j’eus bientôt fait aussi d’y être connu.
Car le bruit s’était répandu que j’y venais pour faire de grandioses achats d’œuvres d’art – ce qui était vrai à moitié – et ce fut alors chez moi, au bout de peu de temps, un véritable défilé.
Tous les marchands antiquaires de Florence crurent devoir venir me faire leurs offres de services. Et les particuliers suivirent !
Il ne fut plus un Florentin ayant chez lui quelque peinture ou quelque statuette, méchante copie des Offices, qui ne vînt à mon « palazzo » briguer l’honneur de voir cette merveille s’en aller dans les musées de la France.
Les faux Luca della Robbia et les Léonard de Vinci apocryphes s’alignèrent dorénavant sur les banquettes de mon antichambre, soutenus précieusement par des mains inquiètes.
Je me résignai, – car j’ai l’habitude.
Aussi bien, il n’y a pas de vraies recherches possibles sans cela.
Je désignai seulement certaines heures de « réception, » en dehors desquelles, était-on prévenu, il n’y avait aucun espoir de me trouver.
Et tout sembla devoir marcher sans incident.
*
Cet état de choses durait depuis quelques semaines déjà lorsqu’un après-midi, pendant que je travaillais dans mon cabinet, le cameriere vint me prévenir qu’un visiteur « du même genre que les autres » me faisait supplier de le recevoir tout de suite ; il n’avait absolument pu venir le matin ; le jour suivant, je ne recevais pas ; il y avait urgence.
D’assez fort méchante humeur, je répondis qu’on le priât d’attendre. Et, mon travail ayant été interrompu à un mauvais endroit, je m’y remettais pour quelques minutes, lorsque le domestique entra de nouveau : le « signore, » en s’excusant, insistait pour me voir sans tarder.
Cette fois, la surprise l’emporta.
Je me fis répéter le nom : Ambrosio Pesarini.
Il ne me disait rien. Qu’était donc ce visiteur exigeant ? Le valet se trompait peut-être après tout, et ce pouvait être quelque personnage.
Je priai donc de l’introduire de suite.
Et il entra.
Jamais je n’oublierai cette minute.
C’était un vieillard assez grand, large et droit, d’une beauté éclatante. Une tête toute de noblesse et d’intelligence, avec le vaste front calme comme nimbé d’immensité, les yeux aux paupières lourdes, yeux de rêve, de douceur et d’énergie à la fois ; les lèvres nettes, la barbe tombant en boucles blanches, le corps svelte et d’une ligne admirable.
Il était vêtu d’un costume étrange, qui était par la forme, mais en étoffes modernes, celui des artisans italiens de la Renaissance : le pourpoint brun très long à plis droits serré à la taille, avec les manches à gigot ; une ceinture de cuir, des culottes assez larges et courtes rappelant le haut-de-chausse, des bas de laine grise moulant la jambe fine.
Il se dégageait de cet homme une impression de majesté telle que, jusque-là, je ne l’avais jamais éprouvée qu’en rêve, et qui me donna aussitôt – comment rendre avec des mots une chose aussi vague ? – le sentiment de mon évidente infériorité.
Je m’étais levé stupéfait, contemplant cette apparition. Et je vis alors, après quelques secondes, ce que le premier coup d’œil ne m’avait pu révéler : l’homme tremblait de tous ses membres ; son visage tendu vers moi était empreint d’une supplication éperdue ; ses yeux se noyaient dans une sorte de buée ; ses lèvres, comme dans l’angoisse, battaient d’un mouvement nerveux qui l’empêcha un instant de parler.
Je m’avançai en proie à une émotion que je ne saurais dire, et mon regard, sans doute, exprima tout de suite l’intérêt bienveillant, car l’inconnu me remercia d’un mouvement de la tête, et fit, à son tour, quelques pas en avant.
Il y a des impressions qui ne trompent pas. J’eus le très net sentiment qu’il y avait là quelque terrible Douleur, et que je la soulagerais peut-être ; et qu’en tout cas, je devais savoir…
Je désignai donc une chaise sur laquelle le vieillard s’assit ; et, jugeant qu’une situation aussi bizarre avait assez duré, je lui demandai ce qui me valait l’honneur de sa visite.
« Monsieur, me répondit-il, vous me pardonnerez, j’en suis sûr, cette démarche. Je suis un inconnu pour vous : Ambrosio Pesarini. Voici ce qui m’amène. »
Il s’arrêta pour reprendre haleine. La voix était chantante et grave, d’un timbre prenant, doux et ferme. Elle tremblait un peu, car il faisait de visibles efforts pour dissimuler son douloureux trouble. Le français était des plus purs, avec le roulement léger d’un accent italien à peine indiqué, tout de nuances.
Je m’inclinai sans rien dire, en signe d’attention.
Il reprit :
« Monsieur, je sais que vous recherchez les chef-d’œuvres de l’Art florentin de toutes les époques. Je crois avoir un spécimen qui vous intéressera et que certainement vous voudrez posséder. Je n’ignore pas la multiplicité des offres qui vous sont faites ; je n’ignore pas les qualités vraiment exceptionnelles que vous exigez. Je suis sûr, monsieur, je le répète, que l’objet que je vous propose gagnera votre admiration. Et je vous demande seulement de bien vouloir l’examiner. »
Ma surprise allait croissant.
Une foule de questions se pressaient sur mes lèvres, en se heurtant les unes les autres.
Quel était donc cet homme-là, si grand et si noble, qui tout à coup s’exprimait comme un vulgaire commerçant ? – Qu’y avait-il, derrière cette émotion poignante, qui se muait soudain en une requête presque ridicule ? – Pourquoi cette mise en scène pour proposer un bibelot ? – Pourquoi, surtout, cette insistance à vouloir être reçu le jour même ? – Fallait-il lui en demander compte, ou attendre plutôt qu’il voulût bien s’expliquer ?
Quel était-il, celui-là ? Et pourrais-je découvrir son secret ?…
À l’œuvre d’art, je ne croyais guère : j’en entendais tant chaque jour ! J’en avais tant entendu le matin même encore !…
Mais ma conduite était en somme toute tracée. Que pouvais-je faire de plus ou de moins que de lui dire :
« Monsieur, je ne demande pas mieux que de voir rapidement l’objet en question. »
Et comme il remerciait d’un nouveau geste :
« L’avez-vous ici, monsieur, ou bien devons-nous convenir d’un rendez-vous ?
– Je l’ai apporté avec moi, me dit-il en se levant, et l’ai déposé dans le corridor. »
Je sonnai le domestique et le priai d’aller chercher le paquet.
Il revint avec un petit sac de cuir, le remit au visiteur et sortit.
J’attendais en silence.
Ce fut rapide.
Le vieillard déboucla une courroie, souleva deux agrafes, ouvrit le sac, et posa sur le coin de ma table une petite aiguière en or.
« Voilà, » fit-il simplement.
Je la pris.
Et, tout de suite, quelque chose d’indéfinissable se passa en moi, fit glisser sous ma peau ce frisson bizarre et si chaud qui n’est peut-être que le brusque arrachement de notre pensée s’envolant loin de tout – dans le rêve.
Pesarini avait dit vrai ; je tenais là un chef-d’œuvre !
Courte et fine, d’un galbe exquis, l’aiguière était entièrement ciselée de petites figures en haut relief représentant des scènes mythologiques, et encadrées de guirlandes des fleurs et de fruits, dans la manière des grands orfèvres du quinzième et du seizième siècles. Jamais Benvenuto Cellini n’avait été plus fin ; jamais Caradosso n’avait été plus grand ! C’était la sublime perfection de la main au service du plus sublime des génies !
Je tenais entre mes doigts le divin objet ! Et mes mains se mettaient à trembler à leur tour.
(À suivre)
–––––
(Paul Heuzé, in Journal des débats politiques et littéraires, cent dix-septième année, n° 92, lundi 3 avril 1905 ; in Annales africaines, revue politique et littéraire de l’Afrique du Nord, trente-cinquième année, nouvelle série, n° 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, vendredis 6, 13, 20 juillet, 3, 10, 17 et 24 août 1923 ; in Le Petit Méridional, journal républicain quotidien, n° 17474, 17475, 17477, 17478 et 17480, mardi 29, mercredi 30 janvier, vendredi 1er, samedi 2 et lundi 4 février 1924. Cette nouvelle a été reprise en volume dans le recueil éponyme, Paris : Jean Bosc & Cie, 1907 ; elle a également fait l’objet, semble-t-il, d’une édition illustrée séparée en 1924, à l’Édition artistique. William Fettes Douglas, « Benvenuto Cellini selling Plate, » huile sur toile, 1856)