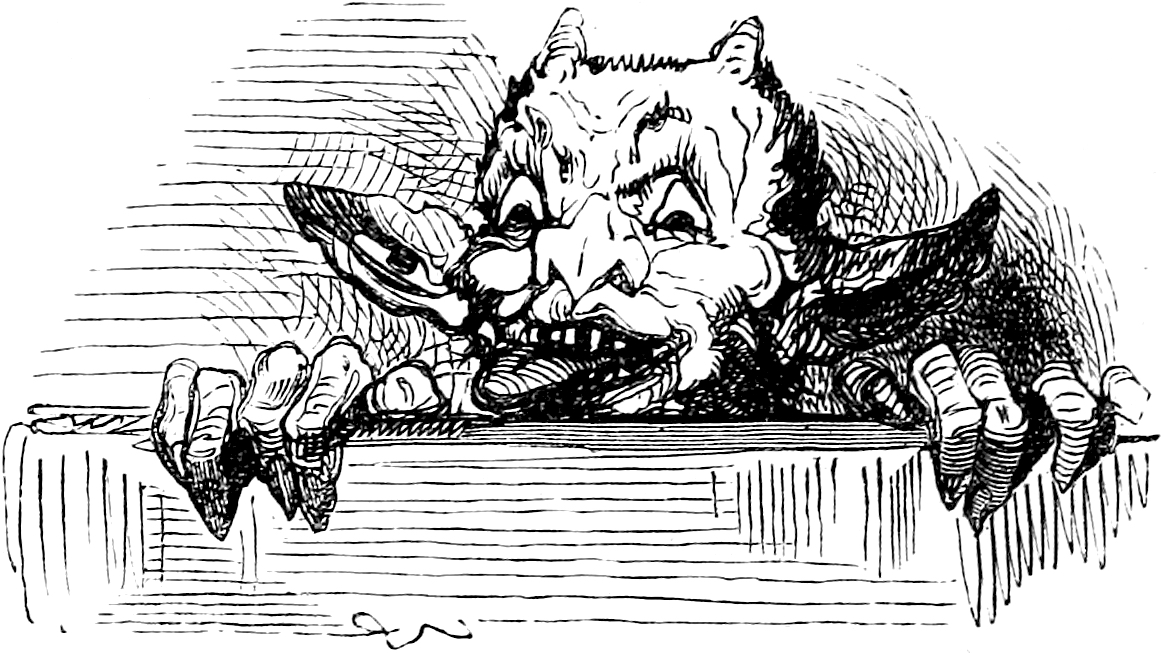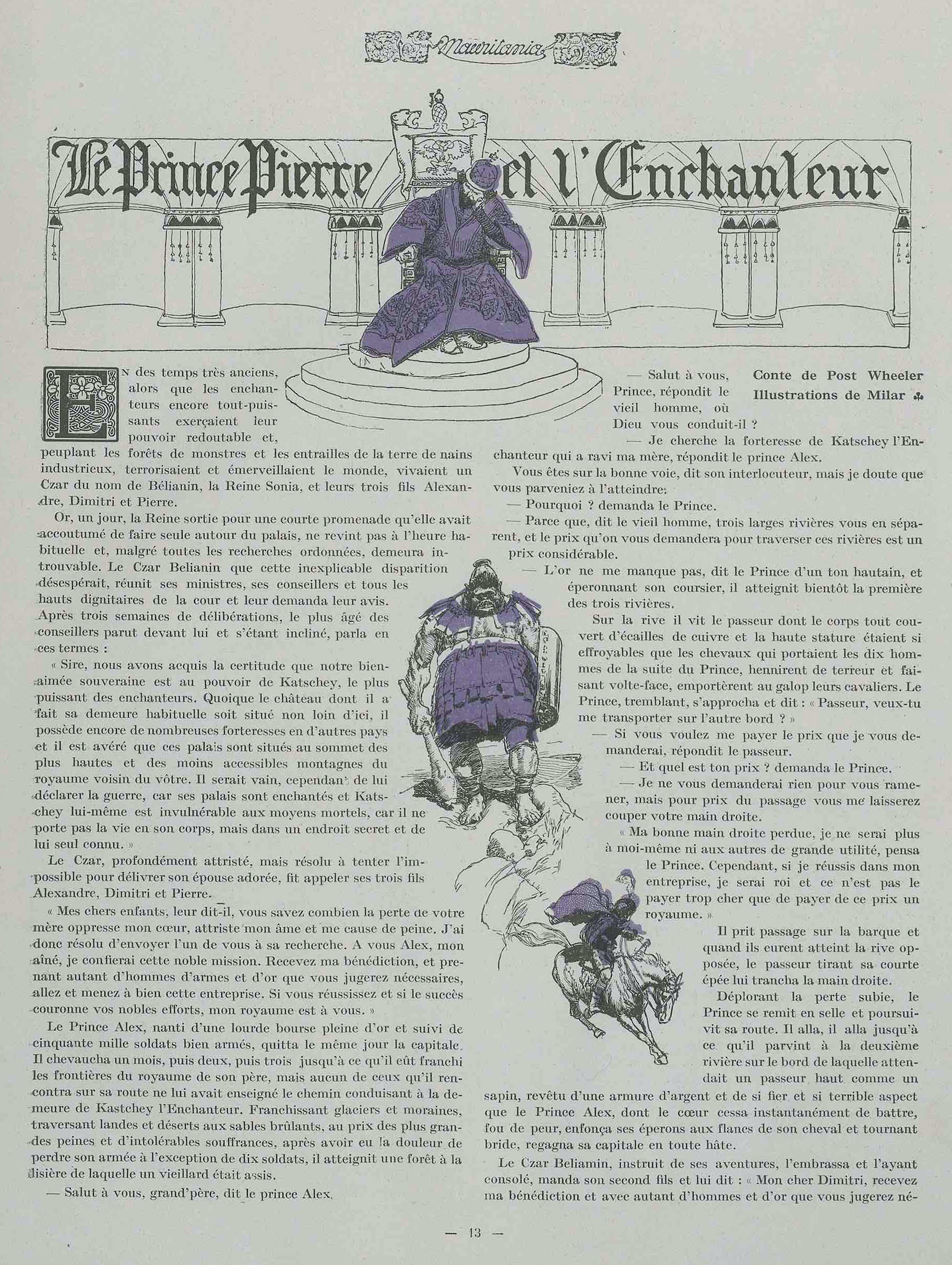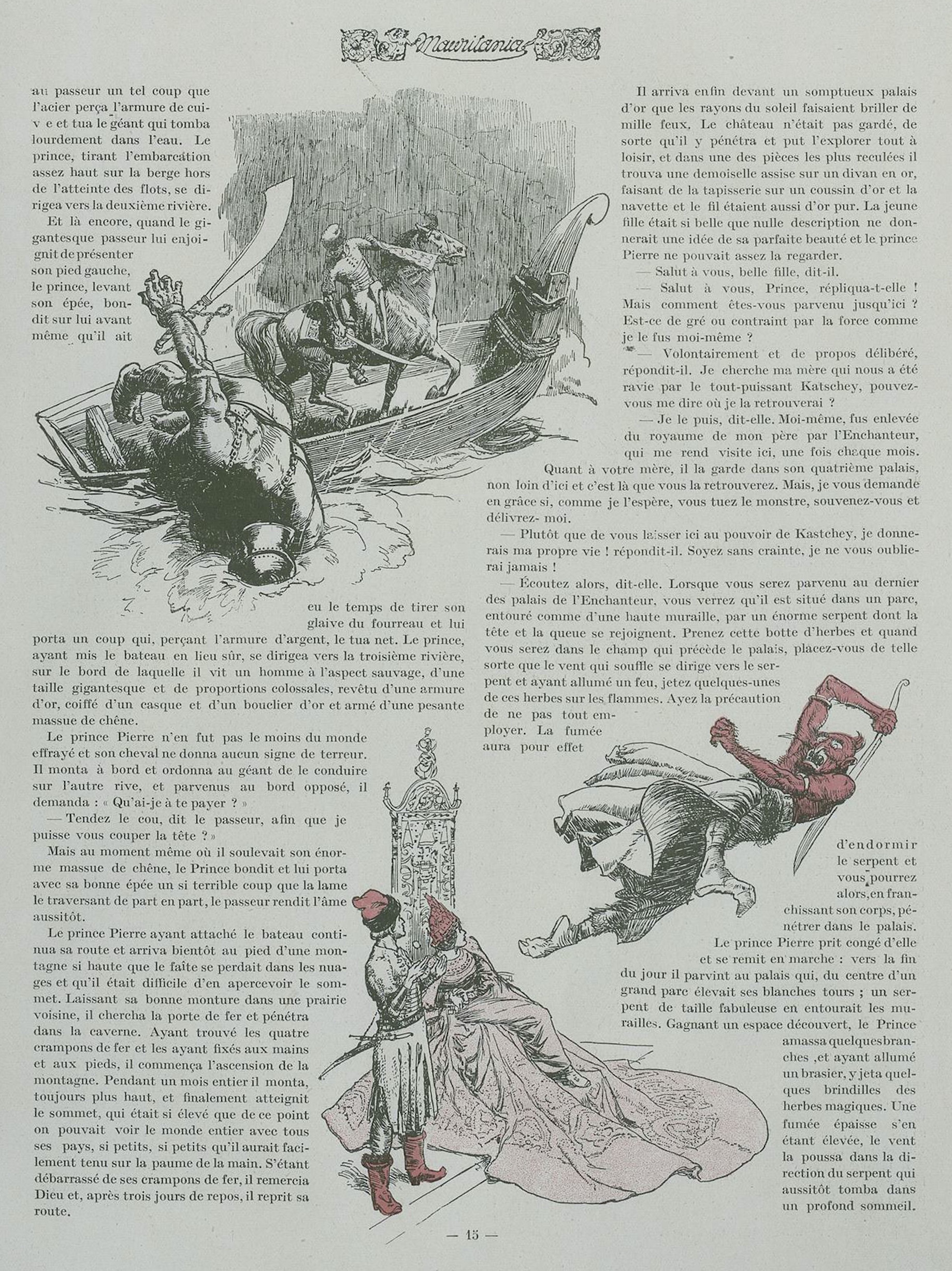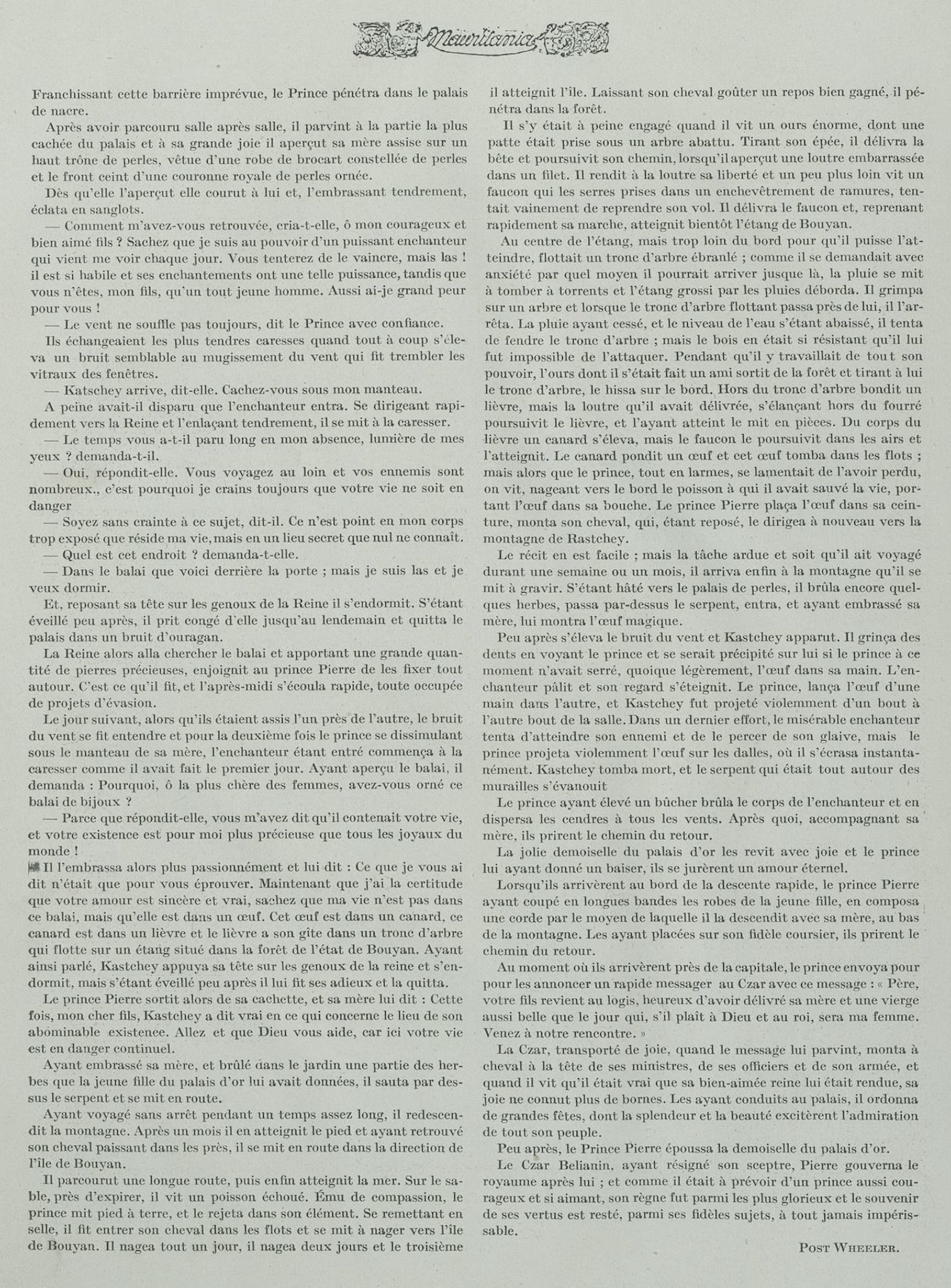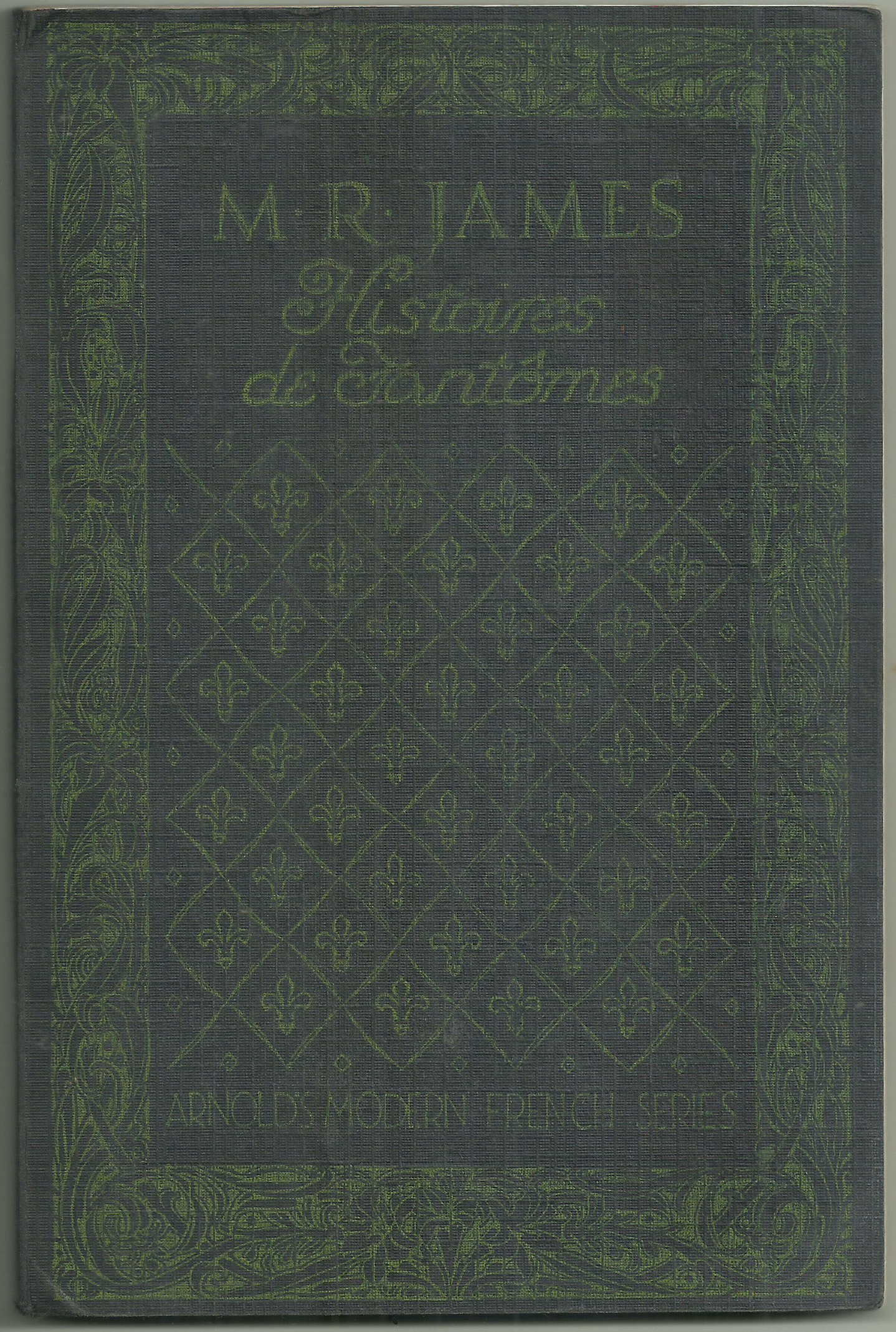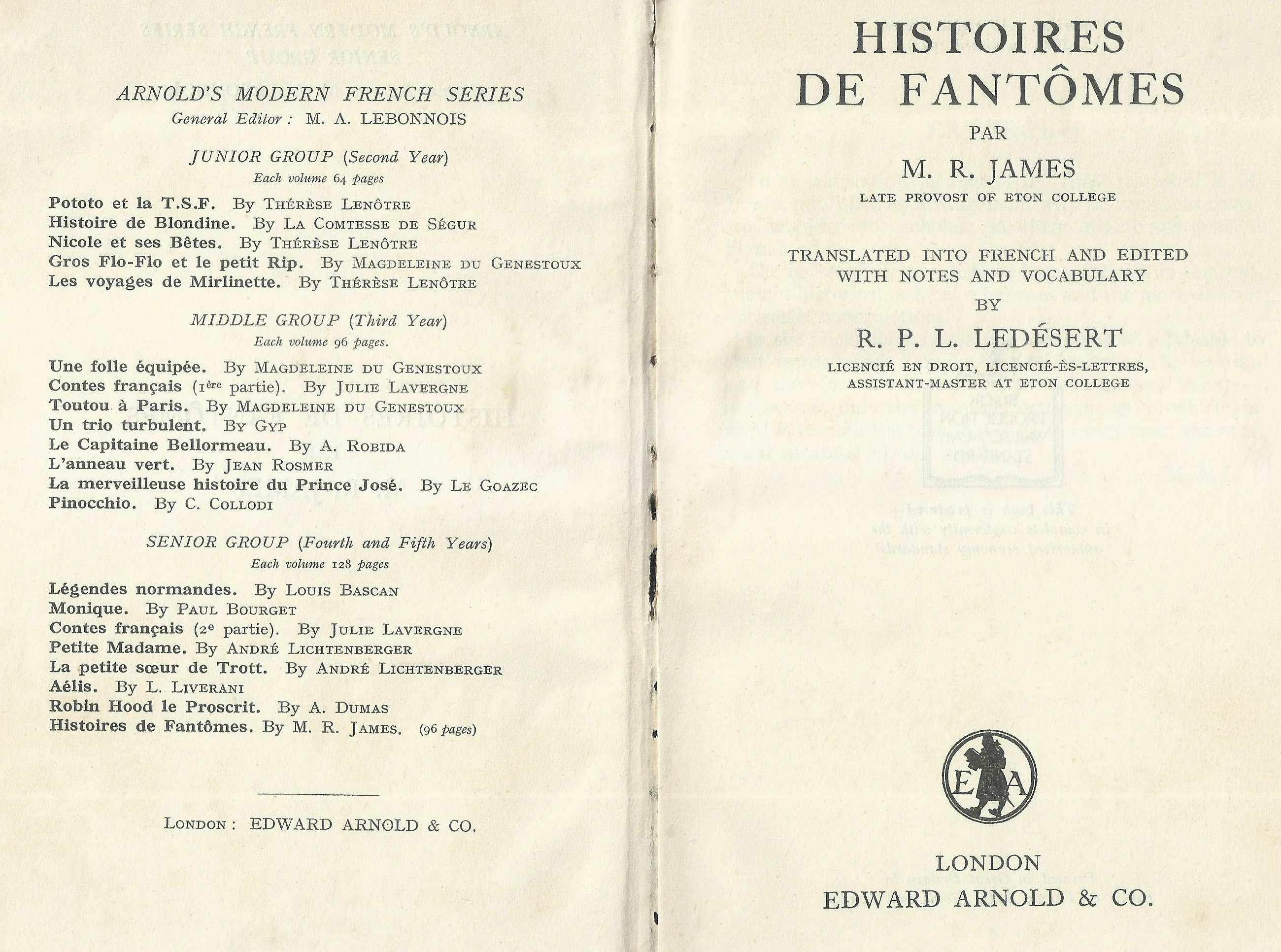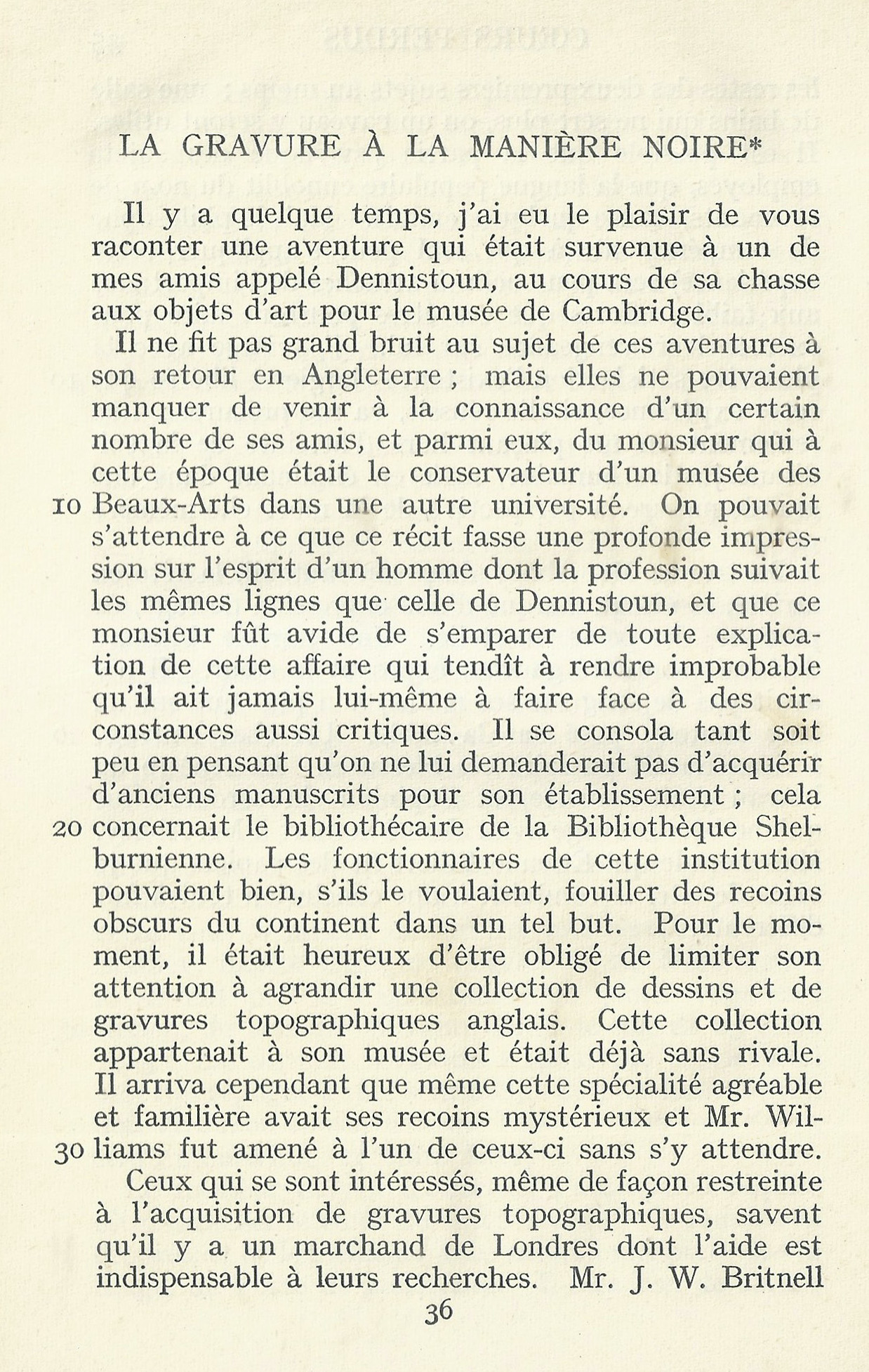Il y a une trentaine d’année, les campagnards du Centre et du Midi de la France avaient une prédilection marquée pour les spirituels conteurs des veillées d’hiver. À Belle-Eau, le vieux Jean-Pierre, dit Crébleu, y avait acquis une réputation incontestée. C’était un homme grand et sec, le nez arqué, le regard expressif, le geste vif. Il était dévot et superstitieux, crédule à l’excès ; il prenait plaisir à jeter un juron sonore dans ses discours lorsqu’on pouvait douter de la véridicité de son récit. Chez lui venaient toutes les gens du voisinage. Le soir, il leur narrait volontiers pour la énième fois le siège de Bitche et la sortie triomphale de la petite troupe qui, après avoir défendu ce fort jusqu’à la signature de la paix, le quitta avec les honneurs de la guerre pour rentrer dans la Patrie mutilée.
Le vieux Jean-Pierre passait ensuite à un conte de fée, d’ogre, de sorcière ou de strige ; mais ce n’était jamais sans avoir un instant réfléchi, secoué lentement la tête et bourré sa pipe avec amour. Un charbon ardent pris entre trois doigts, glissait sur la paume de sa dextre, y sautillait une seconde et apparaissait au sommet du brûle-gueule en faisant se recroqueviller le tabac qui, sans crépiter, s’enflammait. La fumée, en spirales bleuâtres, montait vers le plafond à la grande satisfaction du vieux « briscard » dont la figure, à cette vue, s’épanouissait.
De son souffle puissant, il chassait une bouffée épaisse et blanche, croisait ses jambes, jetait un coup d’œil circulaire, crachait bruyamment et, en jurant, il levait la tête ; il venait d’abandonner son sujet de méditation. C’était un signal compris : on savait qu’il était prêt, avec sa volubilité coutumière, à commencer un de ces contes dramatiques dont seul il possédait le secret d’en rendre l’intérêt poignant.
Entraînant progressivement son auditoire suspendu à ses lèvres, il le transportait par la pensée sur les lieux de l’action que sa fertile imagination décrivait sans négliger le moindre détail. Il savait ingénieusement ménager les surprises et entretenir sous le feu de sa pipe et de son verbe une chaleur communicative que nos grands orateurs lui auraient enviée s’ils l’eussent connu comme moi. La sympathie ou la haine par lui éprouvée pour tel ou tel personnage était, au même degré, ressentie et partagée par les assistants : ils arrivaient au paroxysme de la colère lorsque la sorcière commettait une atrocité, ou que l’enchanteur se livrait à des attouchements criminels sur le corps fluet et virginal de la fille du Roi.
Ah ! oui, on peut le dire, l’oncle Jean-Pierre était éloquent. De tout temps, on a aimé entendre les orateurs de la tribune politique ; on a admiré l’éloquence de la chaire dans toutes ses manifestations.
Aujourd’hui, l’une et l’autre éloquence sont tombées bien bas dans l’esprit du paysan qui découvre, au fond des discours politiques ou religieux, le calcul et le mensonge, l’intérêt et l’hypocrisie. On écoute pour s’étourdir, on applaudit sans comprendre ; on ne veut pas y voir une leçon donnée.
Les causeries de Crébleu, au contraire, étaient suivies avec une attention émue, soutenue tour à tour par l’admiration ou le mépris, la crainte ou l’espoir, l’amour ou le dédain. On suivait avec passion, sous le charme d’une voix vibrante, les phases du développement, de la pensée d’un homme estimé.
Croyez-moi, chers amis, je l’estimais aussi beaucoup, le père Crébleu. Je l’admirais à cause des casemates humides de Bitche où il avait souffert, à cause de la fantasmagorie dont il s’enveloppait, tout en la faisant planer sur les êtres bons ou méchants qu’il dépeignait avec art. Pour les connaître si bien, il devait être en relation directe avec eux, je le croyais du moins ; j’en fus désenchanté plus tard. À l’époque dont je parle, j’avais huit ans. Je me rappelle néanmoins cette originale figure du conteur, illuminée et embellie par les flammes vacillantes que projetait l’âtre garni de grosses bûches de bois de chêne.
*
Un soir à la veillée habituelle, le vieux Jean-Pierre, après avoir parlé du siège de Bitche, alluma sa pipe et se tut. Son silence nous pesait. Nous faisions mille suppositions sur ce mutisme auquel on n’était pas accoutumé.
« Eh bien, compère, dit le docteur Pascal, je vais vous remplacer, voulez-vous ? »
Le docteur, un officier de santé, décrépit et presque aveugle, était demeuré fin causeur. Il suppléait de bonne grâce le vieux soldat quand celui-ci était fatigué ou absent.
« Arrêtez, j’ai une grave nouvelle à vous apprendre. »
Tous les regards convergèrent vers le héros de 70 dont le visage blême, aux traits contractés, montrait manifestement à quelle sorte de sentiments son âme était en proie : la frayeur l’étreignait. Enfin, il s’exclama :
« La païenne ! mes amis, la païenne ! Oui, une païenne non loin d’ici prend ses ébats ; je l’ai vue ce soir même, au gué de Survilly, en rentrant des champs.
– La païenne !! »
Toutes les voix ne firent qu’un son pour l’émission de ce cri d’effroi ; un morne silence s’ensuivit ; un frisson secoua l’assemblée. Je n’eus pas peur ; oh ! non pas que je fusse plus brave que les hommes, mais parce que, à cet âge, j’ignorais et le mot et la chose. La païenne ! Je ne savais pas ce qu’était cette bête terrifiante. C’est pourquoi je ne tremblai point comme le grand Turbin dont les longues jambes repliées brusquement firent rouler de la cheminée sur le plancher un tison énorme ; chaque parcelle incandescente qui s’en détacha au choc laissa échapper des étincelles crépitantes s’élevant rapidement en zigzags fous devant le nez de tout ce monde ahuri. Ce poltron maladroit faillit mettre le feu au logis.
« Les païennes, reprit le vieux Jean-Pierre, chassées de l’autre monde, reviennent habiter nos rivières et les sources de nos forêts ; ce sont de ces femmes maudites qui meurent dans les douleurs de l’enfantement, emportant avec elles dans la nuit des tombeaux leur progéniture que Satan recueille. Ah ! sang de Dieu, celle que j’ai aperçue ce soir à la nuit close lave langes et robes d’enfant ; son malin esprit flotte dans l’air autour d’elle en ondes légères et vaporeuses. Ce mauvais génie, de loin, jette une palette infernale qui toujours atteint et tue. Je vous avertis : le gué de Survilly est hanté ; ne le franchissez que de jour ; si, dans la nuit, vous avez à le traverser, malheur à vous ! Malheur à vous ! Si minuit a sonné quand vous passez dans le rayon formant la zone protectrice de l’âme damnée, cette zone est dangereuse pour vous. Croyez-m’en, sacrebleu, et méfiez-vous. »
*
Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répandit à Belle-Eau. Le braconnier Paulon en rit beaucoup. Grand et fort, le visage hirsute, il était réputé pour son courage et sa présence d’esprit en face du péril. « Le vieux Jean-Pierre, dit-il d’un ton moqueur, a autant de pusillanimité que Turbin le Long ; si, comme moi, il avait souvent eu besoin de gagner sa vie grâce à l’obscurité, il vous dirait non sans fierté : « La peur n’est rien, crénom, et ce rien n’est pas à confondre avec un revenant. » Il rit de bon cœur, puis ajouta, ironique : « Je suis obligé de reconnaître que Bitche a été défendu par de plus vaillants que lui. » Et, de nouveau, Paulon éclata de rire.
Cependant, malgré lui, le braconnier pensait souvent à la strige nouvelle. Un soir, il s’était attardé à longtemps guetter le sanglier qui dévastait un champ de blé situé près de la lisière de la forêt. Ne voyant rien venir, comme l’autre, il prit le chemin du bourg, marcha d’abord tête baissée, ne pensant à rien, puis il s’arrêta sans trop savoir pourquoi. Le gué de Survilly était à quelques centaines de pas : à cette heure indue, il l’avait mainte fois passé. En ce moment, il hésitait, ne se rendant pas bien compte de la cause qui faisait naître sa déconcertante perplexité. Il était effectivement indécis : il pressentait un malheur du côté de la rivière dont le sinistre murmure était distinctement perçu par son ouïe exercée aux bruits nocturnes. Il pensa un instant prendre une voie détournée pour rentrer chez lui. L’idée que la « païenne » pouvait être au gué se présenta à son esprit, nette, implacable, obsédante. Une horrible vision agita son cerveau. L’audacieux Paulon reculera-t-il ? Fuira-t-il un danger imaginaire ? Non. C’eût été de la folie que de ne pas profiter de cet instant propice pour s’assurer si le vieux Jean-Pierre était dans le vrai. Ne voulant, pour rien au monde, avoir à répondre d’une lâcheté envers lui-même, il se dirigea, calme, à pas lents vers le gué de Survilly.
Il était deux heures après minuit lorsqu’il y parvint. La lune, se mirant dans les eaux du ruisseau lui donnait des apparences de phosphorescence troublante ; l’écume de la cascade se dispersait en gouttelettes brillantes disparaissant comme autant de feux follets ; l’onde profonde et claire que, le jour, le passant admirait à deux pas en amont du gué, réfléchissait la figure énigmatique et blafarde de l’astre aux reflets d’argent. Cette tête, à forme humaine, lui parut animée. Paulon frissonna. « Pourquoi, pensa-t-il, ne suis-je plus moi-même ce soir ? » Un effort de sa volonté pour rester maître de lui, l’obligea à lever la tête, à suspendre sa marche. Alors, dans le silence de la nuit, il entendit un bruit de linge mouillé que l’on bat sur une pierre. Il ressentit une émotion extraordinaire qui, ébranlant son être, déplaça son équilibre ; l’homme fit un saut et reprit sa stabilité.
De nouveau, il perçut le même bruit, mais plus distinct. Il pensa au vieux Jean-Pierre et à ce qu’il avait affirmé. « Allons-donc, se dit-il, c’est une invention. Tout cela est étrange, j’en conviens ; mais cette sorcière terrible ne peut exister, puisque je ne crois pas. C’est impossible. D’ailleurs, je m’en rendrai bien compte. Je veux voir et toucher. Je déteste le ridicule. » Et Paulon, décidé à aller vers ce but imprécis, ne quitta de l’œil ni de l’oreille la direction d’où venait le bruit. Il se défit de ce qui le gênait et s’arma pour la circonstance. Il ôta ses bottes, posa à terre doucement son fusil à piston, en prenant à la main la baguette en fer fixée le long des carrons ; sans bruit, il sauta sur une pierre granitique, lisse et ronde, fit encore quelques bonds en avant et prêta l’oreille en regardant vers l’endroit mystérieux. Un spectacle qui faillit lui glacer le sang dans les veines s’offrit à sa vue : une femme, les cheveux épars, une corbeille de linge devant elle, savonnait, frottait, battait, rinçait et plaçait les pièces lavées en tas, par côté. Le braconnier n’hésita plus. Son parti fut vite pris. La sorcière lui tournait le dos. Maintenant, elle se baissait. La baguette du fusil levée, il s’avance avec précaution, ayant son cœur pour tambour : il verra, il saura. Sans que l’autre ait pu l’entendre à cause du bruit de l’eau et du lavage, Paulon est près d’elle ; déjà il avance la main gauche ; la main droite brandit son arme de combat. Nerveusement, la première s’abattit sur les cheveux du fantôme pendant que la seconde fit décrire à la baguette un arc de cercle dessiné en même temps par la lune dans l’eau transparente.
« Ohé ! Robert !… Ohé ! Robert !… » cria la femme dans un appel désespéré. L’écho répéta ce cri lugubre. Paulon a lâché prise ; il revient en arrière à grandes enjambées. On dirait l’ombre d’un voleur qui, surpris, s’échappe en baissant le haut du corps pour ne pas être reconnu. Il replace l’arme flexible qui ne lui servait plus, prend ses bottes à la main, les chausse péniblement un peu plus loin et essuie, la mort dans l’âme, de grosses gouttes de sueur froide qui perlaient dans sa barbe touffue. Il marche, et le vent qui siffle dans les hêtres gigantesques le poursuit de sa sourde clameur indéfinissable. Des brindilles de bois mort lui tombent sur la tête, le blessent à la face. Les fougères se penchent, s’entrelacent, s’enchevêtrent pour l’empêcher de rentrer. Tout bruisse, s’anime et se lève pour le poursuivre. Il fuit ces ennemis conjurés et s’en va, maudissant Jean-Pierre, les dévots et leurs absurdes préjugés. Paulon avait acquis une certitude : la prétendue « païenne » qui, dans un effort suprême avait demandé du secours, était une robuste paysanne de Belle-Eau. Marie Duzan appelait son mari Robert, que le fameux chasseur connaissait parfaitement.
Marie et Robert, au temps de la moisson, habitaient une maisonnette de campagne, au milieu d’un champ de blé bordé par la rivière. Tous deux, dès l’aurore, prenaient la faucille en main. Ce matin-là, Marie Duzan, désirant, aux côtés de son mari, commencer la journée, avait voulu profiter du beau clair de lune en attendant le point du jour qu’elle croyait plus proche ; comme d’autres fois, elle lavait au même endroit le linge d’un bébé de dix-huit mois. Pauvre femme ! mère intrépide ! Paulon le mécréant, maintenant accablé de remords, te fit croire malgré toi aux revenants velus. Lui, de ce fait, devint sombre comme la mort. Il ne raconta sa triste aventure qu’un an après le décès de Marie Duzan ; celle-ci emporta dans les ténèbres du tombeau un enfant à qui elle ne put donner le jour. Cette jeune mère, incrédule mais laborieuse, victime de la stupide superstition du père Crébleu, était la « païenne » que l’on craignait tant à Belle-Eau. Païenne au grand cœur, vraie compagne du prolétaire, je garderai de toi un impérissable souvenir.

_____
(J.-A. Calzaroni, « Conte de l’Écho, » in L’Écho de la Corse & de l’Algérie, organe de défense de tous les intérêts corses et algériens, deuxième année, n° 55 et 56, dimanches 18 et 25 décembre 1910. Paul Guigou, « Lavandière, » huile sur toile, 1860 ; Yan’ Dargent, « Les Lavandières de la nuit, » huile sur toile, c. 1861)