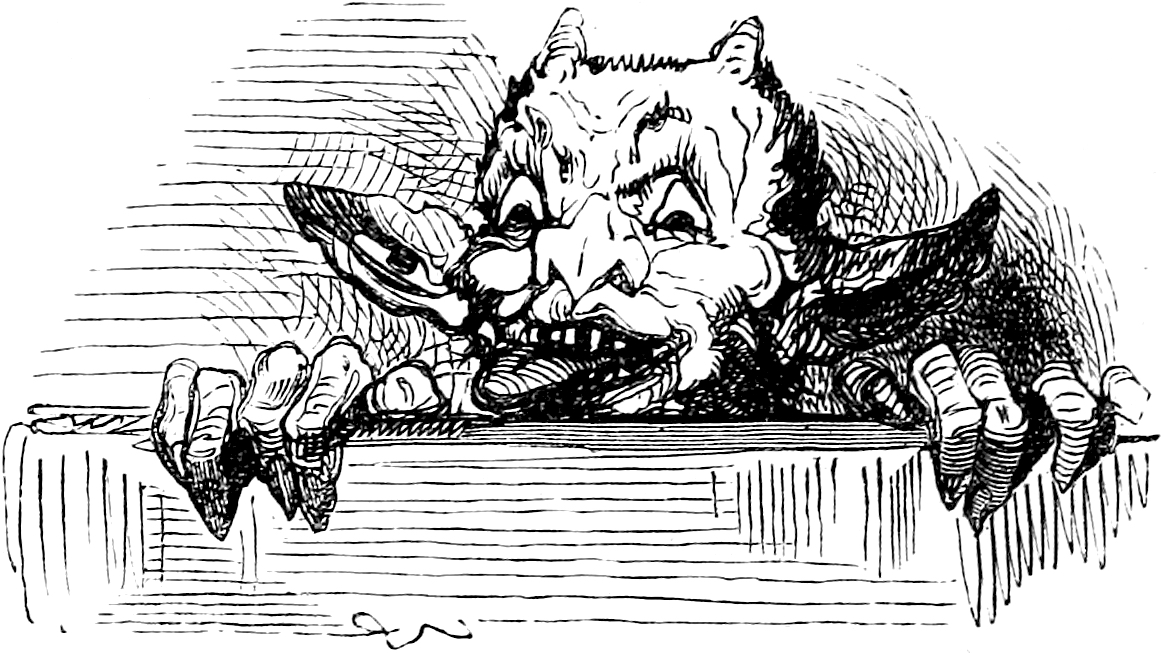Oui, quelque chose d’indéfinissable se passait en moi, à penser qu’il m’était donné de contempler une pareille œuvre et qu’il ne tenait qu’à moi, peut-être, de la posséder !… Ivresse voluptueuse, vibration brûlante de l’âme, que connaît seul le collectionneur ; anéantissement presque absolu de tout l’être devant la beauté de la ligne et l’harmonie de la couleur !
Je tenais entre mes doigts le divin objet !
Et je rêvais déjà !
Je rêvais aux artistes incomparables qui nous léguèrent de telles œuvres, au magique ciseleur qui avait conçu et exécuté celle-là, à l’époque merveilleuse qui l’avait enfantée !…
Je rêvais de l’atelier sombre aux vitraux de grisailles tristes : l’établi dans un coin, l’artiste qui se penche, les fins copeaux d’or qui roulent, les riches bibelots alignés sur les grands dressoirs ; le bruit sec des marteaux, le tic-tac de l’horloge, le murmure d’une chanson…
Était-ce dans l’infini du tiède ciel de Florence, dans la ligne souple de ses collines, dans la brume mauve de ses nuits mystiques, qu’ils avaient puisé cette féconde inspiration de l’éternelle Beauté ? De quels yeux surent-ils voir, ceux-là, la courbe élégante d’une hanche et le modelé d’un beau bras ; et comme l’image, en passant sous leurs doigts, sut se vêtir de charme, comme, sous le pur soleil de leur pays, toute la nature se revêt de Lumière…
« Eh bien, monsieur ?… »
Je revins à moi.
Le vieillard me regardait.
Une légère trace d’anxiété, encore, creusait les plis de son fier visage de poète. Mais l’espoir l’éclairait peu à peu, faisait rayonner les yeux gris et profonds. Je répondis alors :
« Monsieur, je n’ai pas à vous dire des choses que vous devinez déjà. C’est presque à moi de vous remercier. Cette aiguière est une merveille ! Et je n’ai pas besoin d’ajouter, n’est-ce pas, que je serai heureux, très heureux de la posséder – si, toutefois, nous pouvons nous entendre. »
C’était là, en effet, – je venais d’y songer, – un bibelot presque inestimable ; et si, dans mon premier enthousiasme, il me semblait que rien n’était trop cher en échange d’un pareil trésor, ma vieille prudence pourtant me commandait de ne point trop m’aventurer.
Je continuai donc, sur un ton tout à fait convenu :
« Monsieur, que demandez-vous ? »
Il réfléchit quelques instants.
Ses yeux fixèrent les reliefs luisants de l’or pâle, comme pour en emporter une dernière fois l’image ; une flamme rapide, la larme retenue peut-être ? fit battre les cils. Puis le calme revint et, très simplement, de sa voix grave :
« Ce que vous voudrez, fit-il. J’ai besoin d’argent. »
C’était l’aveu.
Quelque rougeur passa sous la peau de son beau front. Un lourd silence tomba entre nous.
Je regardais, à mon tour, sur le vase les taches vives des ciselures. Lui, avait baissé les yeux. Nous attendions.
Besoin d’argent ?… et c’était ce besoin d’argent qui le forçait à se défaire de ce précieux chef-d’œuvre !
Une sorte de honte me prenait, qui me fit rougir moi aussi.
« Quoi ! pensai-je, cet homme – par suite de quels efforts, de quelles luttes peut-être ! – s’est rendu possesseur de cette pièce unique, source de tant de joies pour lui s’il est artiste – et il l’est. Et, pour de vils besoins qui le tyrannisent, il lui faut s’en séparer !… Et parce que moi, j’avais la chance – oui, la chance – d’avoir en cet instant quelque argent de reste, je pouvais, sans vergogne, lui voler son trésor !… Non ! Cela était une injustice. Et elle n’aurait pas lieu. Je ne le voulais pas.
Les solutions se succédaient en foule dans ma tête en feu ; mais toutes me paraissaient impuissantes à me faire agir comme je le devais.
Car que faire, en somme ? Une seule chose : lui rendre l’objet en lui offrant l’argent quand même.
Mais n’était-il pas évident qu’il s’y refuserait ? Est-ce que tout en lui ne criait pas la délicatesse, la volonté aussi de ne rien obtenir pour rien ? Ç’aurait été fou de ne pas le comprendre.
Il « irait ailleurs » et moi seul serais la dupe.
Vit-il mon trouble en cet instant ? En saisit-il, peut-être, la cause tout intime ?
Il interrompit tout à coup ma tumultueuse argumentation :
« Monsieur, dit-il rapidement, je dois maintenant ajouter ceci : l’aiguière est de moi ! »
Et comme, sous ce coup inattendu, je levais vers lui des yeux stupides :
« Sans doute, continua-t-il, vous ne comprenez pas ce que je vous dis là. Vous ne le croyez pas, peut-être !… Voici. Je suis ciseleur d’or, monsieur. Non par métier, mais par goût. Je m’amuse à travailler. Non pour les autres, mais pour moi. Jamais je n’ai rien vendu, jamais je n’ai rien donné. Cette œuvre est la première qui soit sortie de chez moi. »
Je le considérais.
Tout en lui respirait la sincérité. Cet homme ne mentait pas ; quelque chose me le disait.
Était-il fou ? Cela me paraissait impossible…
« Ainsi que vous le voyez, poursuivit-il, l’objet que vous avez là, entre vos mains, est en or. Je ne travaille que l’or. C’est le seul métal, voyez-vous, monsieur ; les autres ne sont que des cailloux… Mais l’or est cher, trop cher : je suis ruiné. »
Il s’arrêta.
Une inquiétude nouvelle se peignit sur ses traits contractés.
« Monsieur, fit-il à voix basse, je n’ai plus aujourd’hui un sou, et ma fille meurt de faim. »
Je gardai le silence.
Le jour était tombé peu à peu. La grande pièce, noyée d’ombre, s’emplissait de mystère. La belle tête blanche du vieillard apparaissait moins nette. L’or jaune du frêle vase luisait seul dans la nuit enveloppante.
J’y reportai mes yeux machinalement, par contenance… C’était vraiment la beauté pure de la forme dans la matière la plus purement belle.
Je cherchais quelque chose à dire.
Quoi ?
Il y a des situations où le mot le plus léger est encore trop lourd, – où l’on craint de briser quelque chose de très subtil qui flotte dans l’air avec le silence et que le moindre bruit peut faire s’envoler…
Je ne trouvai rien.
Ce fut lui, de nouveau, qui parla :
« Je vous ai dit, monsieur, que j’acceptais d’avance le prix que vous fixeriez vous-même. La confiance entière que j’ai en vous ne me laisse aucune crainte. Je sais que vous ferez ce qui sera juste. Je ne vous demanderai donc qu’une chose, parce que je suis obligé de vous la demander : c’est de me donner aujourd’hui, sinon la somme totale, qui sera forte sans doute, au moins ce que vous pouvez en verser d’avance. Cette aiguière est à vous. »
Je ne répondis rien encore.
Je me levai, sans trop de hâte ; j’ouvris le tiroir d’un petit bureau, y pris une liasse de billets de banque, puis, la lui présentant avec une sorte de gêne :
« Monsieur, balbutiai-je, la combinaison que vous me proposez me convient. Je n’ai point à vous interroger sur les tristes circonstances qui vous pressent en cet instant. Voici l’acompte que vous me demandez. Nous déciderons du reste quand vous voudrez. »
J’étais soulagé.
Mais une grande tristesse mêlée de pitié m’envahissait peu à peu, en la minute où je tendais à cet homme l’argent qui pouvait le sauver.
Je n’osais lui rien demander. Car je sentais qu’il avait dit ce qu’il voulait dire et que toute indiscrétion ne m’aurait fait savoir rien de plus pour le moment.
D’ailleurs, l’arrangement que nous avions pris le forçait à me revoir.
Je n’insistai donc sur aucun point ce jour-là.
Il ne jugea point à propos de se faire connaître davantage. Il ne me donna point son adresse ; je ne la lui demandai pas.
Comme je lui présentais les billet, il les prit sans les compter, les garda en chiffon dans le creux de sa main ; puis, d’une voix que l’émotion rendait plus vibrante :
« Monsieur, excusez-moi ; les phrases me viennent mal. Je voudrais vous dire tout ce que je ressens ; je ne le puis… Le temps me manque aussi ; permettez-moi de me retirer. Mais croyez surtout, monsieur, croyez que je vous remercie et que je vous bénis du plus profond de mon cœur. »
Il prit ma main, la serra avec force, tandis que moi-même je bégayais quelques vagues encouragements.
(À suivre)
–––––
(Paul Heuzé, in Journal des débats politiques et littéraires, cent dix-septième année, n° 93, mardi 4 avril 1905 ; in Annales africaines, revue politique et littéraire de l’Afrique du Nord, trente-cinquième année, nouvelle série, n° 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, vendredis 6, 13, 20 juillet, 3, 10, 17 et 24 août 1923 ; in Le Petit Méridional, journal républicain quotidien, n° 17474, 17475, 17477, 17478 et 17480, mardi 29, mercredi 30 janvier, vendredi 1er, samedi 2 et lundi 4 février 1924. Cette nouvelle a été reprise en volume dans le recueil éponyme, Paris : Jean Bosc & Cie, 1907 ; elle a également fait l’objet, semble-t-il, d’une édition illustrée séparée en 1924, à l’Édition artistique. William Fettes Douglas, « Benvenuto Cellini selling Plate, » huile sur toile, 1856)