Cette histoire de chat, aussi inconséquente, cocasse et illogique que la vie réelle, débute par l’apparition d’un matou. Un matou particulier dans ce sens qu’il me fut offert par une tante qui, prise d’une affection soudaine pour un bulldog féroce, ne pouvait plus le garder. Il répondait, ou ne répondait pas, aux noms de Philip, Xerxès, Vagabond ou Bandit, que nous lui donnions selon les manifestations diverses de son tempérament. C’était un chat angora, mais sa fourrure flamboyante, constamment ébouriffée, lui donnait plutôt l’air d’un vulgaire chat de gouttière. Un jour, alors qu’il était parti en exploration, il tomba du balcon de mon voisin sur la tête d’une vieille demoiselle, locataire du rez-de-chaussée. Je pus facilement établir l’innocence de mon matou, animal doux et inoffensif ; mais, trois jours plus tard, le pauvre animal exhala son dernier soupir, empoisonné à l’arsenic… et par la méchanceté humaine. Juste au moment où, les yeux voilés par une sorte de brouillard, je vis ses flancs haletants se creuser pour ne plus se soulever, il y eut, derrière la porte de mon appartement, un miaulement plaintif. J’ouvris et trouvai sur le paillasson un chaton tacheté, hirsute et squelettique. Perdu, ou peut-être abandonné, il tremblait de frayeur et de détresse.
« Eh bien ! pensai-je, tu arrives au bon moment, minet. Entre et fais comme chez toi ; sans doute est-ce la providence divine, la volonté du destin, ou le caprice mystérieux d’une force occulte qui t’a déposé sur mon seuil. »
Ainsi pénétra dans mon appartement et dans mon existence un autre chat, ou plus exactement une chatte à laquelle il fallait, de toute évidence, donner d’abord un nom. Comme elle était petite et tenait peu de place, nous l’appelâmes Poussin. Quand son heure fut venue, elle mit au monde cinq chatons dont le premier était roux, le deuxième noir, le troisième gris, le quatrième tigré, et le dernier angora. Dès ce jour, je commençai à aborder, avec un sourire complice, tous les gens que je connaissais : « Écoutez, disais-je, j’ai quelque chose pour vous, un chaton adorable. » Les uns (probablement des personnes affligées d’une modestie excessive) réussissaient à s’en tirer en affirmant qu’ils seraient enchantés d’avoir un petit chat, mais que, malheureusement, telle ou telle circonstance les empêchait de profiter de mon offre ; d’autres, en revanche, étaient tellement pris de court qu’ils n’arrivaient pas à trouver sur-le-champ une réponse appropriée. Alors, sans même leur laisser le temps de balbutier quelques vagues paroles, je leur serrais affectueusement la main, en déclarant que c’était entendu. Ils n’avaient pas besoin de s’inquiéter ; j’allais leur envoyer le chaton dès qu’il serait sevré. Là-dessus, je partais en courant, à la recherche de ma prochaine victime.
Rien n’est plus charmant que le bonheur maternel d’une chatte ; croyez-moi, vous devriez en avoir une, ne serait-ce que pour jouir de ce spectacle. Pour ma part, je pus goûter cette joie pendant six semaines. Puis, du jour au lendemain, Poussin abandonna ses petits à leur sort et partit dans la rue pour écouter, de très près, l’héroïque baryton de l’énorme matou qui hantait les abords de l’immeuble voisin. Cinquante-trois jours plus tard, elle déposa, dans le grand fauteuil du salon, six ravissants bébés-chats. Probablement, cette fécondité miraculeuse était-elle le résultat et l’aboutissement de la mission que lui avait léguée mon premier chat, mort célibataire et sans postérité. D’après Brehm, le « père de la zoologie, » les chats mettent bas deux fois par an. Poussin, elle, avait des petits trois ou quatre fois par an, dans n’importe quelle saison. C’était incontestablement une chatte surnaturelle chargée de venger, et surtout de remplacer au moins cent fois le malheureux matou qu’une main criminelle avait empoisonné.
Après avoir poursuivi pendant trois ans, et avec une vigueur toujours égale, sa tâche de repeuplement, Poussin périt de mort violente : une concierge lui brisa les reins, pour la punir, hurlait-elle avec une mauvaise foi révoltante, d’avoir volé un poulet rôti dans son garde-manger. Or, le jour même de la mort de Poussin, sa fille cadette nous revint : c’était une chatte jaune que j’avais donnée, presque de force, à mon voisin de palier. Elle vécut désormais avec nous sous le nom de Poussin II, afin d’assurer la continuation directe de la dynastie fondée par sa mère. Et elle perpétua ce souvenir sacré à la perfection : elle n’était encore qu’une frêle adolescente quand, déjà, son ventre commença à s’alourdir. Un beau jour, elle mit au monde quatre chatons. Le premier était noir ; le deuxième avait la même robe flamboyante que le beau mâle qui habitait notre cour ; le troisième ressemblait, par son museau allongé, à Zazou, compagnon du gardien du square ; et le quatrième était tavelé comme le « Tigre » de la concierge d’en face.
Poussin II produisait des chatons trois fois par an, avec la régularité d’une loi de la Nature. En deux ans et trois mois, elle augmenta la population féline du quartier de vingt-et-un échantillons de toutes les races et couleurs possibles, à l’exception toutefois de l’espèce particulière à l’île de Man, dans la mer d’Irlande, où les bébés-chats naissent, paraît-il, sans queue.
Pour le vingt-et-unième, je n’arrivai pas à trouver un « client. » J’envisageais déjà toutes sortes de solutions désespérées – j’allais m’inscrire à l’Association des Amis du Cirque ou au Club de la Pétanque, dans l’espoir d’y faire de nouvelles connaissances – quand Tambour, le chien du locataire du premier, écrasa la tête de Poussin II entre ses mâchoires. Je trouvai la pauvre bête dans l’escalier, la pris dans mes bras, la montai chez nous et la déposai sur le lit. Ses oreilles tremblaient encore. Puis, elles retombèrent, et quelques puces s’échappèrent de son épaisse fourrure, ce qui indique, chez les chats, la mort certaine. Ce fut ainsi que son vingt-et-unième bébé, celui dont je n’avais pu me débarrasser, resta avec nous sous le nom de Poussin III.
Au bout de quatre mois, Poussin III donna le jour à cinq chatons. Depuis ce moment-là, elle n’a cessé de remplir consciencieusement sa tâche, mettant bas toutes les quinze semaines.
À la voir, vous ne croiriez peut-être pas qu’elle puisse être chargée d’une mission aussi haute, aussi immortelle : on la prendrait facilement pour une chatte quelconque, ordinaire, vaguement tigrée, qui passe facilement toute une journée à sommeiller sur les genoux du maître de maison ou sur le lit. Mais, lorsque ses quinze semaines sont révolues, elle commence à devenir nerveuse, inquiète, et elle prend position près de la porte, comme pour nous dire : « Allons, vous, les humains, laissez-moi sortir tout de suite. J’ai besoin de ma liberté. » À la première occasion, elle s’échappe et disparaît dans l’obscurité de la nuit, pour ne rentrer que le lendemain matin, les traits tirés, des cernes autour des yeux. À ces moments-là, l’on voit apparaître dans les parages un énorme matou noir venant du cimetière qui est au bout de la rue ; un vieux bagarreur borgne, à la fourrure rousse, dont le terrain de chasse habituel est le square ; un chat angora dont la queue ressemble à un bouquet de plumes d’autruche, propriété de la vieille douairière qui habite l’hôtel particulier au coin du boulevard ; et une bête mystérieuse, sans domicile connu, au poil hirsute et à l’allure dégingandée. Au milieu du cercle que forment ses soupirants, Poussin III, les yeux brûlants et fiévreux, écoute pendant des heures les hurlements, exclamations rauques, cris à vous glacer le sang, vociférations de marins en bordée, roulements de tambours, bref, tous les sons qui figurent dans la symphonie féline.
Parfois, ces quatre bêtes apocalyptiques assiègent avec persévérance la demeure de Poussin III, donc la nôtre, pendant toute une semaine ; ils bloquent littéralement la porte de l’immeuble, s’introduisent dans la maison par les fenêtres du rez-de-chaussée et laissent sur leur passage une odeur qui vous soulève le cœur. Enfin, arrive la nuit où Poussin III n’éprouve plus le désir de sortir. « Laissez-moi dormir, ronronne-t-elle, dormir et encore dormir. Ah ! mon Dieu, je suis si malheureuse. » Puis, le moment venu, elle met au monde cinq chatons. En ce qui concerne cette conclusion, j’ai déjà acquis une certaine expérience : je sais qu’il y en aura cinq. Je les vois déjà ces petites boules de fourrure, adorables, drôles, titubantes, qui roulent plutôt qu’elles ne marchent dans l’appartement, renversant les vases, laissant de petites mares dans mes pantoufles, escaladant mes jambes pour atteindre mes genoux (mes mollets sont écorchés comme ceux de saint Lazare). Je sais déjà que je vais trouver un bébé-chat dans la manche de ma robe de chambre quand je rentre à la maison, et que je devrai chercher ma cravate quelque part sous le lit.
Dans la rédaction du journal qui me verse mon semblant de salaire, tout le monde, du rédacteur en chef au concierge, a maintenant un chaton. Eh bien ! tant pis, il va falloir que je cherche un autre emploi. Je suis prêt à m’inscrire à n’importe quelle association, société, mutuelle, qui me garantirait l’écoulement annuel d’au moins vingt chatons. Pendant que je continuerai à lutter, dans l’indifférence hostile d’un monde mesquin, pour trouver des foyers susceptibles d’accueillir de nouvelles générations félines, Poussin III, et plus tard Poussin IV, continueront à ronronner, pelotonnées contre mon oreiller, et à œuvrer pour l’immortalité de leur espèce. Elles rêveront d’un monde dominé par les chats, par des légions de chats, d’un univers où les chats seront assez nombreux pour s’emparer du pouvoir. Elles rêveront de mener à bonne fin la grande tâche que leur a léguée mon premier matou, le petit angora ébouriffé, victime innocente d’un bourreau humain.
Ceci dit, parlons sérieusement : « Vous n’aimeriez pas avoir un petit chat ? »
–––––
(Karel Čapek, traduction anonyme, in Constellation, le monde vu en français, n° 39, juillet 1951 ; Benz and Chang, « Rainy Days, » aquarelle, 1918)





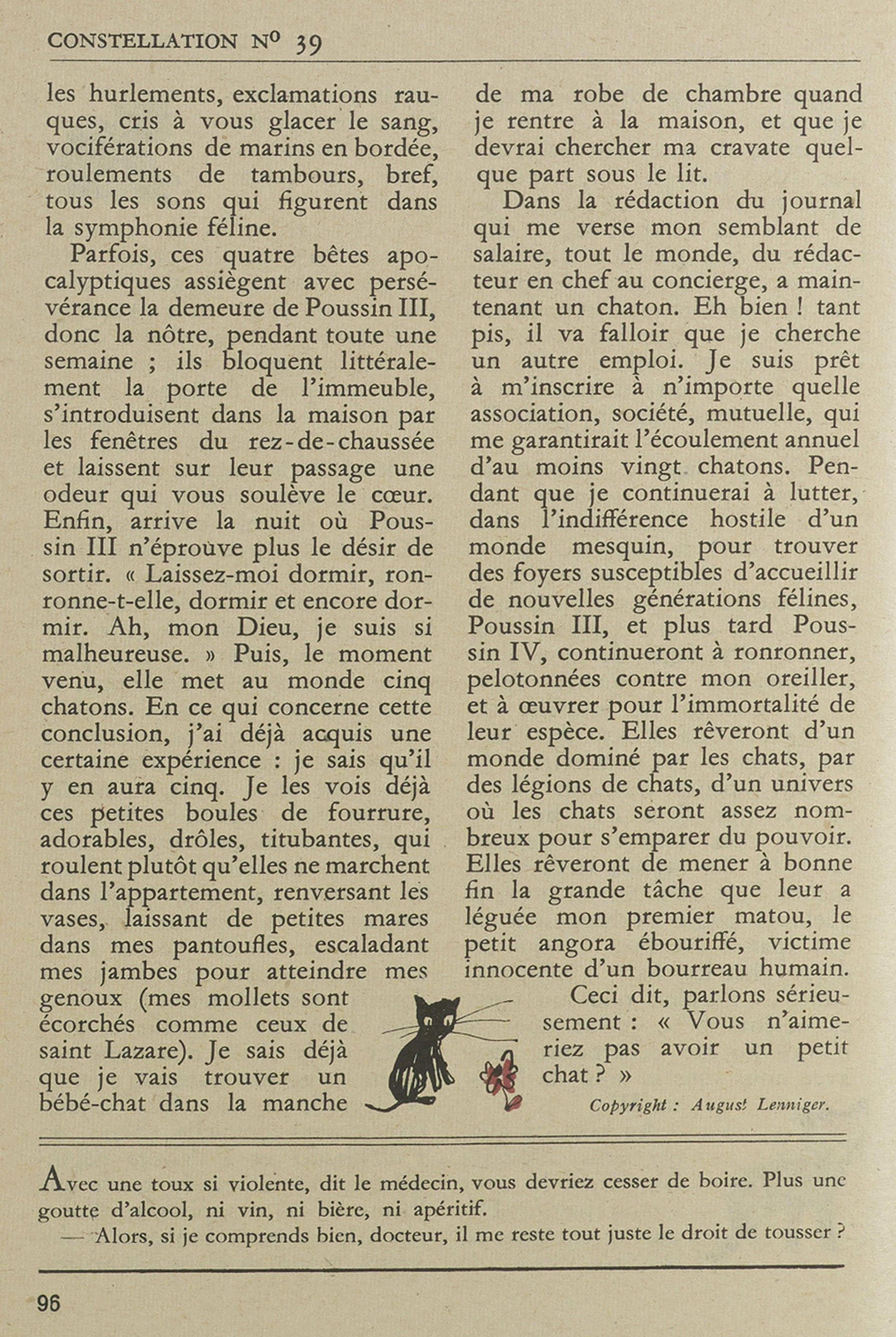
Le « grand-remplacement » de l’humanité, c’est une idée fixe, chez Karel Ĉapek ! Par des robots, par des salamandres, par des chats…