_____
Comme beaucoup d’amateurs de sa génération, Monsieur N a découvert M. R. James à la lecture du « Document secret » et de « La Chambre n° 13 » dans les Histoires et Nouvelles Histoires de fantômes anglais d’Edmond Jaloux (1936 et 1939), de « Cœurs perdus » dans le premier tome de l’Anthologie du fantastique de Roger Caillois (1966), et enfin des neuf nouvelles rassemblées dans Siffle et je viendrai, paru aux Nouvelles Éditions Oswald en 1982. Comme beaucoup encore, il a longtemps cru que ce volume était le premier recueil de Montague Rhodes James à être traduit en français.
Or, il n’en est rien : en réalité, le premier recueil de M. R. James en langue française a été publié en février 1944 à Londres, chez Edward Arnold & Co., l’éditeur attitré de James, dans ses « Arnold’s Modern French Series, » ; il a été traduit par R. P. L. Ledésert, sous le titre : Histoires de fantômes. L’ouvrage, paru durant la seconde guerre mondiale à l’intention des étudiants en français de quatrième ou cinquième année, a fait l’objet d’une diffusion assez restreinte et reste inconnu de la grande majorité des bibliographes, même s’il est référencé dans les appendices de The Legacy of M. R. James: Papers from the 1995 Cambridge Symposium édité par Lynda Dennison (Shaun Tyas, 2001). Il faut dire que l’ouvrage se rencontre assez peu fréquemment : en l’espace de quarante ans, nous n’en avons croisé que deux exemplaires.
La Porte ouverte est heureuse de mettre en ligne aujourd’hui les quatre nouvelles réunies dans ce recueil, extraites des Ghost Stories of an Antiquary (1904) : L’Album du chanoine Albéric [Canon Alberic’s Scrap-Book] ; Cœurs perdus [Lost Hearts] ; La Gravure à la manière noire [The Mezzotint] ; La Chambre numéro 13 [Number 13], accompagnées d’un choix de notes les plus représentatives.
MONSIEUR N
_____
_____
PREFACE
_____
These translations of four of the ghost stories of M. R. James, published by arrangement with his representatives, are intended for scholars in their 4th or 5th year of French.
The notes, which are marked by an asterisk in the text, explain historical or local references and the more difficult idiomatic constructions.
In the vocabulary it has not been deemed advisable to omit words which « ought » to be known. The vocabulary, therefore, is complete ; and it has this new feature – it gives not only the meaning, or meanings, in which the word is used in the text, but also, in every case, the most usual meaning of the word.
M. A. L[ebonnois].
_____
L’ALBUM DU CHANOINE ALBÉRIC
_____
Saint Bertrand de Comminges est une ville endormie dans les contreforts des Pyrénées, non loin de Toulouse, mais plus près encore de Bagnères de Luchon. C’était le siège d’un évêché jusqu’à la Révolution, et il y a là une cathédrale que visitent un certain nombre de touristes. Au printemps de 1883, un Anglais arriva à ce bourg médiéval, que je ne puis guère honorer du nom de cité, car on n’y peut compter mille habitants.
Il était de l’Université de Cambridge, et il était venu spécialement de Toulouse pour voir l’église de Saint Bertrand ; il avait laissé deux amis, archéologues moins passionnés que lui, à leur hôtel de Toulouse en leur faisant promettre de venir le rejoindre le lendemain matin. Il leur suffirait d’une demi-heure pour visiter l’église, et ils pourraient ensuite continuer leur voyage tous trois ensemble dans la direction d’Auch. Mais notre Anglais était arrivé de bonne heure ce jour-là, et il se proposait de remplir un cahier de notes et d’utiliser plusieurs douzaines de plaques pour décrire et photographier les coins et les recoins de l’église magnifique qui domine la petite colline de Comminges. Pour mettre ce dessein à exécution, il lui fallait monopoliser pour la journée les services du bedeau de l’église. La tenancière de l’auberge du Chapeau Rouge, qui était tant soit peu brusque, envoya donc chercher ce sacristain, ou bedeau (je préfère ce premier titre, si inexact qu’il puisse être) ; et quand il arriva, l’Anglais découvrit en lui un sujet d’étude inattendu et intéressant. Ce n’était pas dans l’aspect physique de ce vieillard, petit homme sec et ratatiné, que reposait l’intérêt, car il était exactement pareil à des douzaines d’autres sacristains français, mais dans son air étrangement sournois, ou plutôt traqué et accablé. Sans cesse, il regardait à moitié derrière lui ; les muscles de son dos et de ses épaules semblaient être arrondis en une contraction nerveuse permanente, comme s’il s’attendait à chaque instant à se trouver sous la griffe d’un ennemi. L’Anglais ne savait guère s’il devait le considérer comme un homme hanté par une idée fixe, ou accablé par une mauvaise conscience, ou encore comme un mari mené par le bout du nez par sa femme d’une façon intolérable. Il semblait de toute probabilité que cette dernière impression fût la bonne ; cependant, on avait le sentiment qu’il s’agissait d’un persécuteur plus formidable même qu’une mégère.
L’Anglais (appelons-le Dennistoun) fut bientôt trop profondément absorbé dans ses notes et trop occupé avec son appareil photographique pour accorder plus qu’un regard distrait au sacristain.
Chaque fois qu’il le regardait, il le trouvait à quelques pas derrière lui, soit blotti le dos contre le mur, soit pelotonné dans l’une des magnifiques stalles. Au bout d’un certain temps, Dennistoun commença à s’énerver. Un mélange de soupçons le tourmentait : il empêchait peut-être le vieillard de déjeuner ; ou bien, on le considérait capable de faire disparaître la crosse d’ivoire de Saint Bertrand, ou le poussiéreux crocodile empaillé qui est suspendu au dessus des fonts-baptismaux.
« N’allez-vous pas rentrer chez vous ? dit-il enfin. Je suis bien capable de finir mes notes tout seul. Vous pouvez m’enfermer à clef dans l’église si vous voulez. Il me faudra passer au moins encore deux heures ici, et vous devez avoir froid, n’est-ce pas ?
– Juste Ciel ! dit le petit bonhomme, que cette suggestion sembla jeter dans un état de terreur inexplicable, je ne puis admettre cette pensée un seul instant. Laisser Monsieur tout seul dans l’église ?
Non, non ! deux heures, trois heures, ça m’est égal. J’ai mangé mon petit déjeuner, et je n’ai pas froid du tout, et bien des remerciements à Monsieur. »
– Très bien, mon bonhomme, se dit Dennistoun, tu as été averti, et tu devras en subir les conséquences.
Avant que les deux heures se fussent écoulées, les stalles, l’énorme orgue délabré, le jubé de l’évêque Jean de Mauléon, les restes de vitraux et de tapisserie, et les objets du trésor avaient été examinés en détail ; le sacristain était resté pendant tout ce temps sur les talons de Dennistoun ; de temps en temps, quand l’un de ces bruits étranges qui troublent un grand bâtiment vide frappait ses oreilles, il se retournait subitement comme s’il avait été piqué. Parfois, c’étaient de bien curieux bruits.
« Une fois, m’a dit Dennistoun, j’aurais juré entendre une voix grêle et métallique rire bien haut dans la tour. Je lançai un regard interrogateur à mon sacristain. Il était blanc, ses lèvres exsangues. « C’est lui – c’est-à-dire, personne ; la porte est fermée à clef, » fut tout ce qu’il dit, et nous nous regardâmes pendant une bonne minute. »
Un autre petit incident rendit Dennistoun perplexe. Il était en train d’examiner un grand tableau sombre pendu derrière l’autel, et qui appartient à une série illustrant les miracles de Saint Bertrand. La composition du tableau est presque indéchiffrable, mais il y a cette légende en latin au dessous :
« Qualiter S. Bertrandus liberavit hominem quem diabolus diu volebat strangulare. » (Comment Saint Bertrand délivra un homme que le Diable essaya longtemps d’étrangler.)
Dennistoun se retournait vers le sacristain avec un sourire et quelque remarque facétieuse sur les lèvres, mais il fut confondu de voir le vieillard à genoux, regardant fixement le tableau avec l’œil d’un suppliant à l’agonie, les mains étroitement enlacées, et un torrent de larmes sur les joues.
Dennistoun fit comme s’il n’avait rien remarqué, mais cette question le harcelait : pourquoi un semblable barbouillage pouvait-il affecter quelqu’un à ce point ?
Il crut alors découvrir une sorte d’explication de l’attitude étrange du sacristain qui l’avait rendu perplexe toute la journée : cet homme devait être un monomane, mais quelle était sa monomanie ?
Il était presque cinq heures ; le jour baissait, et l’église commençait à s’emplir d’ombre tandis que les bruits étranges – les bruits de pas assourdis, et les voix lointaines qui avaient été perceptibles pendant toute la journée – semblaient devenir plus fréquents et plus importuns, sans aucun doute à cause de la lumière décroissante qui rendait l’ouïe plus fine.
Pour la première fois, le sacristain commençait à manifester des signes de hâte et d’impatience. Il poussa un soupir de soulagement quand l’appareil photographique et les notes furent enfin remballés, et fit vite signe à Dennistoun de le suivre vers le portail occidental de l’église, sous la tour. C’était l’heure de sonner l’Angélus. Il tira quelques coups sur la corde qui céda avec mauvaise volonté, et la grosse cloche Bertrande, haut dans la tour, se mit à parler, et elle balança sa voix là-haut dans les bois de pins et au fond des vallées sonores du mugissement des torrents, invitant les habitants de ces montagnes isolées à se rappeler le salut de l’Ange à celle qu’il appela bénie entre toutes les femmes.
Alors, un calme profond sembla tomber pour la première fois ce jour-là sur la petite ville, et Dennistoun et le sacristain sortirent de l’église. Sur le seuil, ils entrèrent en conversation.
« Monsieur semblait s’intéresser aux vieux livres de cantiques dans la sacristie.
– Naturellement. J’allais vous demander s’il y avait une bibliothèque dans la ville.
– Non, monsieur ; peut-être y en avait-il une autrefois appartenant au chapitre, mais c’est maintenant si petit… »
Il s’arrêta pendant longtemps, avec indécision, semblait-il ; puis, soudain, il se lança :
« Mais si Monsieur est amateur de vieux livres, j’ai à la maison quelque chose qui pourrait l’intéresser. C’est à peine à cent mètres d’ici. »
À l’instant, tous les rêves caressés par Dennistoun de trouver des manuscrits inestimables dans des coins inexplorés de France se réveillèrent, pour s’évanouir à nouveau tout de suite. C’était probablement un stupide missel de la presse de Plantin (1) d’environ 1580. Était-il vraisemblable qu’un endroit aussi proche de Toulouse n’ait pas été pillé depuis longtemps par les collectionneurs ? Cependant, il aurait été insensé de ne pas aller voir ; il se le reprocherait à jamais s’il refusait. Ils se mirent donc en marche.
En chemin, la bizarre irrésolution, puis la décision soudaine du sacristain revinrent à la mémoire de Dennistoun, et il se demanda un peu honteusement si on ne l’attirait pas dans les bas-quartiers du bourg pour le faire disparaître, car on devait le croire riche puisqu’il était anglais. Il trouva donc moyen de parler avec son guide, et d’amener dans la conversation d’une manière plutôt maladroite sur le fait qu’il attendait la venue de deux amis de bonne heure le lendemain matin. À sa grande surprise, cette nouvelle sembla soulager immédiatement le sacristain d’un peu de l’inquiétude qui l’oppressait.
« C’est parfait, dit-il d’un ton de bonne humeur. Monsieur va voyager en compagnie de ses amis. Ils seront toujours auprès de lui. C’est une bonne chose de voyager en compagnie… parfois. »
Ce dernier mot semblait être ajouté comme une arrière-pensée, et il amena avec lui une nouvelle crise de mélancolie chez le pauvre petit bonhomme.
Ils arrivèrent bientôt à sa maison. C’était un bâtiment un peu plus grand que ses voisins, bâti en pierres, avec un blason sculpté au-dessus de la porte, le blason d’Albéric de Mauléon, descendant collatéral, m’apprit Dennistoun, de l’évêque Jean de Mauléon.
Cet Albéric était chanoine de Comminges de 1680 à 1701. Les fenêtres supérieures de la maison étaient condamnées et le bâtiment entier avait, ainsi que le reste de Comminges, un air de décrépitude.
En arrivant sur le seuil, le sacristain s’arrêta un instant.
« Peut-être après tout, dit-il, Monsieur n’a-t-il pas le temps d’entrer ?
– Oh, non ! j’ai tout le temps qu’il faut. Je n’ai rien à faire d’ici demain matin. Faites-moi donc voir ce que vous avez de beau. »
La porte s’ouvrit alors, et une tête apparut, avec un visage beaucoup plus jeune que celui du sacristain, empreint d’un même air de détresse, mais qui semblait être la marque, non pas tant de crainte pour sa propre sécurité, que de vive anxiété pour quelqu’un d’autre. La propriétaire du visage était la fille du sacristain, et l’expression que je viens de décrire mise à part, c’était plutôt une jolie fille. Elle se dérida fort en voyant son père accompagné d’un robuste étranger. La jeune fille ne réagit que par un regard de terreur à quelques remarques faites par son père, et dont Dennistoun ne saisit que ces mots : « Il riait dans l’église. »
Quelques instants plus tard, ils étaient dans la salle commune de la maison. C’était une pièce haute de plafond, petite et dallée, remplie d’ombres fugitives projetées par un feu de bois qui flambait en tremblotant dans une vaste cheminée. Un grand crucifix qui, sur une cloison, atteignait presque le plafond lui donnait un peu l’air d’un oratoire ; le Christ était peint de couleurs naturelles, et la croix était noire. En dessous se trouvait un coffre ancien et massif. On apporta une lampe et des chaises. Le sacristain alla alors au coffre et en tira, avec une émotion et une nervosité grandissantes selon Dennistoun, un gros livre enveloppé d’un linge blanc brodé en fil rouge d’une croix grossière. Avant même que ce linge eût été retiré, la taille et la forme du volume commencèrent à intéresser Dennistoun.
« Trop gros pour un missel, pensait-il, et ce n’est pas la forme d’un antiphonaire. C’est peut-être bien quelque chose d’intéressant, après tout. »
Un instant plus tard, le livre était ouvert, et Dennistoun sentit qu’il avait enfin rencontré mieux que du beau. Un grand in-folio était devant lui, relié sans doute à la fin du XVIIème siècle ; les plats étaient à l’or, frappés des armoiries du chanoine Albéric de Mauléon. Il devait bien y avoir cent cinquante feuillets dans ce livre, et sur chacun était collée une page de manuscrit enluminé. Dennistoun avait à peine osé rêver d’une telle collection à ses moments les plus fantasques. Il y avait là dix pages d’un exemplaire de la Genèse, illustré de miniatures qui dataient d’au moins l’an 700. Un peu plus loin, il y avait une série complète d’enluminures d’un Psautier de travail anglais, de la meilleure sorte que le XIIIème siècle ait pu produire ; et, peut-être ce qu’il y avait de mieux, vingt pages de latin en écriture onciale, qui, ainsi qu’il le vit immédiatement en lisant un mot de place en place, devait appartenir à quelque traité très ancien et inconnu des Pères de l’Église. Cela pouvait-il donc être un fragment de l’exemplaire de Papias « Des paroles de Notre-Seigneur, » que l’on sait avoir existé jusqu’au XIIème siècle à Nîmes ? (2) En tout cas, il avait pris une décision. Il devait coûte que coûte rentrer à Cambridge avec ce livre, même s’il lui fallait retirer tous ses fonds de la banque et rester à Saint Bertrand de Comminges jusqu’à ce que l’argent arrive.
Il jeta un regard au sacristain pour voir si son visage laissait voir si le livre était à vendre.
Le sacristain était très pâle et ses lèvres remuaient.
« Si Monsieur veut bien aller jusqu’au bout, » dit-il.
Donc, Monsieur continua à tourner les pages, rencontrant de nouveaux trésors ; à la fin du livre, il arriva à deux feuilles de papier de date beaucoup plus récente que tout ce qu’il avait vu jusque-là, qui l’intriguèrent beaucoup. Elles devaient être contemporaines du chanoine Albéric, ce malhonnête homme qui avait sans aucun doute pillé la bibliothèque du chapitre de Saint Bertrand pour composer ce précieux album. Sur la première de ces pages, il y avait un plan dessiné avec soin et reconnaissable à l’instant pour quelqu’un qui connaissait le terrain, comme le bas-côté sud et le cloître de la cathédrale de Saint Bertrand. Il y avait des signes étranges ressemblant à des symboles planétaires, et quelques mots d’hébreu dans les coins ; à l’angle nord-ouest du cloître, on voyait une croix dessinée à l’or. En dessous du plan, on lisait quelques lignes manuscrites de Latin :
« Responsa 12mi Dec. 1694. Interrogatum est : Inveniamne ? Responsum est : Invenies. Fiamne dives ? Fies. Vivamne invidendus ? Vives. Moriarne in lecto meo ? Ita. »
(Réponses du 12 décembre 1694. On demanda : Le trouverai-je ? Réponse : Tu le trouveras. Deviendrai-je riche ? Tu le deviendras. Serai-je envié pendant ma vie ? Tu le seras. Mourrai-je dans mon lit ? Tu y mourras.)
« Très bon spécimen des notes d’un chercheur de trésors. Ça me rappelle celles du Monsieur Quatremain du vieux Saint Paul, chanoine sans prébende du chapitre, » commenta Dennistoun, et il tourna la page.
Il n’aurait jamais pu imaginer, comme il me l’a souvent dit, qu’un dessin ou une peinture eût jamais le pouvoir de faire sur lui une impression aussi forte que celle qu’il éprouva alors. Et quoique le dessin qu’il vit n’existe plus depuis longtemps, il y en a une photographie que je possède, qui confirme pleinement cette déclaration. L’image en question était un dessin à la sépia de la fin du XVIIème siècle ; elle représentait, on pouvait le dire à première vue, une scène biblique ; car l’architecture (le dessin représentait un intérieur) et les personnages avaient ce parfum à demi classique que les artistes d’il y a deux cents ans croyaient convenir aux illustrations de la Bible. À droite, un roi sur son trône élevé de douze degrés et surmonté d’un dais ; des soldats de chaque côté. C’était évidemment le roi Salomon. Il était penché en avant, tendant son sceptre dans une attitude de commandement ; son visage exprimait horreur et dégoût, et cependant il avait aussi l’expression du commandement impérieux et du pouvoir confiant. La moitié gauche du dessin était cependant la plus étrange. C’était évidemment là que tout l’intérêt était rassemblé.
Sur le dallage devant le trône, quatre soldats étaient groupés et entouraient un être accroupi que nous allons bientôt décrire. Un cinquième soldat était étendu mort sur le sol ; son cou était tordu, et les globes de ses yeux sortaient de sa tête. Les quatre gardes vivants regardaient le roi. Le sentiment d’horreur était plus intense encore sur leur visage : en fait, leur confiance aveugle en leur maître semblait seule les empêcher de fuir. Toute cette terreur était visiblement produite par l’être qui était accroupi au milieu d’eux.
Je désespère de pouvoir décrire par des paroles l’impression que cet être produit sur quiconque le regarde. Je me souviens avoir montré une fois la photographie du dessin à un chargé de cours en morphologie – j’allais dire à quelqu’un à l’esprit prosaïque et bien équilibré au-delà de la normale. Il refusa absolument d’être seul pour le reste de la soirée, et il me dit plus tard qu’il n’avait pas osé éteindre sa lumière avant de s’endormir pendant bien des nuits. Cependant, je peux, pour le moins, indiquer les principaux traits de cette créature.
Tout d’abord, on ne voyait qu’une masse de poils raides et d’un noir mat ; mais bientôt on se rendait compte que cela recouvrait un corps d’une maigreur effrayante, presque un squelette, mais dont les muscles ressortaient comme des fils métalliques. Les mains étaient d’une pâleur noirâtre, couvertes, comme le corps, de longs poils rudes ; les ongles étaient affreusement longs. Les yeux, retouchés de jaune ardent, avaient des pupilles d’un noir intense, et étaient fixés sur le roi avec un regard de haine bestiale. Imaginez l’une de ces horribles araignées mangeuses d’oiseaux de l’Amérique du Sud, traduite sous une forme humaine, et pourvue d’une intelligence à peine inférieure à l’intelligence humaine, et vous aurez une vague conception de la terreur qu’inspirait l’effroyable forme. Tous ceux à qui j’ai montré cette image font la même remarque : « Mais, cela a été dessiné d’après nature. »
Le premier saisissement d’irrésistible frayeur à peine passé, Dennistoun jeta un regard à ses hôtes. Les mains du sacristain étaient pressées sur ses yeux ; sa fille égrenait fiévreusement son chapelet et regardait le crucifix fixé au mur. Enfin, il posa cette question : « Est-ce que ce livre est à vendre ? »
Il y eut la même hésitation, la même décision soudainement prise qu’il avait remarquées auparavant, et alors ce fut cette réponse bienvenue :
« Si Monsieur le désire.
– Combien en demandez-vous ?
– J’accepterai 250 francs. »
C’était déconcertant. Même la conscience d’un collectionneur est parfois troublée, et la conscience de Dennistoun était moins endurcie que celle d’un collectionneur.
« Mais, mon brave homme, dit-il à plusieurs reprises, votre livre vaut beaucoup plus que 250 francs, je vous assure, beaucoup plus. »
Mais la réponse fut invariable : « J’accepterai 250 francs, pas plus. »
Il n’était vraiment pas possible de refuser une pareille occasion. L’argent fut versé, le reçu signé ; on but un verre de vin pour sceller le contrat, et le sacristain sembla devenir un nouvel homme. Il se tenait droit et cessa de jeter des regards soupçonneux derrière lui ; il rit même, ou essaya de rire. Dennistoun se leva pour partir.
« Puis-je avoir l’honneur d’accompagner Monsieur jusqu’à son hôtel ? dit le sacristain.
– Oh, non, merci ! C’est à peine à cent mètres d’ici. Je connais très bien le chemin, et il fait clair de lune. »
L’offre fut faite avec insistance trois ou quatre fois, et Dennistoun la refusa chaque fois.
« Alors, Monsieur me fera venir si… s’il en trouve l’occasion ; qu’il garde le milieu de la route ; les bas-côtés sont si pierreux.
– Bien sûr, certainement ! » dit Dennistoun, qui était impatient d’examiner sa trouvaille tout seul ; et il sortit dans le couloir, le livre sous son bras.
Là, il rencontra la fille du sacristain ; il semblait qu’elle aussi fût anxieuse de faire un peu de commerce à son compte ; peut-être, tout comme Gehazi, de « prélever quelque chose » sur l’étranger que son père avait épargné.
« Une croix d’argent et sa chaîne pour mettre autour de votre cou ; peut-être Monsieur voudra-t-il bien l’accepter ? »
Enfin, quoi ! Dennistoun n’avait guère besoin de ces choses-là. Combien Mademoiselle en voulait-elle ?
« Mais, rien ! rien du tout. C’est de bon cœur que je l’offre à Monsieur. »
Le ton sur lequel elle dit ceci, et encore bien d’autres choses, était sincère à ne pas s’y méprendre, de sorte que Dennistoun en fut réduit à se confondre en remerciements ; et il accepta que la chaîne lui fût passée autour du cou. Il semblait vraiment qu’il eût rendu au père et à la fille un service qu’ils ne savaient comment payer. Quand il s’éloigna avec son livre, ils le regardèrent, debout sur leur seuil, et ils étaient encore dans la même position quand il leur dit une dernière fois bonne nuit d’un signe de la main du haut des marches du Chapeau Rouge.
Le dîner était terminé, et Dennistoun s’était enfermé dans sa chambre avec son acquisition. La propriétaire avait pris pour lui un intérêt tout spécial depuis qu’il lui avait dit qu’il avait été chez le sacristain et que celui-ci lui avait vendu un vieux livre. Il lui sembla aussi qu’il avait entendu un dialogue rapide entre elle et ce même sacristain dans le couloir, en dehors de la salle à manger ; la conversation s’était terminée par quelques paroles dont le sens était que Pierre et Bertrand allaient dormir dans la maison.
Cependant, une sensation croissante de gêne avait envahi Dennistoun. Sans doute une réaction nerveuse après le plaisir de la découverte. En tout cas, il avait la sensation que quelqu’un était derrière lui, et il se sentait beaucoup mieux quand il avait le dos contre le mur. Naturellement, ceci avait bien peu d’importance en comparaison de la valeur de la collection qu’il venait d’acquérir. Il était maintenant, ainsi que je l’ai déjà dit, seul dans sa chambre, et il faisait l’inventaire des trésors du chanoine Albéric, qui à chaque instant révélaient des pages encore plus charmantes.
« Que le chanoine Albéric soit béni ! dit Dennistoun qui avait l’habitude invétérée de parler tout haut. Je me demande où il est maintenant ? Ah, mon Dieu ! je souhaiterais que cette propriétaire apprenne à rire de manière plus réjouissante : on croirait que quelqu’un est mort dans la maison. Encore la moitié d’une pipe, as-tu dit ? Tu as peut-être raison, après tout. Je me demande quel genre de crucifix cette jeune femme m’a donné ? Sans doute du siècle dernier ; oui, probablement. C’est plutôt une chose gênante à avoir autour du cou… c’est trop lourd. Il est bien probable que son père l’a porté pendant des années. Je pourrais bien le nettoyer avant de le ranger… »
Il avait retiré le crucifix et l’avait posé sur la table quand son attention fut attirée par un objet reposant sur le drap rouge tout à côté de son coude gauche. Deux ou trois idées de ce que cela pouvait être lui traversèrent l’esprit avec la rapidité de l’éclair.
« Un essuie-plume ? non, rien de semblable dans la maison. Un rat ? non, c’était trop noir. Une grosse araignée ? ce n’était pas possible… non… Grand Dieu, une main comme celle du dessin ! »
En une autre fraction de seconde, il avait enregistré cette vision : une peau pâle, noirâtre, ne couvrant que des os et des tendons d’une force effroyable ; des poils noirs et rudes plus longs qu’aucun poil n’a jamais poussé sur des mains humaines ; des ongles qui croissaient du bout des doigts et qui se recourbaient en avant, des ongles gris, ridés et comme de la corne.
Il bondit hors de son fauteuil ; une terreur mortelle et inconcevable envahissait son cœur. L’être dont la main gauche reposait sur la table se levait pour se tenir debout derrière son siège ; et sa main était recourbée au-dessus de son crâne. Autour de cette forme pendait une tenture noire et en lambeaux ; des poils rudes la couvraient comme dans le dessin. La mâchoire inférieure était mince, (comment devrais-je dire ?) – étroite comme celle d’une brute ; des dents se montraient derrière les lèvres noires ; cette face n’avait pas de nez ; les yeux d’un jaune enflammé sur lesquels se détachaient les pupilles d’un noir intense, et la haine et la soif de détruire la vie qui s’y lisaient, étaient les traits les plus épouvantables de cette vision entière. Il y avait dans ces yeux une sorte d’intelligence ; une intelligence supérieure à celle de la brute, mais cependant inférieure à celle de l’homme.
Les sensations que cette horreur remuèrent en Dennistoun furent celles de la plus intense peur physique, et de l’aversion spirituelle la plus profonde. Que fit-il ? que pouvait-il faire ? Il n’a jamais été absolument certain des paroles qu’il prononça, mais il sait qu’il parla ; qu’il s’empara avec une ardeur aveugle du crucifix d’argent ; qu’il eut conscience d’un mouvement fait vers lui par le démon, et qu’il hurla avec la voix d’un animal saisi d’un mal horrible.
Pierre et Bertrand, les deux vigoureux domestiques, qui se précipitèrent à l’intérieur de la pièce, ne virent rien, mais ils se sentirent poussés par quelque chose qui passait entre eux deux, et ils trouvèrent Dennistoun évanoui.
Ils veillèrent auprès de lui cette nuit-là et ses deux amis arrivèrent à Saint Bertrand vers neuf heures le lendemain matin. Quoique encore ébranlé et ému, il était presque revenu à son état normal, et ses amis prêtèrent foi à son histoire ; ils durent cependant voir auparavant le dessin et parler au sacristain pour être convaincus.
À l’aube, le petit bonhomme était venu à l’auberge sous un prétexte quelconque, et il avait écouté avec le plus grand intérêt l’histoire racontée par le propriétaire. Il ne manifesta aucune surprise.
« C’est lui ! C’est bien lui ! Je l’ai vu moi-même, » fut son seul commentaire ; et il n’accorda qu’une seule réponse à toutes les questions qui lui furent posées : « Deux fois, je l’ai vu ; mille fois, je l’ai senti. » Il ne voulut rien dire de la provenance du livre, ni donner aucun détail sur ses épreuves personnelles. « Bientôt, je m’endormirai du sommeil éternel, et mon repos sera bien doux. Pourquoi donc me tourmenteriez-vous ? » dit-il. (3)
Nous ne saurons jamais combien lui ou le chanoine Albéric de Mauléon souffrirent. Au dos de ce dessin fatal se trouvaient quelques lignes manuscrites qui jettent probablement quelque lumière sur ces événements :
« Contradictio Salomonis cum demonio nocturno.
Albericus de Mauleone delineavit.
V. Deus in adiutorium. Ps. Qui habitat.
Sancte Betrande, demoniorum effugator, intercede pro me miserrimo.
Primum uidi nocte 12mi Dec. 1694 ; uidebo mox ultimum. Peccaui et passus sum, plura adhuc passurus. Dec. 29, 1701. » (4)
Je n’ai jamais exactement compris le point de vue de Dennistoun sur les événements que je viens de raconter. Il me cita un jour un texte de l’Ecclésiaste : « Il y a certains esprits qui sont créés pour la vengeance et qui, dans leur rage, imposent des coups terribles. » Une autre fois, il me dit : « Isaïe était un homme très raisonnable ; n’a-t-il pas dit quelque chose au sujet des montres nocturnes qui vivaient dans les ruines de Babylone ? Ces choses sont plutôt hors de notre portée, maintenant. »
Une autre confidence qu’il me fit m’impressionna plutôt, et je m’associai avec ses sentiments. Il y a un an, nous sommes allés à Comminges pour voir le tombeau du chanoine Albéric. C’est une grande construction de marbre avec la statue du chanoine portant une grande perruque et une soutane. Un éloge compliqué de son érudition se lit en dessous de la statue. Je vis que Dennistoun parlait pendant quelque temps avec le curé de Saint Bertrand ; en partant, il me dit :
« J’espère que je n’ai pas eu tort. Vous savez que je suis presbytérien, mais je… je crois qu’on va dire une messe et qu’on chantera des hymnes funèbres pour le repos d’Albéric de Mauléon. » Puis il ajouta, avec une inflexion de voix du Nord des Îles Britanniques : « Je n’avais pas idée qu’elles revenaient si cher. »
Le livre est dans la Wentworth Collection à Cambridge. Dennistoun photographia le dessin, puis le brûla le jour qu’il quitta Comminges lors de sa première visite.
_____
(1) Plantin (Christophe) : imprimeur établi à Anvers (1520-1589). [Ndt]
(2) On sait maintenant que ces pages contenaient en effet un extrait considérable de ce texte, sinon de l’exemplaire original.
(3) Il mourut cet été-là ; sa fille se maria et s’établit à Saint Papoul. Elle ne comprit jamais les détails de l’obsession de son père.
(4) « La lutte de Salomon contre un démon de la nuit. Dessiné par Albéric de Mauléon. Verset : Ô Seigneur, hâte-toi de me sauver. Psaume : Qui habitat. Saint Bernard, vous qui faites fuir les démons, priez pour moi, qui suis si malheureux. Je l’ai vu pour la première fois pendant la nuit du 12 décembre 1694 ; bientôt, je le verrai pour la dernière fois. J’ai péché et j’ai souffert, et je dois encore souffrir davantage. Le 29 décembre 1701. »
Les Gallia Christiana * donnent la date de la mort du chanoine : le 31 décembre 1701, « au lit, d’une apoplexie foudroyante. » Des détails de ce genre ne se trouvent pas fréquemment dans la grande œuvre des frères Sammarthanus.
* Gallia Christiana : histoire des évêchés et des monastères de la France (XVIIème et XVIIIème siècles). [Ndt]

CŒURS PERDUS
_____
C’était, autant que j’ai pu l’établir, en septembre 1811 qu’une chaise de poste s’arrêta devant la porte d’Aswarby Hall, au cœur du Lincolnshire. Le petit garçon qui était le seul occupant de la chaise et qui en sauta dès qu’elle se fut arrêtée, regarda autour de lui avec la curiosité la plus vive pendant le court moment qui s’écoula entre son coup de sonnette et l’ouverture de la porte du vestibule. Il vit une maison de briques rouges, haute et carrée, construite sous le règne de la reine Anne ; un porche soutenu par des colonnes de pierre avait été ajouté dans le plus pur style classique de 1790 ; les fenêtres de la maison étaient nombreuses, hautes et étroites, avec de petits carreaux et de massives boiseries blanches. Un fronton percé d’une fenêtre ronde couronnait la façade. Il y avait une aile sur la droite et une sur la gauche réunies au bâtiment central par d’étranges galeries vitrées et supportées par des colonnades. Il était évident que les ailes contenaient les écuries et les communs du château. Chacune était surmontée d’une coupole ornementale avec une girouette dorée.
Les lueurs du crépuscule, en illuminant le bâtiment, faisaient briller chacune des vitres avec l’intensité d’un feu. À quelque distance devant le Hall, s’étendait un parc sans relief parsemé de chênes et frangé de sapins, qui se découpaient sur le ciel. L’horloge du clocher de l’église, enseveli dans les arbres à la lisière du parc, et dont seul le coq doré reflétait le soleil, sonnait six heures, et le doux son en arrivait sur les ailes du vent. C’était une impression agréable, quoique nuancée de l’espèce de mélancolie particulière à une soirée du début de l’automne, qui se présentait à l’esprit de l’enfant qui, sous le porche, attendait que la porte lui fût ouverte.
La chaise de poste l’avait amené du Warwickshire, où, environ six mois auparavant, il était devenu orphelin. Maintenant, grâce à l’offre généreuse de son vieux cousin, Mr. Abney, il venait demeurer à Aswarby. L’offre était inattendue, car tous ceux qui connaissaient Mr. Abney le considéraient comme un solitaire tant soit peu austère ; la venue d’un petit garçon apporterait donc un élément nouveau, et en apparence disparate, dans sa maison aux habitudes bien réglées. La vérité est qu’on ne savait que très peu de chose sur les activités de Mr. Abney. On avait entendu le professeur de grec de Cambridge dire que personne ne connaissait mieux les croyances religieuses des derniers païens que le propriétaire d’Aswarby. Sans aucun doute, sa bibliothèque contenait tous les livres publiés jusqu’alors sur les Mystères, les poèmes orphiques, le culte de Mithra et les néo-platoniciens. Dans le vestibule pavé de marbre se dressait un beau groupe de Mithra immolant un taureau, qui avait été importé à grands frais du Levant par le propriétaire. Il avait collaboré au Gentleman’s Magazine par une description de ce groupe, et il avait écrit une série remarquable d’articles dans le Critical Museum sur les superstitions des Romains du Bas-Empire. Bref, on le considérait comme un homme submergé dans ses livres, et ce fut une grande surprise parmi ses voisins d’apprendre qu’il eût jamais entendu parler de son cousin orphelin, Étienne Elliott, et, qui plus est, qu’il se soit offert à en faire un habitant d’Aswarby Hall.
En dépit de ce que ses voisins avaient pu croire, il est certain que Mr. Abney, – le grand, maigre, austère Mr. Abney, – semblait enclin à recevoir son jeune cousin avec bienveillance. Le moment même que la porte de façade fut ouverte, il se précipita en dehors de son cabinet de travail, se frottant les mains de plaisir.
« Comment vas-tu, mon garçon ? comment vas-tu ? Quel âge as-tu ? dit-il, c’est-à-dire, tu n’es pas trop fatigué par ton voyage, j’espère, pour manger ton souper ?
– Non, merci, Monsieur, dit le jeune Elliott ; ça ne va pas mal.
– En voilà un bon gars ! s’écria Mr. Abney. Et quel âge as-tu donc, mon enfant ? »
Il semblait tant soit peu étrange qu’il ait dû poser cette question deux fois au cours des deux premières minutes qui suivirent leur première rencontre.
« J’aurai douze ans à mon prochain anniversaire, Monsieur, dit Étienne.
– Et c’est quand, ton anniversaire, mon cher enfant ? Le onze septembre, hein ? C’est bien, c’est très bien ! Dans presque un an, n’est-ce pas ? J’aime, ah, ah ! j’aime mettre ces choses-là dans mon annuaire. Tu es sûr que c’est douze ans ? certain ?
– Oui, tout à fait sûr, Monsieur.
– Bon, très bien ! Menez-le à la chambre de Mrs. Bunch, Parkes, et donnez-lui son thé, ou son dîner, ou ce que ça peut être…
– Oui, Monsieur, » répondit le tranquille Mr. Parkes ; et il conduisit Étienne vers les régions inférieures.
Mrs. Bunch était la personne de la plus confortable et humaine apparence qu’Étienne eût encore rencontrée à Aswarby. Elle le fit se sentir tout à fait à son aise ; en l’espace d’un quart d’heure, ils devinrent une paire d’amis ; et ils demeurèrent tels. Mrs. Bunch était née dans les environs quelque cinquante-cinq ans avant la date de l’arrivée d’Étienne, et son séjour au Château datait de vingt ans. Par conséquent, si quelqu’un connaissait choses et gens de la maison et des alentours, c’était Mrs. Bunch ; et elle n’était en aucune manière rebelle à transmettre ses connaissances.
Il y avait assurément beaucoup de choses sur le château et ses jardins au sujet desquelles Étienne était très désireux d’avoir des explications, car il était d’esprit aventureux et questionneur. « Qui a bâti le temple au bout de l’allée de lauriers ? Qui était le vieillard assis à une table, un crâne sous sa main, dont le portrait était pendu dans l’escalier ? » Ces questions, ainsi que d’autres semblables, furent éclaircies grâce aux ressources de la profonde intelligence de Mrs. Bunch. Il y en avait d’autres cependant, dont les explications qu’en donna Mrs. Bunch furent moins satisfaisantes.
Un soir de novembre, Étienne était assis auprès du feu dans la chambre de la femme de charge, et songeait à ce qui l’environnait.
« Mr. Abney est-il bon et ira-t-il au Paradis ? » demanda-t-il soudain, avec la confiance singulière que les enfants ont dans le pouvoir de leurs aînés de décider de telles questions, dont on croit que la solution ressort à d’autres tribunaux.
« Bon ?… Quelle idée de gosse ! dit Mrs. Bunch. Mon maître est la meilleure âme que j’aie jamais vue ! Ne vous ai-je jamais parlé du petit garçon qu’il ramassa dans la rue, comme qui dirait, il y a sept ans ? et de la petite fille, deux ans après mon arrivée ici ?
– Non. Oh ! parlez moi donc d’eux, Mrs. Bunch, maintenant, tout de suite !
– Eh bien ! dit Mrs. Bunch, la petite fille… il ne me semble pas que je m’en souvienne bien. Je sais que le patron la ramena avec lui de sa promenade un beau jour, et donna des ordres à Mrs. Ellis, qu’était la femme de charge d’alors, de bien s’en occuper. Et la pauv’ gosse n’avait presque personne à elle (c’est elle qui m’a dit ça, elle-même), et elle vécut ici avec nous, peut-être trois semaines ; et puis, soit qu’elle ait eu du bohémien dans le sang, ou quelque chose d’autre, bref, un beau matin, elle était sortie du lit avant qu’aucun de nous n’ait ouvert l’œil, et depuis, on n’a jamais pu trouver trace d’elle. Mon maître s’est retourné dans toutes les directions pour elle, et il fit draguer les étangs, mais c’est mon idée vraie, qu’elle a été emmenée par les bohémiens, car il y avait des chants et de la musique autour de la maison pendant au moins une heure la nuit qu’elle est partie, et Parkes dit qu’il les avait entendus appeler dans les bois tout cet après-midi-là. Ah, mon Dieu ! une drôle d’enfant, qu’elle était, si silencieuse de ses habitudes, et tout ça, mais je l’avais prise en affection, si bonne petite ménagère qu’elle était… surprenant que c’était !
– Et qu’est-ce qui est arrivé au petit garçon ? dit Étienne.
– Ah ! ce pauv’ gosse, soupira Mrs. Bunch, c’était un étranger ; Jevanny, qu’il s’appelait ; et le voilà qui arrive un jour d’hiver par l’avenue, tournant son orgue de Barbarie, et le patron le fit entrer sur le moment même, et lui demanda d’où il venait, et quel âge qu’il avait, et où était sa famille, et tout ça, aussi gentiment que le cœur peut le désirer. Mais, tout se passa de même avec lui. Je crois que tous ces étrangers-là, ils sont turbulents, et, un beau matin, il avait disparu, tout comme la fillette. Pourquoi il partit, et ce qu’il fit, nous nous le sommes demandé pendant au moins une année ; c’est qu’il n’avait pas emporté son orgue de Barbarie, et le v’là là sur le rayon. »
La fin de la soirée se passa pour Étienne à faire subir un interrogatoire serré et varié à Mrs. Bunch, et à s’essayer à extraire un air de l’orgue de Barbarie.
Cette nuit-là, il eut un rêve étrange. Au bout du couloir en haut de la maison, où se trouvait sa chambre à coucher, il y avait une vieille salle de bains qui ne servait plus. On la tenait fermée à clef, mais la partie supérieure de la porte était vitrée, et puisque les rideaux de mousseline qui autrefois y étaient pendus avaient disparu depuis longtemps, on pouvait regarder à l’intérieur et voir la baignoire doublée de plomb, dont le chevet était tourné vers la fenêtre, et qui était scellée au mur à droite.
La nuit dont je parle, Étienne Elliott se prit, ainsi pensait-il, à regarder à travers la porte vitrée. La lune brillait par la fenêtre, et il contemplait une forme qui était couchée dans la baignoire.
Sa description de ce qu’il vit me rappelle ce que je vis moi-même dans les célèbres caveaux de l’église Saint Michan à Dublin, qui ont l’horrible propriété de conserver intacts les cadavres pendant des siècles ; une forme incroyablement maigre et pitoyable, d’une couleur de plomb poussiéreux, enveloppée d’un vêtement semblable à un suaire, aux minces lèvres tordues en un sourire mince et affreux, les mains étroitement pressées sur la région du cœur.
Alors qu’il regardait cette silhouette, un gémissement lointain et presque imperceptible sembla s’échapper de ses lèvres, et ses bras commencèrent à bouger. L’horreur de ce spectacle força Étienne à reculer, et il se réveilla pour constater qu’il était en effet debout sur le plancher froid du couloir, en pleine clarté de la lune. Avec un courage, que je ne pense pas être fréquent chez des enfants de son âge, il alla à la porte de la salle de bains pour se rendre compte si la forme de son rêve y était réellement. Elle n’y était pas, et il retourna au lit.
Le lendemain matin, Mrs. Bunch fut très impressionnée par son récit et alla jusqu’à remplacer le rideau de mousseline à la porte vitrée de la salle de bains. En outre, Mr. Abney, à qui il raconta son aventure au petit déjeuner, s’y intéressa beaucoup, et nota l’affaire dans ce qu’il appelait « son livre. »
L’équinoxe de printemps approchait ; Mr. Abney le rappelait souvent à son cousin, et ajoutait que cette époque avait toujours été considérée par les Anciens comme une période critique pour les jeunes ; qu’Étienne ferait bien de faire attention, et de fermer la fenêtre de sa chambre la nuit ; et que Censorinus (1) avait formulé quelques remarques très intéressantes à ce sujet. Deux incidents qui eurent lieu à peu près à cette époque firent impression sur l’esprit d’Étienne.
Le premier fut après une nuit particulièrement agitée et oppressée, quoiqu’il lui fût impossible de se souvenir d’aucun rêve particulier. Ce soir-là, Mrs. Bunch était occupée à réparer sa chemise de nuit.
« Miséricorde ! monsieur Étienne, s’exclama-t-elle avec mauvaise humeur, comment faites-vous pour déchirer votre chemise de nuit tout en lambeaux comme cela ? Voyons, monsieur, quel travail vous donnez aux pauvres domestiques qui doivent repriser et raccommoder ! »
Il y avait en effet une série de déchirures et de marques dans le vêtement, faites dans le but de détruire, semblait-il, et une aiguille habile serait certainement indispensable pour en effectuer la réparation. Ces déchirures étaient confinées au côté gauche de la poitrine ; elles étaient longues d’environ six pouces, parallèles, et certaines d’entre elles n’avaient pas complètement traversé l’étoffe. Étienne ne put qu’exprimer son entière ignorance de leur origine : il était sûr qu’elles n’y étaient pas la veille au soir.
« Mais, dit-il, Mrs. Bunch, elles sont exactement semblables aux égratignures qui se trouvent à l’extérieur de la porte de ma chambre : et je suis certain que je ne les ai jamais faites. »
Mrs. Bunch le contempla la bouche ouverte, puis, saisissant une chandelle, elle quitta la pièce à la hâte, et on l’entendit monter l’escalier. Au bout de quelques minutes, elle redescendit.
« Eh bien ! dit-elle, Monsieur Étienne, ça me semble une drôle de chose comment ces marques et ces égratignures-là ont pu arriver là ; trop hautes pour qu’aucun chat ou aucun chien ait pu les faire ; encore moins un rat ; mais en tout point semblables aux traces qu’auraient pu laisser les ongles d’un Chinois, comme mon oncle dans le commerce du thé avait l’habitude de nous décrire quand nous étions fillettes toutes ensemble. Si j’étais de vous, Monsieur Étienne, mon chéri, je n’en dirais pas un mot au patron ; et fermez bien votre porte à clef quand vous vous couchez.
– C’est ce que je fais toujours, Mrs. Bunch, dès que j’ai dit mes prières.
– En voilà un enfant sage ! dites toujours bien vos prières, et alors personne ne peut vous faire du mal. »
Ceci dit, Mrs. Bunch se mit en devoir de réparer la chemise de nuit endommagée, avec un arrêt de temps en temps pour méditer, jusqu’à l’heure du lit. Ceci se passait un vendredi soir de mars 1812.
Le lendemain soir, le tête-à-tête habituel d’Étienne et de Mrs. Bunch fut augmenté par l’arrivée soudaine de Mr. Parkes, le sommelier, qui d’habitude se tenait plutôt compagnie à lui-même dans son office. Il ne vit pas qu’Étienne était là ; en outre, il était bouleversé, et son débit était plus rapide que d’habitude.
« Le patron peut bien aller chercher son vin lui-même le soir s’il veut, fut sa première observation. Ou bien je le fais en plein jour ou pas du tout, Mrs. Bunch. Je ne sais pas ce que ça peut être : il est très vraisemblable que ce soit les rats qui sont entrés dans les caves, ou le vent ; mais je ne suis plus aussi jeune qu’avant, et je ne puis plus supporter cela comme autrefois.
– Mon Dieu ! Mr. Parkes, vous savez que le château, c’est un endroit étonnant en ce qui concerne les rats.
– Je ne dis pas le contraire, Mrs. Bunch ; et, bien sûr, j’ai entendu plus d’une fois les hommes des chantiers navals me raconter l’histoire du rat qui pouvait parler. Jusqu’à maintenant, je n’y avais jamais cru ; mais ce soir, si je m’étais abaissé à poser mon oreille contre la porte du dernier casier à bouteilles, j’aurais pu entendre joliment bien ce qu’ils disaient.
– Oh, allons donc ! Mr. Parkes, vous m’impatientez avec toutes vos lubies. Des rats qui parlent dans la cave, ça non !
– Eh bien ! Mrs. Bunch, je n’ai pas l’intention de raisonner avec vous. Tout ce que je dis est que si vous décidez d’aller au dernier casier à bouteilles, et si vous mettez votre oreille contre la porte, vous pourrez avoir sur-le-champ la preuve de ce que je vous dis.
– Quelles âneries vous racontez, Mr. Parkes… et encore, pas faites pour des oreilles d’enfant ! Voyez donc, vous allez faire une peur bleue à Monsieur Étienne.
– Quoi ! Monsieur Étienne ? dit Parkes, se rendant compte soudain de la présence de l’enfant. Monsieur Étienne sait trop bien quand je blague avec vous, Mrs. Bunch. »
En fait, le jeune Étienne savait trop bien à quoi s’en tenir pour supposer que Mr. Parkes avait eu l’intention de plaisanter dès le début. Cet état de choses l’intéressait, quoique de manière plutôt désagréable ; mais toutes ses questions ne parvinrent pas à décider le sommelier à donner un récit plus détaillé de ses aventures dans la cave.
Nous sommes maintenant arrivés au 24 mars 1812. Ce fut un jour de sensations étranges pour Étienne ; un jour tumultueux et de grand vent, qui remplissait la maison et les jardins d’inquiétude. Alors qu’Étienne se tenait auprès de la clôture du domaine et regardait vers l’intérieur du parc, il eut l’impression qu’un défilé incessant de personnages invisibles passaient rapidement dans le vent, emportés irrésistiblement et sans but, s’efforçant en vain de s’arrêter, de saisir quelque chose qui puisse arrêter leur vol, et les mettre en contact à nouveau avec le monde des vivants, dont ils avaient fait partie autrefois. Après le déjeuner ce jour-là, Mr. Abney dit :
« Étienne, mon enfant, crois-tu que tu pourrais t’arranger pour venir me voir ce soir dans mon bureau, même aussi tard que onze heures ? Je serai occupé jusqu’alors, et je veux te montrer quelque chose qui se rapporte à ta vie future, et qu’il est de la plus grande importance que tu saches. Il ne faut pas en faire mention à Mrs. Bunch, ni à personne d’autre dans la maison ; et tu ferais aussi bien de monter dans ta chambre à l’heure habituelle. »
C’était là un nouveau plaisir ajouté à la vie à Aswarby : Étienne saisit avec empressement l’occasion de rester debout jusqu’à onze heures. Il jeta un regard dans la bibliothèque en passant devant la porte ce soir-là lorsqu’il monta se coucher, et il vit qu’un brûle-parfums, souvent remarqué par lui dans un coin de la pièce, avait été placé devant le feu ; une vieille coupe d’argent doré remplie de vin rouge était sur la table, et quelques feuilles de papier couvertes d’écriture se trouvaient à côté. Mr. Abney éparpillait de l’encens avec une boîte d’argent ronde dans le brûle-parfums lorsqu’Étienne passa, mais il ne sembla pas remarquer son pas.
Le vent était tombé ; la nuit était calme et la lune pleine. À environ dix heures, Étienne était debout devant la fenêtre ouverte de sa chambre à coucher, et regardait dans la campagne. Si calme que la nuit fût, la population mystérieuse des bois lointains éclairés par la lune ne s’était pas encore apaisée. De temps en temps, d’étranges clameurs semblables à celles de voyageurs perdus et désespérés résonnaient à travers l’étang. Elles auraient pu être les cris de hiboux ou d’oiseaux aquatiques ; cependant, elles ne ressemblaient à aucun de ces deux bruits. Mais, ne s’approchaient-elles pas ? Maintenant, elles retentissaient de ce côté-ci de l’eau, et, quelques minutes plus tard, elles semblaient flotter parmi les massifs d’arbustes. Alors, elles s’arrêtèrent. Mais juste au moment où Étienne avait l’intention de fermer la fenêtre et de continuer sa lecture de Robinson Crusoë, il aperçut deux silhouettes debout sur la terrasse sablée qui courait le long du château du côté du jardin… les silhouettes d’un petit garçon et d’une petite fille, semblait-il. Ils étaient debout l’un à côté de l’autre, et regardaient vers les fenêtres. Quelque chose dans l’aspect de la fillette rappelait irrésistiblement son rêve de la silhouette de la baignoire. Le garçonnet lui inspira encore une peur plus intense.
Alors que la fillette se tenait debout sans bouger, souriant à demi, et les mains enlacées sur son cœur, le garçon, forme mince, avec des cheveux noirs et des vêtements en lambeaux, levait les bras en l’air, avec un air de menace, de faim et de désir insatiables. La lune éclairait ses mains presque transparentes, et Étienne vit que ses ongles étaient affreusement longs et que la lumière les traversait… Ainsi debout, les bras levés, il décelait un spectacle terrifiant. Sur la gauche de sa poitrine s’ouvrait une déchirure noire et béante ; et alors Étienne eut l’impression, cérébrale plutôt qu’auditive, d’enregistrer l’un de ces cris affamés et désolés qu’il avait entendus résonner toute cette soirée-là parmi les bois d’Aswarby. Quelques instants plus tard, ce couple effroyable avait glissé rapidement et sans bruit sur le gravier sec, et il ne les vit plus.
Si terrifié qu’il fût, il décida de prendre sa chandelle et de descendre au bureau de Mr. Abney, car l’heure fixée pour leur rendez-vous approchait. Ce bureau, ou bibliothèque, s’ouvrait sur un côté du vestibule de façade, et Étienne, poussé par la terreur, ne fut pas long à y arriver. Mais y entrer ne fut pas si facile. La porte n’était pas fermée à clef, il en était sûr, car la clef était à l’extérieur comme à l’habitude. Ses coups répétés ne provoquèrent aucune réponse. Mr. Abney était occupé : il parlait. Quoi ! pourquoi essayait-il de pousser un cri ? et pourquoi le cri s’étouffait-il dans sa gorge ? Avait-il, lui aussi, vu les mystérieux enfants ? Mais maintenant tout était calme, et la porte céda sous la poussée effrénée et épouvantée d’Étienne.
*
Sur la table, dans le bureau de Mr. Abney, on trouva certains papiers qui expliquèrent la situation à Étienne Elliott quand il fut en âge de les comprendre. Les passages les plus importants étaient les suivants :
« Les Anciens (dont les connaissances sur ce sujet ont été étudiées par moi à un tel point que je suis amené à mettre ma confiance dans leurs affirmations) croyaient fermement et d’une manière générale qu’en utilisant certains procédés, qui, pour nous, Modernes, ont un caractère tant soit peu barbare, un très remarquable éclaircissement des facultés humaines pouvait être acquis : que, par exemple, en absorbant la personnalité d’un certain nombre de ses semblables, un individu peut acquérir une ascendance complète sur les classes d’esprits qui contrôlent les forces élémentaires de notre univers.
On rapporte de Simon Magus (2) qu’il pouvait voler, devenir invisible, ou prendre toute forme désirée, par l’entremise de l’âme d’un jeune garçon que, pour me servir de l’expression calomnieuse utilisée par l’auteur des « Clementine Recognitions, » il avait « assassiné. » En outre, il est indiqué très en détail dans les écrits de Hermes Trismegistus, que des résultats également heureux peuvent être produits par l’absorption des cœurs d’au moins trois êtres humains qui n’ont pas encore atteint l’âge de vingt-et-un ans. J’ai consacré la plus grande partie de ces vingt dernières années à éprouver la vérité de cette recette ; j’ai donc choisi pour « corpora vilia » de mes expériences des personnes qui pouvaient disparaître sans occasionner une brèche visible dans la société. J’ai effectué le premier pas dans cette voie en faisant disparaître une certaine Phoebé Stanley, fillette d’origine tzigane, le 24 mars 1792 ; le second par la disparition d’un jeune vagabond italien, du nom de Giovanni Paoli, le soir du 23 mars 1805. La dernière « victime » (pour me servir d’un mot qui répugne à mes sentiments au plus haut degré) doit être mon cousin Étienne Elliott. Son jour devra être aujourd’hui, 24 mars 1812.
Le meilleur moyen d’effectuer l’absorption requise est d’arracher le cœur du sujet vivant, de le réduire en cendres et de le mélanger avec environ une pinte de vin rouge, du Porto de préférence. Il sera bon de cacher les restes des deux premiers sujets au moins ; une salle de bains qui ne sert plus, ou un caveau y seront utiles. Il est possible que la partie psychique des sujets employés, que la langue populaire ennoblit du nom de revenants, cause quelques ennuis. Mais le philosophe de tempérament (à qui seul peut s’appliquer cette expérience) sera peu enclin à attacher de l’importance aux faibles efforts que ces êtres pourront faire pour exercer leur vengeance sur lui. J’envisage avec la plus vive satisfaction l’existence élargie et libérée que cette expérience, si elle réussit, va me procurer ; non seulement en me plaçant hors d’atteinte de la soi-disant justice humaine, mais en éliminant dans une grande mesure la perspective de la mort elle-même. »
On trouva Mr. Abney dans son fauteuil, la tête en arrière, le visage marqué d’une expression de rage, de peur et de peine mortelle. Une terrible blessure déchirait son côté gauche, exposant le cœur. Il n’y avait pas de sang sur ses mains, non plus que sur un long couteau posé sur la table. Un chat sauvage furieux aurait pu faire ces blessures. La fenêtre du bureau était ouverte, et l’opinion du coroner (3) fut qu’une bête sauvage avait donné la mort à Mr. Abney. Mais l’étude qu’Étienne Elliott fit des papiers que je viens de citer le conduisit à une conclusion tout à fait différente.
_____
(1) Censorinus : auteur latin du IIIème siècle. [Ndt]
(2) Simon Magus ou Simon le Magicien : Juif qui avait voulu acheter de St. Pierre le moyen de faire des miracles ; de là le mot « simonie. » [Ndt]
(3) Coroner : ce fonctionnaire n’existe pas en France, et il est impossible de traduire ce mot. [Ndt]
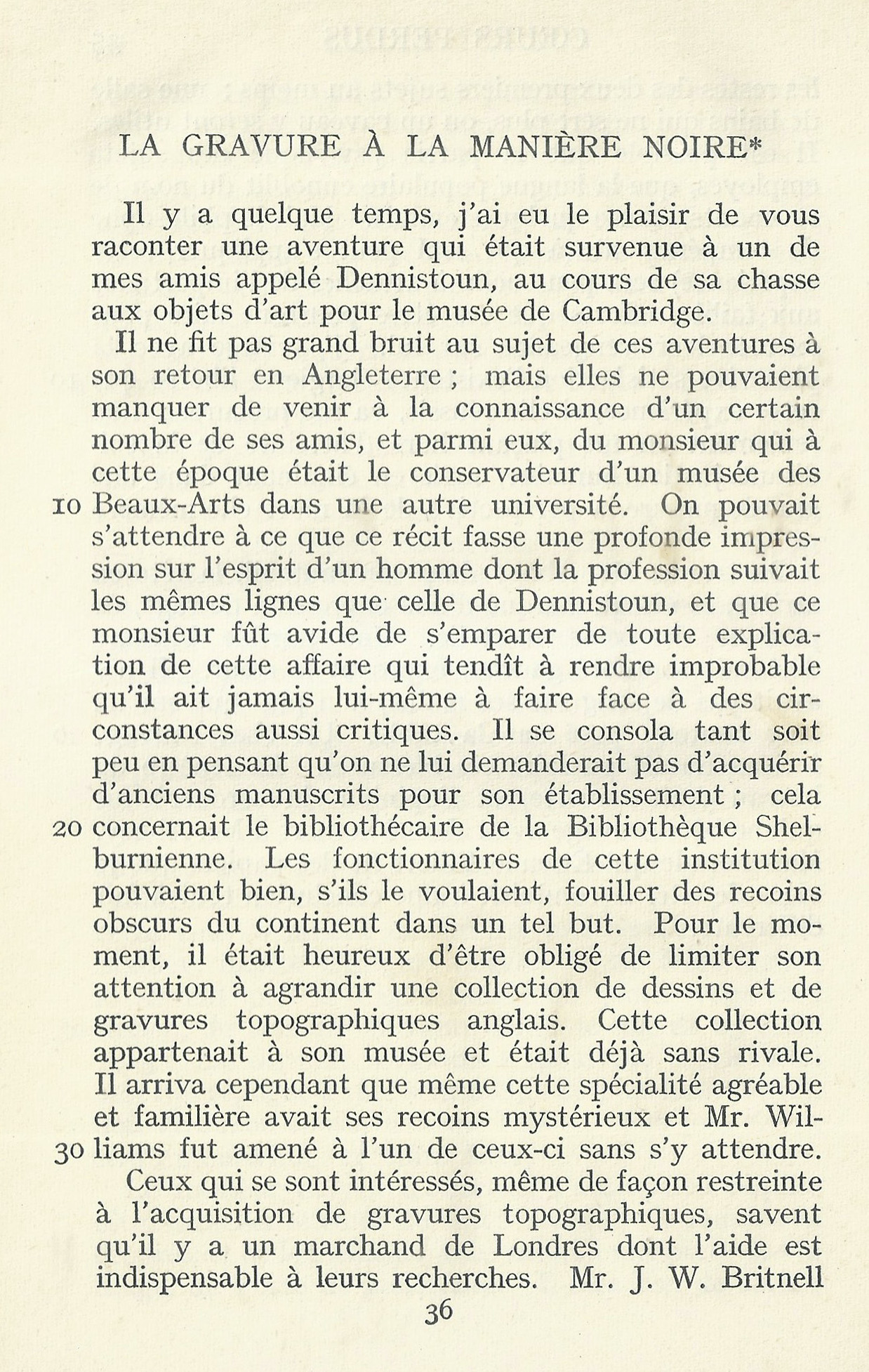
LA GRAVURE À LA MANIÈRE NOIRE (1)
_____
Il y a quelque temps, j’ai eu le plaisir de vous raconter une aventure qui était survenue à un de mes amis appelé Dennistoun, au cours de sa chasse aux objets d’art pour le musée de Cambridge.
Il ne fit pas grand bruit au sujet de ces aventures à son retour en Angleterre ; mais elles ne pouvaient manquer de venir à la connaissance d’un certain nombre de ses amis, et, parmi eux, du monsieur qui à cette époque était le conservateur d’un musée des Beaux-Arts dans une autre université. On pouvait s’attendre à ce que ce récit fasse une profonde impression sur l’esprit d’un homme dont la profession suivait les mêmes lignes que celle de Dennistoun, et que ce monsieur fût avide de s’emparer de toute explication de cette affaire qui tendît à rendre improbable qu’il ait jamais lui-même à faire face à des circonstances aussi critiques. Il se consola tant soit peu en pensant qu’on ne lui demanderait pas d’acquérir d’anciens manuscrits pour son établissement ; cela concernait le bibliothécaire de la Bibliothèque Shelburnienne. Les fonctionnaires de cette institution pouvaient bien, s’ils le voulaient, fouiller des recoins obscurs du continent dans un tel but. Pour le moment, il était heureux d’être obligé de limiter son attention à agrandir une collection de dessins et de gravures topographiques anglais. Cette collection appartenait à son musée et était déjà sans rivale. Il arriva cependant que même cette spécialité agréable et familière avait ses recoins mystérieux et Mr. Williams fut amené à l’un de ceux-ci sans s’y attendre.
Ceux qui se sont intéressés, même de façon restreinte, à l’acquisition de gravures topographiques, savent qu’il y a un marchand de Londres dont l’aide est indispensable à leurs recherches. Mr. J. W. Britnell publie à de courts intervalles des catalogues admirables de son stock toujours varié de gravures, de plans et de croquis de châteaux, d’églises et de villes anglaises et galloises. Ces catalogues étaient naturellement l’A. B. C. de son sujet pour Mr. Williams ; mais comme son musée contenait déjà une énorme quantité de dessins topographiques, ses achats étaient plutôt réguliers qu’abondants, et il s’adressait à Mr. Britnell plutôt pour remplir des vides dans l’ensemble de sa collection que pour lui demander de fournir des pièces rares.
Or, en février de l’an dernier, un catalogue du magasin de Mr. Britnell apparut au musée sur le bureau de Mr. Williams ; une communication dactylographiée du négociant lui-même l’accompagnait. Elle était conçue en ces termes :
« Monsieur,
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le n° 978 du catalogue ci-joint. Nous serons heureux de vous le faire parvenir à condition.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations empressées.
J. W. Britnell. »
Il ne fallut que quelques instants à Mr. Williams (et il s’en fit la remarque avec satisfaction) pour trouver le numéro 978 dans le catalogue, et à l’endroit indiqué il lut le paragraphe suivant :
« 978. – Inconnu. Intéressante gravure à la manière noire : vue d’un château ; début du XIXème siècle. 15 pouces sur dix. Cadre noir. Deux guinées. »
Ce n’était pas particulièrement enthousiasmant, et le prix semblait élevé. Cependant, comme Mr. Britnell qui connaissait bien ses affaires semblait en faire cas, Mr. Williams lui écrivit une carte postale, par laquelle il lui demandait de lui envoyer à condition l’article en question, ainsi que quelques autre gravures et croquis mentionnés dans le même catalogue. Il se mit alors, sans trop s’enthousiasmer à l’avance, à accomplir ses travaux coutumiers.
Tout paquet arrive toujours un jour plus tard qu’on ne l’attend, et pour celui de Mr. Britnell, il n’y eut, selon l’expression, aucune exception à la règle. Il arriva au musée à la distribution du samedi après-midi, après que Mr. Williams eut quitté son travail. Le commis l’apporta, par conséquent, à son appartement à l’université, de manière à ce qu’il n’ait pas à attendre jusqu’au lundi avant d’en examiner le contenu et de retourner les pièces qu’il ne voulait pas conserver. C’est là qu’il le trouva quand il rentra pour prendre le thé avec un ami.
Le seul objet qui m’intéresse est l’assez grande gravure au cadre noir dont j’ai déjà cité la description donnée dans le catalogue de Mr. Britnell. Il me faut vous en donner quelques autres détails, quoique je ne puisse pas espérer vous en présenter l’aspect aussi clairement qu’il apparaît à mes propres yeux. De nos jours, on peut en voir de tout à fait semblables dans le salon d’un certain nombre de vieilles auberges, ou dans les couloirs de paisibles manoirs. C’était une médiocre gravure à la manière noire. Or, une médiocre gravure à la manière noire est la pire sorte de gravure. Elle représentait une vue de face d’un assez petit château du siècle dernier, avec trois rangs de fenêtres à simples châssis à guillotine entourées de maçonnerie rustique ; il y avait un parapet avec des boules ou des vases aux angles et, au centre, un petit porche. De chaque côté se dressaient des arbres et, devant la maison, s’étendait une grande pelouse. La légende « A. W. F. sculpsit » était gravée sur la marge étroite ; il n’y avait aucune autre inscription. Le tout donnait l’impression d’être le travail d’un amateur. Que diantre voulait donc dire Mr. Britnell en fixant ce prix de deux guinées pour un objet semblable ? C’est ce que Mr. Williams ne pouvait comprendre. Il retourna la gravure avec beaucoup de mépris ; au dos, il y avait une étiquette dont la moitié avait été déchirée. Tout ce qui restait était le bout de deux lignes manuscrites. Dans la première, on lisait les lettres : « …ngley Hall » ; dans la seconde : « …ssex. »
Après tout, il valait peut-être la peine d’identifier le château représenté, ce que Mr. Williams pouvait faire aisément avec l’aide d’un dictionnaire géographique ; et puis, il pourrait renvoyer alors l’image à Mr. Britnell, en l’accompagnant de quelques remarques sur son bon goût.
Il alluma les bougies, car maintenant il faisait sombre, prépara le thé et en versa une tasse à l’ami avec qui il avait joué au golf cet après-midi-là (car je crois que les fonctionnaires de l’université dont je parle s’adonnent à ce sport en guise de repos). Ils absorbèrent leur thé en l’accompagnant d’une discussion que les amateurs de golf peuvent imaginer par eux-mêmes, mais que le consciencieux écrivain n’a aucun droit d’infliger à ceux qui ne pratiquent pas ce sport.
Ils arrivèrent à la conclusion que certains coups auraient pu être mieux joués, et que, dans quelques conjonctures, ni l’un ni l’autre des joueurs n’avait eu ce minimum de chance auquel tout humain a le droit de prétendre. C’est alors que l’ami de Williams (appelons-le Professor Binks) prit la gravure encadrée et dit :
« Qu’est-ce que c’est que cet endroit-là, Williams ?
– C’est justement ce que je vais essayer de trouver, dit Williams en allant à la bibliothèque pour prendre un dictionnaire géographique. Regardez au dos. Le château Quelque Chose, soit en Sussex ou en Essex. La moitié du nom a disparu, vous voyez. Vous ne le connaissez pas, par hasard, je suppose ?
– Ça vient de cet homme-là, Britnell, n’est-ce pas ? dit Binks. Est-ce pour le musée ?
– Eh bien, je pense que je l’achèterais si le prix était cinq shillings, dit Williams ; mais, pour quelque raison fantastique, il en demande deux guinées. Je ne puis pas m’imaginer pourquoi. C’est une mauvaise gravure, et il n’y a même pas de personnages pour l’animer.
– Ça ne vaut pas deux guinées, il me semble, dit Binks, mais je ne pense pas que ce soit si mal fait. Le clair de lune me paraît plutôt bon ; et j’aurais pensé qu’il y avait des personnages, ou tout au moins un personnage, juste devant, au bord.
– Laissez-moi regarder, dit Williams. Eh bien, c’est vrai, la lumière est plutôt rendue d’une manière intelligente. Où est votre personnage ? Oh, oui ! Juste une tête, tout en bas de la gravure. »
Et en effet, il y avait la tête fort emmitouflée d’un homme ou d’une femme ; elle apparaissait comme une tache noire à l’extrême bord de la gravure : la tête regardait vers le château et le derrière en était donc tourné vers le spectateur.
Williams ne l’avait pas remarquée auparavant.
« Cependant, dit-il, quoique ce soit meilleur que je ne le pensais, je ne puis pas dépenser deux guinées de la caisse du musée pour l’image d’un endroit que je ne connais pas. »
Professor Binks avait du travail à faire, et il s’en alla bientôt. Williams passa presque tout son temps jusqu’à l’heure du dîner à essayer d’identifier le sujet de la gravure.
« Si seulement la voyelle avant le ng était restée, ça aurait été facile, pensa-t-il, mais, comme ça, le nom peut être n’importe quoi depuis Guestingley jusqu’à Langley, et il y a bien plus de noms se terminant ainsi que je ne le pensais ; et ce sacré livre, qui n’a pas d’index de terminaisons. »
Le dîner dans le college (2) de Mr. Williams était à sept heures. Il n’est pas utile de s’y attarder ; d’autant moins qu’il y rencontra des collègues qui avaient joué au golf pendant l’après-midi, et qui échangèrent à table des paroles de peu d’intérêt pour nous. Je me hâte d’ajouter que ces paroles ne concernaient que le golf.
Ils passèrent une heure ou deux à ce que l’on appelle « common-room » après le dîner, c’est-à-dire au salon. Plus tard dans la soirée, quelques personnes accompagnèrent Williams à son appartement, et je suis certain qu’ils jouèrent au whist et fumèrent.
Pendant une accalmie au cours de ces opérations, Williams prit sur la table la gravure à la manière noire sans la regarder et la donna à un de ses collègues qui s’intéressait assez aux beaux-arts ; il lui dit d’où elle venait, et mentionna les autres détails que nous connaissons déjà.
Ce monsieur la prit nonchalamment, la regarda, puis il dit d’un ton intéressé : « C’est vraiment une bonne œuvre, Williams ; cela sent la période romantique. Il me semble que la lumière est rendue d’une manière admirable, et, quoique le personnage soit plutôt un peu trop grotesque, il est en tout cas très impressionnant.
– N’est-ce pas ? » dit Williams, qui était alors occupé à distribuer des « whisky-and-soda » à d’autres personnes, et ne pouvait pas traverser la pièce pour regarder à nouveau le dessin.
Il se faisait alors tard et les visiteurs se préparaient à partir. Après leur départ, Williams écrivit encore une ou deux lettres, et puis il liquida quelques travaux. Enfin, minuit était passé, et il se disposa à aller se coucher. Il éteignit sa lampe, après avoir allumé la bougie pour sa chambre à coucher. La gravure était posée sur la table où la dernière personne qui l’avait regardée l’avait mise, et elle attira ses regards lorsqu’il éteignait sa lampe. Ce qu’il vit lui fit presque laisser tomber la bougie sur le plancher, et il dit maintenant que s’il avait été plongé dans l’obscurité alors, il aurait eu une attaque de nerfs. Mais, comme ceci ne se produisit pas, il put poser la lumière sur la table et regarder la gravure avec attention. Il n’y avait pas de doute : c’était absolument impossible, sans aucun doute, mais cependant absolument certain. Au milieu de la pelouse, en face de la maison inconnue, il y avait un personnage, là où il n’y en avait pas à cinq heures cet après-midi-là. Ce personnage marchait à quatre pattes vers la maison et était emmitouflé dans un curieux vêtement noir, avec une croix blanche dans le dos.
J’ignore quelle est l’attitude idéale à suivre dans une semblable situation. Je puis seulement vous dire ce que fit Mr. Williams. Il prit la gravure par un coin et la transporta à travers le corridor jusqu’à un autre appartement qu’il possédait. Là, il l’enferma à clef dans un tiroir, barricada les portes des deux appartements, et alla au lit. Mais auparavant, il écrivit et signa un récit du changement extraordinaire que la gravure avait subi depuis qu’elle était en sa possession. Il ne s’endormit qu’assez tard ; mais il était consolant de réfléchir que la conduite de la gravure avait été observée par d’autres que par lui. Évidemment, celui qui l’avait regardée la veille au soir avait vu quelque chose de semblable à ce qu’il avait vu lui-même ; sinon, il aurait été tenté de croire qu’une grave maladie s’était emparée de ses yeux ou de son esprit. Comme ceci était heureusement exclu, il lui restait deux choses à faire au matin. Il fallait examiner la gravure en détail et, à cette fin, convoquer un témoin ; il fallait aussi faire un effort résolu pour déterminer quelle maison elle représentait. Il allait donc inviter son voisin Nisbet au petit déjeuner, et il allait passer ensuite une matinée entière à consulter le dictionnaire géographique.
Nisbet était libre, et il arriva vers neuf heures et demie. J’ai le regret de dire que, même à cette heure tardive, son hôte n’était pas encore tout à fait habillé. Pendant le déjeuner, Williams ne dit rien sur la gravure à la manière noire. Il se contenta de mentionner qu’il avait un tableau sur lequel il désirait l’avis de Nisbet. Mais ceux qui ont l’habitude de la vie universitaire peuvent imaginer l’agréable multiplicité des thèmes sur lesquels la conversation de deux chargés de cours de Canterbury College peut s’étendre pendant le petit déjeuner du dimanche. Ils discutèrent presque tous les sujets possibles, du golf jusqu’au lawn-tennis. Cependant, je dois admettre que Williams était plutôt distrait ; car son intérêt était naturellement centré sur cette gravure si étrange qui reposait alors face contre terre, dans un tiroir de la chambre de l’autre côté du corridor.
Ils allumèrent enfin leur pipe du matin, et ce fut le moment que Williams avait attendu. Avec une grande émotion, presque en tremblant, il courut à l’autre pièce et ouvrit le tiroir ; il retira l’image en la tenant toujours à l’envers ; il retourna rapidement chez lui et la mit entre les mains de Nisbet.
« Maintenant, Nisbet, dit-il, je voudrais que vous me disiez exactement ce que vous voyez sur cette gravure. Décrivez-la-moi, plutôt en détail, si vous voulez bien. Je vous dirai pourquoi après.
– Eh bien ! dit Nisbet, j’ai ici la vue d’un château, – en Angleterre, je pense, – au clair de lune.
– Au clair de lune ? Vous en êtes sûr ?
– Oui, certainement. La lune semble décroître, si vous voulez des détails, et il y a des nuages dans le ciel.
– Bien, continuez. Je jurerais, ajouta Williams à part, qu’il n’y avait pas de lune quand je l’ai vue pour la première fois.
– Eh bien, il n’y a pas beaucoup plus à dire, continua Nisbet. La maison a une, deux, trois rangées de fenêtres, cinq par rangée, sauf au rez-de-chaussée, où il y a un porche au lieu de la fenêtre centrale, et…
– Mais, y a-t-il des personnages ? dit Williams avec un intérêt visible.
– Il n’y en a pas, répondit Nisbet ; mais…
– Comment ! pas de personnage sur l’herbe, devant la maison ?
– Absolument rien.
– Vous le jureriez ?
– Oui, certainement. Mais il y a encore quelque chose d’autre.
– Quoi ?
– Eh bien, l’une des fenêtres du rez-de-chaussée est ouverte. Celle qui est à gauche de la porte.
– Vraiment ? Mon Dieu ! il a dû entrer, » dit Williams avec une grande émotion ; il se précipita derrière le canapé où Nisbet était assis et lui arracha la gravure des mains pour vérifier sa version.
C’était vrai. Il n’y avait pas de personnage et la fenêtre était ouverte. La surprise rendit Williams muet pendant quelques instants, puis il alla à sa table de travail et écrivit pendant quelques minutes. Puis il apporta deux feuilles de papier à Nisbet et lui demanda d’en signer une. C’était la description de la gravure que vous avez tout juste lue. Il lui fit ensuite lire l’autre, qui était sa déclaration de la veille au soir.
« Qu’est-ce que cela peut signifier ? s’écria Nisbet.
– Voilà ! répondit Williams. Eh bien ! il faut que je fasse une chose, ou, plus exactement, trois choses, maintenant que j’y pense. Il faut que je demande à Garwood (c’était son ami de la veille au soir) ce qu’il a vu ; ensuite, que je fasse photographier la gravure avant qu’elle ne change encore ; et enfin, que je trouve le nom de ce château.
– Je ferai la photographie moi-même, dit Nisbet. Mais, vous savez, il me semble bien que nous assistons au développement d’une tragédie quelque part. Une question se pose : s’est-elle déjà produite, ou va-t-elle se produire ? Il faut que vous trouviez où est ce château. Oui, dit-il en regardant la gravure, je pense que vous avez raison : il est entré, et, si je ne me trompe pas, ça va coûter bien cher à quelqu’un dans une des chambres à coucher.
– Voilà ce que je vais faire : je vais porter la gravure au vieux Green (C’était le doyen des membres du « college, » qui avait été économe pendant de nombreuses années). Il est fort possible qu’il le connaisse. Nous avons des propriétés dans l’Essex et le Sussex, et il a dû voyager beaucoup dans ces deux comtés quand il était économe.
– C’est fort possible, répondit Nisbet ; mais, d’abord, laissez-moi prendre la photo. Mais, j’y pense, je crois que Green n’est pas ici aujourd’hui. Il n’était pas à dîner hier soir, et je crois l’avoir entendu dire qu’il allait s’absenter ce dimanche-ci.
– Ah oui, c’est vrai ! dit Williams. Je sais qu’il est parti à Brighton. Eh bien ! si vous prenez la photo maintenant, je vais aller chez Garwood pour lui demander sa déclaration ; pendant que je serai parti, surveillez la gravure. Je commence à penser maintenant que deux guinées n’est pas un prix trop exorbitant. »
Il revint bientôt, ramenant Mr. Garwood. Garwood déclara que le personnage, quand il l’avait vu, était entièrement dégagé de la bordure, mais ne s’était pas fort avancé sur la pelouse. Il se rappelait une marque blanche sur la draperie qui couvrait son dos, mais il n’était pas sûr que c’était une croix. Ils composèrent un document à cet effet et le signèrent. Nisbet prit alors la photographie.
« Qu’avez-vous l’intention de faire maintenant ? dit-il. Allez-vous rester assis à surveiller cette gravure toute la journée ?
– Je n’en ai pas l’intention, répondit Williams. Je pense plutôt qu’on veut nous faire voir tout ce qui se passe. Vous voyez, d’hier soir à ce matin, il y avait suffisamment de temps pour que beaucoup de choses se produisent ; mais cette créature n’a fait qu’entrer dans la maison. Elle aurait facilement pu terminer ses affaires dans cet espace de temps et retourner à sa place ; mais le fait que la fenêtre est ouverte doit signifier, je crois, qu’elle est maintenant à l’intérieur. Par conséquent, je crois que nous pouvons laisser la gravure la conscience tranquille. Et en outre, j’ai idée qu’elle ne changerait guère, ou pas du tout, en plein jour. Nous pourrions aller faire une promenade cet après-midi et rentrer pour le thé ou à la tombée de la nuit. Je la laisserai ici, sur la table, et je fermerai la porte à double tour. Mon domestique pourra entrer, mais personne d’autre. »
Ils tombèrent tous trois d’accord que c’était une une bonne idée. En outre, en passant l’après-midi ensemble, il y aurait moins de chances qu’ils parlent de cette affaire à d’autres personnes ; car le moindre bruit de ce qui se passait mettrait tout le Cercle Psychique à leurs trousses.
Laissons-les donc en paix jusqu’à cinq heures. À peu près à cette heure-là, nos trois amis montaient l’escalier de Williams. Tout d’abord, ils furent tant soit peu irrités de voir que la porte de l’appartement avait été ouverte ; mais ils se souvinrent sur-le-champ que, le dimanche, les domestiques venaient pour recevoir leurs ordres pour les repas environ une heure plus tôt que les jours de semaine. Cependant, une surprise les attendait. La première chose qu’ils virent fut la gravure appuyée contre une pile de livres sur la table, ainsi qu’ils l’avaient laissée ; et, tout de suite après, le domestique de Williams, assis en face sur une chaise et la contemplant avec une horreur visible. Comment cela pouvait-il se faire ? Monsieur Chipeur (je n’invente pas ce nom) était un serviteur de grande distinction, et il fixait les règles de l’étiquette pour tous les domestiques de son collège et de plusieurs collèges voisins. Rien ne pouvait donc être plus étranger à ses habitudes que d’être surpris assis sur le fauteuil de son maître, ou d’avoir l’air d’examiner ses meubles ou ses tableaux. Il semblait s’en rendre compte lui-même. Il sursauta lorsque les trois hommes entrèrent dans la pièce et se leva avec un effort visible. Puis il dit :
« Je demande pardon à Monsieur d’avoir pris la liberté de m’asseoir…
– Je vous en prie, Robert, interrompit Williams, j’avais l’intention de vous demander un jour ce que vous pensiez de ce tableau.
– Eh bien ! je ne veux pas opposer mon idée à celle de Monsieur, mais ce n’est pas le tableau que je pendrais là où ma petite fille pourrait le voir.
– Vraiment, Robert ? Pourquoi non ?
– Non, Monsieur. La pauvre gosse ! je me souviens qu’un jour elle vit une Bible de Doré (3), avec des images, pas même à moitié aussi horribles que celle-ci, et il nous a fallu rester debout auprès d’elle les trois ou quatre nuits d’après, si Monsieur veut bien me croire ; et si elle voyait ce squelette-là, ou ce que vous voudrez bien l’appeler, emportant ce pauvre bébé, elle serait dans un état impossible. Monsieur sait ce que c’est que les enfants, comment un rien les effraie. Mais ce que je dirais, Monsieur, c’est qu’il me semble que ce n’est pas une sorte de tableau à laisser traîner ; en tout cas, pas où quelqu’un qui s’effraie facilement pourrait tomber dessus. Monsieur désirera-t-il quelque chose ce soir ? Bien obligé, Monsieur. »
Avec ces paroles, le brave homme sortit pour prendre les ordres de ses autres maîtres, et vous pouvez être certain que les messieurs qu’il quitta ne perdirent pas une minute pour se rassembler autour de la gravure. La maison était là comme auparavant, sous la lune à son déclin. La fenêtre qui avait été ouverte était maintenant fermée, et le personnage était à nouveau dans la pelouse : mais cette fois-ci, il ne rampait pas avec précaution à quatre pattes. Il se tenait debout et marchait rapidement à grands pas vers la bordure inférieure de la gravure. La lune brillait derrière lui, et la draperie pendait devant son visage, de sorte qu’on ne pouvait s’en faire qu’une vague idée. Mais ce qui était visible rendit les spectateurs très heureux de ne pas pouvoir en discerner plus qu’un pâle front bombé et quelques rares cheveux. Sa tête était penchée en avant, et ses bras serraient étroitement un objet que l’on pouvait voir indistinctement. C’était un enfant, mais il était impossible de dire s’il était vivant ou mort. On ne pouvait bien voir que les jambes de l’apparition : elles étaient horriblement maigres.
De cinq à sept heures, les trois amis restèrent assis et examinèrent la gravure chacun à son tour. Mais elle ne changeait pas. Ils finirent par décider qu’ils pouvaient la laisser en toute sûreté, et revenir après le dîner pour attendre des changements ultérieurs.
Lorsqu’ils se réunirent à nouveau, dès que ce fut possible, la gravure était toujours là, mais le personnage avait disparu, et la maison dormait au clair de lune. Il n’y avait rien d’autre à faire que de passer la soirée à consulter des dictionnaires géographiques et des guides. Williams eut enfin la chance (sans doute le méritait-il) de lire les lignes suivantes dans le guide de l’Essex publié par Murray :
« À 16 milles, Anningley. L’église était un bâtiment intéressant de la période romano-normande, mais a été complètement mise au goût classique au siècle dernier. Elle contient les tombes de la famille Francis, dont le château, Anningley Hall, construction massive de l’époque de la reine Anne, s’élève juste derrière le cimetière dans un parc de 80 acres. La famille est maintenant éteinte. Le fils du dernier membre de la famille disparut mystérieusement étant tout enfant en 1802. Son père, Mr. Arthur Francis, était connu localement comme graveur amateur de talent. Après la disparition de son fils, il vécut dans un isolement complet au château ; on le trouva mort dans son atelier, le troisième anniversaire du désastre. Il venait de terminer une gravure de la maison, dont les exemplaires sont fort rares. »
Il semblait bien que ce fût la solution. En effet, Mr. Green reconnut immédiatement que la maison était Anningley Hall.
« Y a-t-il une explication quelconque du personnage, Green ? demanda tout naturellement Williams.
– Je ne sais vraiment pas, Williams, Ce que l’on disait dans le village, quand j’y fus pour la première fois (c’est-à-dire, avant que je ne vinsse au collège), c’était tout juste ceci : le vieux Francis était toujours contre les braconniers ; toutes les fois qu’il en trouvait l’occasion, il expulsait des maisons qu’ils occupaient dans son domaine, ceux qu’il soupçonnait ; et, petit à petit, il se débarrassa d’eux tous, sauf un. Les châtelains pouvaient faire alors bien des choses auxquelles ils n’osent même plus penser de nos jours. Eh bien ! cet homme qui restait, c’était ce que vous rencontrez souvent dans cette région-là : le dernier représentant d’une vieille famille. Je crois qu’ils furent châtelains jadis. Je me souviens de quelque chose d’analogue dans ma paroisse.
– Oui, quelque chose comme l’homme dans Tess d’Urberville ? interrompit Williams.
– Oui, je pense ; c’est bien un livre que je n’ai jamais pu lire. Mais ce garçon-là pouvait montrer une rangée de tombeaux dans l’église du village, qui appartenaient à ses ancêtres, et tout cela l’avait aigri. On dit que Francis n’avait jamais pu le prendre ; il se tenait toujours du bon côté de la loi. Mais une nuit, les gardes-chasse le surprirent en train de braconner dans un bois à l’extrémité du domaine. Je pourrais encore vous montrer l’endroit. Il est limitrophe de terrains qui appartenaient à un de mes oncles. Et vous pensez bien qu’il y eut de la casse ; et cet homme-là, Gawdy (ah, oui ! c’était son nom, Gawdy ; je pensais bien qu’il me reviendrait, Gawdy) eut la malchance – le malheureux – de tuer un garde. C’était juste ce que Francis voulait, et un jury !… Vous savez ce qu’étaient les jurys, alors… et le malheureux fut pendu en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. On m’a montré l’endroit où il fut enterré, sur le côté nord de l’église. Vous connaissez les habitudes dans cette région-là : ils enterrent de ce côté-là tous ceux qui ont été pendus ou qui se sont suicidés. Et l’on disait que quelque ami de Gawdy (pas un parent, car il n’en avait pas, le pauvre diable ; c’était le dernier de sa famille : une sorte de spes ultima gentis) avait dû projeter de s’emparer du fils de Francis et de mettre fin aussi à sa postérité. Je ne sais vraiment pas. Il me semble que c’est plutôt une chose trop extraordinaire pour qu’un braconnier de l’Essex y pense… mais, vous voyez, je dirais maintenant qu’il semble plutôt que ce brave Gawdy s’en soit occupé lui-même. Pouah ! c’est horrible d’y penser ! Du whisky, Williams ! »
Ces faits furent communiqués par Williams à Dennistoun, et par lui, à diverses personnes, dont l’une était moi-même, et une autre, le Professeur Sadducéen d’Ophiologie (5). J’ai le regret de dire que ce dernier, quand on lui demanda ce qu’il en pensait, se contenta de faire la remarque suivante : « Oh, ces gens de Bridgeford diraient n’importe quoi ! » Ce point de vue fut reçu ainsi qu’il le méritait.
Je n’ai rien d’autre à ajouter, sinon que la gravure est maintenant au musée Ashléien ; qu’elle a été traitée de manière à découvrir si on y avait utilisé de l’encre sympathique, mais sans résultat ; que Mr. Britnell ne savait rien à son sujet, sinon qu’elle était rare ; et que, quoiqu’on la surveillât soigneusement, on ne l’a jamais vue changer depuis.
_____
(1) Gravure à la manière noire : mezzotint (de l’Italien : Mezzo tinto) [NdT]
(2) College : il n’y a rien en France qui corresponde aux « colleges » de certaines universités anglaises. Les universités françaises sont divisées en facultés. C’est un mot qui, dans ce sens, ne peut pas se traduire. [NdT]
(3) Doré (Gustave) : fameux artiste français du XIXème siècle qui a illustré de gravures pleines d’une imagination exubérante les œuvres de Rabelais, Dante, Cervantes, etc., et la Bible. [NdT]
(4) Tess d’Urberville : roman par Thomas Hardy. [NdT]
(5) Le Professeur Sadducéen d’Ophiologie : Sadducéen, nom donné à la chaire en l’honneur du fondateur ; ophiologie, science qui s’occupe de l’étude des serpents. [NdT]

LA CHAMBRE NUMÉRO 13
_____
Parmi les villes du Jutland, Viborg occupe un haut rang. C’est le siège d’un évêché ; on y trouve une cathédrale, jolie mais presque neuve, un jardin charmant, un lac de grande beauté et de nombreuses cigognes. Auprès de la ville se trouve Hald, que l’on dit être l’une des plus jolies choses du Danemark ; et tout auprès est Finderup, où Marsk Stig assassina le roi Erik Glipping le jour de Sainte Cécile en l’année 1286. On trouva les traces de cinquante-six coups d’une masse de fer à tête carrée sur le crâne d’Erik quand sa tombe fut ouverte au XVIIème siècle. Mais, ce n’est pas un guide que j’écris.
Il y a de bons hôtels à Viborg : Le Phénix et Preisler sont tout ce que l’on peut désirer de mieux. Mais mon cousin, dont je vais vous décrire les aventures maintenant, alla au Lion d’Or quand il séjourna à Viborg. Il n’y a pas été depuis, et les pages suivantes expliqueront peut-être la raison de son abstention.
Le Lion d’Or est l’une des très rares maisons de la ville qui n’ont pas été détruites dans le grand incendie de 1726 qui démolit presque la cathédrale, la Sognekirke, l’Hôtel de Ville et bien d’autres choses qui étaient vieilles et intéressantes. C’est une grande maison de briques rouges. C’est-à-dire que la façade est en briques avec des pignons en escalier et un texte inscrit au-dessus de la porte ; mais la cour dans laquelle entre l’omnibus de l’hôtel est en colombage, poutres noires et plâtras blanc.
Le soleil se couchait quand mon cousin arriva devant la porte, et la lumière frappait en plein la façade imposante de la maison. Il était enchanté de cet ancien aspect, et il se promit un séjour tout à fait satisfaisant et divertissant dans une auberge si typique du vieux Jutland.
Ce n’était pas des affaires dans le sens habituel du mot qui avaient amené Mr. Anderson à Viborg. Il faisait des recherches sur l’histoire ecclésiastique du Danemark, et il avait eu connaissance que, dans les archives d’État de Viborg, il y avait des documents sauvés de l’incendie, qui se rapportaient aux derniers jours du catholicisme romain dans le pays. Il se proposait donc de passer un temps considérable, peut-être de quinze jours à trois semaines, à les examiner et à les copier, et il espérait que le Lion d’Or pourrait lui offrir une pièce suffisamment grande pour servir à la fois de chambre à coucher et de cabinet de travail. Il expliqua ses désirs au propriétaire, et, après avoir quelque peu réfléchi, ce dernier suggéra que peut-être il serait préférable que Monsieur examine une ou deux des plus grandes chambres, et en choisisse une lui-même. Ceci semblait être une bonne idée.
L’étage supérieur fut bientôt mis de côté, car cela signifiait trop de marches à monter après le travail de la journée ; le deuxième étage ne contenait aucune pièce ayant exactement les dimensions requises ; mais, au premier étage, il y avait un choix de deux ou trois chambres, qui convenaient admirablement en ce qui concernait la taille.
Le propriétaire était tout à fait en faveur du Numéro 17, mais Mr. Anderson fit remarquer que ses fenêtres n’ouvraient que sur le mur nu de la maison voisine, et qu’il devait y faire très sombre dans l’après-midi. Le Numéro 12 ou le Numéro 14 seraient préférables, car ces deux chambres dominaient la rue, et la lumière claire du soir et la jolie vue feraient plus que compenser pour lui le bruit supplémentaire.
Enfin, il choisit le Numéro 12. Comme dans les chambres voisines on y comptait trois fenêtres, toutes trois d’un seul côté. C’était une pièce assez haute et remarquablement longue. Naturellement, il n’y avait pas de cheminée ouverte, mais le poêle était joli et plutôt ancien ; c’était un poêle de fonte, et sur son côté il y avait une représentation d’Abraham sacrifiant Isaac, et au-dessus l’inscription : « I Bog Mose, Cap. 22. » (1) Il n’y avait rien d’autre de remarquable dans la pièce. Le seul tableau intéressant était une vieille estampe coloriée de la ville, d’environ 1820.
L’heure du dîner approchait, mais quand Anderson, rafraîchi par les ablutions d’usage, descendit l’escalier, il restait encore quelques minutes avant que la cloche ne retentît. Il les passa à examiner la liste des autres locataires. Comme c’est l’habitude au Danemark, leurs noms figuraient sur un grand tableau noir divisé en colonnes et en lignes, et les numéros des chambres étaient peints au commencement de chaque ligne. La liste n’était pas digne de grande attention. Il y avait un avocat ou Sagförer, un Allemand et quelques commis-voyageurs de Copenhague. Le seul point qui fit réfléchir était l’absence d’un Numéro 13 de la liste des chambres ; Anderson avait déjà remarqué cela au moins six fois au cours de ses séjours dans des hôtels danois. Il ne pouvait s’empêcher de se demander si l’objection à ce nombre-là, si fréquente qu’elle fût, était assez répandue et assez forte pour rendre difficile la location d’une chambre avec le Numéro 13 ; il décida de demander au propriétaire si lui-même et ses collègues avaient vraiment eu affaire à beaucoup de clients qui refusaient d’être logés au Numéro 13.
Pendant le dîner, il n’y eut rien de remarquable (Je raconte l’histoire telle que je l’ai entendue de ses propres lèvres). La soirée, qu’il passa à défaire ses valises et à ranger ses vêtements, ses livres et ses papiers, ne fut pas plus remarquable. Vers onze heures, il se décida à aller au lit ; mais pour lui, comme pour bien d’autres personnes de nos jours, il était presque nécessaire de lire quelques pages comme introduction au sommeil ; il se rappela alors que le livre qu’il avait commencé à lire dans le train, et qui seul l’intéressait à ce moment-là, était dans la poche de son pardessus. Ce vêtement était resté pendu à une patère en dehors de la salle à manger.
Descendre le chercher fut l’affaire d’un instant, et comme les corridors étaient loin d’être sombres, il ne lui fut pas difficile de retrouver son chemin jusqu’à la porte de sa chambre… ou, tout au moins, c’est ce qu’il croyait ; mais, quand il y arriva et tourna la poignée, le panneau refusa complètement de s’ouvrir, et il surprit, venant de l’intérieur, le son d’un mouvement rapide vers la porte. Il s’était trompé de porte, bien sûr. Est-ce que sa chambre était à droite ou à gauche ? Il jeta un coup d’œil au numéro : c’était le Numéro 13. Sa chambre devait donc être sur la gauche. Oui, c’était exact. Il était couché depuis quelques minutes ; il avait lu ses trois ou quatre pages coutumières ; il avait éteint sa lumière et s’était retourné pour s’endormir quand il lui vint à l’esprit que tandis que, sur le tableau noir de l’hôtel, il n’y avait pas de Numéro 13, il y avait sans aucun doute une chambre numéro 13. Il regretta presque de ne pas l’avoir choisie. Il aurait ainsi peut-être rendu un petit service au propriétaire en l’occupant, et en lui donnant l’occasion de dire qu’un gentleman anglais y était resté pendant trois semaines et s’y était beaucoup plu. Mais sans doute était-elle utilisée comme chambre de domestique ou encore quelque chose d’analogue. En tout cas, elle n’était probablement pas aussi grande ni aussi agréable que la sienne. Et il regarda, à moitié endormi, autour de la chambre, que l’on pouvait voir assez distinctement dans la demi-clarté du bec de gaz de la rue. C’était un effet étrange, pensa-t-il. D’habitude, les pièces ont l’air plus grandes dans un demi-jour qu’en pleine lumière, mais celle-ci semblait s’être contractée dans sa longueur et être devenue en proportion plus haute de plafond. En tout cas, le sommeil était plus important que toutes ces ruminations… et il s’endormit.
Le lendemain de son arrivée, Anderson s’attaqua aux archives royales de Viborg. On le reçut aimablement ainsi qu’on peut s’y attendre partout au Danemark, et on lui donna accès aussi facile que possible à tout ce qu’il désirait voir. Les documents étalés devant lui étaient beaucoup plus nombreux et plus intéressants qu’il ne s’y était attendu. Outre les papiers officiels, il y avait un gros paquet de correspondance sur l’évêque Jörgen Friis, dernier catholique romain titulaire de l’évêché. De nombreux détails amusants et qu’on appelle intimes sur la vie privée et le caractère de contemporains s’y trouvaient. On y parlait fort d’une maison de la ville dont l’évêque était propriétaire, mais qu’il n’habitait pas.
Son occupant était, semble-t-il, tant soit peu un objet de scandale, et il servait de pierre d’achoppement au parti de la Réforme.
Ils écrivaient que c’était un déshonneur pour la ville, qu’il s’adonnait aux arts occultes et mauvais, et qu’il avait vendu son âme au Diable. Qu’un tel serpent, un semblable « Troldmand » buveur de sang, fût patronisé et logé par l’évêque, cela allait de pair avec la corruption et la superstition grossières de la Babylone qu’était l’Église romaine. L’évêque fit face hardiment à ces reproches ; il protesta de son horreur de tout ce qui était sciences occultes, et il mit ses adversaires en demeure d’amener l’affaire devant le tribunal compétent (naturellement, le tribunal ecclésiastique) et de l’examiner minutieusement. Personne ne pouvait être aussi prêt que lui à condamner Mag. Nicolas Francken si les témoignages le prouvaient être coupable des crimes qui lui étaient imputés officieusement.
Anderson eut à peine le temps de jeter un coup d’œil sur la lettre suivante, écrite par le chef protestant Rasmus Nielsen, avant la fermeture des Archives ce jour-là, mais il en comprit la teneur : c’était que les Chrétiens n’étaient plus engagés par les décisions des évêques de Rome, et que le tribunal épiscopal n’était pas, ni ne pouvait être, une cour compétente pour juger une affaire aussi grave et lourde de conséquences.
En quittant le bâtiment, le vieux monsieur qui en était le conservateur accompagna Mr. Anderson, et comme ils marchaient la conversation tourna tout naturellement sur les documents dont je viens de parler.
Quoiqu’il fût bien renseigné sur l’ensemble des documents dont il avait la responsabilité, l’archiviste de Viborg, Monsieur Scavenius, n’était pas un spécialiste de ceux du temps de la Réforme.
Ce qu’Anderson lui dit à ce sujet l’intéressa fort. Il se faisait un plaisir à l’avance, disait-il, de voir la publication dans laquelle Mr. Anderson parlait d’incorporer leur contenu. « L’emplacement de cette maison de l’évêque, ajouta-t-il, est une grande énigme pour moi. J’ai étudié avec soin la topographie du vieux Viborg. C’est bien dommage, mais, de l’inventaire des propriétés de l’évêque qui a été dressé en 1560, et dont nous avons la plus grande partie aux Archives, c’est juste le document qui portait la liste de ses propriétés de la ville qui manque. Enfin ! Peut-être que je réussirai un jour à le trouver. »
Après avoir pris un peu d’exercice (j’ai oublié où et comment), Anderson retourna au Lion d’Or. Il mangea son souper, fit sa partie de réussite et alla au lit. En montant à sa chambre, il se souvint qu’il avait oublié de parler à l’hôtelier du Numéro 13 ; en outre, il décida de vérifier que le Numéro 13 existait bien avant d’en faire mention. Cela n’était pas difficile. La porte était en face de lui et son numéro était aussi clair que possible. À l’intérieur, quelqu’un s’y adonnait à quelque sorte de travail, car, en approchant de la porte, il pouvait entendre des pas et des voix, ou encore une seule voix. Il s’arrêta quelques secondes pour s’assurer du numéro, et alors le bruit de pas s’arrêta, très près de la porte, semblait-il, et il fut un peu étonné d’entendre une respiration rapide et sifflante, comme celle d’une personne sous le coup d’une grande émotion. Il continua jusqu’à sa chambre, et il fut à nouveau surpris de constater qu’elle semblait bien plus petite maintenant que quand il l’avait choisie. C’était un léger désappointement, mais seulement léger. Si vraiment il ne la trouvait pas assez grande, il pouvait aisément en changer. En attendant, il voulait prendre quelque chose dans sa valise. Autant que je me le rappelle, c’était un mouchoir. La valise avait été mise par le garçon sur un mauvais tréteau contre le mur à l’extrémité la plus éloignée de son lit. C’était fort curieux, mais la valise n’était plus là. Elle avait dû être emportée par des serviteurs empressés. Sans doute le contenu avait dû être mis dans l’armoire. Non, elle était vide. C’était vexant. Il congédia la pensée d’un vol. Cela arrive rarement au Danemark. Mais, ce qui n’est pas si rare, c’était certainement le résultat de quelque acte stupide ; et Anderson devrait en parler d’un ton sévère à la « stuepige. » (2) Ce qu’il avait cherché n’était pas tellement nécessaire à son confort qu’il ne puisse attendre jusqu’au matin, et par conséquent il décida de ne pas sonner et de ne pas faire déranger les domestiques. Il alla à la fenêtre – c’était la fenêtre de droite – et il regarda au-dehors, dans la rue tranquille. Il y avait un haut bâtiment en face, avec de grands espaces de mur plein ; pas de passants ; une nuit sombre ; et bien peu à voir.
La lumière était derrière lui, et il pouvait voir son ombre nettement projetée sur le mur d’en face. Il voyait aussi l’ombre de l’homme barbu du Numéro 11 à gauche, qui passa et repassa une ou deux fois en bras de chemise ; la première fois, il brossait ses cheveux, et, plus tard, il était en robe de chambre. Et puis aussi, il y avait l’ombre du locataire du Numéro 13 sur la droite. C’était peut-être plus intéressant. Le Numéro 13 était accoudé comme lui-même sur l’appui de fenêtre qui donnait sur la rue. Il paraissait être un homme mince – ou était-ce par hasard une femme ? En tout cas, c’était quelqu’un qui se couvrait la tête avec quelque sorte de linge avant d’aller au lit. Cette même personne devait, pensa-t-il, avoir un abat-jour rouge, et la lampe devait vaciller beaucoup : on voyait sur le mur d’en face le tremblement d’une lumière rouge sombre. Il se pencha un peu en dehors pour voir s’il pouvait voir un peu plus de cette forme, mais il ne put rien apercevoir, sinon le pli de quelque tissu léger, peut-être de couleur blanche.
Des pas lointains se firent alors entendre dans la rue et leur approche sembla rappeler au Numéro 13 qu’il était visible, car il se retira de la fenêtre tout à coup et sa lumière rouge s’éteignit. Anderson, qui fumait une cigarette, en déposa le bout sur l’appui de fenêtre et alla se coucher.
Le lendemain matin, la « stuepige » le réveilla en lui apportant de l’eau chaude, etc. Il rassembla ses esprits, et après avoir assemblé les mots danois corrects, il dit aussi distinctement qu’il put :
« Je ne veux pas que vous changiez ma valise de place. Où est-elle ? »
Ainsi qu’il arrive parfois, la bonne se mit à rire et s’en alla sans faire de réponse précise.
Plutôt irrité, Anderson s’assit sur son séant, avec l’intention de la rappeler. Mais il resta ainsi, regardant fixement devant lui. Sa valise était sur son tréteau, exactement où il avait vu le garçon la mettre quand il était arrivé. C’était une rude secousse pour un homme qui se vantait de la précision de son pouvoir d’observation. Il n’essaya pas de comprendre comment il avait pu ne pas remarquer sa valise la veille au soir. De toute façon, elle était là maintenant.
La lumière du jour faisait voir bien plus que la valise. Elle montrait les proportions véritables de la pièce avec ses trois fenêtres, et son locataire s’estima satisfait de son choix. Quand il fut presque habillé, il alla jusqu’à la fenêtre centrale pour voir quel temps il faisait. Un autre saisissement l’y attendait. Il devait être bien plus observateur hier au soir. Il aurait juré plus de dix fois, si nécessaire, qu’il avait fumé à la fenêtre de droite, juste avant d’aller au lit, et le bout de sa cigarette était maintenant sur l’appui de la fenêtre du centre. Il se mit en devoir de descendre pour le petit déjeuner. Il était plutôt en retard. Mais le Numéro 13 était encore plus en retard : ses chaussures, des chaussures d’homme, étaient encore devant sa porte. Donc, le Numéro 13 était un homme, non pas une femme. Tout à coup, il vit le numéro sur la porte ; c’était le Numéro 14. Il pensa qu’il avait dû dépasser le numéro 13 sans le remarquer. Trois erreurs stupides dans l’espace de douze heures, c’était trop pour un homme à l’esprit méthodique et précis. Il retourna donc sur ses pas pour vérifier. Le numéro voisin était le 12, sa chambre. Il n’y avait pas de Numéro 13.
Après avoir passé quelques minutes à se rappeler soigneusement tout ce qu’il avait bu et mangé depuis vingt-quatre heures, Anderson décida d’abandonner son enquête. Si sa vue ou son cerveau faiblissait, il aurait bien d’autres occasions de s’en assurer ; sinon, il vivait au milieu de circonstances tout à fait étonnantes. En tout cas, la suite des événements vaudrait bien la peine d’être considérée de près.
Pendant la journée, il continua à examiner la correspondance épiscopale que j’ai déjà résumée. À son grand désappointement, elle n’était pas complète. Il ne put trouver qu’une seule autre lettre qui se référât à l’affaire de Mag. Nicolas Francken. C’était une lettre de l’évêque Jörgen Friis à Rasmus Nielsen. Il écrivait :
« Bien que nous ne fussions pas au moindre degré enclins à acquiescer à votre opinion en ce qui concerne notre tribunal, et que nous fussions préparés, s’il était nécessaire, à vous résister extrêmement sur ce point ; cependant, vu que notre loyal et aimé Mag. Nicolas Francken, contre qui vous avez osé alléguer certaines accusations fausses et malveillantes, a soudainement disparu de parmi nous, il est évident que cette question fait défaut pour cette fois. Mais vu que, comme vous alléguez en outre que Saint Jean, Apôtre et Évangéliste, décrit dans sa divine Apocalypse la Sainte Église romaine sous les traits et le symbole de la Femme vêtue d’écarlate, sachez que, etc.. »
En dépit de ses recherches, Anderson ne put pas trouver d’indice de la cause ou de la manière dont avait « disparu » le casus belli. Il se contenta de supposer que Francken était mort subitement ; et comme il y avait un intervalle de deux jours seulement entre la date de la dernière lettre de Nielsen, lorsque Francken vivait encore, et celle de la lettre de l’évêque, la mort avait dû être tout à fait inattendue.
Dans l’après-midi, il alla visiter Hald, et il prit son goûter à Bækkelund ; quoiqu’il fût dans un état de tension quelque peu nerveuse, il ne put remarquer aucun indice du déclin de sa vue ou de son cerveau, ainsi que ses aventures du matin l’avaient amené à craindre. Au dîner, il se trouva assis à côté du propriétaire. Après une conversation banale, il lui demanda : « Quelle est la raison pour laquelle le Numéro 13 ne se trouve pas parmi la liste des chambres dans la plupart des hôtels où l’on descend au Danemark ? J’ai vu qu’ici non plus, il n’était pas inscrit. »
Cela sembla amuser le propriétaire.
« Tiens ! et vous avez remarqué une telle chose. J’y ai pensé moi-même une fois ou deux, pour vous dire la vérité. Un homme instruit, ai-je dit, ne doit pas faire attention à ces superstitions. J’ai été élevé au lycée de Viborg, et notre vieux professeur a toujours été contre toutes ces choses-là. Il est mort maintenant depuis bien des années. C’était un homme remarquable et toujours prêt à se servir à la fois de ses mains et de son cerveau. Je me rappelle qu’un jour de neige, nous autres enfants… »
Et il se laissa aller à ses souvenirs.
« Alors, vous ne pensez pas qu’il y ait une objection particulière à avoir un Numéro 13 ? demanda Anderson.
– Ah, sûrement non. Vous comprenez, j’ai été mis au courant des affaires par mon pauvre vieux père. Il avait d’abord un hôtel à Aarhus, et puis, quand nous naquîmes, il changea pour Viborg, qui était son pays natal, et il y tint le Phénix jusqu’à sa mort. C’était en 1876. Alors, je me mis dans les affaires à Silkeborg, et il n’y a que deux ans que je me suis établi dans cette maison. »
Il donna alors d’autres détails quant à l’état de la maison et de l’affaire quand il les reprit.
« Et quand vous êtes arrivé ici, y avait-il un Numéro 13 ?
– Ah, mais non ! J’allais vous en parler. Vous voyez, dans un endroit comme ici, notre clientèle comprend en général les commerçants, les commis-voyageurs. Et allez donc les mettre dans le Numéro 13 ! Eh bien ! ils préféreraient dormir dans la rue. Pour moi, le numéro de ma chambre me serait complètement égal, et je le leur ai dit bien souvent ; mais ils y tiennent, à ce que le Numéro 13 leur porte malheur. Ils ont parmi eux des quantités d’histoires au sujet de personnes qui ont dormi dans un Numéro 13, et qui n’ont jamais été les mêmes ensuite, ou qui ont perdu leurs meilleurs clients, ou bien encore, un tas d’autres sornettes… dit le propriétaire après avoir cherché une phrase plus frappante.
– Alors, à quoi sert votre Numéro 13 ? » dit Anderson. Et, en disant ces mots, il se rendait compte d’une étrange anxiété qui était tout à fait disproportionnée à l’importance de la question.
« Mon Numéro 13 ? Ne vous ai-je donc pas dit qu’il n’y en a pas dans la maison ? Je pensais que vous auriez dû le remarquer. S’il y en avait un, ce serait la chambre voisine de la vôtre.
– Eh bien, oui. Seulement je pensais… ou plutôt j’avais cru la nuit dernière que j’avais vu une porte avec le Numéro 13 dans ce couloir-là. Et vraiment, je suis presque sûr que j’avais raison, car je l’ai vue aussi la veille au soir. »
Naturellement, Herr Kristensen se moqua de cette idée, ainsi qu’Anderson s’y était attendu, et il réitéra ses assurances qu’il n’y avait pas de Numéro 13 dans l’hôtel, et qu’il n’y en avait jamais eu un avant lui.
Anderson se sentit tant soit peu soulagé par son assurance, mais il était encore intrigué. Il se mit à penser que le meilleur moyen de s’assurer s’il avait été ou non la proie d’une illusion, était d’inviter le propriétaire à venir fumer un cigare dans sa chambre plus tard dans la soirée. Il avait avec lui quelques photographies de villes anglaises, et cela constituait une excuse suffisante pour l’invitation.
Herr Kristensen se sentit flatté par cette invitation et il accepta très volontiers. Il devait venir à environ dix heures, mais Anderson avait quelques lettres à écrire avant cela et il se retira pour accomplir cette tâche. Il ne pouvait pas dénier qu’il était inquiet au sujet de l’existence du Numéro 13, et cette admission le fit presque rougir. Il alla à sa chambre en passant devant le numéro 11 pour éviter de passer devant la porte, ou plutôt, l’endroit où la porte aurait dû être. Il regarda rapidement, et avec suspicion, autour de lui quand il entra dans la chambre, mais il n’y avait rien qui justifiât de la méfiance, à part cette impression indéfinissable de rétrécissement. Cette fois-ci, il ne s’agissait pas de savoir si sa valise était là ou non. Il l’avait vidée lui-même et l’avait glissée sous son lit. Il congédia de son esprit le souvenir du Numéro 13 avec une certaine difficulté, et il s’assit et se mit à écrire.
Ses voisins étaient raisonnablement tranquilles. De temps en temps, on ouvrait une porte sur le couloir, et on jetait une paire de chaussures, ou bien un commis-voyageur passait en fredonnant, et dehors, une charrette roulait à grand fracas sur les horribles pavés, ou encore quelqu’un marchait d’un pas rapide sur les dalles du trottoir.
Anderson termina ses lettres et commanda un whisky and soda. Il alla à la fenêtre et il examina avec attention le mur d’en face et les ombres qu’on y voyait.
Autant qu’il pouvait s’en souvenir, le Numéro 14 était occupé par l’avocat, homme posé, qui parlait peu aux repas, car il étudiait généralement un petit paquet de documents posé à côté de son assiette. Cependant, il devait avoir l’habitude de s’adonner à son naturel quand il était seul. Sinon, pourquoi donc aurait-il dansé ? L’ombre qui venait de la chambre voisine montrait d’une manière évidente qu’il dansait. Sa forme maigre passait et repassait derrière la fenêtre, ses bras s’agitaient, et il lançait en l’air sa jambe décharnée avec une agilité surprenante. Il paraissait être nu-pieds, et le plancher devait être bien construit, car aucun son ne trahissait ses mouvements. Monsieur l’avocat Herr Anders Jensen, dansant à dix heures du soir dans une chambre d’hôtel, semblait être un sujet convenable pour un tableau historique de grand style ; et les pensées d’Anderson, comme celles d’Émilie dans « Les Mystères d’Udolphe, » (3) commencèrent « à se placer dans l’ordre suivant » :
« Quand je rentre à mon hôtel
À dix heures du soir
Les garçons pensent que je suis malade ;
Cela m’est bien égal.
Mais, quand j’ai fermé à clef la porte de ma chambre
Et mis mes chaussures dehors,
Je danse pendant toute la nuit sur le plancher.
Et même si mes voisins se fâchaient,
Je danserais encore davantage,
Car je connais la loi,
Et, en dépit de toute leur gueule,
Je me moque de leurs protestations. »
Si le propriétaire n’avait pas alors frappé à la porte, il est probable que le lecteur aurait pu lire un texte plus long. À en juger par son air surpris quand il se trouva dans la chambre, Kristensen fut frappé, ainsi qu’Anderson l’avait été plus tôt, par quelque chose d’insolite dans son aspect. Mais il ne dit rien. Les photographies d’Anderson l’intéressèrent prodigieusement et elles fournirent le texte de nombreuses dissertations autobiographiques. On ne sait pas bien comment la conversation aurait pu être détournée sur le Numéro 13, si l’avocat n’avait pas alors commencé à chanter. Et il chantait d’une manière qui ne pouvait laisser aucun doute quant au fait qu’il était ou très ivre, ou fou furieux. C’était une voix haute et grêle, et elle semblait sèche, comme par un long manque d’entraînement. Il n’était question ni de paroles ni d’air. Elle allait, montant jusqu’à une hauteur surprenante, et descendait avec un gémissement de désespoir, comme un vent d’hiver dans une cheminée creuse, ou un orgue dont le souffle fait défaut tout à coup. C’était un son vraiment horrible, et Anderson eut l’impression que, s’il avait été seul, il se serait enfui pour trouver un refuge et de la compagnie dans la chambre voisine d’un commis-voyageur.
Le propriétaire était assis, la bouche ouverte de stupéfaction.
« Je n’y comprends rien, dit-il enfin en s’essuyant le front. C’est horrible. J’ai entendu ce bruit-là une fois déjà, mais c’était un chat, ainsi que je m’en étais assuré.
– Est-il fou ? demanda Anderson.
– Il doit l’être ; et comme c’est triste ! C’est aussi un si bon client, et il est si heureux dans ses affaires, d’après ce qu’on me dit, et il a de la famille à élever. »
Juste à ce moment, on frappa avec impatience à la porte, et la personne qui avait frappé entra sans attendre à y être invitée. C’était l’avocat ; il était en négligé, avait les cheveux en désordre et il avait l’air fort mécontent.
« Je vous demande pardon, Monsieur, dit-il, mais je vous serais fort reconnaissant de cesser… »
Il s’arrêta alors, car il était évident que ni l’une ni l’autre des personnes qui étaient devant lui n’était responsable de la perturbation ; et après un moment d’accalmie, le son s’éleva et prit du volume à nouveau, plus sauvagement encore qu’auparavant.
« Mais, au nom du Ciel, que signifie donc cela ? s’exclama l’avocat. Où est-ce ? Qui est-ce ? Est-ce que je deviens fou ?
– Sûrement, Herr Jensen, cela vient de votre chambre, juste à côté ? N’y a-t-il pas un chat ou quelque chose d’autre qui s’est attrapé dans la cheminée ? »
C’était la meilleure réponse qui se présenta à l’esprit d’Anderson, et il se rendit compte de sa futilité en parlant ; mais tout était préférable à rester là debout à écouter cette voix horrible et à regarder le large visage pâle du propriétaire qui, suant et tremblant, s’agrippait aux bras de son fauteuil.
« C’est impossible, dit l’avocat, impossible. Il n’y a pas de cheminée. Je suis venu ici parce que j’étais convaincu que le bruit en venait. C’était certainement dans la pièce voisine de ma chambre.
– N’y avait-il pas une porte entre la vôtre et la mienne ? dit Anderson impatiemment.
– Non, Monsieur, répondit Herr Jensen assez brusquement. Tout au moins, pas ce matin.
– Ah, s’exclama Anderson. Ni ce soir ?
– Je n’en suis pas sûr, » dit l’avocat avec quelque hésitation.
Tout à coup, la voix qui criait ou chantait dans la pièce voisine se tut ; et l’on entendit alors le chanteur qui semblait rire tout seul avec une sorte de roucoulement. Ce bruit fit frémir les trois hommes, et un silence s’ensuivit.
« Eh bien ! dit l’avocat, Herr Kristensen, comment expliquez-vous cela ? Qu’est-ce que cela signifie ?
– Grands dieux ! répondit Kristensen, que pourrais-je dire ! Je n’en sais pas plus que vous, Messieurs ! Je voudrais ne plus jamais entendre un pareil bruit.
– C’est bien mon avis, » dit Herr Jensen, et il ajouta quelque chose à voix basse. Anderson pensait que cela ressemblait aux dernières mots du Psautier, « omnis spiritus laudet Dominum, » mais il n’en était pas sûr.
« Il faut que nous agissions, dit Anderson, nous trois. Si nous allions examiner la pièce voisine ?
– Mais c’est la chambre de Herr Jensen, geignit le propriétaire. Ce n’est pas la peine. Il en vient lui-même.
– Je n’en suis pas absolument sûr, dit Jensen. Je crois que ce monsieur a raison : il faut que nous allions voir. »
Les seules armes défensives qu’ils purent rassembler sur place étaient une canne et un parapluie. L’expédition sortit dans le couloir, non sans trembler. Un silence de mort régnait dehors, mais une lumière brillait en dessous de la porte voisine. Anderson et Jensen s’en approchèrent. Le second tourna la poignée et donna une poussée vigoureuse. Rien à faire ; la porte tenait ferme.
« Monsieur Kristensen, dit Jensen, voulez-vous aller chercher le plus fort domestique que vous ayez ? Il faut que nous pénétrions au cœur de cette affaire. »
Le propriétaire y consentit d’un signe de tête et se dépêcha de s’en aller, heureux de quitter le théâtre des événements. Jensen et Anderson restèrent dans le couloir, regardant la porte.
« Vous voyez, c’est le Numéro 13, dit ce dernier.
– Oui ; voici votre porte, et voilà la mienne, répondit Jensen.
– Ma chambre a trois fenêtres en plein jour, ajouta Anderson, réprimant avec difficulté un rire nerveux.
– Sacrebleu ! il en est de même dans ma chambre, » dit l’avocat en se retournant et en regardant Anderson. Il tournait maintenant le dos à la porte. À cet instant, elle s’ouvrit, un bras en sortit et chercha à attraper l’épaule de Jensen de la main griffue qui le terminait. Il était recouvert d’un linge jaune en lambeaux, et la peau, où on pouvait la voir, était garnie de longs poils gris.
Anderson avait eu juste le temps de pousser Jensen hors de la portée du bras avec un cri de dégoût et d’effroi, quand la porte se referma, et on entendit alors un rire étouffé.
Jensen n’avait rien vu, mais quand Anderson lui dit rapidement quel risque il avait couru, il se troubla fort et suggéra d’abandonner l’entreprise et de s’enfermer à clef tous deux dans l’une ou l’autre de leurs chambres.
Cependant, tandis qu’il exposait ce plan, le propriétaire et deux hommes vigoureux arrivèrent sur le théâtre des événements ; ils avaient tous l’air sérieux et alarmé. Jensen les salua d’un torrent de descriptions et d’explications, qui ne contribua en aucune façon à les encourager à la bagarre.
Les hommes laissèrent tomber les pinces-monseigneur qu’ils avaient apportées, et dirent tout net qu’ils n’allaient pas risquer leur cou dans cet antre du diable. Le propriétaire était affreusement inquiet et indécis, à la fois conscient du fait que, si l’on ne faisait pas face au danger, son hôtel serait ruiné, et répugnant à y faire face lui-même. Par bonheur, Anderson trouva un moyen de rallier le courage de cette armée démoralisée.
« Est-ce donc, dit-il, ce courage danois dont j’ai tant entendu parler ? Ce n’est pas un Allemand qui est là-dedans, et si c’en était un, nous sommes cinq contre un. »
Ceci fouetta le courage des deux domestiques et de Jensen, et ils se précipitèrent sur la porte.
« Arrêtez ! s’écria Anderson. Ne perdez pas la tête. Vous, le propriétaire, restez ici avec la lumière et que l’un de vous deux enfonce la porte. Surtout, quand elle cédera, n’entrez pas. »
Les deux hommes firent signe de la tête qu’ils avaient compris. Le plus jeune s’avança, leva sa pince-monseigneur et donna un coup formidable sur le panneau supérieur. Le résultat ne fut en rien ce qu’ils attendaient. On n’entendit ni craquement ni le bruit que fait le bois en se fendant, mais seulement un son mat, comme si l’on avait frappé le mur plein. L’homme laissa tomber son instrument avec une exclamation et commença à se frotter le coude. Son cri attira les yeux sur lui pendant un instant ; alors, Anderson regarda de nouveau la porte. Elle avait disparu ; la paroi de plâtre du couloir était devant ses yeux, et on y voyait une entaille profonde à l’endroit que la pince-monseigneur avait frappé. Le Numéro 13 s’était évanoui.
Pendant un court moment, ils restèrent sans mouvement, regardant fixement le mur nu. Alors, ils entendirent un coq matinal chanter dans la cour ; et comme Anderson regardait dans la direction du son, il vit par la fenêtre au bout du long couloir que l’aube pâlissait à l’orient.
*
« Peut-être, dit le propriétaire avec hésitation, peut-être que ces messieurs voudraient avoir une autre chambre pour cette nuit… une chambre à deux lits ? »
Ni Jensen ni Anderson n’étaient contraires à cette suggestion. Après cette dernière aventure, ils étaient enclins à se tenir compagnie dans leurs entreprises. Ils convinrent de l’utilité, quand chacun d’eux entra dans sa chambre pour prendre les effets qu’il désirait pour la nuit, que l’autre entrât avec lui pour tenir la bougie. Ils remarquèrent que le Numéro 12, aussi bien que le Numéro 14, avait trois fenêtres.
Le lendemain matin, les mêmes personnes se rassemblèrent dans le Numéro 12. Le propriétaire était naturellement désireux d’éviter d’avoir recours à une aide extérieure, et cependant, il était impérieux d’éclaircir le mystère qui enveloppait cette partie de la maison. Par conséquent, on avait décidé les deux domestiques à prendre les fonctions de charpentiers.
On déménagea les meubles, et on défit, au prix d’un bon nombre de planches irréparablement endommagées, cette partie du plancher qui était le plus près du Numéro 14.
Vous allez tout naturellement supposer qu’on découvrit un squelette…. disons, celui de Mag. Nicolas Francken. Mais il n’en fut rien. Ce qu’ils découvrirent entre les poutres qui supportaient le plancher fut une petite boîte de cuivre rouge. À l’intérieur, il y avait un document de vélin soigneusement plié et couvert d’environ vingt lignes manuscrites. Cette découverte, qui promettait de donner la clef de ces phénomènes extraordinaires, anima fort Anderson et aussi Jensen, qui se montra quelque peu paléographe.
*
J’ai en ma possession un exemplaire d’un ouvrage astrologique que je n’ai jamais lu. Son frontispice est une gravure sur bois de Hans Sebald Beham, qui représente quelques mages assis autour d’une table. Ce détail pourra peut-être permettre aux connaisseurs d’identifier le livre. Je ne puis pas me souvenir du titre, et le volume n’est pas à ma portée en ce moment. Mais ses gardes sont couvertes de notes manuscrites. Depuis dix ans que je l’ai, je n’ai pas été capable de décider dans quel sens doit se lire ce document, et encore moins dans quelle langue il est écrit. La position d’Anderson et de Jensen n’était guère différente après le long examen auquel ils soumirent le document du coffret de cuivre.
Après un examen de deux jours, Jensen, qui avait l’esprit le plus hardi de nos deux héros, hasarda la supposition que la langue utilisée était ou du latin ou de l’ancien danois.
Anderson ne se lança dans aucune conjecture ; il était tout en faveur de céder le coffret et le parchemin à l’Association Historique de Viborg, afin qu’elle les plaçât dans son musée.
Quelques mois plus tard, il me raconta toute cette histoire alors que nous étions assis dans un bois auprès d’Upsal. Nous étions allés à la bibliothèque de cette ville et nous avions ri, ou plutôt, j’avais ri, du contrat par lequel Daniel Salthenius (plus tard professeur d’Hébreu à Kœnigsberg) se vendit à Satan. Cela n’amusa guère Anderson.
« Quel jeune imbécile ! dit-il, en se référant à Salthenius qui n’était encore qu’étudiant lorsqu’il commit cette imprudence, comment pouvait-il savoir en quelle compagnie il frayait ? »
Et il se contenta de répondre par un grognement lorsque je suggérai les considérations habituelles sur ce sujet. Cet après-midi-là, il me raconta ce que vous venez de lire ; mais il refusa d’en tirer aucune conclusion et de donner son assentiment à aucune de celles que je fis pour lui.
_____
(1) I Bog Mose, Cap. 22 : Danois pour : Ier Livre de Moïse, chapitre 22. [NdT]
(2) Stuepige : mot danois signifiant femme de chambre. [NdT]
(3) Roman d’Ann Raddcliffe (1794). [NdT]
_____
Illustration de James McBryde pour Canon Alberic’s Scrap-Book

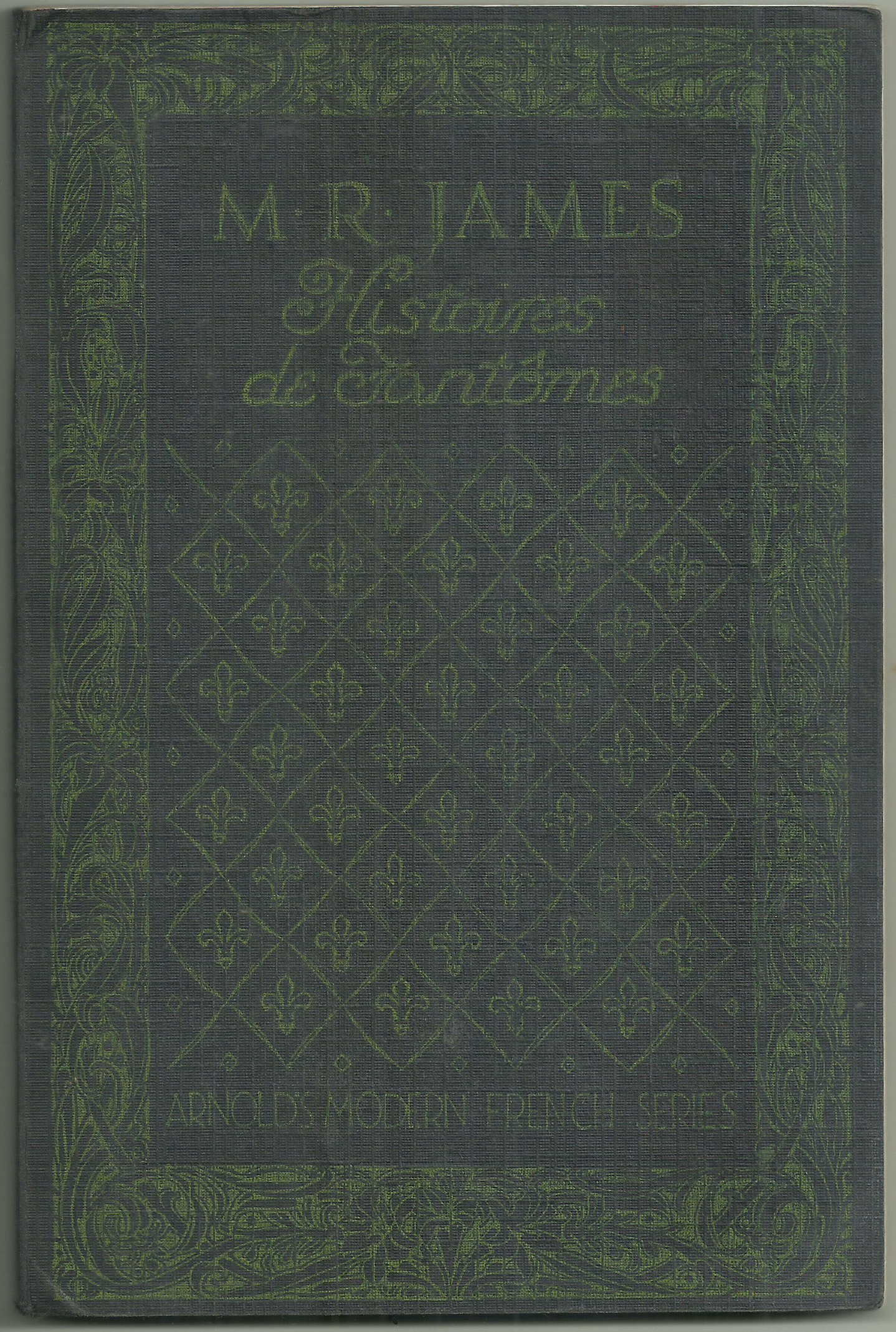
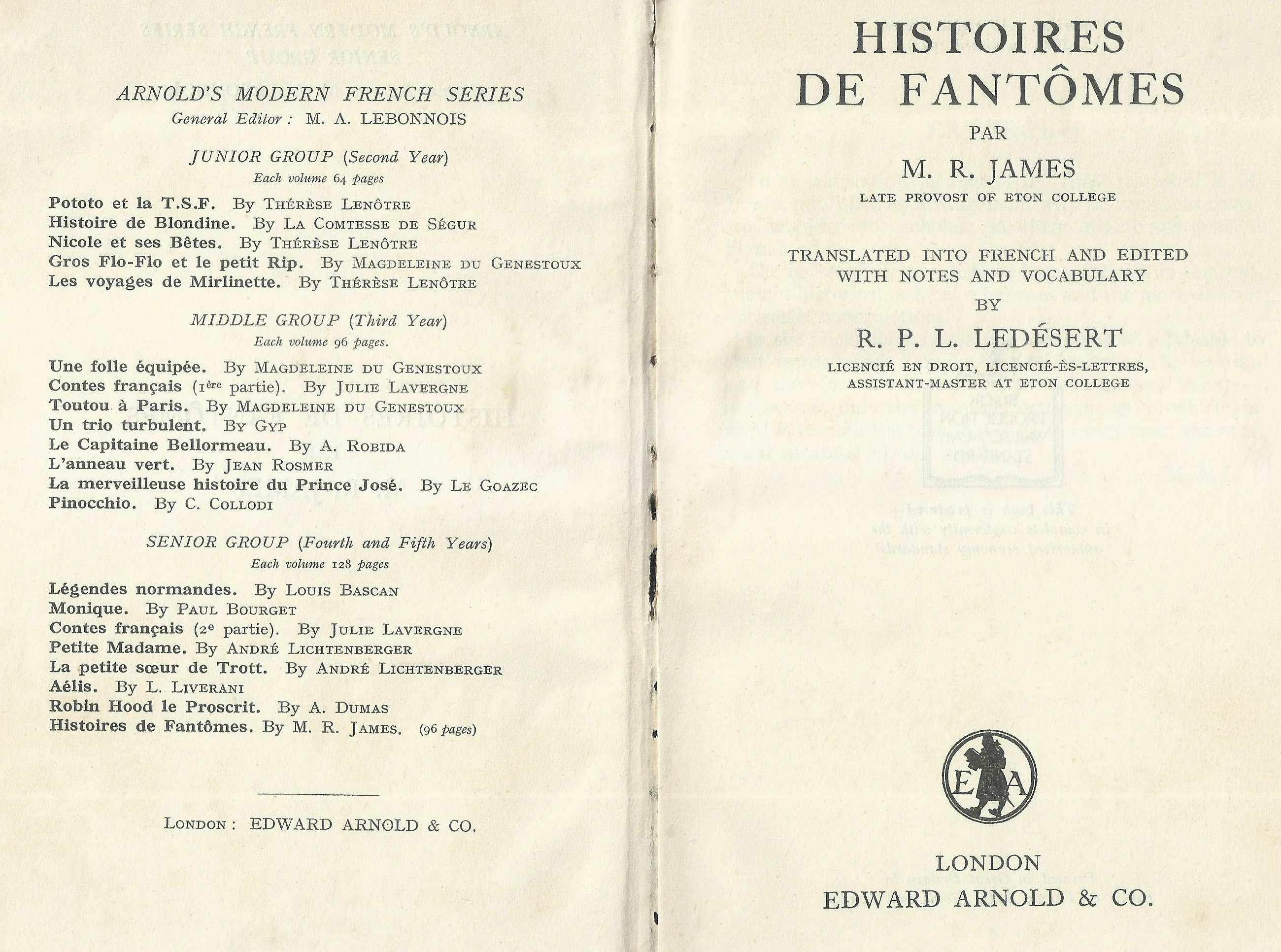



Délicieuse lecture. Merci !