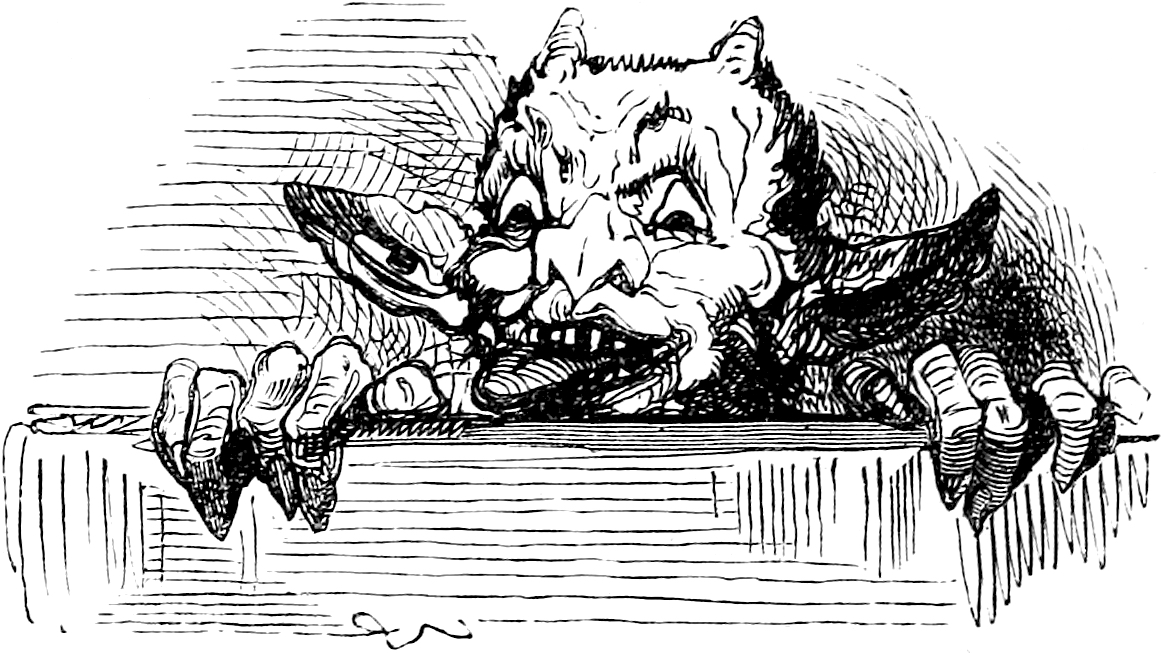J’y retournai, la semaine suivante. Lorsque j’entrai dans la grande pièce calme, il ne travaillait pas.
Dans le milieu de l’atelier, était posé un petit berceau de bois, et, penché sur lui, le visage anxieux, Ambrosio Pesarini regardait son enfant.
« Ah ! c’est vous, fit-il ; vous voyez : je contemple ! »
Il éclata d’un rire sonore.
« Ce nez exquis !… ce crâne élégant !… ces yeux troublants !… ces lèvres adorables !… Ha, ha !… ha, monsieur !… que voilà un superbe enfant !… Ha, ha, ha… »
Je reculai malgré moi.
Cet homme était fou ?
Un grand froid pinça toute ma chair…
Mais déjà Pesarini s’était levé et parlait d’autre chose : le père était parti, l’artiste était revenu ; il ne fut plus question de l’enfant.
Il travailla devant moi, m’entretint de son art, me montra, sur le flanc du vase, que le faune était presque fini.
Ce fut une journée comme les autres journées. Mon admiration pour lui ne faisait que s’accroître.
*
Je fis plusieurs autres visites.
Nous fûmes deux amis.
Nos entretiens roulaient toujours sur les mêmes sujets.
Et j’arrivai peu à peu à le connaître mieux.
J’acquis ainsi rapidement la conviction que la laideur de son enfant était chez lui une idée fixe ; et ses exaltations subites, sans cesser de m’épouvanter, me surprirent moins.
Lorsqu’il m’avait dit son âge, la première fois, j’avais pensé : il est presque impossible que sa raison soit intacte. Les apparences me trompent sans doute. Il doit y avoir là quelque faiblesse cachée.
Et c’était cela.
Chez ce vieillard, dont les facultés artistiques étaient restées si solides, le cerveau chancelait devant les choses de la vie.
II fallait donc lui en éviter le plus possible le contact, et le maintenir dans le domaine de la pensée. Je m’y appliquai avec soin et je compris alors que ma présence, en effet, dans ce sens-là, pouvait adoucir sa tristesse.
Parfois, pourtant, je n’étais plus assez fort, et lorsqu’il parlait de sa fille, les mêmes folies passaient sur ses lèvres et les mêmes lueurs passaient dans ses yeux.
Je venais maintenant tous les jours chez lui, négligeant mes autres travaux. Quelque chose m’attirait vers cet être extraordinaire. Il emplissait toute mon existence.
IV
Comme j’entrais, un matin, dans le sombre atelier, il me reçut d’une manière tout à fait étrange.
Sans bouger de son établi, devant lequel il était debout, il me fit de grands signes de bras en me criant des : « Chut ! » très prolongés.
« Chut ! chut! Ne faites pas trop de bruit ! vous me troubleriez… Ah ! c’est qu’aujourd’hui il ne faut pas me troubler ! Venez voir… »
Je m’approchai en m’efforçant de rire, comme j’avais pris l’habitude de le faire lorsqu’il était dans ses instants de folie.
Et je regardai.
Dans un gros bloc d’or, – où l’avait-il eu ! je frissonnai à l’idée qu’il avait pu, dans son égarement, détruire, pour le former, quelque autre de ses chefs-d’œuvre, – dans un gros bloc d’or, serré par l’étau, il ciselait une tête d’enfant.
Il ne s’interrompit pas, comme il le faisait d’ordinaire.
Il tourna seulement la tête ; puis, avec un sourire navrant :
« Vous voyez, fit-il doucement, je retouche mon enfant… »
C’était sa fille qu’il sculptait, en effet. Mais il faisait en beau son enfant si hideux !
Il le faisait tel qu’il l’aurait voulu, tel qu’il aurait dû être ! Et dans la vague ébauche que ses outils fouillaient avec une impatience nerveuse, on retrouvait déjà le souffle splendide de ses autres œuvres.
Ah ! si elle avait été comme ça !…
Comme je le comprenais, en cette minute, ce haïsseur de laid ! Comme il devait souffrir – au point d’en perdre la raison ?… Et quelle triste joie que la joie qu’il se donnait là de « retoucher » l’œuvre mal venue !…
Ses doigts légers faisaient leur miracle.
Les fines papillotes d’or sautaient autour de lui, sans qu’il les recueillît. Et le « portrait » – amère ironie, encore ! – s’annonçait tout à fait « joli. »
Je gardai longtemps le silence.
Et je voulus alors, pour chasser une fois de plus le maudit cauchemar, reprendre avec lui notre entretien coutumier.
Ce fut en vain.
Il se lança aussitôt dans une sorte de divagation qu’il me fut impossible d’arrêter.
Sa voix était saccadée ; un spasme faisait vibrer ses mains moites. De la sueur luisait sur son front.
« Qui donc, disait-il, qui donc a dit qu’elle était laide pour toujours ?… Pourquoi cela : pour toujours ? Ah ! non, nous verrons bien, vous verrez tous !… Courez, ô mon burin, courez dans l’or éclatant… Et refaites, sous ma main, les traits bénis de celle que j’aime ..
Laide pour toujours !… Est-ce qu’on est laid pour toujours lorsqu’on a près de soi Celui qui embellit !… Qu’est-ce qu’ils diront demain, lorsqu’ils te verront si belle, si belle, ô toi, qu’ils ont appelée, qu’ils ont osé appeler le monstre !… »
Je sentais bien qu’il était inutile à présent de rien essayer.
Un grand malaise m’était venu, et je me demandais si je ne voyais pas là sombrer définitivement cette intelligence si lumineuse.
Mais, tout à coup, il s’arrêta. Et ce fut un mutisme dont rien ne put le tirer.
Puis, le soir venu, comme je me décidais à prendre congé, il ne prêta à mon départ aucune attention.
Il posa seulement bien droit le lourd buste d’or, se recula, puis, le détaillant d’un regard aigu :
« Non… non… décidément, murmura-t-il ; ce n’est pas encore ça. »
Ce furent ses seules paroles.
L’heure était très avancée. Je le quittai.
*
Ce triste incident m’avait empli plus que jamais de cette sorte de souffrance que donne la compréhension de l’inutile, de la force finie, du génie usé redevenant enfant.
J’étais, en même temps, très inquiet.
Je m’étais attaché profondément à cet homme, si grand, chez qui j’avais découvert – en plus des admirables dons de l’artiste – les qualités les plus hautes de noblesse et de bonté.
Et je cherchais dans ma tête le moyen de soulager encore la misère – morale, cette fois – de cette pauvre intelligence en détresse.
Après une nuit agitée de visions pénibles, je m’éveillai fort tard, avec la sensation d’un poids lourd dans la tête.
Un besoin de le revoir me prit.
Je m’habillai à la hâte et j’allai chez lui.
Il y a quinze ans de cela !
Et je me rappelle ces choses comme si elle dataient d’hier !…
Lorsque j’entrai, il était, comme la veille, à son établi.
Comme la veille, il ne bougea point et me fit de grands gestes des bras pour me recommander le silence.
« Chut ! chut ! Ne faites pas trop de bruit !… Vous me troubleriez, aujourd’hui !… Ah ! c’est qu’aujourd’hui, il ne faut pas qu’on me trouble… »
La voix était plus sourde, avec quelque chose de monotone qui me surprit.
Je m’approchai, faisant de grands effort pour rire encore un peu.
Et tout à coup, comme j’arrivais auprès de lui, je m’arrêtai net, dans un un vertige d’épouvante… Un grand flot de sang vint marteler mon crâne. Mes jambes se raidirent… Ma gorge se ferma… Je ne pus crier…
Son enfant, – dans l’étau, –- son enfant cette fois était serrée, sa fille vivante en chair et en os ! Et Pesarini la sculptait !…
Un grand tremblement secouait tous mes membres, qui craquaient…
Ma main avait saisi le bord d’un meuble sur lequel mes doigts battaient en une espèce de roulement saccadé…
Mes jambes soudain devinrent insensibles…. Je tombai sur les genoux…
Et je restai là, hagard…
Il ne s’était pas interrompu.
Il tourna seulement la tête, puis, avec un sourire qui me tortura :
« Vous voyez, fit-il doucement ; je retouche ma fille !… »
Que celui-là se souvienne, qui, une fois dans sa vie, s’est trouvé face à face avec le Fou !
J’étais presque accroupi sur la dalle et je voyais !
La tête mutilée de l’enfant, l’étau, l’établi, les outils, tout était rouge de sang et les mains du vieillard étaient celles d’un boucher…
D’un grand coup de ciseau, il avait fait sauter toute une bosse du crâne pour le faire plus rond : pour remonter l’un des yeux, il l’attaquait par en-dessous avec une large gouge, qui soulevait peu à peu une flasque papillote de chair, tandis que son pouce pointu était entré, pour mieux soutenir le tout, dans l’orbite béante.
Et l’enfant vivait encore !… Horreur !… De cette boule rouge qui était la tête, une sorte de râle entrecoupé de hoquets s’échappait faiblement… Et cela ressemblait, à s’y méprendre, à son rire, son petit rire léger, que j’avais bien souvent entendu.
L’horreur de la vision fut trop forte… Un voile gris passa devant mes yeux… je ressentis à la nuque comme un grand coup de poing…
Je m’évanouis….
V
On me retrouva, le soir, dans le grand atelier.
Tout près de moi était la dépouille sanguinolente de l’enfant.
Au milieu de la pièce, un gros monceau d’or, débris de toute sorte déchiquetés et martelés, portant les traces de ciselures merveilleuses : tout ce qui restait du sublime musée…
Sur le sommet, en travers, le cadavre d’Ambrosio, avec un long couteau enfoncé dans le cœur…
FIN
–––––
(Paul Heuzé, in Journal des débats politiques et littéraires, cent dix-septième année, n° 97, samedi 8 avril 1905 ; in Annales africaines, revue politique et littéraire de l’Afrique du Nord, trente-cinquième année, nouvelle série, n° 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, vendredis 6, 13, 20 juillet, 3, 10, 17 et 24 août 1923 ; in Le Petit Méridional, journal républicain quotidien, n° 17474, 17475, 17477, 17478 et 17480, mardi 29, mercredi 30 janvier, vendredi 1er, samedi 2 et lundi 4 février 1924. Cette nouvelle a été reprise en volume dans le recueil éponyme, Paris : Jean Bosc & Cie, 1907 ; elle a également fait l’objet, semble-t-il, d’une édition illustrée séparée en 1924, à l’Édition artistique. William Fettes Douglas, « Benvenuto Cellini selling Plate, » huile sur toile, 1856)