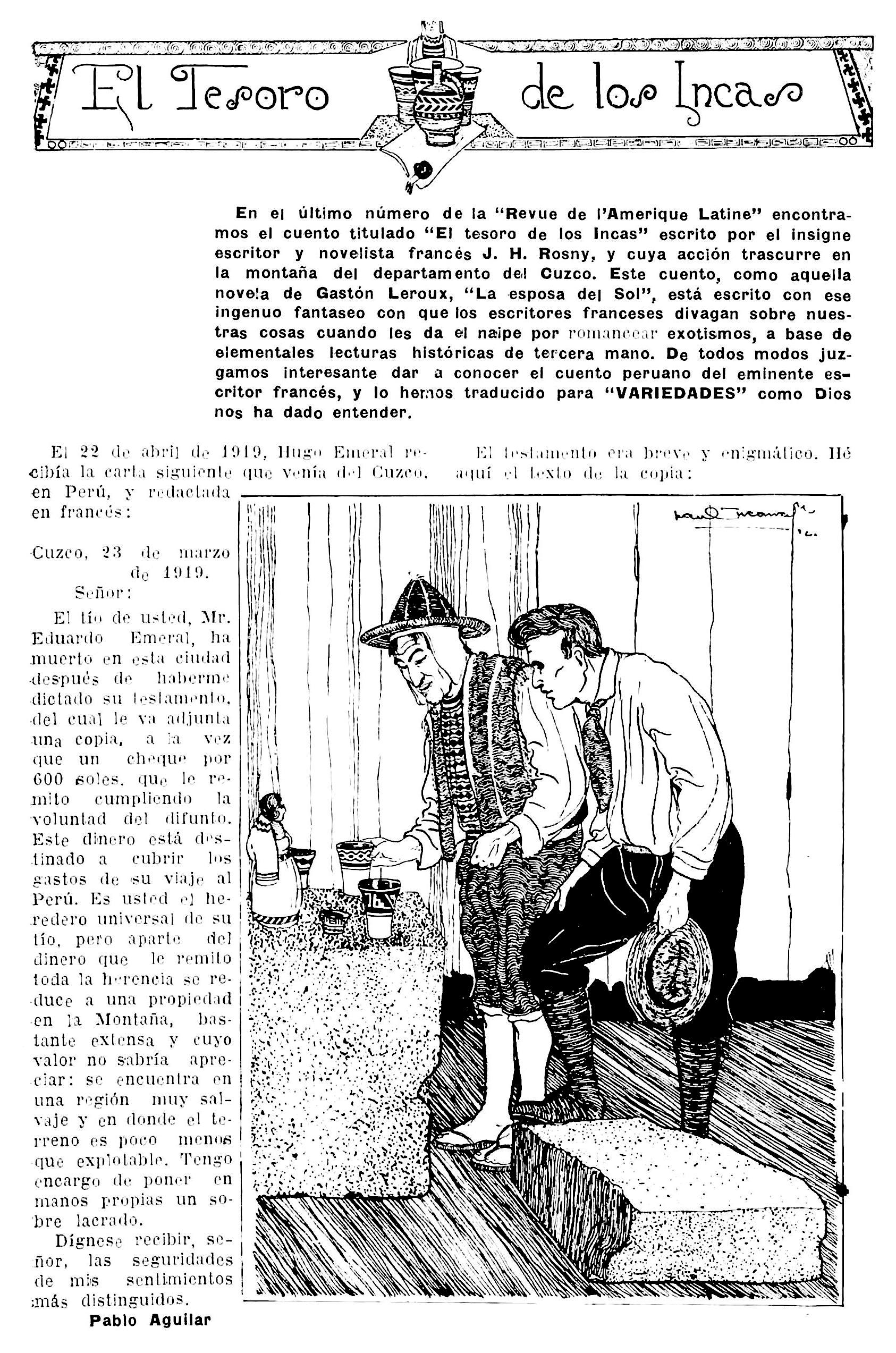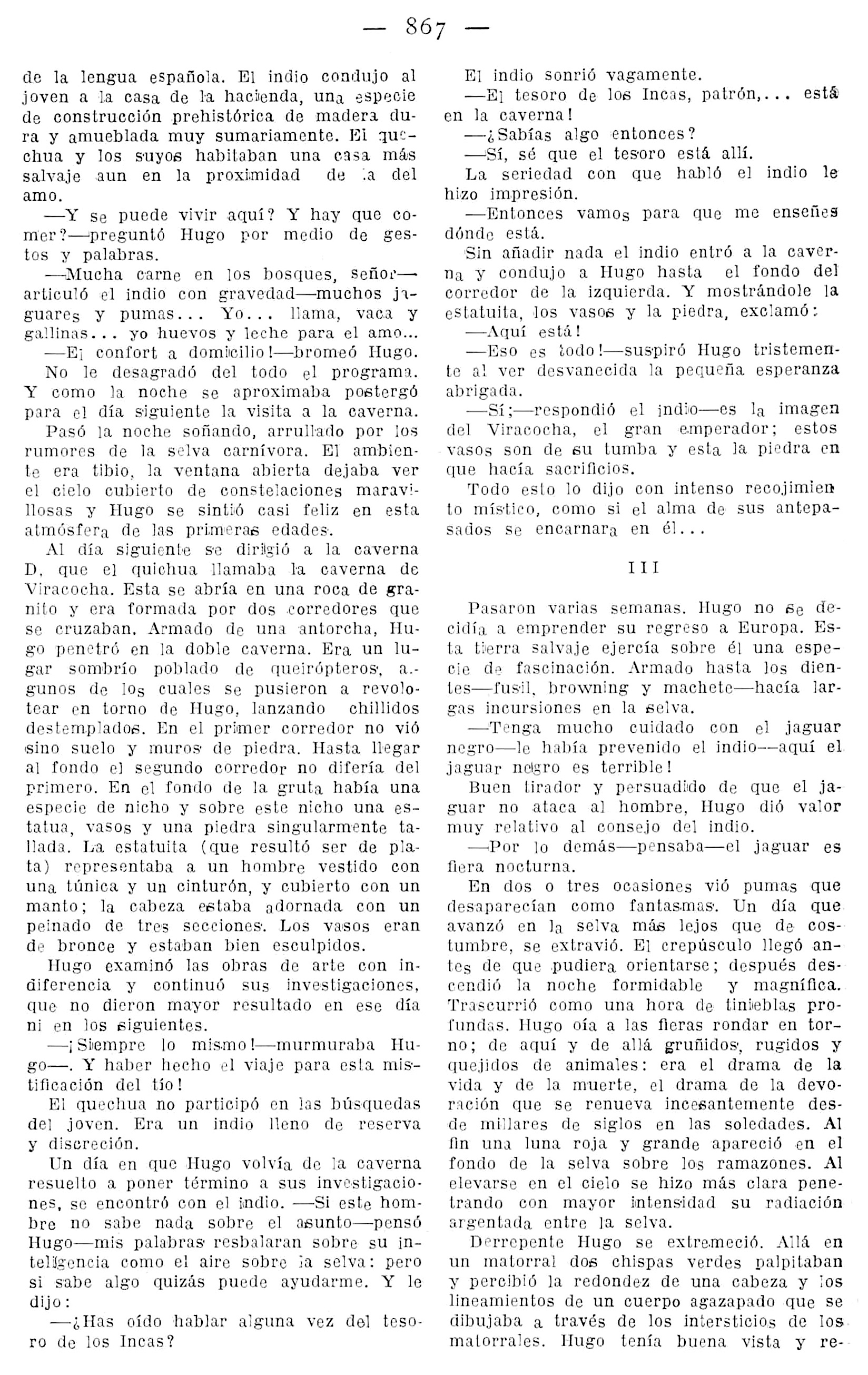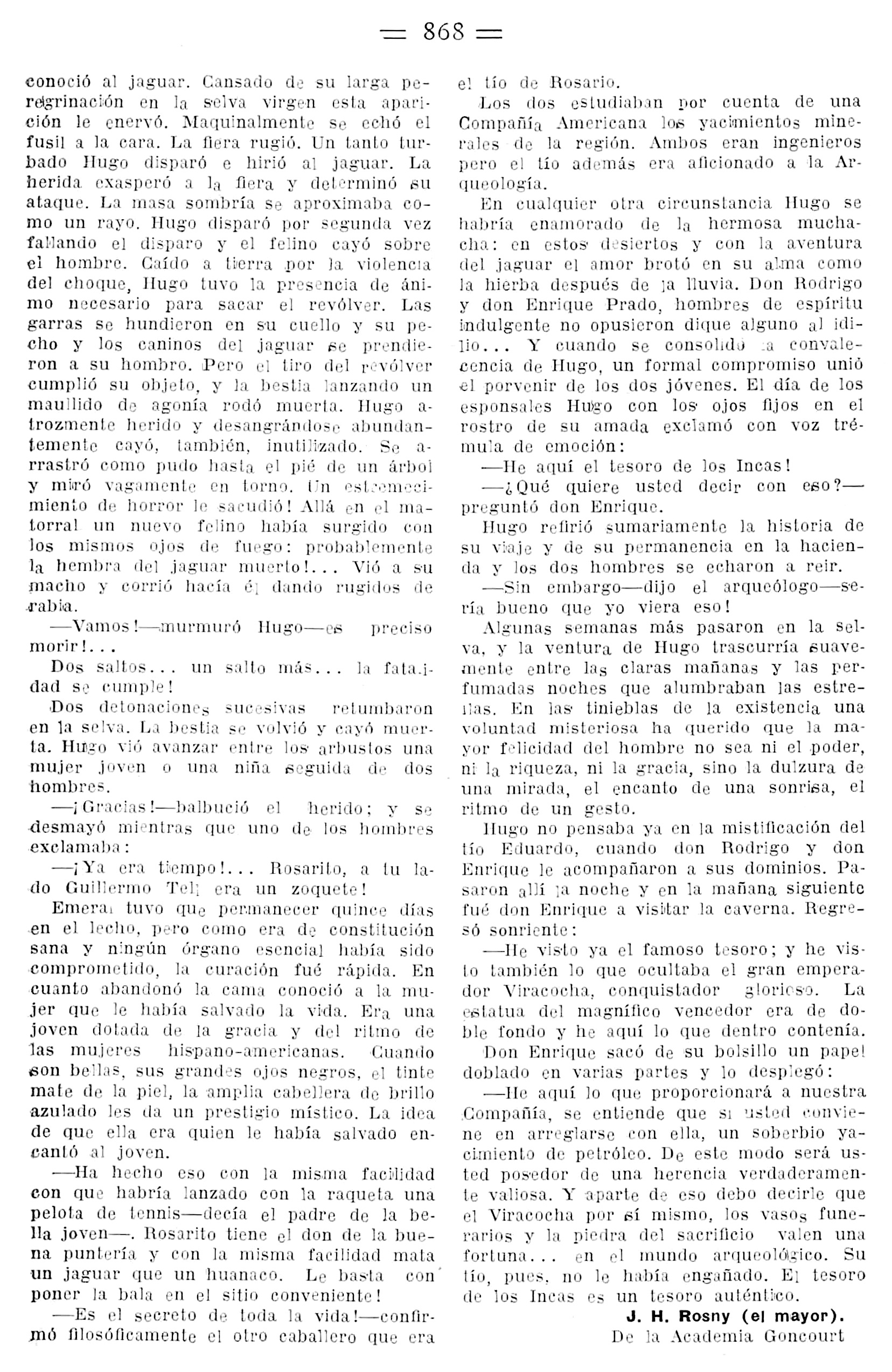I
Le 22 avril 1919, Hugues Émeral recevait de Cuzco, au Pérou, la lettre suivante, rédigée en français :
Cuzco, 23 mars 1919.
Monsieur,
Votre oncle, M. Édouard Émeral, est décédé en cette ville, après m’avoir fait dresser son testament, dont vous voudrez bien trouver une copie ci-jointe en même temps qu’un chèque de 600 soles que je vous envoie selon la volonté du défunt. Cet argent est destiné à vous couvrir des frais d’un voyage au Pérou. Vous êtes l’héritier universel du défunt mais, à part l’argent que je vous envoie, l’héritage ne se compose que d’une propriété dans la Montaña, assez vaste, et dont on ne saurait estimer la valeur : elle se trouve dans un pays fort sauvage, où la terre est à peu près inexploitable. Je dois vous remettre en mains propres une enveloppe cachetée.
Veuillez recevoir, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les plus distingués.
Pablo AGUILAR.
Le testament était bref et énigmatique. En voici le texte :
Moi, Édouard Émeral, sain de corps et d’esprit, je lègue à mon neveu Hugues Émeral, tous mes biens meubles et immeubles, entr’autres ma propriété du Jaguarundi, dont il trouvera l’acte de propriété chez Me Pablo Aguilar.
Fait à Cuzco, le 19 décembre 1918.
Édouard ÉMERAL.
« Diantre ! se dit l’héritier, voilà qui n’est pas très séduisant ! »
Il se méfiait de l’oncle Édouard, homme fantasque, mystificateur, brouillé de tout temps avec les siens, et dont on n’avait pas entendu parler depuis quinze ans.
Hugues Émeral n’avait qu’un maigre patrimoine, amoindri encore par des hypothèques. L’esprit d’aventures le disposa à entreprendre le voyage.
« D’ailleurs, se dit-il, grâce à ce chèque tombé de la lune, cela ne me coûtera rien. »
Il prit ses dispositions et, quelques semaines plus tard, il s’embarquait. Après une traversée passable et un médiocre voyage en chemin de fer, il arriva à Cuzco et se fit mener chez don Pablo Aguilar.
Le sieur Aguilar le reçut avec la courtoisie héréditaire des Hispano-Américains et, après quelques préliminaires, lui dit :
« Je ne crois pas que votre propriété ait, par elle-même, une valeur sérieuse. Votre oncle l’avait achetée à bas prix… Mais il m’a paru qu’il avait son idée et il se pourrait que cette idée fût incluse dans l’enveloppe que je vais vous remettre. »
Don Pablo atteignit dans un coffre-fort une grosse enveloppe de papier parchemin, scellée de trois cachets de cire rouge.
« Si je puis vous aider en quoi que ce soit, reprit don Pablo, je le ferai avec plaisir et vous pouvez compter sur mon zèle. »
Rentré à l’hôtel, Hugues décacheta l’enveloppe. Il trouva une lettre et un plan. La lettre disait :
Mon neveu,
Je n’ai aucune raison de vous être agréable. D’abord, je ne vous connais pas ; ensuite, votre père et moi avions fini par nous détester. Mais je n’ai pas d’ami sincère. Alors, je vous lègue mon domaine du Jaguarundi, en vous prévenant qu’il contient le Trésor des Incas (caverne marquée D sur le plan). Sur la valeur de ce Trésor, je ne vous donne aucune indication ; il vous appartient de le découvrir ; quant à moi, je n’ai plus à m’inquiéter de la valeur des choses de ce monde ; dans quelques mois, j’aurai franchi la grande frontière !
Édouard ÉMERAL.
« Le Trésor des Incas ! murmura Hugues. Quel beau titre pour le cinéma ! Allons-y ! mais, décidément, l’oncle était un fumiste. »
II
Hugues n’atteignit pas sans fatigue le domaine du Jaguarundi. C’était un lieu terriblement sauvage, perdu au fond de la sylve, dévoré par une végétation féroce, si vivace qu’on avait l’impression de la voir grandir à vue d’œil. Aucune culture régulière. Comme habitants, un Quichua, sa femme et trois petits Indiens, agiles comme de petits chats-tigres.
L’homme était un ex-serviteur d’Édouard Émeral ; il continuait à veiller sur le domaine, dont il vivait du reste.
Il accueillit le nouveau maître avec l’empressement d’un solitaire qui s’ennuie. Au service de l’oncle, il avait appris à baragouiner un peu de français et, de son côté, Hugues se servait rudimentairement de la langue espagnole.
Il mena le jeune homme dans sa case, une construction préhistorique, en bois dur, meublée sommairement. Le Quichua et les siens habitaient une case plus sauvage encore, à proximité de celle du maître.
« Est-ce qu’on peut vivre ici ? Est-ce qu’on peut manger ? demanda Hugues, par gestes et par paroles.
– Beaucoup viande dans les bois, señor, articula le Quichua avec gravité… beaucoup jaguars aussi et pumas. Moi, lama, vaca et poules, moi, œufs et lait pour le maître.
– Le confort chez soi ! » gouailla Hugues.
Ça ne lui déplaisait point. Et comme la nuit allait venir, il remit au lendemain la visite de la caverne D.
Il passa le soir à rêver, bercé par les rumeurs de la forêt carnivore. La nuit était tiède ; la fenêtre ouverte laissait voir des constellations merveilleuses et Hugues se sentit presque heureux dans cette atmosphère des premiers âges.
Le lendemain, il se rendit à la caverne D, que le Quichua nommait la caverne de Vira Cocha…
Elle s’ouvrait dans un roc de granit et elle était formée de deux couloirs qui fourchaient. Armé d’une torche, Hugues s’engagea dans la double caverne.
C’était un lieu farouche, plein de chéiroptères, dont quelques-uns se mirent à voleter avec des cris grêles. Dans le premier couloir, il ne vit qu’un sol et des murailles de pierre. Jusqu’au fond, le second couloir ne révéla rien d’autre que le premier… Mais au fond, il y avait une espèce de niche et, dans cette niche, une statuette, des vases, une pierre singulièrement taillée. La statuette (qui se trouva être en argent) représentait un homme vêtu dune tunique avec ceinture et d’un manteau ; la tête était couverte d’une coiffure à trois étages. Les vases étaient en bronze et bien sculptés…
Hugues examina les œuvres d’art avec indifférence et continua ses recherches. Elles n’aboutirent ni ce jour ni les jours suivants.
« Tout de même ! se disait-il… Si c’est pour ça qu’il m’a fait faire le voyage, l’oncle est un mystificateur féroce. »
Le Quichua ne se mêla aucunement des recherches du jeune homme. C’était un Indien plein de réserve et de discrétion…
Un jour que le jeune homme revenait, définitivement résolu à abandonner ses recherches, il rencontra l’Indien. « Si cet homme ne sait rien, songea Hugues, les paroles passeront sur lui comme la brise sur la forêt… S’il sait quelque chose, il peut m’être utile. »
Et il dit :
« Avez-vous jamais entendu parler du Trésor des Incas ? »
Le Quichua eut un pâle sourire.
« Le Trésor des Incas, Maître… il est dans la caverne ! »
Hugues le regarda, stupéfait.
« Alors, vous savez ?
– Je sais que le Trésor est là. »
La gravité de l’Indien impressionna Hugues.
« Alors, dit-il, montrez-le-moi… »
Sans rien répondre, le Quichua entra dans la caverne et conduisit Hugues jusqu’au fond du couloir gauche. Et là, montrant la statuette, les vases et la pierre :
« Voilà, fit-il.
– C’est tout ! soupira Hugues, d’autant plus mélancolique qu’il avait eu une lueur d’espoir.
– Oui, reprit l’Indien. C’est l’image de Vira Cocha, le grand empereur ; ce sont des vases de son tombeau et c’est la pierre sur laquelle il sacrifiait. »
Il parlait avec un recueillement mystique, comme si l’âme des ancêtres s’incarnait en lui…
III
Plusieurs semaines se passèrent ; Hugues ne pouvait se décider à partir. Cette terre sauvage exerçait sur lui une sorte de fascination. Armé jusqu’aux dents, – fusil, browning et coutelas, – il faisait de longues randonnées à travers la sylve.
« Prendre garde au jaguar noir ! avait dit le Quichua. Ici, jaguar noir très méchant. »
Bon tireur, et persuadé que le jaguar n’attaque guère l’homme, Hugues ne tenait qu’un compte restreint de cet avis.
« D’ailleurs, se disait-il, le jaguar est une bête nocturne. »
Il vit deux ou trois fois le puma, qui disparaissait comme un fantôme. Un jour qu’il était allé plus loin que de coutume, il s’égara. Le crépuscule vint, avant qu’il eût pu s’orienter, puis la nuit descendit, formidable et magnifique.
Il y eut presque une heure de profondes ténèbres ; Hugues entendait les bêles rôder autour de lui ; de-ci de-là, un appel, un rauquement, des souffles, une plainte : c’était le drame de la vie et de la mort, le drame de la dévoration qui se renouvelle depuis des milliers de siècles dans les solitudes.
Enfin, une lune légèrement écornée apparut au fond des futaies. Rouge et très grande, elle ne jeta d’abord qu’une lueur confuse ; mais en s’élevant et se rapetissant, elle devint plus claire et sa vie argentée pénétra le sous-bois…
Subitement, Hugues frissonna. Là-bas, dans un fourré, deux lueurs vertes palpitaient, et on apercevait la rondeur d’une tête, les linéaments d’un corps trapu, à travers les interstices des végétaux.
Hugues avait de bons yeux. Il reconnut le jaguar… Las de sa longue rôderie, et dans le désert de la forêt vierge, cette apparition l’énerva. Il épaula machinalement son fusil. Le fauve rauqua. Un peu halluciné, Hugues tira et blessa le jaguar. La blessure exaspéra le fauve et détermina l’attaque. La masse sombre arrivait en foudre. Hugues tira une seconde fois, sans succès ; le félin tomba sur l’homme.

Renversé par la violence du choc, Hugues eut encore la présence d’esprit de sortir son revolver… Les griffes s’enfoncèrent dans son cou et sa poitrine ; des canines en poignards lui entamèrent l’épaule… Tout de même, le revolver avait fait de la bonne besogne et la brute, avec un miaulement d’agonie, roula sur le terreau… Mais Hugues, atrocement blessé, perdant son sang en abondance, était désormais impuissant.
Il se traîna jusqu’au pied d’un arbre et regarda vaguement autour de lui… Un frisson d’horreur ! Là-bas, un nouveau félin avait surgi, avec les mêmes yeux de feu – vraisemblablement, la femelle du jaguar.
Elle vit son mâle ; elle accourut avec des souffles de fureur.
« Allons ! murmura Hugues. Il faut mourir… »
Encore deux bonds… encore un bond… la destinée est close !
Deux détonations retentirent coup sur coup. La bête tournoya et s’abattit. Hugues vit s’avancer une créature svelte, jeune femme ou jeune fille, suivie de deux hommes.
« Merci ! » balbutia le blessé.
Et il s’évanouit, tandis qu’un des hommes disait :
« Il était temps… Ma petite Rosario, Guillaume Tell n’était qu’un sabot à côté de toi ! »
*
Émeral demeura quinze jours étendu, mais comme il avait un corps parfaitement sain, qu’aucun organe essentiel n’avait été endommagé, la guérison fut rapide. Quand il put sortir du lit, il vit celle qui l’avait sauvé.
C’était une toute jeune fille, douée de la grâce et du rythme des Hispano-Américaines. Quand elles sont belles, leurs immenses yeux noirs, leur teint mat, leur grande chevelure aux reflets bleuâtres leur donnent un attrait mystique…
L’idée que c’est elle qui l’avait sauvé éblouissait le jeune homme.
« Elle a fait ça comme elle relancerait une balle de tennis ! disait son père. Rosarito a reçu le don du tir, et ce n’est pas plus difficile de tuer un jaguar qu’un guanaco… Il suffit de savoir placer convenablement la balle !
– C’est le secret de la vie tout entière, » ajouta l’autre homme, qui était l’oncle de Rosario.
Ces deux hommes étudiaient, pour le compte d’une Société américaine, les gisements de la région. Tous deux étaient ingénieurs, mais l’oncle pratiquait en outre l’archéologie.
En tout temps, Rosario eût séduit Émeral ; dans ces déserts, et après l’aventure, l’amour poussa comme les herbes après la pluie.
Don Rodrigue et don Enrique Prado, hommes pleins d’indulgence, n’opposèrent aucune digue à l’idylle… Et lorsque la convalescence fut venue, des promesses formelles liaient l’avenir des jeunes gens.
Le jour des fiançailles, Hugues, les yeux fixés sur Rosario, murmura d’une voix tremblante :
« Le voilà, le Trésor des Incas !
– Qu’est-ce que vous dites là ? » demanda don Enrique.
Hugues raconta sommairement son histoire et les deux hommes se mirent à rire.
« Tout de même, fit l’archéologue, il faudra que j’aille voir cela… »
Quelques semaines coulèrent sur la sylve. Et l’humble joie de Hugues Émeral s’épanouit par les matins clairs et les nuits étincelantes. Dans les ténèbres de l’existence, une volonté mystérieuse a voulu que le plus grand bonheur des hommes ne fût ni la puissance, ni la richesse, ni la gloire, mais la douceur d’un regard, la griserie d’un sourire, le rythme d’un geste.
Hugues ne songeait plus à la mystification de l’oncle Édouard lorsque don Rodrigue et don Enrique le reconduisirent dans son domaine. Ils y passèrent la nuit et, le lendemain matin, don Enrique alla voir la caverne… Il en revint avec le sourire.
« Je l’ai vu, ce fameux trésor ! fit-il. Et j’ai vu aussi ce que cachait le grand empereur Vira Cocha, conquérant glorieux. Il était à double fond, ce vainqueur magnifique, et voici ce qu’il contenait… »
Enrique tira de sa poche un papier assez volumineux et le déploya.
« Voilà, dit-il, qui donnera à notre Société, si vous voulez bien traiter avec elle, une superbe nappe de pétrole. Donc, vous posséderez les richesses de ce monde. Mais sachez qu’à lui seul Vira Cocha, ses vases funéraires et sa pierre de sacrifices valent une fortune… pour le monde archéologique… Votre oncle ne vous a pas trompé. Le Trésor des Incas est un trésor authentique. »
–––––
(J.-H. Rosny aîné, de l’Académie Goncourt, in Revue de l’Amérique latine, première année, volume I, n° 3, mars 1922 ; les illustrations sont extraites de la publication espagnole dans Variedades)
–––––
☞ À notre connaissance, cette nouvelle de Rosny aîné n’a jamais été répertoriée ; elle a été traduite dans Variedades, revista semanal ilustrada [Lima], dix-huitième année, n° 737, 15 avril 1922, avant de faire l’objet d’une autre traduction sous le titre : « El Tesoro del Inca, » par J. B. [sic] Rosny aîné, dans Pucky, la lectura para todos, volume II, première année, n° 14, juillet 1922.
–––––
EL TESORO DE LOS INCAS
–––––
–––––
(J.-H. Rosny (el mayor), de la Academia Goncourt, in Variedades, revista semanal ilustrada [Lima], dix-huitième année, n° 737, 15 avril 1922)