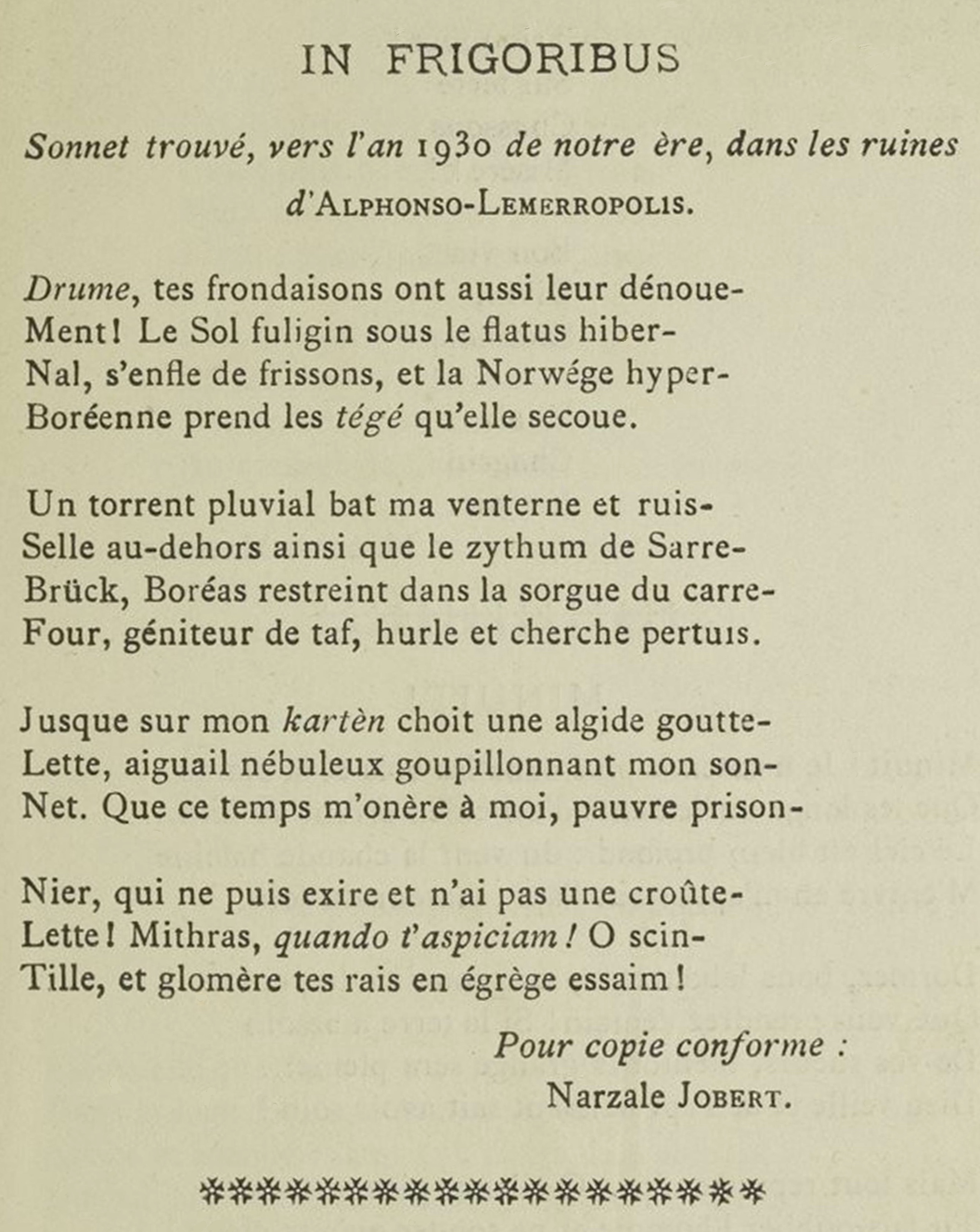L’éternel Satan est pris de fringale à la vue des âmes les plus maigrelettes. Ainsi peut s’expliquer la rage avec laquelle il pourchassa le pauvre Jean-Marie Merlou, simple garçon de ferme à Saint-Léger-sous-Beuvray.
L’histoire du Jean-Marie, conservée sous les toits du Haut-Morvan, fait songer aux légendes des âges révolus. Pourtant, à en croire les conteurs, les événements ne sont pas si lointains : ils ont eu pour témoins des yeux encore ouverts.
Et certes l’aventure exhale, en nombre de ses détours, l’odeur d’une époque assez proche, mal refroidie. Ce Jean-Marie est un gaillard qui a lu les vies des savants fameux dans un livre illustré et aussi le « Robinson suisse. » Autour de lui, les puissances diaboliques n’apparaissent pas dans un équipage princier, avec cornes, habits rouges ou pieds fourchus ; elle ne répandent point une odeur de soufre ; elles ont prudemment sacrifié à l’humeur d’un siècle où l’on commençait à canaliser les prodiges, tant à la manière des spirites qu’à celle de Charcot.
De nos jours, les Morvandiaux – surtout ceux des bourgades – se donnent comme de bons sceptiques, mais devant une vache malade, chacun hésite entre les soins du vétérinaire et ceux du guérisseur d’Arleuf, qui connaît tant de secrets ; et ce même guérisseur, on n’aime pas à le voir rôder sans raison autour d’une ferme ou d’un champ ; on ne croit plus aux sorts, bien sûr, mais enfin on n’aime pas ça.
L’existence contemporaine d’un Jean-Marie Merlou n’aurait rien d’absolument invraisemblable au milieu de ces forêts. Toutefois, sur les lieux que le récit désigne de la manière la plus formelle, les indigènes se montrent évasifs ; certains se croient moqués et sont pris de colère ; d’autres vous citent une vieille fille qui serait la sœur cadette de la Thérèse, l’héroïne de l’affaire, mais ils ne savent plus si elle réside à Cercy ou à Corbigny.
Dans cette incertitude, il nous faut encore constater que la collecte des souvenirs, si abondants sur d’autres points, ne nous livre à peu près rien quant à l’aspect physique du Jean-Marie. Imaginons simplement un robuste gars de dix-neuf ans – la mauvaise inspiration lui étant advenue à cet âge. Et, puisqu’il va surgir au milieu d’une grande foire du pays, revêtons-le à tout hasard du costume que personne ne porte plus à présent, hormis les vieux, mais qui était de rigueur voici moins de trente ans à l’occasion de ces solennités : le feutre noir et rond, le col blanc roide et l’ample blouse de toile rêche.
Donc, le Jean-Marie se rendait à Château-Chinon pour la foire de septembre ; son oncle malade l’avait chargé d’y conduire deux gros coissots (ainsi là-bas nomme-t-on les cochons). Il y a sept lieues entre Saint-Léger et Château-Chinon et une route pire que vingt bossus, mais le garçon, qui disposait de la voiture de la ferme et d’un vigoureux cheval, était parti longtemps avant l’aube ; cette foire valait le voyage, on y trouvait de bons prix.
Trop novice pour la vente, Jean-Marie ne devait s’occuper que du transport. Le Montillot, un ami de l’oncle, l’attendait à l’arrivée et se réservait les marchandages, lesquels exigent des ruses et une patience de brigand, si l’on ne veut point être roulé par plus brigand que soi.
Jean-Marie n’appréciait guère ces discussions, car il était un mauvais paysan, un distrait, un rêve-tout-debout. Il se préparait donc à une journée sans joie. Mais à peine entré en ville, il aperçut le Montillot souriant comme moine après carême : « Hé ! Jean-Marie ! tes coissots sont tout vendus ! » Le bonhomme avait entortillé un marchand de Nevers et, sur le vu des porcs, le marché fut bâclé en cinq minutes.
Quand le Montillot eut topé et payé la goutte à l’acquéreur, il dit au Jean-Marie :
« Ma foi, je pensais bien manger un morceau avec toi ; mais puisque te voici débarrassé de tes bêtes, il vaut mieux que j’aille retrouver le père Péchon, qui est venu d’Ouroux tout exprès pour me parler de son fermage. »
Jean-Marie ne songea pas à repartir tout de suite : il devait laisser à son cheval quelques heures de répit et s’en fut, désœuvré, à travers le champ de foire. Il gravit le Champlain, dont on ne saurait dire, aujourd’hui encore, si c’est un carrefour, un boulevard ou une piste pour toboggans, tant ce lieu manque d’aplomb et de régularité : toute la ville est ainsi disloquée à flanc de côte et couronnée par un escarpement chauve d’où l’on découvre à l’infini la sombre tempête des monts et des bois.
Le Champlain, d’ordinaire si désertique, était ce jour-là recouvert d’un tapis blanc, épais et vivant : l’assemblée des bœufs, des beaux bœufs nivernais, bien tranquilles sous le soleil et que l’irritante piqûre des mouches ne parvenait pas à tirer de leur quiétude. Les maquignons circulaient à travers le bétail, sans hâte, sans éclats de voix : cette cohue était sobre de bruits.
Le vacarme commençait un peu plus haut, aux abords du faubourg de Paris. Là, c’était le grouillement rose des cochons de toutes tailles, les petits enfermés dans des parcs et plus jacassants qu’oiseaux de volière, toujours prêts à faire scandale dès qu’un amateur les empoignait.
Jean-Marie se lassa vite : il n’avait aucune passion pour les bêtes ; il redescendit, se dirigea vers l’ancien cours Ambroise où se tenaient les marchands à la bricole, vendeurs de gros linge, de mercerie, de colifichets. Le flâneur se demanda s’il achèterait du ruban pour l’offrir à la Thérèse, sa cousine, mais il ne trouva aucune des nuances qu’elle aimait ; et puis, pour d’autres motifs, le cadeau risquait de faire long feu.
Ce fut alors que, se détournant, le gars aperçut le Biscancard ; il n’avait pas rencontré ce vieux chenapan depuis des mois, mais il reconnaissait bien ses énormes moustaches flottantes à la cosaque, sa sacoche débordante et sa jambe torse.
Le Biscancard écoulait indifféremment des chapelets, des baumes, des herbes-fées, des porte-bonheur, de petits livres-farces et d’autres plus singuliers, des dés à jouer et de la poudre à punaises. Son commerce, roulé de bourg en hameau, semblait précaire, mais le vieux y joignait des industries clandestines. Un charlatan, selon les uns ; un fraudeur, d’après les autres. Point de logis avoué ni même de nom : « biscancard » est un sobriquet ; cela veut dire tordu. En tout cas, un bon vivant et fort à son aise ; au fond de ses poches sordides grouillaient les pièces blanches.
Jean-Marie avait forte envie de l’interpeller pour lui reprocher une menue filouterie commise à son préjudice. Mais il fut intimidé par la présence d’un tiers personnage, en grande conversation avec le Biscancard.
Plus exactement, ce tiers parlait seul et le colporteur l’écoutait, pensif, le regard à cent lieues. Jean-Marie, guettant la minute propice pour aborder son homme, observait du même coup l’inconnu, chez lequel il découvrait une particularité : un certain air de famille avec le Biscancard lui-même, bien que ce dernier fût pourvu d’une trogne généreusement colorée, tandis que le visage de l’autre se distinguait par une pâleur quasi repoussante.
À plusieurs reprises, le discoureur blême fixa Jean-Marie avec une telle impatience que le gars crut l’avoir irrité en le lorgnant ainsi et, découragé, quitta la place ; tout bien réfléchi, qu’eût-il pu dire au Biscancard ? Son grief était de ceux qui ne se plaident point en public, une dupe ayant toujours les rieurs contre soi.
Jean-Marie, sentant la faim, entra dans une auberge déjà bondée, demanda une chopine ; il avait apporté pain et fromage. Tout en mangeant, assis sur un coin de banc, indifférent aux coups de gueule et aux bouffées des pipes, il voyait ses idées prendre un tour déplaisant ; la rencontre du Biscancard y était pour quelque chose.
Le garçon se disait que son amour pour la Thérèse lui avait valu déjà bien des déboires et le mènerait encore à de plus grandes peines. Quelle folie le poussait donc ?
★
Jean-Marie était natif de Villapourçon ; à l’âge de quatre ans, il avait perdu coup sur coup père et mère. Son oncle, le fermier de Saint-Léger, l’adopta bravement et l’éleva comme s’il avait été son propre fils ; du moins, pendant les premiers temps.
Jusqu’à l’adolescence, Jean-Marie put se croire l’égal de sa cousine Thérèse. Comme elle, on l’avait conduit à l’école, vêtu d’habits propres, et, dans ses largesses, la tante ne lui avait fait tort ni d’un bonbon ni d’un baiser. Bien sûr, aux heures de liberté, il devait donner un coup de main aux gens de la ferme, mais Thérèse n’était pas davantage épargnée.
À l’école, le gars fut distingué par son maître et cité en exemple. On lui confiait de beaux livres à cartonnages dorés qu’il lisait le soir, au coin du feu. Thérèse, plus indolente, revenait avec de mauvaises notes ; les parents la grondaient, affectaient de prôner les mérites de son cousin, et la fillette se trouvait encore bien heureuse d’être admise auprès du Jean-Marie pour admirer les images de ses livres.
Les enfants ayant pris de l’âge, tout changea. Le fermier jugea son neveu désormais assez solide pour travailler aux champs, le retira de l’école. Une timide remarque de l’instituteur, qui eût voulu cultiver ce bon sujet, n’obtint qu’un gros rire : « Point n’est besoin de connaître tous les rois de France pour déterrer les treuffes (les pommes de terre). »
La Thérèse devenait une beauté. On s’accorde à dire qu’elle avait des cheveux très noirs, un teint bis et des yeux comme deux soleils sombres ; bien que le Morvan soit terre gauloise, il est fréquent d’y découvrir de ces créatures brunies par on ne sait quel souffle du sud. Jean-Marie ressentit un coup à lui briser la poitrine lorsqu’un soir il surprit Thérèse accordant un baiser à un autre jeune homme : sans bien s’en douter, il était fou d’elle depuis longtemps.
À Saint-Léger, on répétait couramment que Thérèse recevrait quatre hectares en dot, à quoi s’ajoutaient les espérances. Jean-Marie n’avait pas une chemise à lui ; dans ce pays où tout se compte, il ne pouvait prétendre au mariage avec sa cousine ; l’oncle et la tante l’aimaient bien, mais voulaient pour leur fille un parti sérieux ; et le rival en était un.
Notre gars ne manqua pourtant aucune des maladresses traditionnelles : il joua son va-tout auprès de la Thérèse qu’il croyait facile à émouvoir, mais fut accueilli par une risée. Comme il persévérait, la jeune fille passa de la gaieté à l’impatience ; un triste jour, le fermier prit son neveu à part et le remit à sa place, avec les mots qu’il fallait.
Jean-Marie bouda, sans se résigner. Le prétendant de Thérèse avait dû partir, appelé par le service militaire. « Bon débarras ! La cousine est oublieuse ; il ne s’agit que de rentrer en faveur. »
Justement, une mauvaise fièvre terrassa l’oncle, et cela au plein des récoltes. Le gars, zélé comme un caniche, fit telle besogne qu’un jour sa tante lui dit :
« Vrai, Jean-Marie, je suis ben contente de t’avoir ; si le maître venait à manquer, je ne me sentirais point toute seule. Je ne veux point diminuer les hommes de louée, mais enfin rien ne vaut la famille. »
Le compliment eut des conséquences funestes. Le Jean-Marie se crut élevé de plusieurs échelons, hasarda de nouvelles avances auprès de la Thérèse et prit peut-être ses moues pour des sourires. Un dimanche, entraîné par un camarade, il fit quelques stations dans les cabarets de Saint-Léger, regagna la ferme sans avoir toute sa tête à lui. Le soupirant de sa cousine se trouvait là, en permission ; pour un mot, au sujet de la fille, les gaillards s’échauffèrent et eurent une querelle chargée d’horions. Thérèse fut outrée.
L’oncle, instruit de l’algarade, appela Jean-Marie à son chevet et lui infligea une admonestation plus meurtrissante que la première ; il lui rappela sa condition, qui était celle d’un parent pauvre et, pour tout dire, d’un valet de ferme un peu trop gâté. « Si tu t’avises encore de jeter les yeux sur Thérèse, je te montrerai la porte, tout neveu que tu sois ! » Il y avait là, de la part du fermier, une grande ingratitude, après le dévouement marqué par le Jean-Marie ; mais le vieux croquant ne partageait pas toutes les idées de sa femme, et peut-être éprouvait-il les hargnes d’un homme trop prestement porté en terre.
Après cette semonce, le gars eut bien envie de faire son baluchon ; mais une atroce sujétion le retenait, il ne se sentait pas la force de s’éloigner de Thérèse. Il avala affront sur affront, la cousine ne cachant plus sa mésestime et affectant à son égard un silence méprisant.
Durant des nuits entières, Jean-Marie, sans pouvoir fermer les yeux, s’accordait des revanches imaginaires. Parfois, il voyait les champs ravagés par la grêle, le bétail frappé par une épidémie et, pour finir, la ferme dévorée par le feu ; alors, tandis que le vieux se lamentait devant certain coffre anéanti, lui, Jean-Marie, sauvait la Thérèse des flammes et savourait la pesée du beau corps entre ses bras. En d’autres moments, il se trouvait sur mer, un caprice inexpliqué de l’oncle ayant fait émigrer la famille ; une tempête anéantissait le navire et, après les péripéties ordinaires des naufrages, tout le monde se retrouvait dans une île déserte où l’argent ne comptait plus ; Jean-Marie devenait un prométhée, lui seul possédant la connaissance du feu, des bêtes farouches et des fruits multicolores.
Car il demeurait fier de ses lectures, imprégné d’une science enfantine au point de construire des rêves encore plus saugrenus, du goût de celui-ci : il découvrait dans le ciel d’étranges mouvements d’étoiles et les signalait à l’instituteur, qui écrivait aussitôt à l’observatoire de Paris. Peu après, Jean-Marie était appelé à une assemblée d’astronomes, félicité par M. Leverrier (il ignorait si celui-ci était vivant ou mort) et doté d’une bourse de deux mille louis ; de plus, on lui promettait une statue. À son retour à Saint-Léger, les gens de la ferme l’accueillaient le front dans la poussière et sa cousine pleurait de honte pour l’avoir méconnu.
Lorsqu’il était émoustillé par le vin, – ayant pris, si jeune, le goût de boire, – il allait jusqu’à confier ces fichaises à son ami de cabaret sur un ton mi-drôle mi-sérieux. Le copain, un nommé Gaufriot, un bon à rien qui passait pour avoir éprouvé des ennuis du côté de Lormes, donna son avis :
« Tu te rends malade pour cette fille. Quand on souffre ainsi d’amour, on ne doit cracher sur aucune médecine. À ta place, je demanderais conseil à un vieux malin comme le Biscancard. »

Lorsqu’il avait, pour la première fois, pris garde au Biscancard, Jean-Marie était encore un gamin ; battant les bois au pied du mont Beuvray, il s’était mis en tête de visiter une lointaine pierre levée dénommée le Clocher ; là, il avait surpris le bonhomme en train de besogner, le nez contre le sol. Le Jean-Marie crut tout d’abord que l’autre posait des collets ; en l’observant mieux, il le vit tracer des signes, puis cueillir une plante ; il l’entendit marmonner et, apeuré par ces manigances, s’enfuit sans demander son reste.
Depuis, il avait souvent revu le Biscancard vendant des drogues ou des images aux commères de Saint-Léger. Le colporteur, plaisanté et vaguement haï par la plupart des hommes, possédait-il vraiment des « pouvoirs » ainsi que l’affirmaient les femmes ? Était-on sûr qu’il eût ensorcelé une fille d’Anost et charmé un loup qui ravageait le pays, du côté des Brenets ? En tout cas, la Mariotte du Croux disait sans se gêner qu’un sien vœu – sans doute un vœu trop noir pour être soumis à la Vierge – avait été exaucé grâce au Biscancard et à ses patenôtres.
Un garçon comme le Jean-Marie n’était pas foncièrement prévenu contre ces merveilles équivoques. Ne trouvait-il pas de tout dans les livres ? À côté de sarcasmes voltairiens, il lui arrivait de découvrir, imprimées noir sur blanc, des histoires certifiées vraies et carrément inexplicables : on avait fait parler une tête coupée en présence du roi Charles IX ; à Nancy, une veuve possédée s’élevait dans les airs ; et le grand Descartes, si logicien fût-il, emmenait au long de ses voyages une poupée douée d’une vie énigmatique.
Le Biscancard étant venu à Saint-Léger, Jean-Marie guetta longtemps une occasion de l’aborder ; il n’osait le faire trop publiquement, craignant de devenir la pâture des loustics.
Le hasard le servit : dans un chemin bordé de taillis, presque au débouché de la ferme, il croisa le colporteur, qui allait probablement en maraude ; enhardi, le gars se lança. Les idées lui tournaient un peu ; il s’étonnait d’ouïr sa voix, comme venue d’ailleurs, s’épancher avec une précipitation sauvage : oui, il était amoureux, il voulait savoir s’il existait des secrets pour mater les récalcitrantes, il ne reculerait point devant « les choses qu’il coûte cher de connaître. »
Après l’avoir toisé et jaugé, le Biscancard tira de sa sacoche une minuscule brochure.
« Là-dedans, tu trouveras ce que tu cherches ; mais c’est un livre rare, crois- moi ! Il vaut deux louis ; je te le laisserai pour moitié parce que tu as l’air malheureux. »
Jean-Marie ne possédait pas pareille somme sur lui. Il dut convenir d’un rendez-vous à la nuit tombée. Il cassa sa tirelire, donna les vingt francs et, les yeux chauds, emporta la panacée…
Une misère ! Un grimoire de pacotille, vomi par quelque imprimerie besogneuse ! Que d’invocations sans queue ni tête ! que d’opérations immondes ! Était-il possible de sauver le bétail, de trouver des trésors ou de gagner une fille par ces procédés absurdes et pour la plupart impraticables ? Comment se procurer les singulières « denrées » que nécessitaient ces belles cérémonies : herbes magiques, clous de cercueils, parchemins ? Jean-Marie haussait les épaules.
Il tâta néanmoins de cette basse cabale : son mal était fort. Jamais le garde champêtre ne devina pourquoi une main irrespectueuse avait découpé un carré de peau dans son tambour tout neuf ; pas davantage la femme du sacristain ne s’expliqua les motifs pour lesquels Jean-Marie, après lui avoir acheté un petit cierge, le fourra dans la poche intérieure de sa veste au lieu de le porter devant l’autel. Le gars s’était décidé à une expérience, séduisante en ce qu’elle contenait une conjuration aux astres : elle devait lui livrer toute fille, même la plus sage. Mais il eut beau inscrire le nom de Thérèse sur la peau volée (et au revers deux mots ahurissants : « Machidaël Barofchas »), puis invoquer à minuit, genou en terre et cierge au poing, la plus brillante étoile, enfin placer le talisman dans son soulier gauche, le charme demeura inopérant et la cousine rebelle.
Dans un sens, Jean-Marie fut soulagé, car son oraison nocturne se terminait par un vague engagement envers des puissances inconnues : « Je promets de vous satisfaire. » Les satisfaire en quoi ? Beaucoup plus jeune, il avait entendu dire que de telles prières et de tels livres sont des pièges tendus aux âmes et lu – il ne savait plus dans quel almanach ! – l’histoire d’un nommé Hans Schmidt qui, à Ingolstadt, en Bavière, mit le diable à ses trousses par un exploit de ce goût. Son propre échec le rassurait : « Les douteurs ont raison, tout cela n’est que grimaces. Le Biscancard ? Un tire-sous ! »
Mais, du même coup, plus d’espoir sur la Thérèse, décidément engouée du rival ! Jean-Marie ne pouvait se décider à la fuite qui, seule, eût été digne ; il était fixé là comme aiguille sur l’aimant. Et encore, pour rendre sa présence tolérable, il devait se faire petit, ne point relancer la belle. Le fermier, bien qu’égrotant, mal remis de sa grande fièvre, le tenait à l’œil et le simple achat d’un ruban à la foire eût peut-être donné prétexte à quelque avanie, tant du père que de la fille.
★
L’horloge de l’auberge sonnait deux heures de l’après-midi quand Jean-Marie reprit la route. Le cheval était dispos ; on arriverait à Saint-Léger avant le souper. Quel beau ciel ! Sitôt la ville dépassée, la calotte d’azur paraissait plus vaste et distendue par le cercle des montagnes : le soleil rissolait la route, mais, au-delà des premiers tournants, la forêt levait ses cent mille bras couleur de fin d’été.
Devant la voiture, le gars vit planer, à cinq pieds du sol, un fil d’argent oblique, un fil de la Vierge, que l’air poussait doucement. Signe de rencontre ! Quand le fil passe de droite à gauche, il donne un présage favorable ; dans le sens contraire, il devient funeste. Mais celui-ci était porté droit vers le Jean-Marie. Qu’en penser ? Le voyageur anéantit l’énigme d’un coup de fouet.
Comme la route contournait une colline, apparurent les grosses roches de Montseaulain, grisâtres, mouchetées par les bruyères ardentes, les fougères et les genévriers. Soudain, un homme assis et presque dissimulé au milieu des herbes, se leva, héla le garçon qui, non sans stupeur, reconnut le Biscancard.
« Oh ! tu es de Saint-Léger, je crois ? Cède-moi quelques pouces de banquette, mon fils. Je vais de ton côté. »
L’audacieux affichait, derrière ses moustaches torrentielles, la mine la plus innocente. Jean-Marie tira sur les rênes.
(À suivre)
–––––
(Jean-Louis Bouquet, illustré par Mariner, in Plaisir de lire, première année, n° 11, jeudi 12 mai 1949. Cette nouvelle, rédigée à la fin de l’année 1941, a été reprise en volume sous le titre : « Asmodaï ou le piège aux âmes » dans le recueil Le Visage de feu, Paris : collection « L’Envers du Miroir, » Robert Marin, 1951)
–––––
(Plaisir de lire, première année, n° 10, jeudi 5 mai 1949)