J’ai une voisine qui élève des poules. Ma voisine est charmante, ses poules sont admirables, et c’est une joie de visiter les parquets où sont rassemblés, avec un art méthodique qu’eût approuvé Darwin, des exemplaires multiformes et multicolores de toutes les races, depuis le primitif Malais, au thorax proéminent, au regard cruel, à la parure éclatante de prince barbare, depuis le lourd, le placide Cochinchinois, aux culottes bouffantes, à la démarche sacerdotale, jusqu’au minuscule Java et au brillant Game-Bautam, dont l’allure svelte et batailleuse rappelle celle des anciens reîtres, bien sanglés dans leur pourpoint de cuir, et qui allaient, par les chemins, l’épée haute et l’œil insolent, trousser les filles, et donner de grands coups d’estoc. Une visite à travers ces parquets équivaut à un voyage autour du monde. C’est un raccourci de géographie universelle ; car chaque race de poule conserve et enseigne, avec une précision étonnante, les caractères ethniques, les différences de mœurs, d’habitudes des peuples parmi lesquels elle naquit.
À force de vivre avec ses bêtes, ma voisine a fini par les comprendre, et par pénétrer au plus obscur de leur âme décriée. Il ne faudrait pas lui dire que les bêtes n’ont point d’âme, cela lui semblerait un affreux blasphème. Elle conte sur ses poules des choses merveilleuses, des actes surprenants de volonté, de conscience, toute une complexité mentale, qui effarouche un peu nos idées, et qui prouve combien, chez les bêtes, l’intelligence prédomine sur l’instinct, et le raisonnement sur l’impulsion atavique.
Je vais souvent voir ma voisine. Ses bêtes m’enchantent, et les observations quotidiennes qu’elle en tire m’intéressent au plus haut point. Hier, j’y suis allé, après une absence de huit jours. Je l’ai surprise, juste au moment où elle se disposait à « faire la tournée » de ses parquets. Vêtue d’une blouse rose, coiffée d’un chapeau de paille, ennuagé de gaze, elle portait une boîte garnie de fioles pharmaceutiques et d’instruments de chirurgie avicole. Son petit domestique la suivait, avec une assiette pleine de boulettes de viande roulées dans de la poudre de quinquina. Une forte odeur d’acide phénique circulait dans l’air stérilisé, et flottait au-dessus des lys naissants et des mourantes pivoines.
« Je suis désolée !… me dit-elle. Une épidémie, figurez-vous !… Mes pauvres poules ont la diphtérie… Venez donc avec moi, car il faut que je les soigne, et c’est l’heure du pansement. »
J’évitai de risquer quelques railleries sérothérapiques, qui eussent été pourtant de circonstance. Mais il ne faut jamais plaisanter un amour, quel qu’il soit. Au contraire, je crus devoir compatir à l’affliction très réelle de ma voisine, en des termes qui la touchèrent vivement. Elle m’expliqua qu’elle badigeonnait au pétrole, quatre fois par jour, la gorge de ses poules, leur lavait le bec et les yeux avec une dissolution de sulfate de cuivre, et qu’elle était obligée de leur faire avaler de force des nourritures toniques, ce qu’elles n’aimaient pas.
« Des enfants ! conclut-elle… de petits enfants volontaires et têtus… têtus ! Ah ! si ce n’était si triste, combien je m’amuserais à toutes leurs manies, à toutes les ruses qu’elles inventent ! »
Nous trouvâmes les poules malades réunies dans un parquet charmant que clôturait un grillage, sur lequel couraient des roses blanches, des capucines et des clématites. Çà et là, sur l’herbe désinfectée, de petits arbustes disposaient des reposoirs d’ombre, des haltes de fraîcheur. Faisant le gros dos, la huppe triste, les ailes tombantes, le plumage hérissé, elles étaient rangées l’une près de l’autre, sur de bas perchoirs, et elles ressemblaient aux pauvres malades qui se traînent sur des bancs, dans un jardin d’hospice. Des insectes volaient autour d’elles. Des insectes sautillaient dans l’herbe, auprès d’elles. Elles n’y prêtaient aucune attention, absorbées dans une sorte de coma, voisin de la mort. Mais, dès qu’elles eurent aperçu, entre les clématites, la blouse rose et le grand chapeau, et la terrible boîte de leur maîtresse, elles manifestèrent une agitation insolite. On eût dit qu’elles s’efforçaient de prendre des airs de santé et de belle humeur, dont la sincérité, d’ailleurs, me parut douteuse. Quelques-unes gloussèrent, quittèrent le perchoir, et, râlant, trébuchant, traînant, dans l’herbe, leurs ailes débiles, elles se dirigèrent vers des augettes pleines de millet, et se mirent à manger avec une ostentation bruyante.
« Mais elles ne sont pas malades, vos poules, puisqu’elles mangent !… protestai-je.
– Vous croyez qu’elles mangent !… répondit ma voisine. Elles ne mangent pas… elles font semblant de manger. C’est une comédie !
– Çà ! par exemple !… m’écriai-je.
– Mais observez-les donc !… Je les comprends, moi, allez !… Elles savent que je viens leur racler, leur brûler la gorge, leur entonner ensuite des boulettes de viande et des amers, toutes choses qui sont pour elles une souffrance et un dégoût !… Elles tâchent d’éviter la corvée, simplement… Quand elles ont donné deux ou trois coups de bec dans l’augette, examinez leurs yeux, ce regard de coin, à la fois malicieux et suppliant, qu’elles glissent sur moi, comme pour me dire : « Que viens-tu faire ici avec ta boîte de supplice ?… Nous ne sommes plus malades… Nous allons très bien… Remporte tes drogues qui nous brûlent la gorge et ta nourriture qui nous étouffe… Vois quel est notre appétit ! » Elles veulent me tromper, comme feraient les hommes… Mais je suis aussi poule qu’elles !… N’est-ce point une chose charmante et terrible ? Terrible surtout, car enfin il y a des gens qui les mangent… Oui, qui mangent de la volonté, de la pensée, de l’intelligence, de la fantaisie !… Et vous savez, il y a des poules qui deviennent folles… je vous assure, folles… comme Ophélia !… Est-ce que cela seul ne devrait pas les rendre sacrées ?… Moi, quand je vois sur une table un poulet rôti, ça me fait l’effet d’un crime !… »
Je vérifiai l’exactitude de l’observation si curieuse de ma voisine, et je rentrai chez moi, rêveur.
*
Et maintenant, je me souviens qu’un jour, au collège, chez les jésuites, je causai un scandale inouï. Dans une composition française, j’avais, fort innocemment d’ailleurs, écrit, je ne sais à propos de quoi, ces mots détestables : « L’intelligence des bêtes… » Ce fut de la stupeur. Mon professeur, indigné, m’admonesta sévèrement devant toute la classe, et il déclara que Voltaire – oui, Voltaire lui-même, comprenez-vous ? – n’eût pas osé aller si loin dans l’impiété. L’intelligence des bêtes ! Mais alors, que faisais-je donc des hommes, du pape et de Dieu ! Est-ce que la religion avait été inventée pour les baudets et pour les porcs ?… Et la conscience ?… Où donc la mettais-je ?… Et la création ?… Oui, je l’arrangeais bien, la création !… Je la biffais tranquillement, d’un trait de plume ! Il termina son éloquente apostrophe en m’infligeant huit jours de pain sec et deux jours de cachot, pour avoir donné à un tel blasphème une forme si audacieuse et si précise.
Je ne me rendais pas compte de la nature de mon crime, ni que j’eusse biffé, d’un trait de plume, la création de Dieu, tant était grande, évidemment, la perversité foncière de mon esprit ! Mais que j’eusse commis ce crime, il n’en fallait pas douter. Et je n’en doutai pas un instant. Mon professeur était un des Pères les plus aimés du collège, en ce qu’il se mêlait, plus que les autres, à nos jeux. Il était de première force sur le ballon, sautait à pieds joints d’incroyables distances, et nul ne le pouvait battre dans la course aux échasses. Aussi sa parole était crue comme les Évangiles, et souveraine son autorité ! Dans ce petit monde très discipliné que nous étions, une remontrance publique venant d’un homme si prestigieux des reins, si indiscutable des jarrets, avait force de loi. Elle me valut des huées, dans les cours, de la part de mes camarades scandalisés, et le surnom de Voltaire me resta, stigmate d’infamie. Depuis, bien des années ont passé ; les jésuites ont été dispersés, et ils sont revenus ; les professeurs sont morts ; d’autres les remplacent. Eh bien ! si j’en crois mes jeunes neveux qui apprennent la vie, dans ce même collège, le souvenir y persiste toujours de mon impiété. À de certains anniversaires, on en parle encore, comme d’une terreur.
Durant que je faisais mes deux jours de cachot, fort troublé par le crime que j’avais commis et dont je ne parvenais à m’expliquer l’inconcevable horreur, le Père vint me voir, une après-midi, et telles furent les paroles qu’il prononça :
« Mon cher enfant, votre faute est très grande, – tuâ culpâ, tuâ maximâ culpâ, – mais peut-être n’est-elle pas aussi irrémédiable qu’on pourrait le croire… Vous êtes jeune, d’une famille chrétienne, élevé dans les principes du plus strict honneur et de la morale la plus judicieuse. J’espère encore qu’il existe dans votre âme des parties que n’a point gâtées le poison du doute. Un repentir sincère et une bonne confession vous apporteront, je le pense, le pardon de Dieu… Mais je n’en réponds pas, car vous l’avez offensé cruellement !… Sans doute, il faudra une longue suite de prières spéciales et de pénitences appropriées !… Et puis, il y a le grand chien noir !… »
Le visage du Père prit aussitôt une expression d’effroi, et cet effroi dont il était tout bouleversé, à cette diabolique évocation du grand chien noir, se communiqua instantanément de ses yeux à mon âme. Il continua :
« Il y a quelques années, un de nos enfants, de votre âge, avait, comme vous, commis une grande faute contre la religion. Sans doute qu’il ne s’en était pas repenti… Ou bien… qui sait ? Les voies de Dieu sont si impénétrables !… Bref, un jour, à la promenade, un chien, tout à coup, un grand chien noir avec des prunelles rouges comme du feu, des oreilles droites et pointues comme des cornes, et tout couvert de bave sulfureuse, se précipita sur le pauvre petit enfant pécheur et l’emporta… On ne l’avait pas vu venir ; on ne le vit pas davantage s’en aller… Et jamais l’on n’entendit parler de l’enfant ! Quant au grand chien noir, il rôde quelquefois autour des enfants impies et il grogne, il grogne affreusement. Oh ! Prenez garde au grand chien noir ! »
J’étais devenu tout pâle et je tremblais d’épouvante. Le Père reprit alors, avec une voix moins solennelle, et, me tapotant des genoux, doucement, avec un air de bonté attristée et familière, il me dit :
« Allons !… allons !… remettez-vous… Nous l’écarterons, le grand chien noir… nous l’écarterons… Mais il faut que vous nous y aidiez… Comprenez-vous maintenant ce que ces mots : « L’intelligence des bêtes, » contiennent d’affreuse hérésie ?… Quand vous les avez écrits, ces mots abominables, était-ce en vous le désir de vous révolter contre l’ordre immuable de la divine création ?… Avez-vous blasphémé inconsciemment ? Car, enfin, les péchés s’aggravent ou s’atténuent, selon l’intention qu’on y met !… »
Je balbutiai quelques paroles de dénégation.
« Vous ne parlez pas ?… J’aime mieux cela. Vous n’êtes pas tout à fait perdu, tout à fait pourri… Il y a de la ressource, grâce à Dieu… Rappelez-vous bien, mon cher enfant, que les bêtes ne peuvent pas avoir de l’intelligence… Si les bêtes étaient intelligentes, elles honoreraient Dieu, elles bâtiraient des églises… elles auraient de la religion, enfin !… Et puis, elles ne vivraient pas comme elles vivent, dans cet état d’impudeur tranquille et de répugnante anarchie… Cela saute aux yeux… Affirmer l’intelligence des bêtes, c’est détruire l’œuvre de Dieu !… c’est nier l’âme immortelle !… Dieu n’a donné aux bêtes que de l’instinct, rappelez-vous ce mot-là, de l’instinct !… Et encore, c’est beaucoup !… Mais ne discutons pas… Dieu sait ce qu’il fait… Et vous, savez-vous ce que c’est que l’instinct ? »
Et, sans attendre ma réponse, le Père dit :
« L’instinct, cher enfant, c’est le diable ! »
Après quoi, il se leva, et, après m’avoir exhorté de nouveau aux longues prières et aux dures pénitences, il s’en alla…
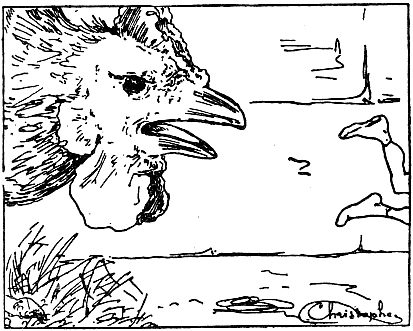
–––––
(Octave Mirbeau, in Le Journal quotidien, littéraire, artistique et politique, quatrième année, n° 999, dimanche 23 juin 1895 ; « Contes et nouvelles, » in La Lanterne, journal politique quotidien, trente-deuxième année, n° 11936 et 11938, lundi 27 et mercredi 28 décembre 1909)

