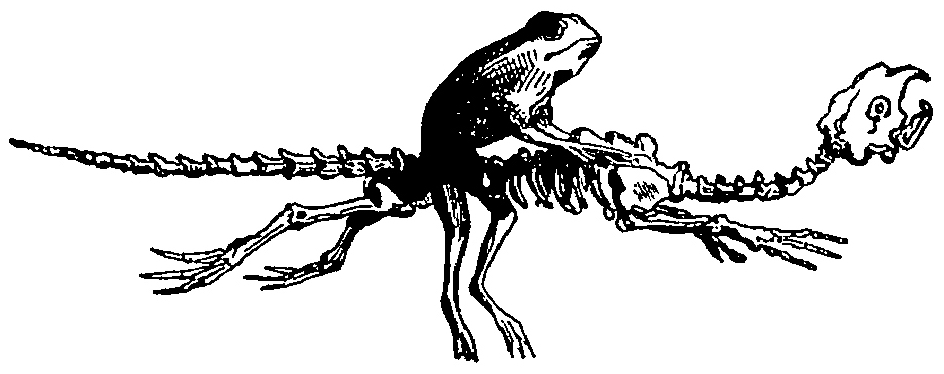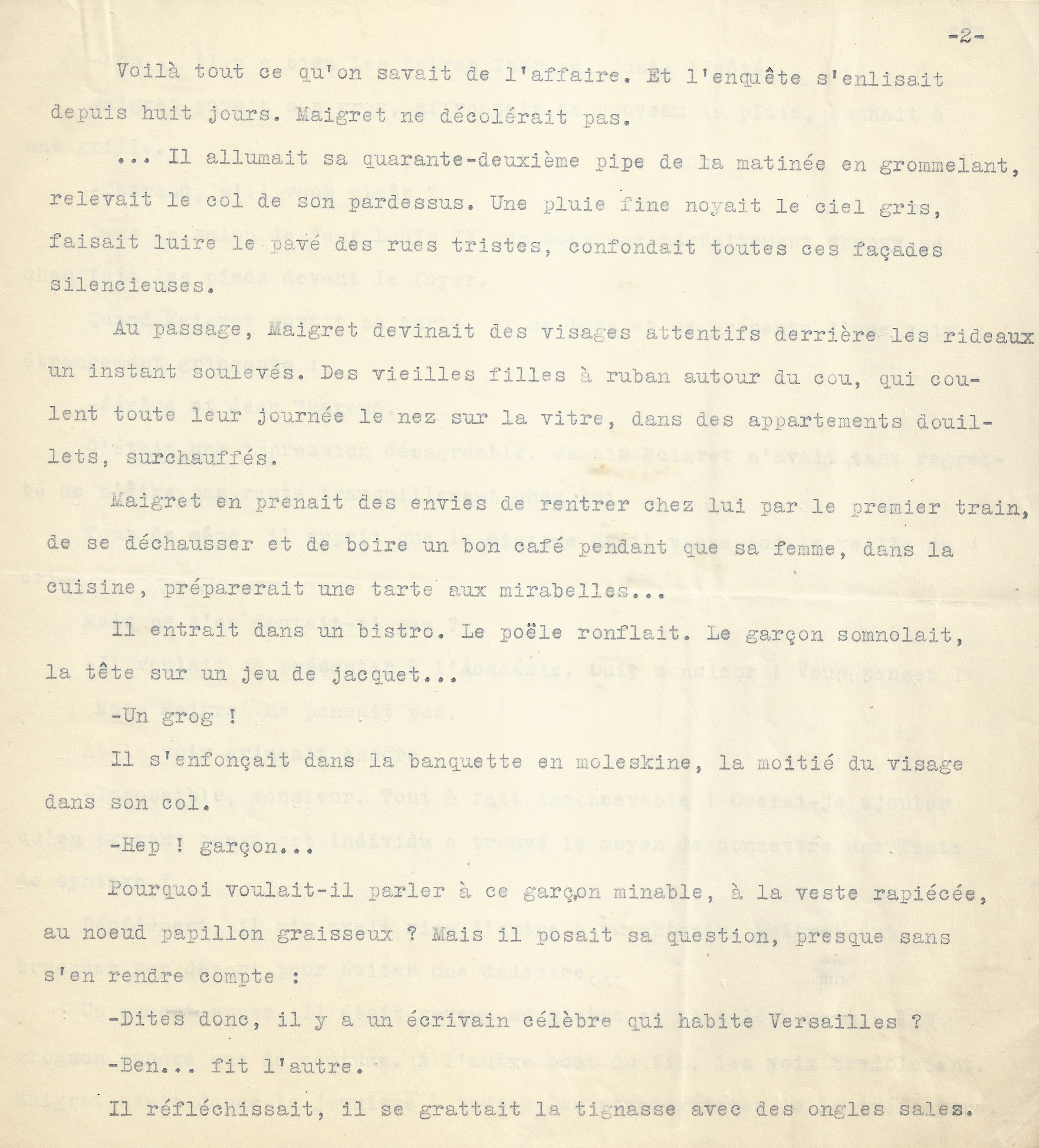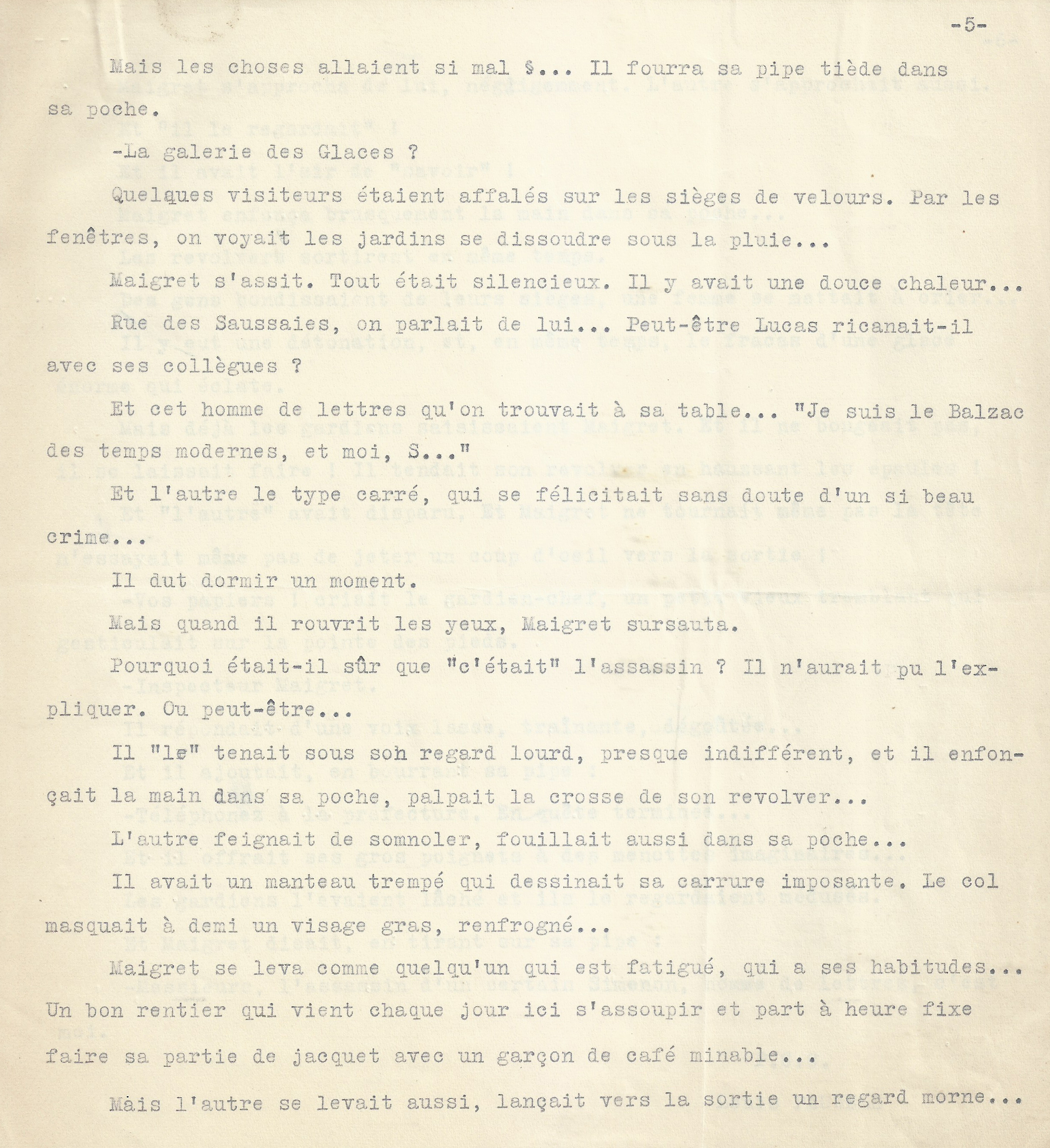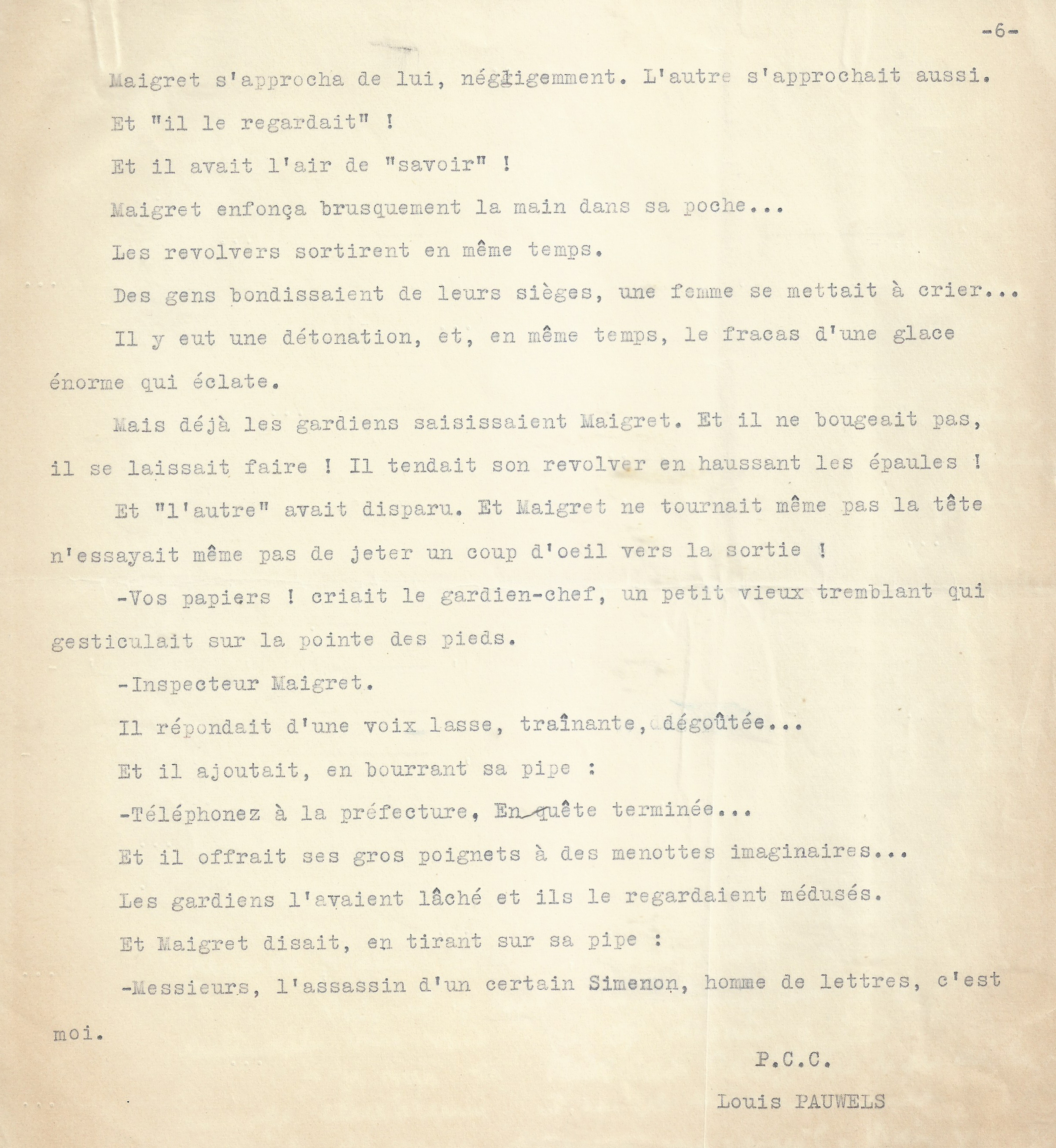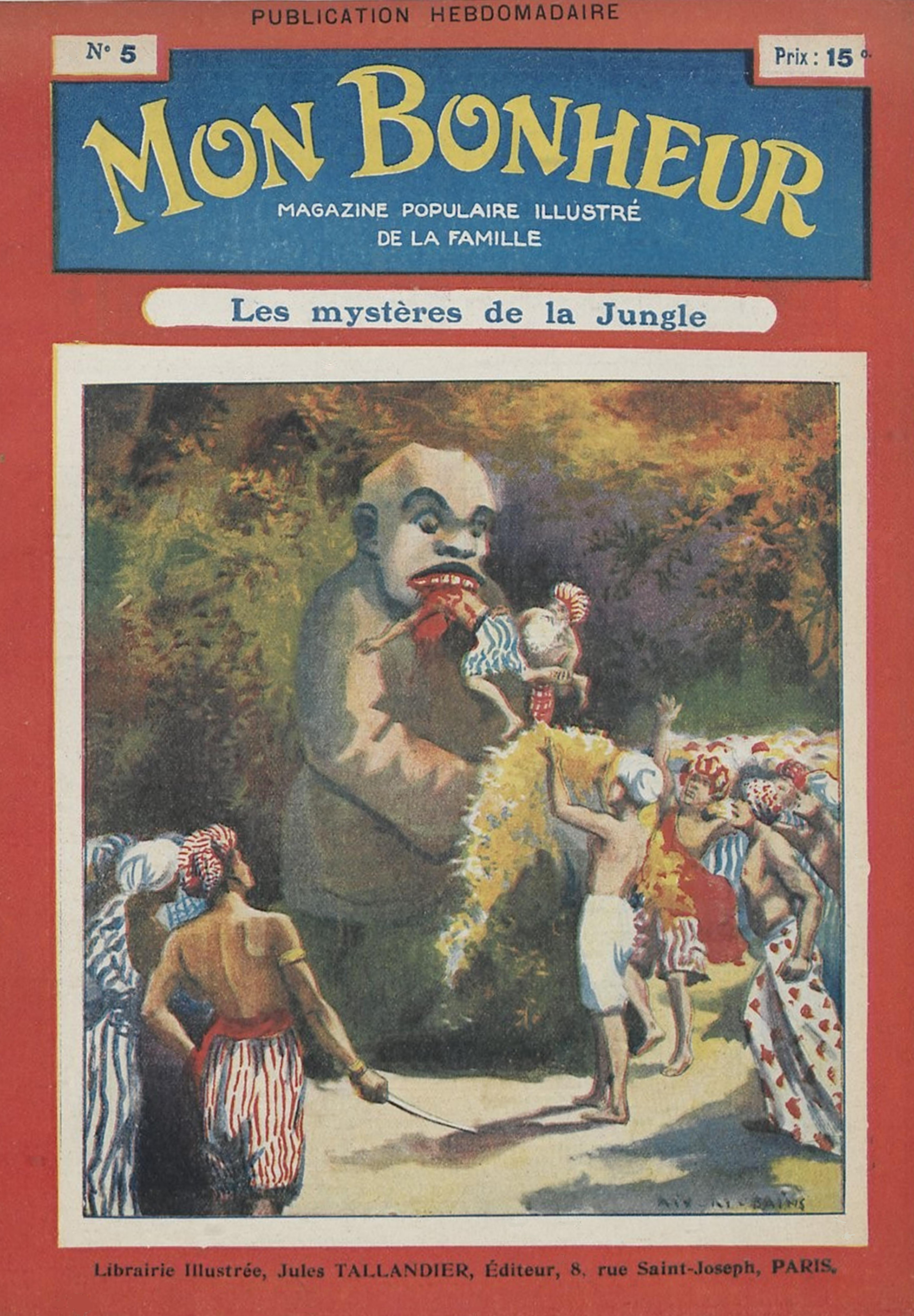Nuit et jour, sous le soleil ou la clarté des lampes, dans le brasillant reflet des forges et sous le voile des fumées vomies au ciel par les cheminées de ses usines, aux premiers jours de cet hiver de l’an 2020, l’Europe fabriquait fébrilement ses tanks et ses mitrailleuses, coulait ses monstrueux canons et distillait ses gaz, et déjà les armées se précipitaient vers les frontières pour une tuerie qu’on disait encore la dernière et qui serait la plus gigantesque de l’Histoire, quand l’événement se produisit.
Au soir du 8 décembre, après une bourrasque qui tordit les arbres, emporta les tuiles et joncha le sol de débris, dans Moscou, Berlin et Paris, à Prague, Londres et Varsovie, dans son tube de verre, partout à la fois, on vit brusquement fléchir le mercure du thermomètre. Tant le froid fut intense et soudain, dans les villes et les campagnes, on dut abandonner le travail en cours, se réfugier dans les maisons auprès des poêles chauffés au rouge. Et, dans les capitales, la nouvelle se répandit que les armées avaient interrompu leurs opérations, dans les tranchées, les champs de bataille ou sur les routes, les soldats mourant par multitudes.
Les femmes songèrent à leur mari, les mères à leurs enfants, et partout dans le monde civilisé on dormit mal, cette nuit-là, le cœur étreint de vague appréhension et d’obscure épouvante.
Ce qui se passa les jours suivants, nul ne l’a su et, par la douceur de son printemps ou le flamboiement de son calme été, dans l’entrecroisement sinistre des S. O. S., l’hémisphère austral aux aguets perçut encore durant quelques jours ces terrifiantes nouvelles : typhus et peste, famine, révolution, soldatesque déchaînée, anarchie… Puis la T. S. F. elle-même cessa d’égrener ses déchirants appels et, morne et lugubre, sépulcral, ce fut le silence.
Alors, de Buenos-Ayres, de Melbourne et de Bombay, les rapides destroyers partirent à toute allure. Devant eux, les flots s’apaisèrent, le monde redevint ce qu’il avait été. Et par une humide et tiède soirée londonienne, après avoir circulé à travers le gigantesque charnier, enjambé les corps étendus et qui se putréfiaient et franchi à la course l’amoncellement sans nom des ruines diverses et des débris de toute sorte, le masque sur le nez, James Brice pénétra dans la maison de son père. Une maison modeste et basse, dans une tranquille avenue de faubourg, au cœur d’un site qui s’était voulu de charme agreste et campagnard : un cottage au toit de tuiles, avec un jardin jadis planté de fleurs, des arbres, une confortable grille, des murs tendus de vigne vierge et des fenêtres garnies de ces rideaux de cretonne à fleurs peintes que John Ruskin et William Morris avaient autrefois mis à la mode, quand ils avaient ingénument proposé aux hommes de se rédimer par l’esthétique et d’apprendre la beauté pour devenir meilleurs.
La grille était ouverte, la porte et les fenêtres fracassées, la façade balafrée par le sillon des balles. À terre, des éclats de vitre, des bouteilles, des hardes.
Le cœur battant d’un indicible émoi, James courut, dès le couloir buta dans un corps allongé : sa mère. Dans la pièce voisine était sa sœur Marie ; plus loin, son jeune frère. Hagard, la tête perdue, il alla de l’un à l’autre, les appela, les releva, les laissa doucement retomber. Morts, ils étaient morts, tout le monde était mort et lui se sentait devenir fou. La maison était saccagée de fond en comble, mise au pillage, les meubles fracturés, les armoires enfoncées à croire qu’étaient passés par là tous les voleurs du monde. Pourtant, des choses de valeur restaient à la traîne, des objets d’art, des soieries, des bijoux, un authentique Turner pendu au clou où il l’avait toujours vu : biens dédaignés, fortune dont les hommes, à ce moment-là, ne s’étaient guère inquiétés, plus avides d’un morceau de charbon, d’une croûte de pain ou d’un lambeau de lard.
Dans le bureau de son père, on n’avait rien touché : les livres demeuraient sur les rayons, les cadres au mur, le fauteuil devant la table surchargée de paperasses et la plume abandonnée en travers de la dernière page écrite, sur une phrase interrompue. Mais le vieillard n’était pas là, et quelques instants James Brice connut un espoir insensé : celui de le retrouver vivant.
« Papa ! cria-t-il, papa ! »
Il écouta mais rien ne répondit, nul bruit, nulle plainte, nul soupir. Il le chercha. Vides les chambres, le salon, la cuisine, désert le grenier où de prestes mains avaient fait la rafle, sur les étagères, des fruits qu’on y gardait : ces poires amoureusement cultivées en espaliers par le vieil homme, écrivain professionnel qui usait ses loisirs à pratiquer le jardinage. Sa lampe à la main, James s’engagea par l’escalier qui mène à la cave. Il était semé d’une poussière de charbon qui crissait sous ses semelles. Ici aussi la porte était ouverte, ses ferrures pendantes et brisées. Et dans un coin, près d’un poêle froid, équipé d’un tuyautage de fortune, le faisceau lumineux montra une forme étendue. Couvert de tous les vêtements qu’il avait possédés, enfoui comme un cœur d’oignon sous la successive enveloppe de ses pantalons, de ses vestes et de ses pardessus, c’était le vieillard, maigre cadavre aux chairs desséchées, aux yeux creux, au nez pincé, aux joues feutrées d’une mousse de barbe. Et autour de lui, place nette : plus un brin de charbon, plus un atome de bois, plus une seule de ces bouteilles de vin de France ou de ces alcools réputés dont il aimait à savoir sa maison bien garnie. Dans un chandelier, une bougie à demi consumée ; à terre, un cahier de papier. James Brice fit la lumière et près du mort, hérissé d’horreur et se croyant la proie d’un cauchemar, voici ce qu’il put lire, en phrases hâtives et en notations cette fois exemptes de littérature. Un journal en somme, une relation où le vieux professionnel de la plume avait voulu, jusqu’à sa dernière minute, retracer l’extraordinaire enchaînement de ces faits incroyables.
*
« Mardi 8 décembre. – La guerre ! Nous repartons pour cette folie. On arme, on mobilise dans la fièvre et l’enthousiasme touche au délire. La grande flotte a pris la mer. À 9 heures du soir, le bruit circule d’une grande victoire. Flotte allemande anéantie, dit-on. Musiques. et vivats, immense bourdonnement des foules. Dix minutes après, tempête brutale, le froid… Le thermomètre tombe, il fléchit d’heure en heure. À l’aube, nous avons dix-huit au-dessous de zéro. Nos chambres sont inhabitables. Tous quatre, nous nous réfugions au sous-sol où Fred installe un poêle. Au menu, pour nous réchauffer : jambon, thé bouillant, alcool…
Mercredi 9. – Au matin, verglas, sol gelé. Rues désertes et silencieuses. Les journaux paraissent. Aucune confirmation de notre foudroyante victoire. L’affaire se réduit à l’échange de quelques coups de canon. Le froid est général. Dans le couloir, Fred me dit que le thermomètre marque moins vingt-quatre. Je reste auprès du feu et me félicite d’avoir fait rentrer du charbon… Mais les autres… Et ces armées qui tiennent la campagne ?… Même régime : graisse, thé, alcool. Marie fait la grimace ; ma pauvre Lisbeth me paraît très fatiguée…
Même jour, 2 heures. – Fred qui revient de la Cité, à pied, car il n’est plus de voitures ou de trams qui circulent, me dit que les gens tombent dans les rues, frappés de congestion. Les hôpitaux regorgent, la police est sur les dents… Le froid a encore augmenté. Au thermomètre du couloir, au passage, Fred a cru lire moins quarante, mais je pense qu’il s’est trompé. Nous chauffons au rouge et dans cette cave, les soupiraux obstrués, avec nos couvertures et nos matelas, nous résistons assez bien. Ma femme et mes enfants ont descendu ici tout ce que nous avons de vivres dans l’office, lard fumé, confitures, conserves. Nous sommes pourvus, heureusement ! La boisson non plus ne manque pas… Mais le charbon diminue. Quatre tonnes, pourtant, ça fait un joli tas. C’est bizarre, ce froid, tout d’un coup. Hé ! hé ! Des idées me passent par la tête, que j’aime mieux taire, des idées folles, des idées de romancier.
Même jour, 6 heures. – Fred a pu se procurer un journal du soir. Il n’y est presque pas question de la guerre. La flotte tient toujours la mer, malgré qu’y sévisse une tempête d’une violence inouïe. Je ne comprends même pas très bien, car l’atmosphère est d’un calme parfait. Froid général dans toute l’Europe. On prévoit l’arrêt forcé des hostilités. Sur le Continent, Français et Allemands accusent des pertes énormes. Je présume qu’il doit y avoir déjà pas mal de déserteurs. Dans l’Europe centrale, les communications sont interrompues. On annonce plusieurs naufrages, toutefois sans préciser. Les détails manquent… Et je reviens à mes idées, à mes lubies de romancier d’anticipation… J’ai conté quelque chose de semblable, jadis : la fin d’un monde, la mort d’une civilisation… Bizarre, ce froid, bizarre tout à fait. J’essaye d’être joyeux pour ragaillardir ces deux pauvres femmes ; je ris, mais ça sonne faux… Fred est pensif. À huit heures, dîner. Nous couchons tous quatre côte à côte sous le même monceau de couvertures pour être plus au chaud. Et je dors très mal ou très peu ; mon imagination travaille… C’est, je crois, la première fois de ma vie que je regrette de n’être pas une brute, une créature d’inerte passivité, en pierre, en bois…
Jeudi 10 décembre. – Ce matin, l’eau fait défaut, les conduites sont gelées. Nous faisons fondre un bloc de glace dans une bassine sur le poêle chauffé au rouge cerise. Le charbon diminue et je prie qu’on l’économise. Nul bruit du dehors ne nous parvient, sauf de sourdes et lointaines explosions. Dans la cuisine, le gaz n’arrive plus, mais nous avons encore de la lumière, l’électricité répond. Jusqu’à quand ? Heureusement, Marie a pu retrouver deux paquets de chandelles et je les ai soigneusement rangés, à tout hasard. Fred a voulu sortir. À son retour, je l’ai entendu verrouiller les portes avec un luxe de précautions qui ne fut pas sans m’alarmer. Péniblement, il a pu se procurer un journal, le « Times, » en édition réduite. Il m’en a fait la lecture. Quoi, n’était-ce pas pas assez de cette guerre insensée ?… Et fallait-il encore que puissent s’y ajouter toutes ces abominations ?…
La flotte a rejoint les ports, incapable de tenir contre la mer. Les marins ont débarqué ; on les abrite du mieux qu’on peut dans les docks, les entrepôts, les écoles désaffectées. Ils chantent l’« Internationale » ; en plusieurs endroits, il a fallu faire intervenir la troupe ; les mitrailleuses s’en sont mêlées : la guerre civile après la guerre étrangère.
De Moscou, de Kiev et de Sébastopol, où le froid décime les populations, les Russes ont signifié à l’univers qu’ils renonçaient à la guerre, qu’ils déclaraient la paix au monde et rappelaient leurs troupes. Les navires allemands sont bloqués par les glaces ; on ne sait trop rien de ce qui se passe en France où un gouvernement révolutionnaire provisoire s’est emparé du pouvoir. À Londres, dans les quartiers excentriques et la banlieue, la populace a procédé à la mise à sac des magasins de comestibles ; on a pillé les dépôts de charbon des compagnies de chemins de fer ; le ravitaillement n’arrive plus, les trains demeurent sur les voies ferrées à l’endroit même où ils durent s’arrêter ; la foule famélique et transie a envahi les bâtiments publics, les palais d’État, les ministères. Il a fallu la pourvoir de braseros, de vivres et de vêtements. On a mis en distribution les stocks de l’armée, toutes les réserves disponibles. Aucun navire n’est arrivé. On estime que Londres a encore pour quatre jours de vivres et, aux dernières nouvelles, la force publique réquisitionne les denrées. Dans les rues, les gens tombent foudroyés. On a toutes les peines à évacuer les cadavres et, faute de pouvoir les ensevelir, on les dépose dans les caveaux des cathédrales, sur des lits de chaux vive, et on redoute d’avoir bientôt à les brûler sur les places publiques. Dans les ports, les marins se révoltent ; le gouvernement a décrété l’état de siège…
Même jour, 3 heures. – On entend des explosions, de vagues tumultes que recouvre en nappe le bruit des feux de salves. Canons, mitrailleuses, je ne discerne pas très bien, mais Fred, qui s’y connaît, déclare que c’est bien cela. Je lui ai interdit toute nouvelle sortie, par prudence, l’extérieur me paraissant peu sûr. Par un voisin venu se réfugier auprès de notre poêle et qui nous a apporté un lot très appréciable de provisions, j’apprends que les journaux ne paraissent plus, qu’on ne pense plus à la guerre. Comme les Russes, les Français et les Allemands font retraiter leurs troupes. Installés aux carrefours, des hauts-parleurs rapportent les événements : 60 degrés au-dessous de zéro à Cracovie ; en France, l’anarchie, une ère sanglante de meurtres et d’assassinats, folie rouge, fureur collective où se massacrent ceux qui ne périssent point de mort naturelle. À Londres, on manque d’eau, non seulement pour boire ou se laver, mais encore pour l’évacuation des détritus, des déchets. On redoute pour la santé publique. Nous, nous avons renoncé à faire toilette et, près de notre charbon, avec nos mains noires et nos figures poudrées de poussière métallique, nous semblons des mineurs. Depuis cette nuit, les lampes ne brûlent plus ; nous vivons à la chandelle et le plus souvent dans l’ombre, pour ménager notre luminaire. Le voisin déclare qu’il n’y a plus d’État, d’armée, de police. Il paraît qu’on se tue dans les rues, qu’on brûle les pavés, les meubles, les planchers, les arbres. Dans la campagne, tout le bétail serait mort. Le thermomètre autoluène descend toujours ; Fred me dit des chiffres, des chiffres fabuleux. Il est du reste très drôle, ce garçon-là ; il verrouille les portes, il a toujours un revolver en main et c’est un véritable arsenal qu’il a transporté dans notre cave. À tout prix, il veut aussi masquer la fumée de notre poêle. Que redoute-t-il ?… Hé ! hé ! bizarre, ce froid, bizarre ! Je l’ai écrite, cette histoire, telle ou à peu près, cependant moins lugubre, moins sinistre, moins terrible. La réalité est plus tragique que toutes les fictions ! Heureusement qu’un fils me demeure, là-bas, à Melbourne où ne sévit pas le cataclysme, j’ose l’espérer…
Même jour, 8 heures. – Thé bouillant, graisse, alcool… Marie ne se donne plus la peine de faire la grimace. Le charbon diminue, déjà réduit de moitié. Nous souffrons cruellement de la pénurie d’eau. Ma pauvre Lisbeth est horriblement lasse. Pour moi, je sens mes forces diminuer… Dormirai-je ?…
Vendredi 11 décembre. – Je n’ai pas dormi. Le froid est polaire. On dirait que mon sang se caille, qu’on m’enfonce des aiguilles sous la peau, que de la glace coule dans mes os. Le charbon diminue. Quand il n’en sera plus, c’en sera fait de nous tous. Et nous sommes là, tous les quatre, tous les cinq, veux-je dire, puisque M. Willis nous honore de sa compagnie, à nous regarder sans rien nous dire, avec des yeux d’infinie commisération, des serrements de mains, des baisers furtifs. Mes enfants paraissent avoir compris. Romanciers, eux aussi, parbleu ! fils de romancier ! Ah ! l’imagination !…
Même jour, midi. – Je veux écrire cela jusqu’au bout, cette agonie, cette lente mort. Quelqu’un peut-être retrouvera ces pages où je note cette fin d’un monde, cette mort de notre civilisation. Imbécile humanité qui faisais la guerre, qui t’entre-massacrais, qui t’amputais de tes bras et de tes cerveaux au lieu de te prémunir, de t’organiser, de te défendre. La fin, la fin pour un accident climatérique, une vague de froid, un dérèglement de la saison ! Imbécile humanité ! Je suis un trop vieux matérialiste pour y voir une punition du ciel, et pourtant, et pourtant ! Mes forces s’en vont, faiblesse, fumée… Le charbon aussi s’en va… Et ce froid, ce froid !… Moins cinquante, prétend Fred… Mais ces coups, Fred, mon fils, dis-moi, qu’est-ce, que se passe-t-il ?… On enfonce la porte ?… Reste ici, Fred ; restez Marie, Lisbeth !… J’ordonne et c’est moi qui commande, je pense… Mais personne ne m’écoute, mais tous se précipitent… Des détonations, des cris ?… Reviens, Fred ; revenez Marie, Lisbeth !… Mais personne ne répond… Ah ! seigneur ! on me les a tués, je le comprends, je le comprends !… Et je meurs en te maudissant, imbécile humanité !… »
*
« Imbécile humanité ! » répéta James Brice, quand il reparut au jour sous le tiède soleil, dans le monde redevenu tel qu’il l’avait toujours connu, où refleurissaient les roses, chantaient les oiseaux et, sans rien vouloir, apprendre, se détruiraient toujours les hommes.

–––––
(Charles Hagel, « Les Contes inédits de l’Écho d’Alger, » in L’Écho d’Alger, dix-huitième année, n° 7082, mercredi 27 février 1929 ; Martin Bureau, « Saint-Déluge-de-la-Consolation 4, » aquarelle sur papier d’Arches, 2020)