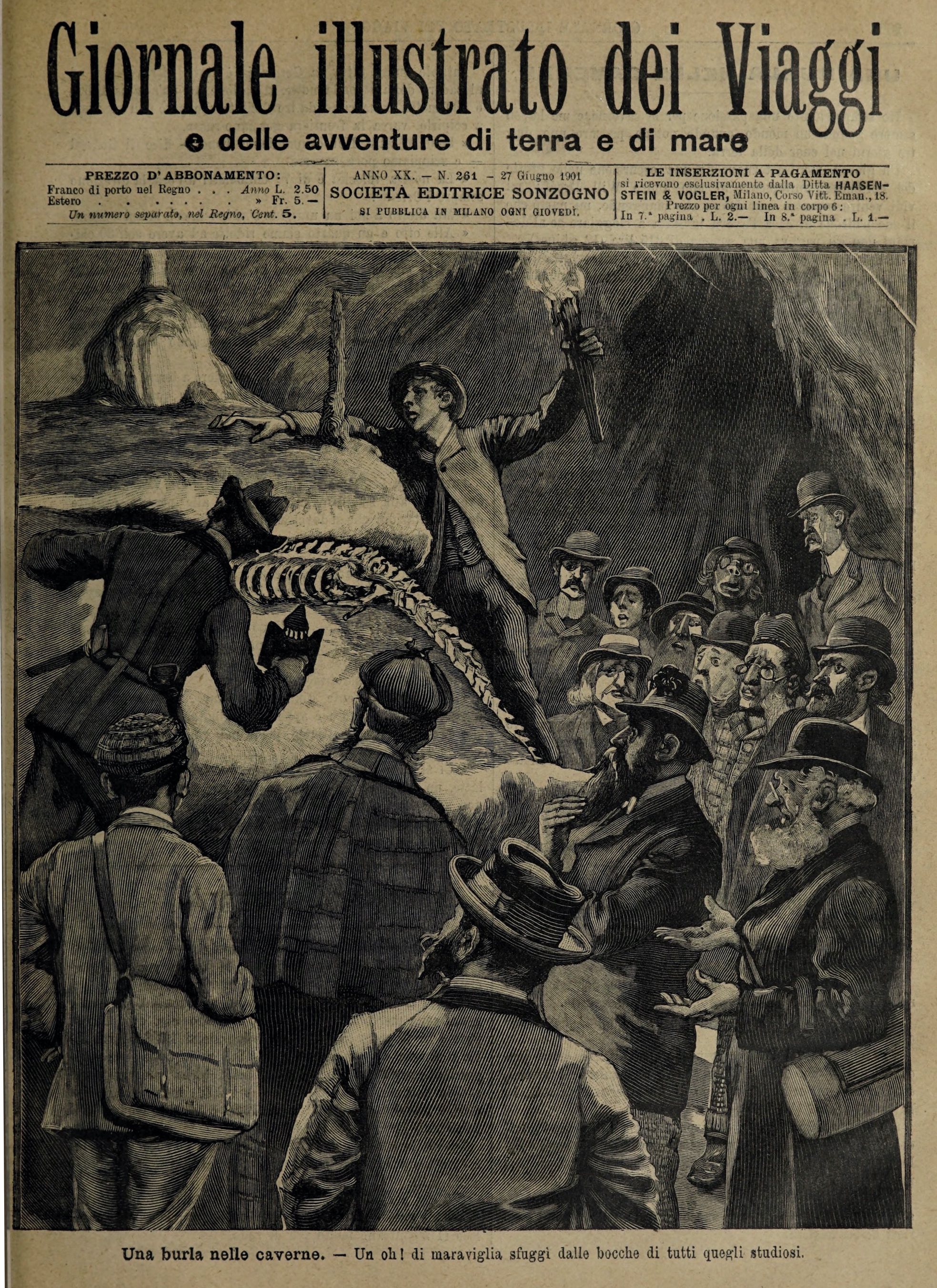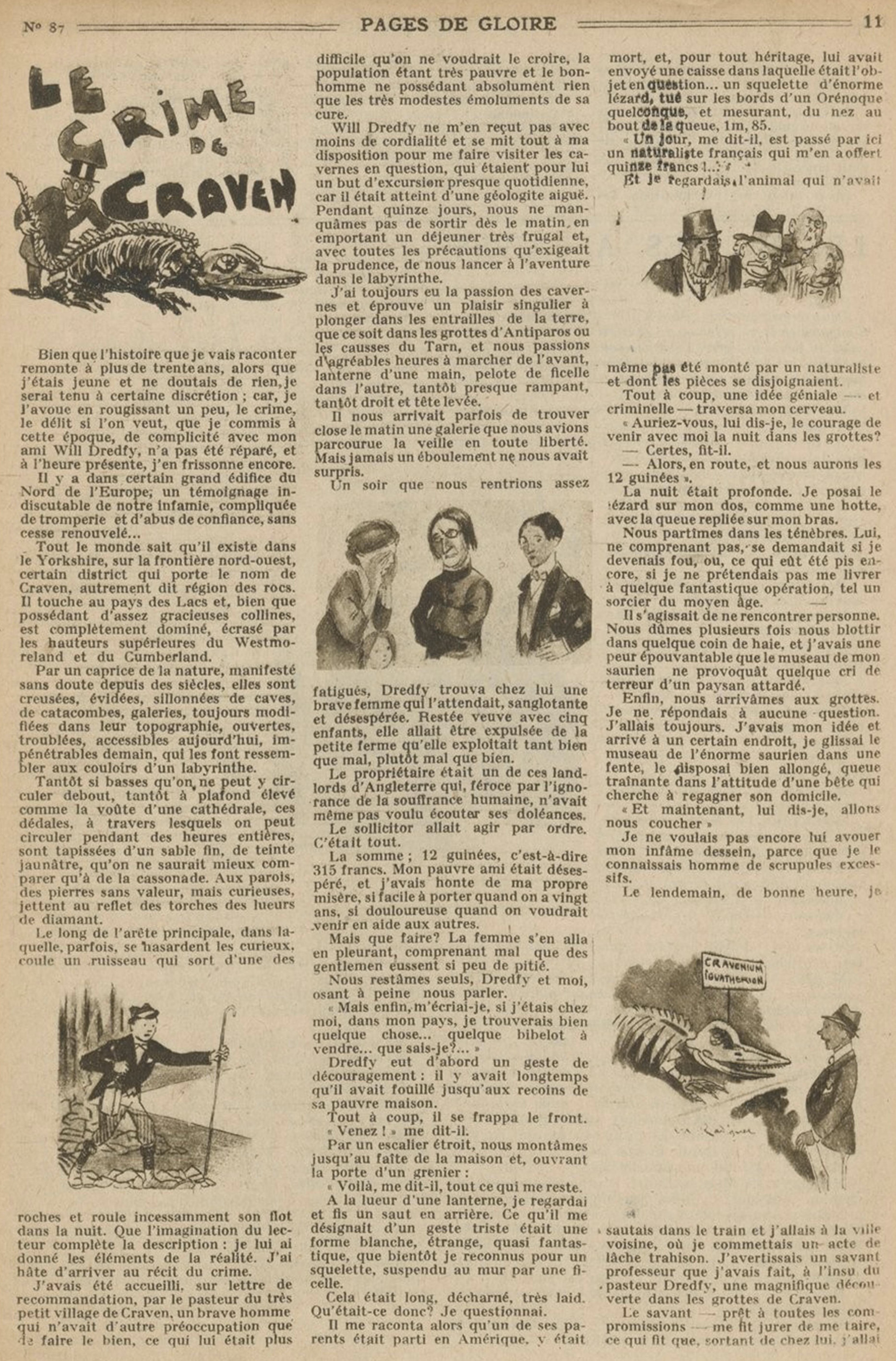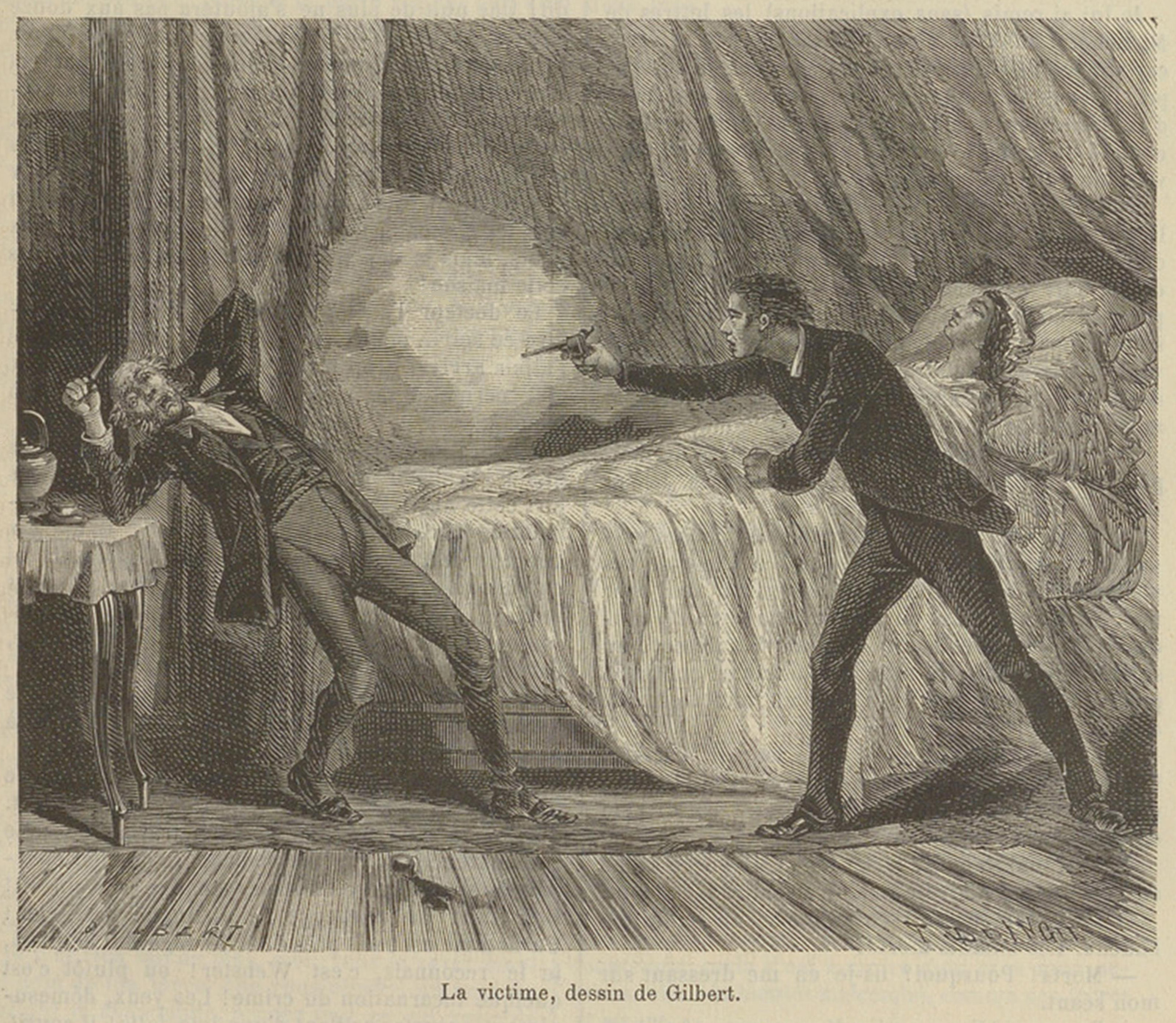Par une belle soirée d’été, je m’en allais, en flânant, le long du chemin qui traverse la campagne. C’était un dimanche et je rentrais chez moi, en rêvant je ne sais à quoi : j’avais entendu, le matin, à l’église, un sermon un peu plus long et, sans doute, un peu plus ennuyeux ou monotone que de coutume ; le trot égal et doux de ma jument s’accordait admirablement avec mes songeries somnolentes.
Tout à coup, cette somnolence se dissipa : je me redressai sur ma selle et je raccourcis les rênes. Je m’imaginais avoir entendu un son familier et j’écoutai longuement, avidement, afin de l’entendre encore et de le bien reconnaître. Mais seuls, le long, bas et nocturne frémissement des bois, et le bruissement léger des champs étaient dans l’air. Un engoulevent poussait sa plainte monocorde sous le feuillage épais de la forêt voisine et, d’un arbre voisin de la route, un oiseau moqueur, éveillé certainement par le pas de ma monture, s’envola en faisant entendre cette douce et liquide mélodie, que seul connaît ce roi des chantres empressés de la profonde nuit.
Puis, soudain, le son que je cherchais si anxieusement à entendre se répète… Bien loin et bien affaibli, comme en un rêve : c’était le chant d’un cor de chasse, un chant suivi, comme d’un refrain qui traîne, par la réponse de l’écho, si lointain, si mièvre, si étrangement peu naturel, que le motif, en forme de fugue, semblait s’échapper de la corne de Diane et tomber, en se déroulant, des montagnes de la lune, en réponse à celle d’un dévot de cette triste terre, puis surnager et se balancer en cadences rythmiques, au-dessus des profondeurs des abîmes de l’espace…
Sur le même doux zéphyr, qui l’avait apporté à mon oreille anxieusement avide, arrivaient les abois de quelque meute fantomatique, en pleine chasse, sur quelque rive lointaine.
Jamais auparavant je n’avais entendu un cor et des chiens comme ceux-là : aussi écoutais-je attentivement, à mesure qu’ils approchaient et que les sons devenaient de plus en plus distincts, et j’attendais, avec une sorte d’impatience, quelque note familière qui les trahît et m’apprît quel était celui de mes voisins de campagne qui chassait le renard, en profitant de cette nuit obscure de dimanche pour envahir mon territoire de chasse.
Bien que j’eusse préféré croire que quelque bizarre particularité dans l’acoustique de l’atmosphère avait défiguré les sons que je percevais et leur avait enlevé ce qu’ils avaient de familier à mon oreille, je dus bientôt me laisser convaincre que jamais cette meute ne s’était fait entendre dans le pays que j’habitais, et que, même dans mes rêves, je n’avais de ma vie entendu quelque chose d’aussi aérien et d’aussi peu de notre monde.
Je remarquai aussi que les abois de la meute qui approchait avaient une sorte de faculté particulière à la ventriloquie, car tandis qu’elle arrivait sur moi avec la rapidité du vent, les sons ne paraissaient pas plus forts, bien qu’ils fussent plus rapprochés !…
Les rayons de lune blanchissaient la montagne qui s’étendait en pente douce devant moi, en une obscurité infinie, comme si quelque torrent silencieux glissait doucement le long de ses flancs immenses jusqu’aux champs, où il s’engloutissait et gisait autour d’elle comme une mer immobilisée dans la nuit. Sur la lueur de ce torrent, la silhouette d’un cavalier se découpait vaguement, apparaissait puis disparaissait, comme s’il jouait au milieu des arbres dont l’ombre se projetait sur la surface du torrent.
Mais, devenant bientôt plus grande et plus nette, cette forme vague se précisa et se fit la silhouette d’un chasseur monté sur un vigoureux et superbe pur-sang.
Je remarquai presque aussitôt, avec une réelle frayeur, que sa monture, qui galopait furieusement sur la route dure, ne produisait aucun bruit. Ses sabots semblaient chaussés avec du silence !…
Ce fut en vain que je m’efforçai de distinguer, au passage, les traits du cavalier. Un moment après, lorsque je pus rassembler mes idées et reprendre possession de moi-même, je songeai que la chasse était encore à une faible distance et, frappant ma jument de mes éperons, je me lançai éperdument dans la plaine, afin de la couper, car elle revenait à angle droit vers la montagne.
Jusqu’alors, ma jument n’avait jamais eu la honte de se voir gagner de vitesse, ni sur route, ni à travers champs, et cependant, malgré ses efforts et les miens, il nous fut impossible de rejoindre le chasseur qui fuyait devant moi, ni même de nous rapprocher de lui. J’eus donc la cruelle mortification de voir la meute sortir du bois comme un éclair et traverser la route, alors que j’étais encore très éloigné d’elle.
Par-dessus les haies et les barrières et à travers champs, le chasseur filait et bondissait, et moi, résolu à voir la fin de cette aventure, piqué par la curiosité et par une jalousie mêlée de colère, j’enlevai ma jument par-dessus la palissade voisine, puis, m’installant bien en selle, je me préparai à une course comme je n’en avais jamais fait. Je voulais, désormais, que nul chasseur étranger ne vînt plus sur mon territoire, chasser mes renards et me faire l’affront de paraître ne pas me voir et surtout de me battre de vitesse chez moi.
Je voulais aussi savoir qui était cet intrus et d’où il venait : il faudrait qu’il s’expliquât avant de s’en aller !…
Mais, dès que la première ardeur de cette résolution se fut évaporée, je compris quelle lourde tâche je venais de m’imposer.
De ma vie, je n’oublierai cette sauvage poursuite à travers la nuit !
Sous bois et dans les sentiers invisibles, parmi les traîtresses taches de lumière et d’ombre, sur les troncs d’arbres et sous les branches, au risque de finir comme Absalon, dans la campagne et les sillons profonds, avec l’espace ouvert devant nous, ainsi qu’un vide étrange qui nous eût attirés et absorbés et où nous plongions tête baissée tandis que les haies et les palissades surgissaient, à chaque instant, de l’obscurité et se précipitaient à notre rencontre sur les ailes du vent, nous allions et c’était un vrai charme que ma brave petite jument eût été entraînée à chasser la nuit.
Avec la ténacité et la témérité d’une bouledogue, je filais à toute vitesse, mais ma bête, malgré sa vaillance, perdait peu à peu son énergie et son élasticité. Je pus enfin sentir ses flancs oppressés, qui battaient entre mes jambes et comprendre que j’étais vaincu, bien vaincu, tandis que le démon de chasseur continuait de sa même allure, sans seulement se retourner, ou daigner laisser voir qu’il m’avait aperçu, absolument comme s’il eût ignoré que je le poursuivais.
Dans ma rage grandissante, je me décidai à l’y contraindre, en l’appelant de toutes mes forces, mais au même instant, cette effrayante poursuite prenait fin : la meute avait commencé la curée, dans la campagne nue, à quelque distance de nous.
Le chasseur sauta à terre et s’élança au milieu de sa meute, afin de s’emparer de la queue du renard, ce trophée si cher aux fox-hunters. J’arrivais, en ce moment, sur ma jument essoufflée et chancelante, et je vis à sa selle plusieurs trophées de chasse, qui y étaient déjà suspendus, en témoignage de ses prouesses de la nuit. Mais je remarquai aussi, avec un soudain étonnement, que ces trophées, au lieu d’être de touffus et gracieux panaches de renard, ressemblaient tout à fait à des fouets de chiens.
Mais cette découverte était bien insignifiante auprès de celle qui suivit. Comme il se redressait avec un autre de ces hideux trophées à la main, je vis que la meute qui bondissait autour de lui, en glapissant de joie et en le caressant, était une meute de renards !…
« Eh bien, Monsieur ! s’écria le chasseur étrange, en remarquant pour la première fois ma présence. Vous en êtes donc ?
– De la chasse, vous voulez dire ? répondis-je avec un certain tremblement dans la voix. Toute ma vie, j’ai été un zélé fox-hunter !
– Aussi, maintenant, chassez-vous pour l’éternité, n’est-ce pas ?
– Comment cela ?
– Depuis quand êtes-vous mort ?
– Je ne suis pas mort encore. Du moins, je le crois !… repris-je, avec une inquiétude bien naturelle et quelque incertitude.
– Oh ! Oh ! s’écria l’inconnu, avec une surprise aussi grande que la mienne, je vois ! Je vois ! » répéta-t-il.
Et il me regardait curieusement, afin de s’assurer si j’étais réellement en chair et en os, tandis que, moi, j’observais une chose qui m’avait échappé, sous les pâles rayons de lune, c’est-à-dire que mon étrange compagnon de chasse n’était qu’une ombre, comme tous les animaux qui l’entouraient : son cheval, ses renards et le chien lui-même, qui avait été la bête de chasse et qui venait d’être pris, tous étaient des fantômes.
« J’espérais, la première fois que je vous ai aperçu, que vous aussi vous étiez un fantôme, dit-il avec un regret évident, qu’il expliqua de suite, en ajoutant : Le malheur n’aime pas la solitude, vous savez.
– Ce n’est pas un malheur de jouir du plaisir de la chasse, observai-je avec un sincère étonnement.
– Plaisir ! Niaiseries ! Illusion ! s’écria-t-il vivement. Quelle peut donc être la punition plus effrayante, pour un fox-hunter, que d’être forcé de travailler comme un démon toutes les nuits et de ne chasser que de pauvres chiens avec une meute de renards ladrés ? La seule consolation qu’on puisse y trouver n’est-elle pas que les chiens méritent la mort, car ils sont bavards, lâcheurs, escrocs, paresseux, égoïstes et cruels ?
– C’est vrai, répondis-je ; cependant, ce sont ces défauts qui font leurs qualités, pour nous, chasseurs. Mais vous, comment avez-vous donc mérité ce terrible châtiment ? Non pas que je veuille vous rappeler un passé regrettable, mais je songe que peut-être cela me permettrait, à moi, d’éviter une semblable destinée. Et vous serez bien, bien aimable, si vous vouliez me permettre de profiter de votre expérience et de votre douloureux exemple.
– Certainement, répondit l’aimable fantôme. Je n’ai aucune raison pour ne pas vous obliger, d’autant plus qu’il n’y a aucun danger, du moins je le suppose, pour que vous péchiez aussi gravement que moi : cela fait, du reste, partie de mon châtiment d’être obligé de raconter mes tristes méfaits, toutes les fois qu’on me le demande.
– Eh bien, voyons, Monsieur, et croyez à…
– D’abord, commença mon interlocuteur, comme s’il n’avait que faire de mes condoléances, j’ai chassé le dimanche et les jours de fêtes. C’est pourquoi je suis condamné à chasser toutes les nuits de dimanches, depuis le coucher du soleil jusqu’à l’aube prochaine.
– Heureusement, je ne chasse pas le dimanche. Je suis même allé à la messe aujourd’hui, dis-je en me félicitant.
– Vous n’avez jamais, le dimanche matin, par une fraîche matinée, fait seller votre cheval pour vagabonder à travers la campagne ? demanda le fantôme, d’un ton narquois et comme s’il en savait long sur mon compte.
– Oui, répondis-je, à contrecœur.
– Et, quelquefois, les chiens vous ont suivi et, accidentellement, ont mis sur pied un renard qui dormait dans un boqueteau ? continua-t-il, de l’air d’un juge d’instruction adroit et railleur.
– Oui, fus-je forcé de reconnaître.
– C’est bien cela ! s’écria mon facétieux et diaphane interlocuteur. C’est précisément comme cela que j’ai péché moi-même. Je veux bien vous avouer, confidentiellement, que, chaque fois, l’Ange préposé à cette besogne prenait note de mes méfaits. Depuis longtemps, il est devenu mon ami personnel et il m’a confié que mon crime eût été moins grand, si j’étais allé carrément à la chasse, en sortant par la grande porte au lieu de feindre de vouloir promener mes chiens et d’aller à la messe les seuls jours de pluie.
Mais ce n’est pas tout, » continua mon spectral mentor, en notant la dépression produite sur moi par cette déclaration, et comme si cette constatation lui rendait un peu de gaieté.
Je ne veux pas dire par là qu’elle lui donnait de l’esprit ni l’envie d’en faire montre, car il n’alla pas jusque-là, mais il continua, en se redressant avec plus d’aisance, et en tournant, dans sa main droite, le fouet du pauvre chien qu’il venait de prendre :
« J’étais, et j’ai le regret de l’avouer, expliqua-t-il, enragé pour réclamer, à tout propos. Le chien qui avait, le premier, trouvé la piste était toujours le mien : si un chien avait mis la meute en défaut et lui avait fait prendre le change, c’était toujours celui de mon ami…
– Hélas ! m’écriai-je, plein de repentir. Je crains bien de n’avoir que trop suivi ces errements fâcheux. »
Son humeur s’adoucit encore – en parlant au figuré naturellement.
« Je prétendais aussi que ma meute était la meilleure du monde et la mieux gorgée.
– Moi, j’ai toujours affirmé, m’écriai-je avec feu, que c’étaient ceux de mon père qui étaient les meilleurs, les seuls !… Ce sont ceux dont je me sers !…
– Vous verrez qu’il y en a d’autres, reprit-il sentencieusement, et vous le reconnaîtrez, le jour où vous viendrez chasser avec moi sur les bords du Styx. Lorsque j’avais envoyé ma meute à l’Exposition-canine ou simplement au Club, j’essayais de gagner les juges à ma manière de voir, et lorsqu’ils ne voulaient pas donner à mes chiens la récompense que je désirais, je parcourais les groupes et j’excitais les autres candidats, évincés comme moi, à maudire leurs juges et leurs décisions, et à les accuser de toutes les indélicatesses ; un arbitre dans une partie de balle ou de tennis mène une vie enviable en comparaison de celle d’un juge dans une réunion de fox-hunters, quand j’étais sur cette terre.
– Hélas ! trois fois hélas ! m’écriai-je avec désespoir. J’ai péché aussi et vous avez eu beaucoup de successeurs. Errare humanum est !
– Et l’énumération de mes fautes n’est pas terminée, » fit-il en m’interrompant, d’une voix plus basse et en rougissant de honte.
Avez-vous jamais vu rougir un spectre ? Je vous affirme que c’est étrange.
« Malheur à moi ! continua-t-il. C’est moi le misérable, le perfide, qui remplissais les colonnes de journaux de chasse du récit des exploits de ma meute, de mes aventures de chasse et de mes observations.
– Moi aussi ! j’ai péché ! sanglotai-je, plein de remords et de honte par mes fautes anciennes.
– Frère, donnez-moi la main ! » s’écria le spectre, en me tendant une main illusoire, que je ne parvins pas à saisir, ayant seulement réussi à passer mon bras à travers son corps, sans cependant avoir, le moins du monde, paru troubler son économie générale.
« Dire que je ne croyais pas rencontrer un jour sur mon chemin un aussi grand coupable que moi ! s’écria-t-il, avec une sincère admiration. J’attendrai donc votre arrivée avec impatience, cher Monsieur ! Et je parie qu’on tient en réserve une jolie harde de vieux chiens pour vous les faire courir et même quelques-uns de vos vieux clients, comme renards de meute. Chaque condamné a le devoir de former et d’entraîner sa propre meute, vous savez ?
– Jamais ! m’écriai-je, désespéré. Jamais ! Je me corrigerai ! Je me repentirai ! J’expierai pendant qu’il en est temps encore. Je ne chasserai plus, d’ailleurs, que six jours et six nuits par semaine ! Je rendrai justice à tout fox-hunter et à son chien. J’apprendrai à perdre sans crier et à renoncer à l’espoir d’un prix… lorsque je ne le mériterai pas. Et jamais plus on n’entendra l’écho de ma trompe, dans les feuilles des journaux de chasse !
– Ah ! très bien ! fit mon spectre, d’un air de profond dégoût. Si vous voulez renoncer à ce qui fait la vie !… Je regrette d’avoir été trop franc et trop bavard. Mais vous savez que vous avez diablement à faire pour vous réformer. Allons, j’ai perdu assez de temps avec vous ; il vaut mieux que je vous quitte. Il faut maintenant que je courre un vieux chien qui, jadis, n’avait pas son pareil pour découper et qui rôde actuellement près d’un cimetière, non loin d’ici ; avec lui, jadis, je battais tous mes voisins. Mais en châtiment de ses crimes, ce vieux découpeur a été condamné à se découper lui-même éternellement. Mais, assez ! si je ne me hâte, je rentrerai sans avoir mon compte de panaches et je serai puni par sa Satanique Majesté. En route ! »
Et, portant à sa bouche sa corne de chasse, il fit entendre quelques notes, puis il disparut, suivi de sa meute de renards, dans la direction qu’il avait indiquée, tandis que je me hâtais de prendre la direction opposée, effrayé et tremblant que j’étais.
Dans ma hâte à m’éloigner de ce funèbre compagnon, je ne remarquais pas où passait ma jument et, dans l’obscurité, je trébuchai sur un rocher ou dans un trou de puisard, je ne sais lequel. Toujours est-il que je me sentis tomber, tomber, tomber d’une hauteur formidable à travers l’insondable espace, et avec le sentiment douloureux que tout était perdu ; puis cela se termina par un choc assez violent et par un retour incomplet à la raison, pour me trouver devant ma propre porte, avec ma jument debout et tranquille auprès de moi…
Lorsque je racontai à ma femme ce que j’avais vu pendant cette horrible nuit, elle soutint que je m’étais tout simplement endormi en flânant le long du chemin, que j’avais rêvé toutes ces âneries – ce fut le mot dont elle se servit – et que, par la force de l’habitude, j’étais resté en selle jusqu’à ce que ma jument s’arrêtât à ma porte, où j’avais passé par-dessus sa tête.
Mais naturellement, nous autres, fox-hunters, nous en savons plus long que cela.
J’ai cependant encore un regret. J’avais oublié de demander au spectre son nom. Mais un ami, à qui je racontai mon aventure et qui, je le sais, a connu beaucoup de fox-hunters, crut pouvoir m’apprendre ce nom.
Il me dit que c’était « Légion. »

–––––
(D’après F.-J. Hagau, in La Chasse illustrée et la Vie rurale & sportive, quarantième année, n° 44, mardi 15 décembre 1907 ; Franz von Stuck, « Die Wilde Jagd » [La Chasse sauvage], huile sur toile, c. 1888)