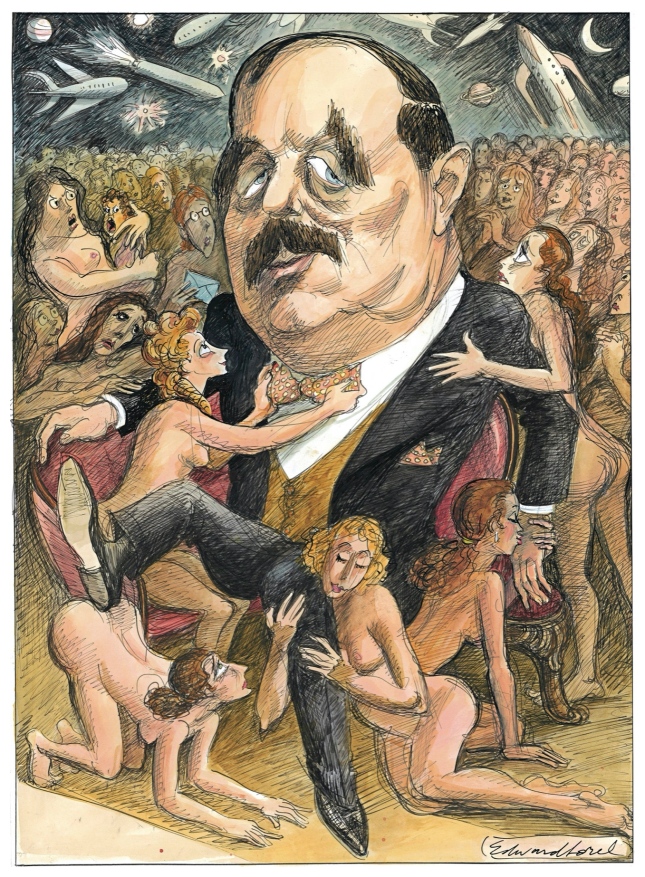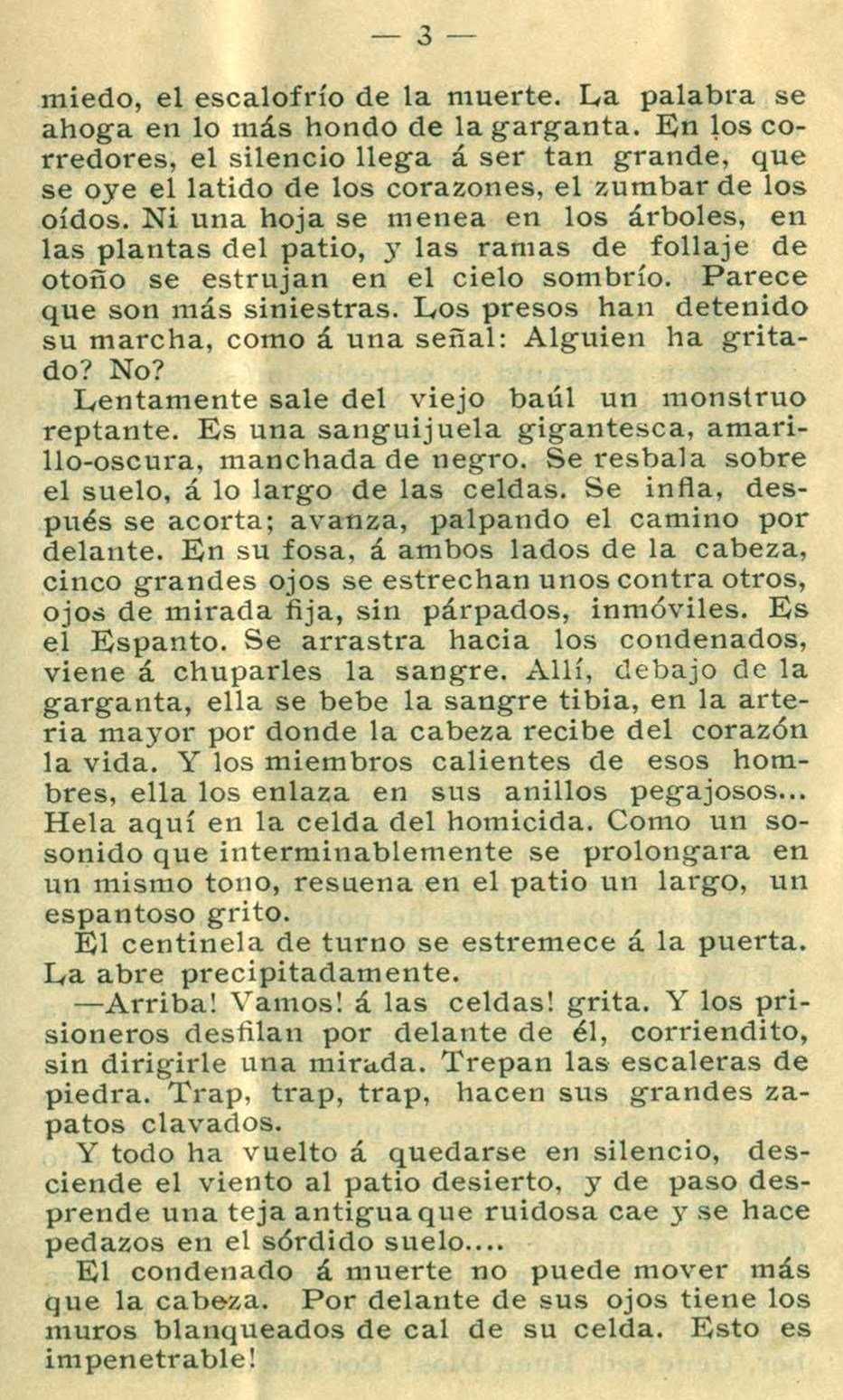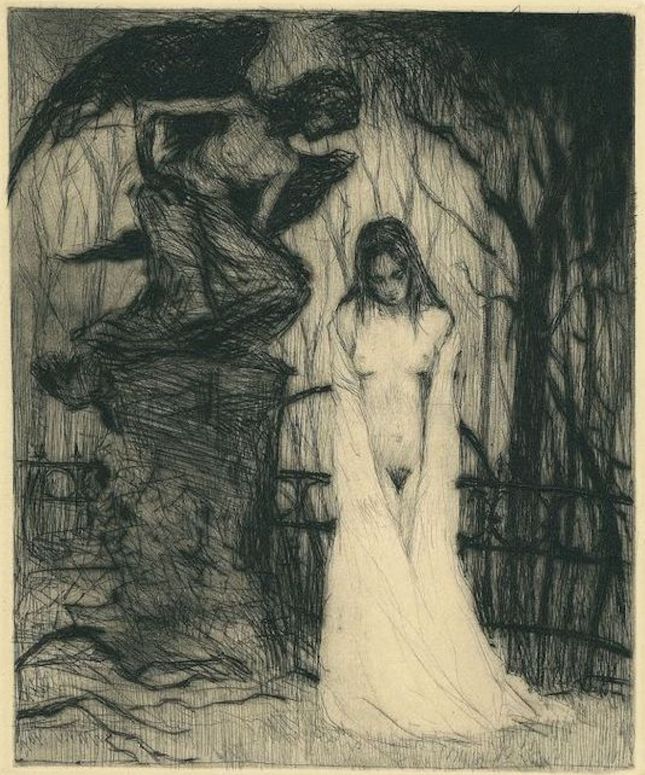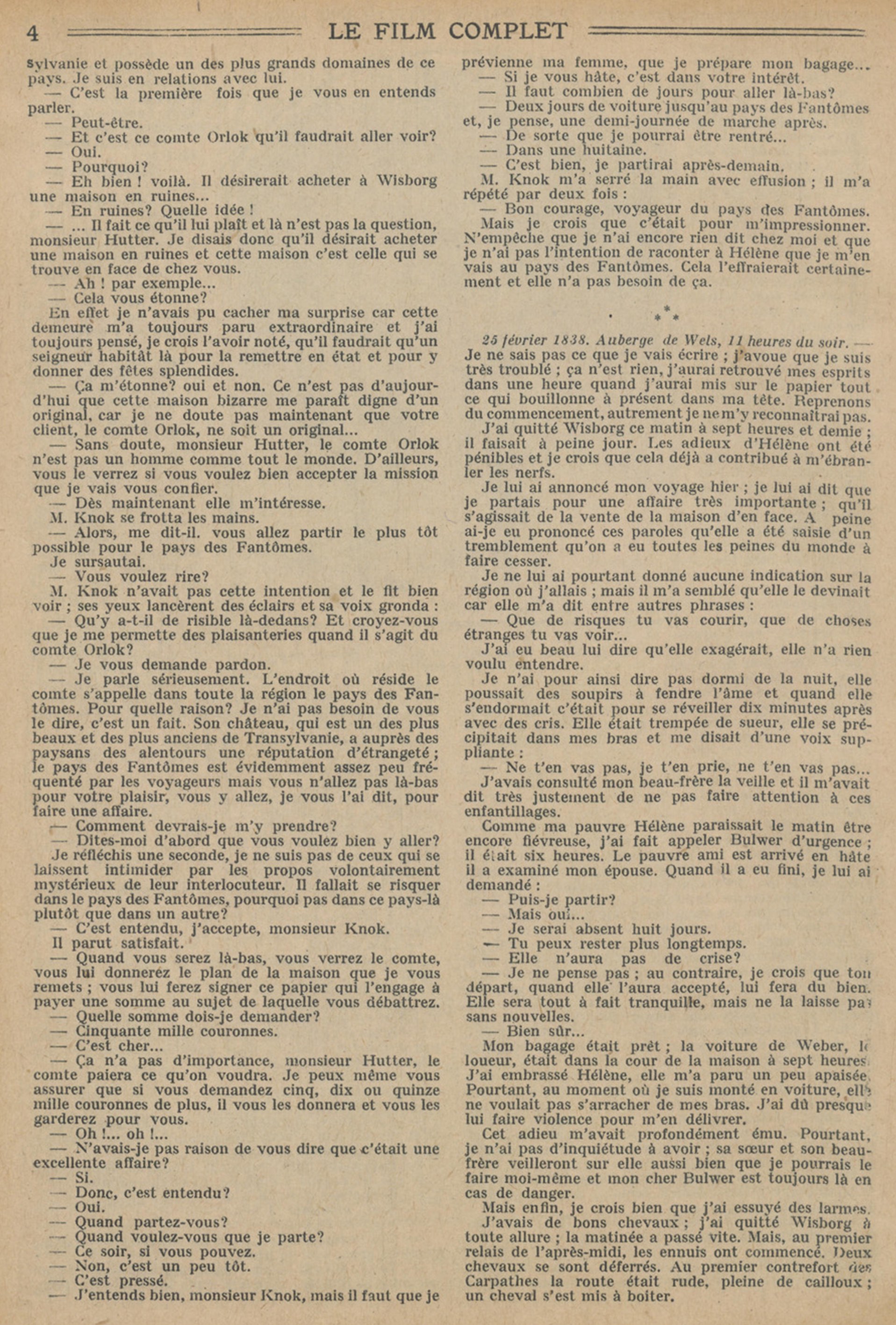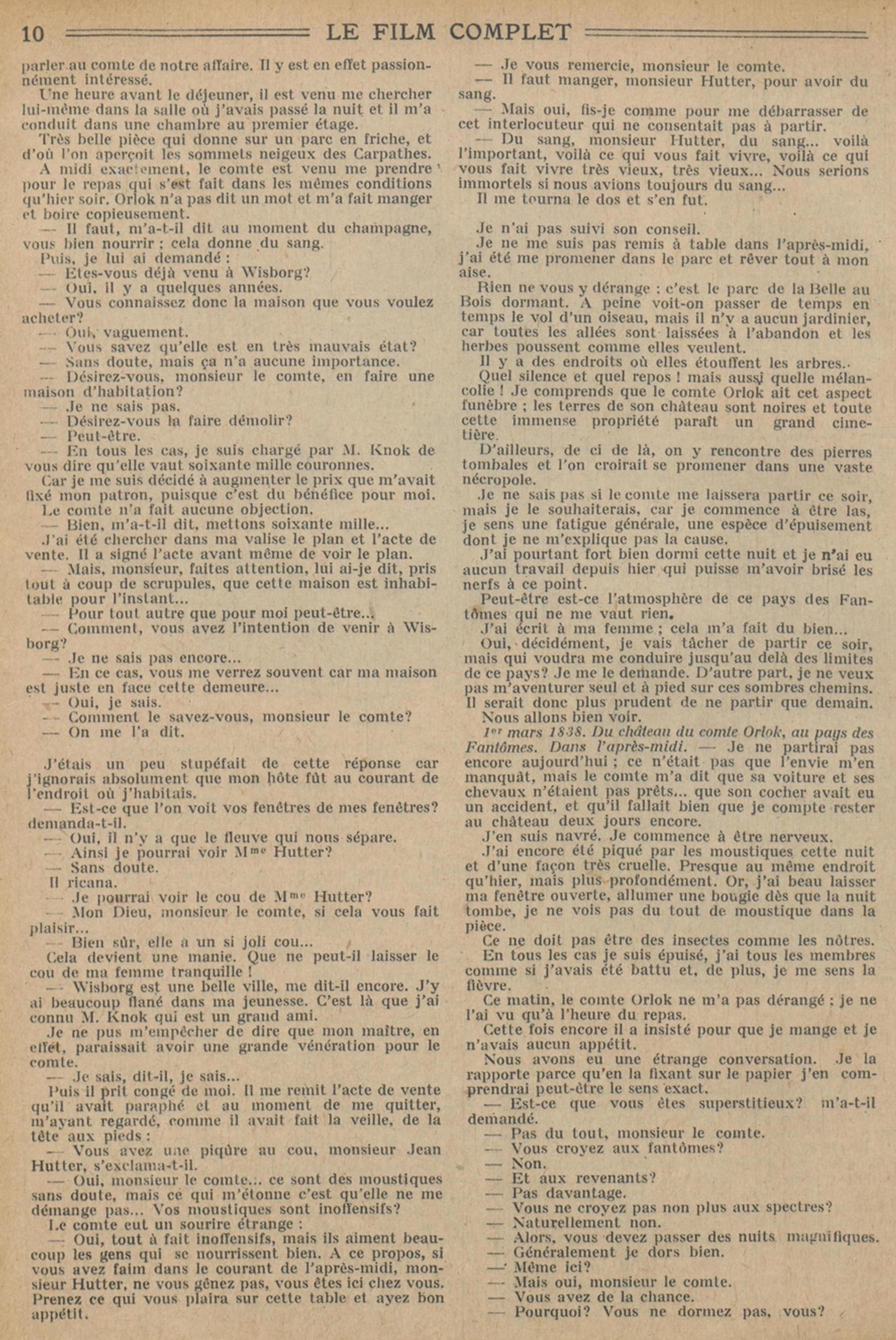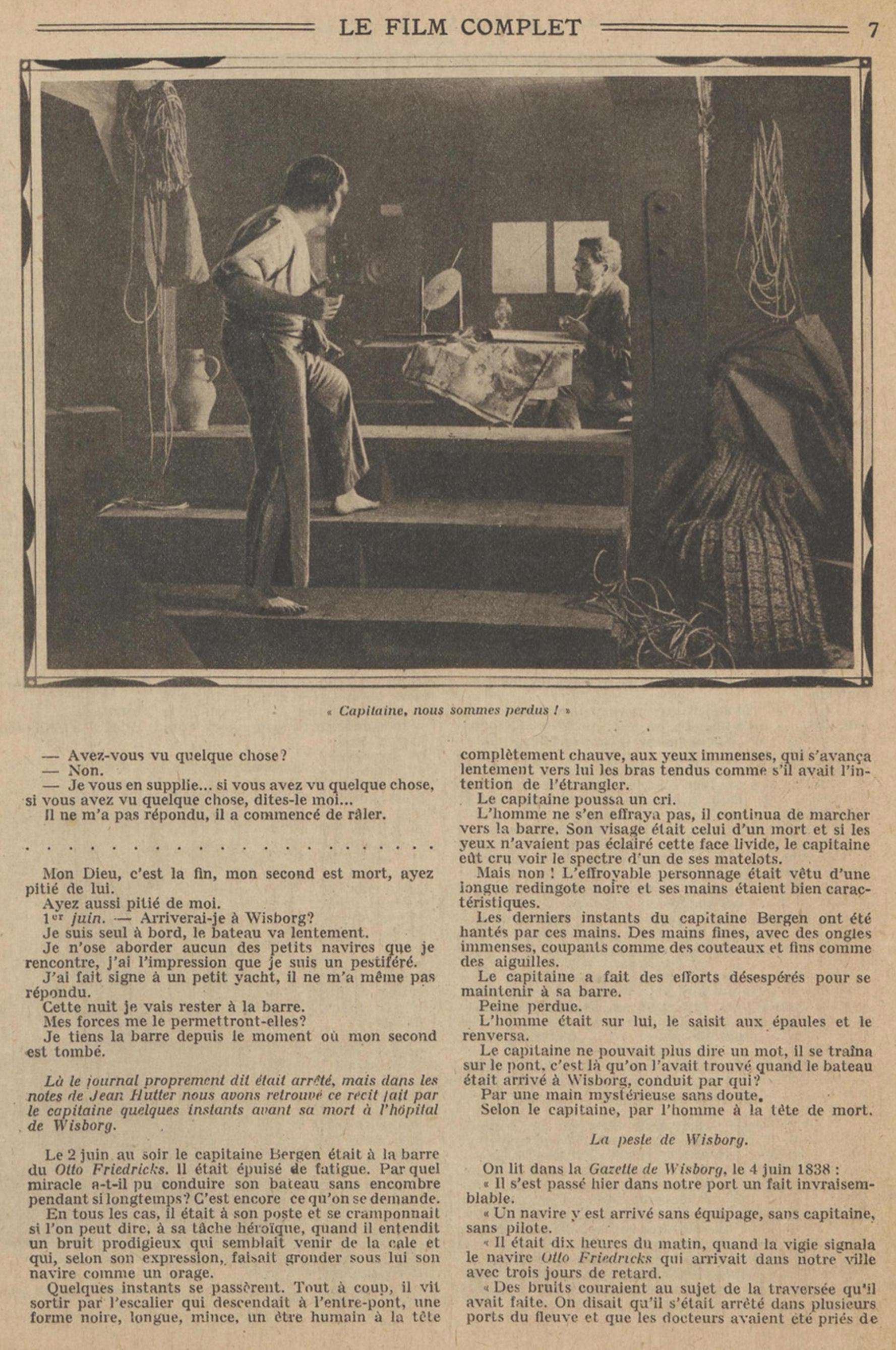Lorsque, par un soir d’orage, le revenant pénétra dans la chambre que j’occupais au sein de l’antique château écossais de mon ami Mac O’Ric, je ne fus pas autrement surpris, car, à vrai dire, je l’attendais depuis huit jours. J’ajoute que j’aurais été déçu s’il ne s’était pas présenté. J’éprouvais un besoin morbide de fumer une pipe en sa compagnie, histoire d’étonner ensuite les camarades au récit de cette entrevue.
J’aurais d’ailleurs raconté l’aventure même si elle ne s’était pas produite, et, mon Dieu, on n’aurait pas davantage prêté créance à mes paroles. Seulement, ç’aurait été justifié.
À dessein, j’avais choisi une chambre dont la porte tenait avec des ficelles de jute afin de faciliter l’entrée du revenant.
Mac n’avait jamais consenti la dépense d’un penny pour faire restaurer son château. Il avait abouti à ce résultat que si ma chambre n’avait plus de serrure, la sienne n’avait plus de plafond. Dans la vaste salle à manger, les plâtras jonchaient le sol. Les repas se prenaient debout pour ne pas faire d’imprudence. Car, au moindre craquement dans le mur ou le plafond, la dizaine de garçons que nous étions se ruait hors de la pièce. On revenait achever le repas un moment après, en parlant bas et en marchant doucement afin d’éviter la chute de nouvelles écailles dont le haut de la pièce nous arrosait avec générosité.
Avec ses couloirs suintants d’ignobles et visqueux liquides, ses murs qui ne tenaient debout qu’à force de bonne volonté, ce château était évidemment un paradis pour un fantôme écossais.
Donc, ce diable de revenant entra dans ma chambre et vint délibérément s’asseoir sur mon lit. Il tenait d’une main une misérable paire de castagnettes, dont l’origine était on ne peut plus mystérieuse, et de l’autre, le pan de son suaire taillé dans de la toile de sac. Il avait deux yeux, deux dents et deux narines, mais il ne gardait ouvert qu’un œil, ne se servait que d’une dent, et une seule narine était en action.
Comme je lui demandais la raison de cet état de choses, il me répondit que son œil, sa narine et sa dent gauches étaient de repos cette nuit.
« Vous comprenez, me dit-il, quand on n’est qu’un pauvre fantôme sans fortune, il faut être économe. Et c’est trop dépenser que de se servir à la fois de deux organes lorsqu’un seul est suffisant. Surtout que le Père Éternel a dévalué les jetons de présence.
– Que voulez-vous, c’est la crise, fis-je d’un air morose.
– Évidemment, c’est la crise, reprit le revenant. Tenez, moi qui vous parle, je n’ai même pas de quoi m’acheter une chaîne. Là-haut, au magasin d’habillement, on a refusé de me donner cet instrument à crédit. Heureusement qu’un fantôme espagnol de mes amis m’a offert cette paire de castagnettes. Car se promener sans faire de bruit, c’est un coup à se faire envoyer vingt jours dans le pied d’un guéridon du Spirite-Club. Du travail forcé, quoi !
Et pourtant, monsieur, le pauvre fantôme que vous avez devant vous, avait, en même temps que le nom de Douglas O’Reye, une fortune suffisante pour couler en paix, non seulement sa vie, mais encore les jours divins d’un gâtisme enraciné. Mais le malheur voulut que je rencontrasse cette crapule de Mac O’Ric.
– Mac O’Ric une crapule ? Vous badinez !
– Ai-je vraiment l’air de badiner, monsieur ? » me demanda le fantôme d’une voix sinistre. Il approcha son visage du mien et je me rendis compte que cette face à moitié décomposée n’était pas taillée pour la plaisanterie. De plus, son haleine dégageait une épouvantable odeur d’eau bénite.
Ou j’avais affaire à un fantôme alcoolique, – et ma situation était plutôt équivoque, – ou Douglas O’Reye disait vrai et j’allais en apprendre de belles sur le compte de mon ami.
Toutefois, je me méfiais un peu depuis que j’avais été abominablement trompé par un fantôme marseillais.
Cependant, le fantôme de Douglas s’installa sur mon lit plus commodément, alluma une chose qu’on devinait être une pipe et qu’il devait tenir d’un lointain aïeul, et commença son histoire :
« À cette époque-là, tous les soirs de l’année nous retrouvaient assis, Mac O’Ric, quelques amis et moi, autour d’un même tapis vert. Le poker nous tenait, monsieur, comme une arapède. Or, tandis que nos partenaires se tiraient quittes des coups les plus douteux, moi, je gagnais toujours, tandis que la malchance s’acharnait sur Mac. Et, naturellement, étant donné la neutralité des autres joueurs, je gagnais exactement tout ce que perdait O’Ric.
Un jour vint où il me proposa un étonnant marché.
« Old fellow, me dit-il, je t’achète ta mandragore. »
Monsieur, je n’avais rien à perdre dans cette affaire, bien au contraire, puisque, non seulement je ne croyais pas au pouvoir de cette plante, mais encore que je ne songeais pas le moins du monde à me pendre.
Bref, je vendis la mandragore.
À partir de cet instant, monsieur, une malchance extraordinaire me poursuivit tandis que le cas contraire se produisait pour lui. Et je vous le dis, monsieur, au poker, il est imbattable.
Il m’a ainsi gagné toute ma fortune et conduit au suicide – au suicide par pendaison, car il ne me restait plus qu’une vieille paire de bretelles, lequel suicide est la conséquence directe des heures cuisantes que je traverse.
Et lorsque je fus mort, il vint lui-même, avec une joie diabolique, arracher la mandragore du pied de mon gibet.
Comme on dit, il m’a eu. Il m’a même eu jusqu’à la mandragore, monsieur. »
(Extrait de « Panorama, » journal littéraire mensuel ; directeur : André Héléna. Abonnement : 15 fr. Chèque postal Montpellier 304-21)

–––––
(André Heléna, in La République sociale, quarante-neuvième année, n° 2840, jeudi 26 septembre 1940 ; Diego Rivera, « Las tentaciones de San Antonio o La Noche de los rábanos, » huile sur toile, 1947)