Notre rédacteur en chef a parlé, la semaine dernière, dans sa chronique littéraire, de ce livre si curieux : « Dans l’Épouvante, » par Hans [sic] Heinz Ewers (la Renaissance du Livre). Nous publions ci-dessous l’étrange histoire qui ouvre ce volume extraordinaire :
Le vapeur de la Hamburg Amerika Line était à l’ancre devant Port-au-Prince, quand Petit-Ruban-Bleu se précipita dans la salle à manger, comme un ouragan :
« Maman n’est pas encore là ! »
Non, maman était encore dans sa cabine. Mais les officiers et les passagers se levèrent tous pour prendre Petit-Ruban-Bleu sur leurs genoux. Jamais aucune dame, à bord du Président, n’avait été fêtée comme cette petite filles aux six années souriantes ; celui dans la tasse de qui Petit-Ruban-Bleu avait pris le thé était heureux toute la journée. Elle portait toujours une robe de batiste blanche, et toujours un petit nœud bleu ornait ses boucles blondes. On lui demandait cent fois par jour : « Pourquoi t’appelles-tu Petit-Ruban-Bleu ? » Alors, elle riait : « Pour qu’on me retrouve si je me perds ! » Mais elle ne se perdait pas dans ses vagabondages solitaires à chaque escale ; c’était une enfant du Texas, rusée comme un petit chien.
Cette fois, aucun des convives ne put l’attraper. Elle courait au bout de la table et grimpa sur les genoux du capitaine. Le Frison géant eut un sourire ; il était le préféré de Petit-Ruban-Bleu ; c’était son seul orgueil.
« Trempette ! dit Petit-Ruban-Bleu, qui plongea sa biscotte dans la tasse à thé du capitaine.
– Où es-tu encore allée, ce matin ? demanda-t-il.
– Oh ! oh ! dit l’enfant, et ses yeux resplendissaient avec plus de clarté encore que le ruban de ses cheveux. Maman doit venir. Vous devez tous venir ! Nous sommes au pays des fées !
– Haïti !… le pays des fées ? » dit le capitaine, sceptique.
Petit-Ruban-Bleu se mit à rire !
« Je ne sais pas du tout comment s’appelle ce pays-ci, mais c’est le pays des fées ! Je les ai vu, de mes yeux vus, les merveilleux monstres, couchés les uns près des autres sur le pont de la place du marché. Il y en a un qui a des mains aussi grosses qu’une vache, et auprès de lui il y en a un autre qui a une tête grosse comme deux vaches ! Un autre a des écailles de crocodile. Ils sont encore plus beaux et plus admirables que dans mon livre de contes ! Veux-tu venir, capitaine ? »
Elle se précipita alors vers la jolie femme qui venait d’entrer dans la salle.
« … Vite, maman, bois ton thé. Vite ! vite ! Il faut que tu viennes, maman ! Nous sommes au pays des fées ! »
Et tous l’accompagnèrent, jusqu’au premier ingénieur mécanicien. Il n’avait pas de temps du tout, il n’était même pas venu déjeuner ; il y avait quelque chose de détraqué dans la machine, et il devait la réparer pendant qu’on était à l’ancre. Mais Petit-Ruban-Bleu l’aimait beaucoup, parce qu’il taillait si joliment l’écaille. Il fut donc forcé de l’accompagner. Petit-Ruban-Bleu commandait à bord.
« Je travaillerai la nuit, » dit-il au capitaine.
Petit-Ruban-Bleu, d’un air sérieux, l’approuva de la tête :
« Oui, tu peux travailler la nuit. Moi, je dors pendant ce temps-là. »
Petit-Ruban-Bleu les guida par les ruelles sales du port. Partout, les nègres allongeaient indiscrètement aux fenêtres et aux portes leurs masques grimaçants. Les compagnons de la petite enjambaient les larges ruisseaux, et Petit-Ruban-Bleu eut un rire de satisfaction quand le docteur fit un faux pas et que l’eau sale éclaboussa son costume blanc. Ils continuèrent leur route à travers les misérables baraques du marché, au milieu d’un indescriptible vacarme et des cris perçants des négresses.
« Regardez, regardez, les voilà ! Ô les jolis monstres ! »
Petit-Ruban-Bleu échappa à la main de sa mère et se précipita vers le petit pont de pierre jeté sur le ruisseau desséché.
« Venez tous, venez vite ; regardez les étranges créatures, les merveilleux monstres ! »
Elle claquait des mains, et elle gambadait et courait dans la poussière brûlante.
Les mendiants gisaient là ; ils étalaient leurs horribles maladies. Les nègres passent sans y faire attention, mais pas un étranger ne les aperçoit sans mettre la main à la poche. Ils le savent bien. Et ils les jaugent : celui qui recule devant l’affreux spectacle donnera 25 cents, mais la dame qui se trouve mal, au moins un dollar.
« Ô maman ! regarde donc celui-là aves ses écailles ! Est-il assez beau ? »
Elle montrait un nègre dont un hideux ulcère avait rongé et déformé le corps entier. Il était verdâtre, et les croûtes durcies avaient formé sur sa peau de véritables écailles triangulaires.
« Et celui-là, capitaine, regardez donc, celui-là ! Qu’il est drôle à voir ! Il a une tête de buffle, et son bonnet à poils semble ne faire qu’un avec sa tête ! »
Petit-Ruban-Bleu frappa du bout de son ombrelle la tête d’un noir géant. Il souffrait d’un horrible éléphantiasis ; sa tête était enflée comme un énorme potiron. Sa chevelure laineuse s’était feutrée et pendait en lambeaux de tous côtés.
Le capitaine cherchait à écarter la petite du nègre, mais déjà, tremblante de joie, elle le tirait vers un autre.
« Ô cher capitaine, as-tu jamais vu des mains pareilles ? Dis-moi, est-ce qu’elles ne sont pas prodigieuses, belles à ravir ? »
Petit-Ruban-Bleu rayonnait d’enthousiasme. Elle se pencha sur le mendiant, dont l’éléphantiasis avait monstrueusement enflé les deux mains.
« Maman, maman, regarde ! Ses doigts sont beaucoup plus gros et beaucoup plus longs que mon bras tout entier ! Maman, si Je pouvais avoir d’aussi belles mains ! »
Et elle mit sa petite main dans la main grande ouverte du nègre, telle une petite souris blanche qui glissait sur l’énorme surface brune.
La jolie femme poussa un cri et perdit connaissance dans les bras de l’ingénieur. Tout le monde s’empressa autour d’elle : le docteur imbiba son mouchoir d’eau de Cologne et lui frictionna le front. Mais Petit-Ruban-Bleu fouilla dans la poche de sa mère, y prit le flacon de sels et le lui fit respirer. Elle était à genoux par terre ; de grosses larmes coulaient de ses yeux bleus et mouillaient le visage de sa mère.
« Maman, chère et douce maman, réveille-toi, je t’en prie, ma petite maman ! Réveille-toi vite ; je peux te montrer encore beaucoup de créatures merveilleuses ! Non, ce n’est pas le moment de dormir, maman ; nous sommes au pays des fées ! »
–––––
(Hanns Heinz Ewers, traduit par Féli Gautier et Marc Henry, « Notre Page littéraire, » in Le Populaire de Nantes, quarante-neuvième année, n° 14109, mercredi 30 août 1922. « The famous Thomas Joseph, » accordéoniste atteint d’éléphantiasis, Antigua, carte postale, José Anjo publ., 1921)
–––––
Dans leur genre, les histoires de Hans [sic] Heinz Ewers que la Renaissance du Livre publie sous ce titre : « Dans l’Épouvante, » et dans la traduction de Féli Gautier et Marc Henry sont, pour les lettres, ce que sont les pièces d’André de Lorde sont au théâtre. Elles sont rouges, sanglantes, violentes, macabres ; elles font passer au lecteur des instants d’angoisse ; et si, d’aventure, elles ne procurent pas, pendant le sommeil, des visions de cauchemar, elles le secouent du moins de telle sorte que les nerfs en demeurent, pour un temps, exacerbés. Leur qualité, comme leur violence même, est supérieure, et c’est en quoi résident leur puissance d’attractions, leur force, leur originalité.
Enfoncés ! du même coup, les récits d’Edgar Poe et les contes fantastiques d’Hoffmann. Hans [sic] Heinz Ewers se complaît dans la réalité horrifique, et, à cet égard, « Dans l’Épouvante » pourrait bien détenir un record.
La traduction de Féli Gautier et Marc Henry est excellente. Il n’en saurait être autrement pour qui connaît, comme moi, les ouvrages personnels de Marc Henry, qui ont révélé au public français les grandes villes d’Allemagne et les mœurs du monde théâtral et des fêtards allemands.
En province, les amateurs d’émotions fortes n’auront pas besoin de courir à Paris pour se repaître aux spectacles par lesquels le Théâtre du Grand Guignol a assis sa réputation. Il leur suffira de lire « Dans l’Épouvante » pour éprouver, à domicile, tout ce que la hantise de l’horreur, de l’effroi et du sang peut ajouter aux sensations nées de l’effroi, de la crainte et de la peur.
–––––
(J. Tallendeau, « Les Livres qu’on lit, » in Le Populaire de Nantes, quarante-neuvième année, n° 14103, mercredi 23 août 1923)
–––––
☞ Nous reproduisons ci-dessous la première traduction américaine du conte d’Ewers, publiée dans la revue de George Sylvester Viereck, The International, en juillet 1916.
–––––
HANNS HEINZ EWERS : FAIRYLAND
–––––
–––––
(Hanns Heinz Ewers, in The International, volume X, n° 7, juillet 1916)



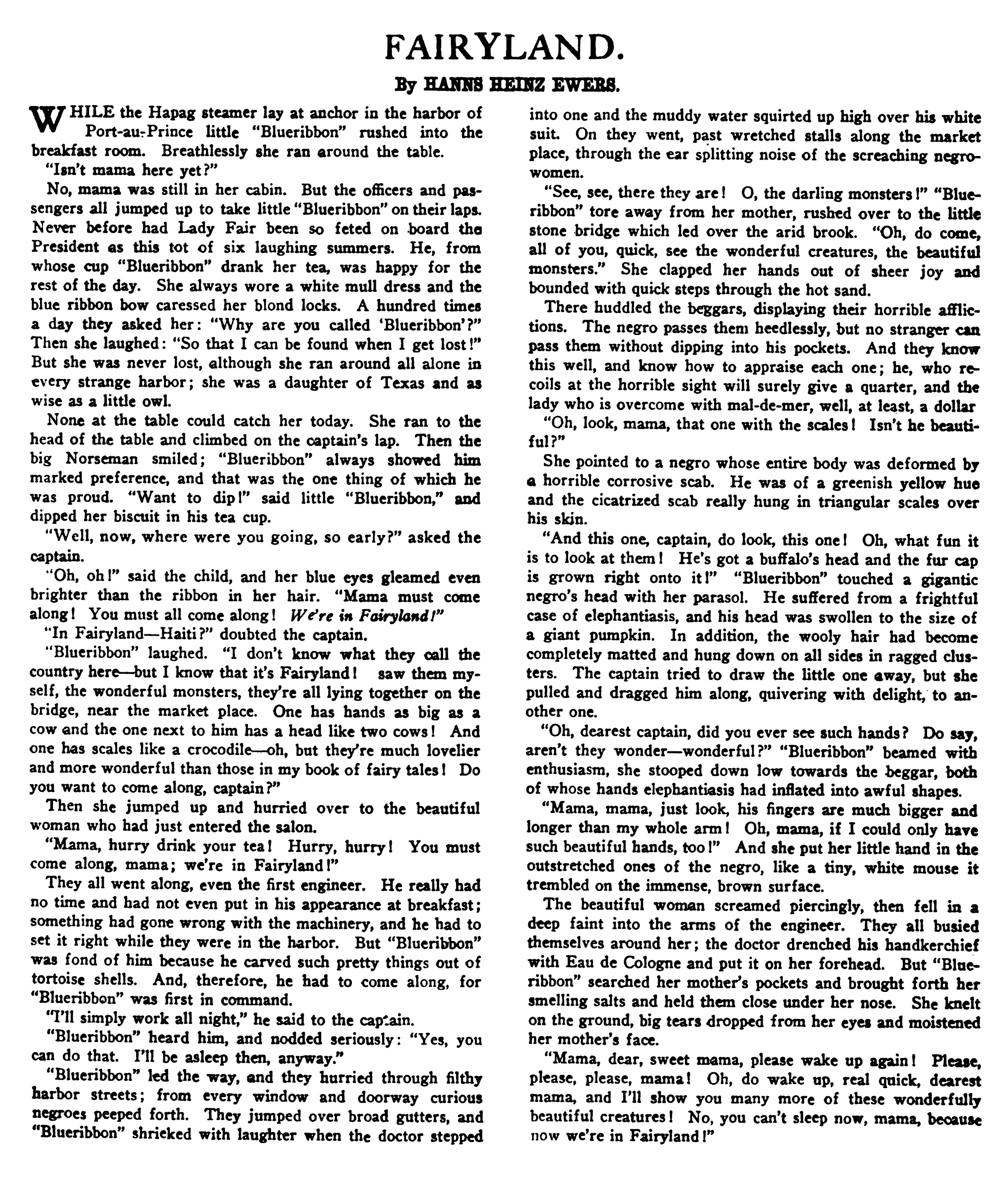

Hanns Heinz Ewers, traduit par Féli [sic] Gautier et Marc Henry
« Féli Gautier » [sans x] est bien le pseudonyme de Félix-François Gautier.