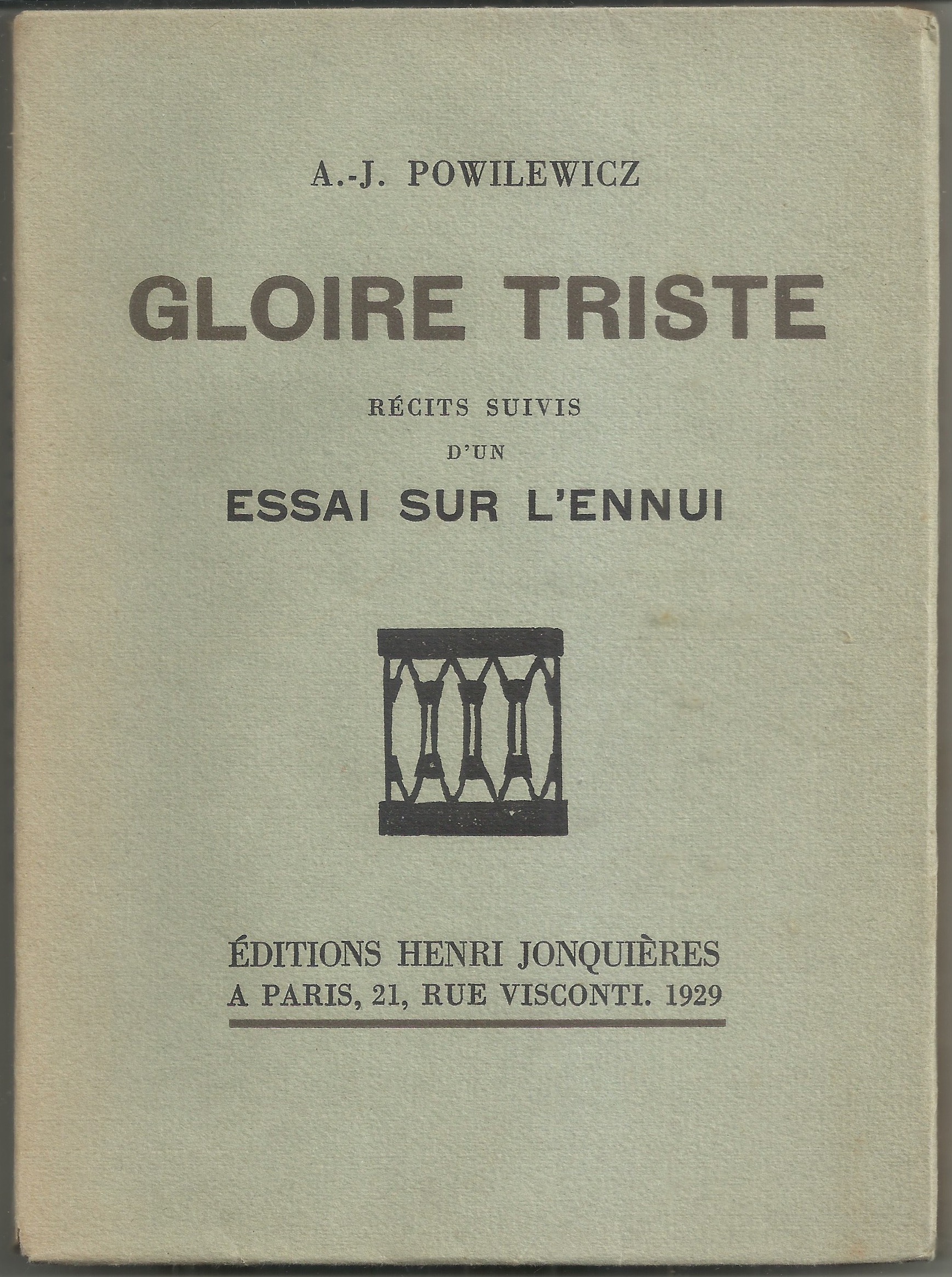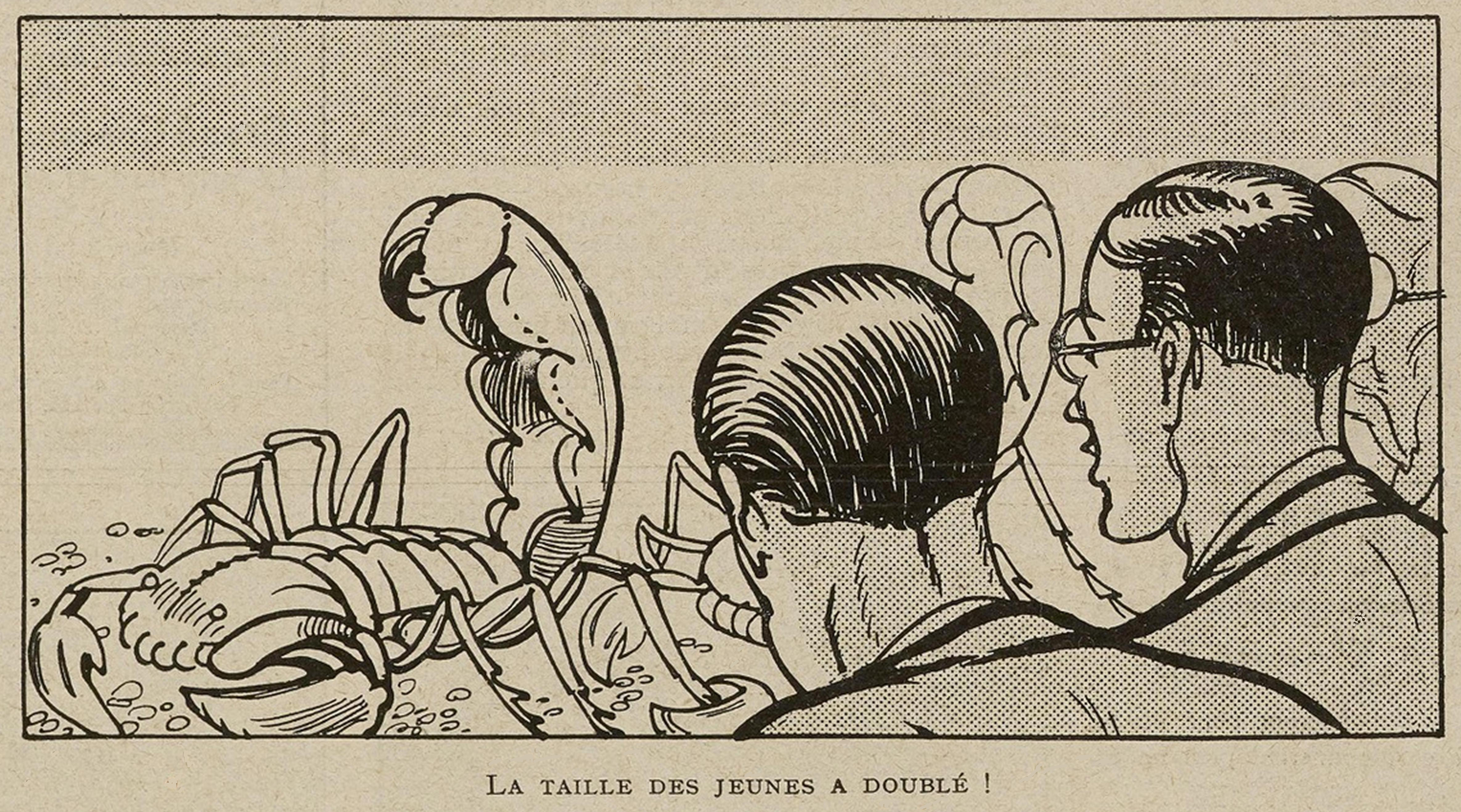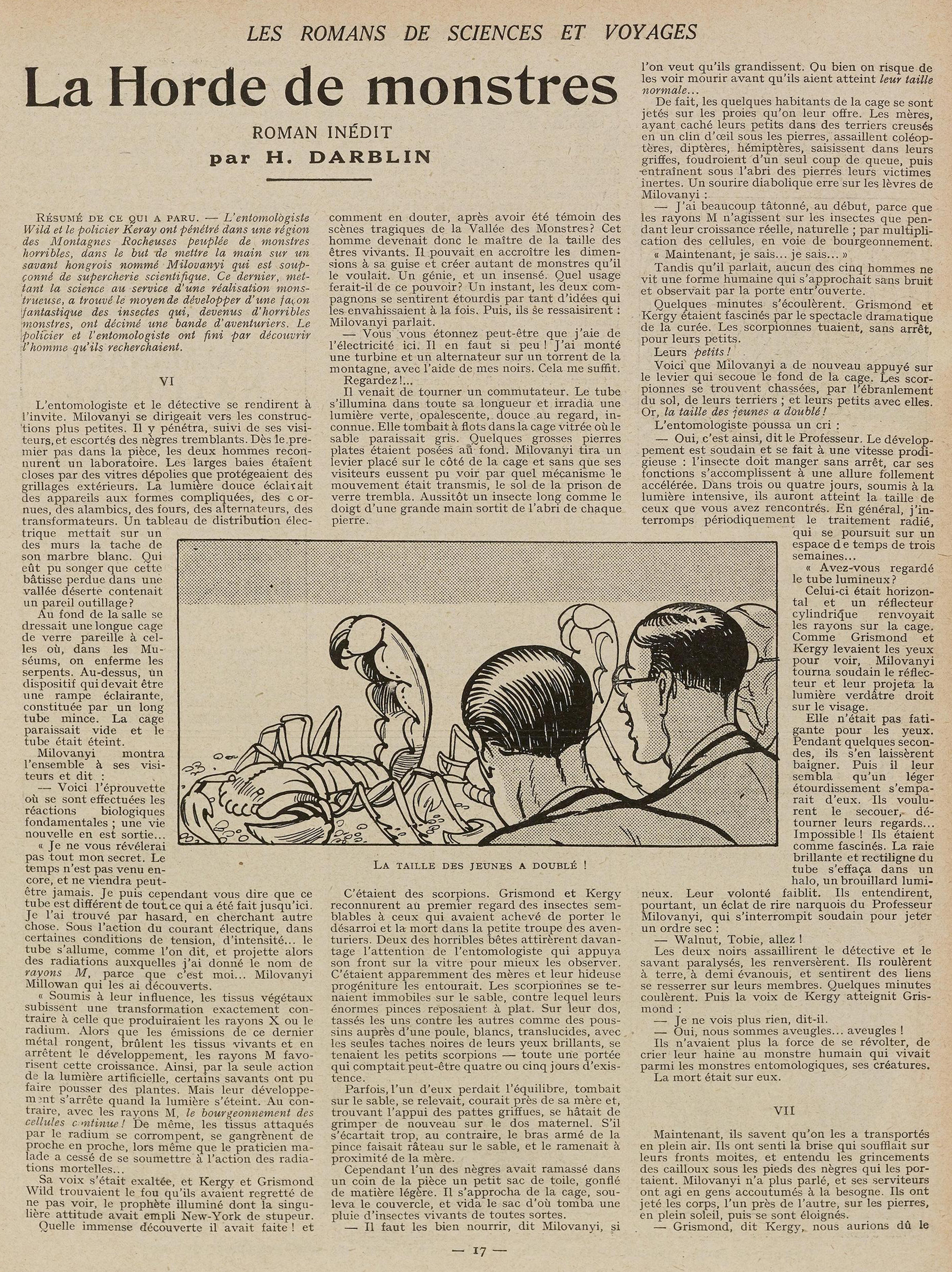À la manière de Jack London (Fragment d’un roman futur.)
–––––
En l’an mil neuf cent soixante et quelques, les bolcheviks avaient fini par conquérir la Russie entière.
Seule, la Crimée échappait encore à leur pouvoir. Sa presqu’île demeurait accrochée à l’immensité froide de la Sovdépie torturée par la faim, ainsi qu’une incommestible breloque qui se balancerait sur le ventre gigantesque d’un cannibale affamé.
Quant aux états voisins, ceux-ci avaient fait bâtir tout le long de leurs frontières un mur haut et épais. Après avoir couronné cette enceinte de fils barbelés, ils y accrochèrent, de cinquante en cinquante mètres, d’immenses écriteaux portant cette inscription :
« L’entrée est interdite aux personnes étrangères. »
Ainsi abandonnée à elle-même, la Sovdépie était condamnée, comme on dit, à mijoter dans son propre jus.
Ni importation, ni exportation, ni commerce, ni industrie !
Pas de lois humaines, plus de sciences, plus d’arts !
Quant aux lois divines, il y avait bien des années qu’elles n’existaient plus. Un décret du Sownarkom avait exilé Dieu sous prétexte que celui-ci n’était qu’un petit bourgeois.
Vers cette époque même, le dernier pope avait été pendu à la maîtresse branche du tilleul sous lequel il avait tant aimé à rester assis en buvant du thé et en mangeant de la confiture de framboise.
Le culte orthodoxe avait été un moment remplacé par celui des divinités plus récentes : Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Mais, à la longue, cette dernière religion tomba aussi en désuétude.
Une tête jamais lavée et que nul ciseau ne visite se couvre peu à peu d’une chevelure longue, touffue et hantée par d’innombrables parasites.
De même, la Russie s’était bien vite revêtue de forêts impénétrables, d’herbes hautes et drues.
Ces sylves et ces herbages se peuplèrent à leur tour d’une quantité prodigieuse de bêtes. Les loups, les ours, les bisons, les élans, les cerfs et les renards y pullulaient, transformant le pays de Pierre le Grand en une jungle sombre et sauvage.
Par moment, une horde de sangliers traversait en courant le ruban des vieux rails recouverts d’une végétation de pavots et d’herbes folles. D’autres fois, un lynx, caché parmi les ruines d’une usine, guettait pendant des heures un lièvre gris.
Les aigles faisaient leur nid dans les télescopes brisés des observatoires. Les murs de l’ancienne Université de Moscou servaient d’habitation à une horde de pillards chinois qui faisaient trembler toute la contrée.
Çà et là, quelques ruines subsistaient, vestiges de palais, de musées et d’églises. Leurs larges escaliers de marbre étaient recouverts abondamment d’une végétation d’orties. La nuit, les rayons de la lune s’y introduisaient par les orifices des fenêtres béantes, et, sous les plafonds masqués de toiles d’araignées, de silencieuses chauves-souris voltigeaient en dessinant des courbes étranges.
Les rez-de-chaussée s’emplissaient alors de petits cris de souris, de soupirs et de craquements. Ces derniers étaient-ils provoqués par le jeu des planchers desséchés ou bien était-ce là, ainsi que l’affirmaient les gens du voisinage, le bruit que faisaient les vieux squelettes, dansant au clair de lune, la corde au cou ?
La population de ce pays se divisait en trois castes, séparées d’une façon très nette : la tribu des Sownarkoms, celle des Ispolkoms et enfin la tribu des travailleurs.
La première était composée d’un seul homme : l’autocrate de Sovdépie, Micha Ier, fils de feu Léon Ier, de l’illustre famille des Trotsky.
L’histoire parlée, la seule d’ailleurs qui existât dans ce pays, prétendait que ce dernier, avant de devenir chef de l’armée du prolétariat rouge et objet d’orgueil pour l’avant-garde de la Révolution mondiale, était venu dans un wagon plombé arrivant d’un pays lointain qu’on nommait Zimmerwald.
Depuis, le principe monarchique s’était introduit d’une façon tellement peu perceptible que nul ne protesta quand la dépouille de Léon Ier fut enterrée parmi les tombes des anciens souverains de la Moscovie.
La seconde caste, celle des Ispolkoms, assumait la charge de gouverner le pays. En dépit de son nom, qui n’est qu’une abréviation des deux mots « Comité Exécutif, » chaque Ispolkom se composait d’un seul personnage qui, doté d’un pouvoir absolu dans la région qu’il gouvernait, était responsable devant le seul Sownarkom, Micha Ier.
Quant à la caste des travailleurs, celle-ci s’occupait de semer et récolter le blé, chasser l’élan et le bison. C’est encore elle qui confectionnait les vêtements en peaux de bêtes. Ces multiples besognes conféraient à ses membres le droit de vivre et leur permettaient de jouir d’un tiers du produit de leur travail. Des deux tiers, l’un allait à l’Ispolkom, tandis que le dernier était attribué au Sownarkom.
Les populations des villes habitaient des terriers et des tentes en peau d’élan. Le reste couchait dans le creux des arbres séculaires, dans des cavernes, ou simplement courait les steppes en guettant ours et sangliers.
*
C’était par une belle soirée estivale de l’année mil neuf cent soixante et quelques…
À l’orée d’une immense forêt, un joyeux feu de bois pétillait au pied d’un grand sapin, baignant d’une lumière crue les troncs des arbres voisins.
Trois êtres l’entouraient.
Desséchée, brunâtre et enveloppée d’une loque de velours qui provenait sans doute de quelque antique portière, une vieille femme s’occupait activement à ronger un os de loup. Tout près d’elle, deux adolescents étaient assis. Chacun d’eux était armé d’une hachette en silex aiguisé, montée sur un bâton en chêne. Tous deux se drapaient dans des peaux de bêtes.
La vieille, aux dents jaunes, interrompit un instant son repas et, s’adressant à un de ses petits-fils, questionna :
« Où est donc passé votre frère aîné ?
– Nous l’avons envoyé en qualité de délégué à la réunion plénière du Sownarkhos. On va y décider du sort des Essers capturés tout récemment par les hommes de notre tribu. Les débats se poursuivent, et l’opinion est divisée, paraît-il. On ne sait s’il faut les manger ou bien les échanger contre les membres de notre cellule communiste prisonniers des Essers internationalistes.
– Malheur ! s’écria la vieille, cette guerre ne finira donc jamais ? »
Elle ramassa une brindille qui traînait à ses côtés et, après l’avoir transformée en cure-dent, la plongea dans les interstices de ses chicots.
« Et si seulement votre frère s’avisait de nous rapporter un petit morceau de ce maudit Esser ! ajouta-t-elle avec un sourire de convoitise.
– Quant à cela, tu peux dès à présent abandonner tout espoir, grand’mère, ricana le jeune homme. Te rappelles-tu cet Anglais qui, il y a de cela six lunes, vint chez nous sur une machine volante ? On l’a pris et bouffé séance tenante, sans même nous octroyer le bout du petit doigt. Il en sera de même cette fois-ci, je suppose. »
Cela dit, l’adolescent se plongea dans des réflexions. Elles devaient être bien amères, car, sous leur influence, sa figure s’assombrissait de plus en plus.
Un silence plana, et le plus âgé des deux jeunes gens demanda :
« Et le père, quand revient-il de la chasse ?
– Il sera ici avant que le soleil se montre six fois au levant. L’Ispolkom lui a donné un mandat bien défini. »
La vieille s’arrêta, et son regard tomba sur les doigts de son petit-fils.
« Que tiens-tu donc dans ta main ?
– J’ai trouvé cela en posant des filets dans la forêt. On dirait bien une noix, mais les dents se cassent dessus. »
Curieuse, la vieille se pencha. Un instant, elle contempla la chose que lui tendait son petit-fils. Il était visible que cet objet lui rappelait quelque chose, car ses dents s’ouvraient dans un sourire.
Puis, s’emparant soudain de la chose mystérieuse, d’un mouvement simiesque, elle voulut enfouir le trésor dans une cachette dissimulée entre les plis de l’ancienne portière qui lui servait de vêtement.
Mais le jeune garçon ne la laissa point faire et, d’un geste unique, reprit son bien.
« Mais c’est un écrou ! murmura la grand’mère, en continuant toujours de contempler l’objet d’un air de convoitise. Donne-moi cela, petit ; je le mettrai parmi mes bijoux de famille, supplia-t-elle.
– Non. Qu’est-ce que cela veut dire, « écrou » ?
– De mon temps, on employait ces choses pour fixer les rails.
– Quels rails ?
– Les rails du chemin de fer, parbleu ! Chemin de fer, te dis-je, chemin de fer… de fer ! répétait la grand’mère d’une voix irritée.
– Quel drôle de mot : le fer !
– Comment ! tu n’as donc pas vu le clou que je garde parmi mes objets de famille ? Tu sais, une petite baguette avec un chapeau au bout. Eh bien ! c’est du fer, cela !
– Je ne comprends pas bien comment on arrivait à faire tout un chemin avec des objets pareils. On les plantait donc en terre l’un à côté de l’autre ? »
En voyant que son petit-fils dépassait de beaucoup les bornes permises de la naïveté et de l’ignorance, la vieille esquissa un sourire bienveillant.
« Eh bien ! tu en as de bonnes, mon ami ! On prenait simplement du fer et on en fabriquait des rails, c’est-à-dire de longs, de très longs bâtons qu’on posait ensuite à terre !… C’est sur ces bâtons que couraient de grandes maisons, trois fois plus grandes que la nôtre et qu’on nommait « wagons. »
Méfiant, le jeune garçon partit d’un rire narquois.
« Des maisons qui couraient sur des bâtons ! Allons donc, grand’mère ! à d’autres !
– Je t’assure.
– C’est des chevaux qui les traînaient, alors ? »
La vieille commençait à se fâcher.
« Mais si, mais si, que je te dis. Il n’y avait point de chevaux dans cette affaire. On versait simplement de l’eau dans la marmite, on allumait, et la maison partait. Elle courait si vite qu’aucun cheval n’aurait pu l’atteindre.
– Qu’est-ce qui fabriquait tout cela ? demanda l’adolescent, qui ne semblait pas convaincu.
– Des savants, des ingénieurs.
– Et c’était bon à manger, ces ingénieurs ?
– Je n’en sais rien, car je n’en ai jamais goûté. Quand j’étais jeune, un de ces ingénieurs me fit la cour.
– Qu’est-ce que cela veut dire, « faire la cour » ?
– C’est un mot que tu ne peux comprendre. Il voulait m’épouser et m’offrit un jour sa main, que je repoussai. »
À ces mots, le petit-fils ne put dissimuler son indignation.
« Pourquoi avoir refusé la main ? espèce de vieille bête ! Tu aurais pu la manger. C’est tendre, cela, une main. »
La vieille femme hocha sa tête chenue.
« Qu’il est donc difficile de causer avec vous. »
Un instant, elle regarda le feu, dont les langues joyeuses léchaient le bois sec. Elle semblait plongée dans ses rêves. Puis un souvenir hanta sans doute son cerveau obtus, car sa face anguleuse s’éclaira d’un sourire rêveur.
« Il m’écrivait des lettres ! » dit-elle.
L’étonnement du jeune homme fut à son comble.
« Qu’est-ce que cela veut dire, « écrivait » ? »
Docile, la vieille reprit ses explications.
« On prenait une baguette en bois, armée d’une petite pointe en fer. Puis, après l’avoir trempée dans de la couleur noire, on en traçait des signes sur du papier.
– En voilà un mot : « papier » !
– Tu n’as donc jamais vu du papier ? s’étonna la vieille. .le possède parmi mes bijoux un ticket de tramway que je te montrerai quand tu m’apporteras un lièvre »
Un silence se fit. Seul, le feu pétillait encore en s’éteignant doucement.
Un des adolescents, l’aîné, s’étira et, soudain, se mit à rire. Il se rappelait sans doute un événement joyeux.
« Hier, il est arrivé une drôle d’histoire, dit-il en parlant à sa grand’mère. Un étranger, envoyé par le Proletoult, a essayé d’épouser une de nos voisines : la prenant par les cheveux, il l’entraîna dans la forêt… »
La grand’mère sursauta.
« Et que dit de tout cela l’ancien fiancé de la fille ?
– Il fit réunir le Sownarkhos et obtint du conseil une résolution qui considérait comme forfaiture une action commise sans mandat de l’Ispolkom.
– Et quel fut le texte de l’ordre du jour ?
– Un texte quelconque. Bref, le fiancé assomma l’intrus à coups de hachette. Quant à la promise, il l’a attachée à un arbre et lui a pris son scalp. »
La vieille battit des mains.
« Admirable, admirable ! On dirait un roman.
– Quoi ? »
Mais elle ne répondit pas. Quelque souvenir hantait sans doute maintenant sa mémoire, car elle se taisait en souriant à son passé.
Tout était silence. Le bruit d’une branche cassée, la fuite éperdue d’un écureuil ne le troublèrent point, pas plus que ne le troubla le pleur ultime d’un cerf blessé quelque part dans les profondeurs de la forêt. Puis ce fut le sifflement coléreux du lynx qui courait après sa proie.
Quittant les couronnes des grands arbres, le silence descendit lentement le long de leurs troncs sveltes. Il se posa un instant sur les branches que venait de remuer la brise nocturne et, plongeant plus bas encore, il s’épanouit sur le soi, recouvert d’un tapis de mousses et de lichens…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
–––––
(Avertchenko, Douze couteaux dans le dos de la Révolution, traduit et adapté du russe par G. d’Ostoya, Paris : La Renaissance du Livre, [1928]. « Les Anthropophages de la Nouvelle-Calédonie : le vieux chef crevant les yeux du crâne, » gravure extraite du Journal des Voyages et des Aventure sur terre et de mer, n° 68, dimanche 27 octobre 1878)