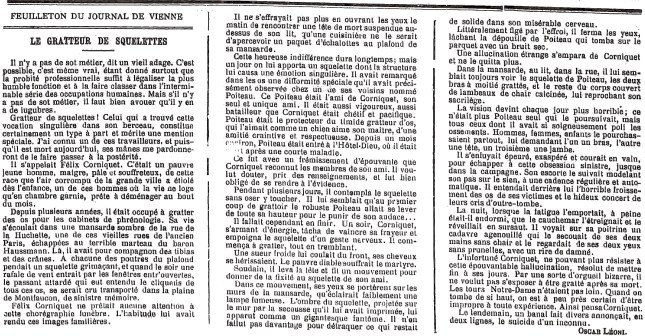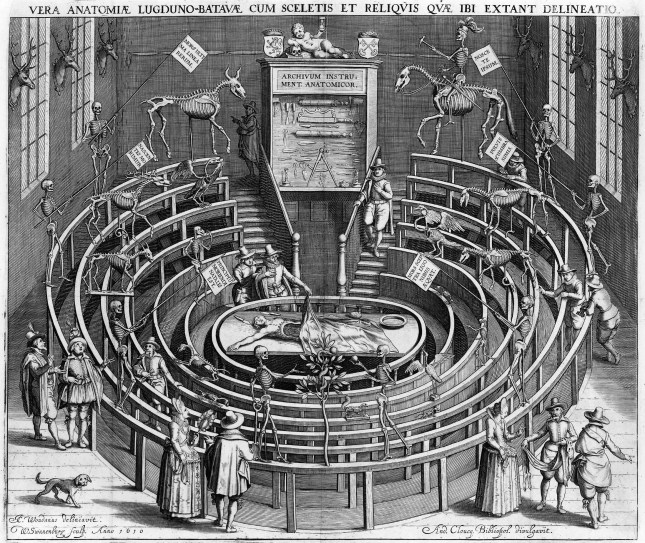ÉTRANGETÉS, RÊVES ET CAUCHEMARS LITTÉRAIRES. CHIMÈRES ET HANTISES.
Articles de la Catés:gorie “PETITS DÉLICES ANATOMIQUES”
_____
(in Journal de Vienne et de l’Isère, trente-sixième année, n° 62, samedi 5 août 1893)
NOTES D’UN SPECTATEUR
Une heure. – L’air est froid, le ciel gris. Sur la place de la Roquette, près de leurs faisceaux rangés en bataille, les municipaux battent la semelle en causant à voix basse. Sous les arbres, les officiers se promènent, se croisant avec quelques rares journalistes tôt arrivés. Déjà les rues adjacentes sont barrées. Seuls, brillent dans la nuit, sous la lueur jaune des réverbères, les casques des plantons qui renforcent les lignes noires des gardiens. Cependant, au dehors, des groupes se forment ; des rôdeurs, le col relevé et les mains dans les poches, des femmes en cheveux.
« Tiens ! C’est pour à ce matin ! Chouette !
– Tu payes une blanche ?
– Y va rien renifler, le gonse, quand y va avoir le nez au-dessus du panier.
– Eh! Polyte, t’as pas une contremarque ? »
Les débits de vins s’emplissent. Ici des messieurs emmitouflés de fourrures, en chapeau haute forme, boivent sur le zinc à côté de deux voyous, qu’ils observent du coin de l’œil ; à toutes les tables, on verse du punch et du café. Dans un coin, une femme assise et tenant sur ses genoux un enfant de quatre ans, se fait servir un vin chaud.
Deux heures. – « Il est deux heures ! Il faut fermer ! crie un brigadier dans l’entre-bâillement des portes.
– Oh ! monsieur ! laissez-nous… pour aujourd’hui…
– Y a pas de permission, fermez ! C’est l’ordre ! Vous rouvrirez à cinq heures ! Allons ! Dépêchons. »
Lentement et à regret, les mastroquets mettent leurs volets et font sortir la pratique. Les rues redeviennent sombres ; seuls, les becs de gaz jettent des lueurs indécises et blafardes.
« Brr ! Il fait rien frillot ! Moi, je me débine. Viens-tu, Polyte ? on verra rien.
– Me tirer ? Tu rigoles ! Jamais de la vie.
– Tu vas te geler.
– Qu’ça fait ! ça passe le temps. »
Des voitures s’arrêtent plus nombreuses ; des reporters en descendent, qui exhibent leurs cartes et passent ; puis des mentons rasés, comédiens ou chanteurs, qui ont appris la nouvelle au sortir du théâtre. Ils parlementent avec l’officier de service, puis finalement entrent, saluant à grands coups de chapeau. Sur la place, on cause toujours tout bas, on se promène, on bat la semelle contre les arbres.
Trois heures. – La Petite Roquette, plongée jusque-là dans l’obscurité, s’anime ; des fenêtres s’allument. On voit des ombres passer et repasser.
« C’est ici qu’on commence, dit un philosophe en montrant la Maison des jeunes détenus, et c’est là qu’on finit ! »
Un roulement sourd. Deux fourgons noirs descendent la rue de la Roquette, au trot. C’est M. de Paris et ses aides. Les voitures se rangent dans l’allée transversale. Un mouvement de curiosité suspend la marche des promeneurs qui se massent autour des fourgons. M. de Paris descend le premier. Son parapluie à la main, le chapeau haute forme enfoncé jusqu’aux oreilles, le corps courbé en deux. Il fait quelques pas. Il jette un regard inquiet autour de lui. Tout flageolant sur ses jambes de rhumatisant, il s’avance vers un officier de paix à qui il parle à l’oreille. M. de Paris est gêné ; il n’aime pas qu’on le regarde travailler ; il faut faire reculer les journalistes.
« Allons ! Messieurs, reculez, je vous en prie ! Vous gênez M. l’Exécuteur. »
Cependant les aides ont dépouillé les hermétiques redingotes qui les serrent jusqu’au col. Ils alignent par terre les différentes pièces qui composent la machine et, sur le bord du trottoir, l’Exécuteur fait disposer ses boîtes d’accessoires, des éponges et des seaux d’eau. C’est une ligne qu’il ne faut pas franchir, et il demande un planton.
« Si on dépasse, geint-il de sa voix pleurarde, je me plaindrai au ministère. »
Quatre heures. – Les montants rouges de la butte sont debout ; pas un coup de marteau ; chaque morceau trouve sa place. La sinistre besogne s’achève à la lueur des lanternes, qui font briller les cuivres incrustés dans le bois. Aux fenêtres des maisons de la rue Merlin, des curieux se pressent, intéressés de loin par ces feux follets précurseurs, qui paraissent danser dans l’ombre. Un murmure lointain se fait entendre. De temps en temps, des cris, parmi lesquels on distingue le le nom du condamné. C’est la foule, maintenue par le barrage, qui augmente à chaque minute. Sur le terrain, on cesse de se promener. On s’entasse le plus près possible, pour garder sa place et bien voir… tout à l’heure… quand la porte s’ouvrira…
Cinq heures. – Le chapiteau et sa poulie sont posés sur les montants. Les magistrats arrivent, se promènent gravement dans l’enceinte réservée.
On apporte le couteau. On l’engage dans la rainure. On hisse à l’aide d’une prolonge le rasoir énorme. Deux fois le déclic joue, deux fois cette masse de soixante-dix kilos descend et remonte avec un bruit sourd. C’est fait, l’instrument est est accordé. M. de Paris jette un dernier coup d’œil à ses accessoires et va se dissimuler dans l’ombre d’un fourgon.
Six heures. – La guillotine se dresse, immobile et fatale. Il fait froid, on ne cause plus guère. On échange tout bas ses impressions. On commence à s’intéresser au condamné que guette la machine inexorable. Dort-il ? Ne dort-il pas ? A-t-il entendu quelque bruit ?
« À quelle heure l’exécution ?
– À sept heures et demie, au lever du soleil ! »
Un petit frisson vous secoue les os et on compte les minutes. Des pas de chevaux. Un cliquetis de sabres. Par-dessus les têtes qui s’entassent, des bicornes passent ; ce sont des gendarmes d’Ivry, la dernière escorte… Ils se rangent derrière la guillotine.
« À votre place ! Pas de faveur ! Ne poussez pas ! On ne voit rien ! »
Énervés par l’attente, les esprits s’aigrissent. Chacun veut s’approcher plus près… On se bouscule.
« Messieurs, ces cris sont indécents… On entend de la prison ! »
Et le bruit cesse… On ne parle plus que bas, comme au seuil de la chambre d’un mourant.
Sept heures. – Les magistrats pénètrent dans la prison. Ils sont six et avec eux l’aumônier, qui suit, tête basse, rassemblant toutes ses forces pour affronter son terrible devoir. Dans la grande cour, ils s’arrêtent. L’aiguille de la grande horloge marque sept heures dix minutes, ils attendront qu’elle marque sept heures dix-huit… Le réveil, la toilette dure douze minutes et l’ordre du Procureur général porte que l’exécution aura lieu à sept heures trente. Elles sont longues, ces minutes d’attente !
M. de Paris paraît. Il passe devant le groupe des magistrats, marchant de son pas traînard, salue très bas avec un air malheureux. Suivi par ses aides, il entre au greffe et cet homme investi de la plus haute fonction de France va mettre son nom sur le registre d’écrou dans la colonne : Sortie, sous cette mutation :
– Remis entre les mains de M. l’exécuteur des Arrêts criminels en exécution des instructions de M. le Procureur général.
Sept heures dix-huit minutes… II fait encore sombre, mais le ciel blanchit à l’Orient.
« Si vous voulez, messieurs ? » dit le Directeur.
Les six fonctionnaires se mettent en marche, précédés d’un gardien de prison. Des portes cadenassées et verrouillées grincent sur leurs gonds… Un couloir… Une petite salle nue, où un aide de M. de Paris vient apporter une chaise, simplement… C’est la salle de toilette… puis des ateliers sombres, très longs, des séchoirs… Les dalles résonnent sous les pas…
« Messieurs, de grâce, pas de bruit ! »
Un cloître, donnant sur un préau, entouré de grands murs, puis un enfoncement avec trois portes de fer… Le gardien tourne sans bruit la clef dans une serrure. Tous entrent. Une bouffée d’air chaud monte au visage. Deux gardiens se lèvent. Dans un coin de la chambre, un lit de camp dans lequel dort un homme.
Les six fonctionnaires sont rangés autour de ce lit, nu-tête… Un silence règne… une hésitation… une angoisse muette…
Enfin, le Directeur touche l’épaule du dormeur, qui se dresse sur son séant et promène autour de lui des yeux hagards…
« Votre pourvoi est rejeté et M. le Président de la République n’a pas accueilli votre recours en grâce… Rassemblez tout votre courage… »
Un instant, l’homme a hésité, l’œil vague et hébété… L’aumônier s’approche :
« Mon enfant… »
Et pendant que le condamné s’habille, il lui parle et l’embrasse…
Il est long, ce trajet de la cellule à la salle de toilette. L’homme le parcourt, soutenu par deux gardiens…
M. de Paris s’approche, il pose sa main sur l’épaule du condamné, qu’il fait asseoir. Il a pris livraison. Désormais, nulle puissance humaine ne peut lui arracher cette proie, dont il a donné reçu.
Le col de chemise est coupé… Les pieds sont attachés… les mains sont liées derrière le dos… on noue une blouse autour du cou du condamné et on repart… Le malheureux est livide… il avance à petits pas de quinze centimètres. M. de Paris ouvre la marche. La porte s’ouvre ; une lumière vous aveugle. C’est le grand jour ! Dans l’encadrement de porte, un spectacle d’une beauté grandiose et horrible :
Au fond, une rangée de casques qui étincellent, les lattes des gendarmes qui scintillent, un fourmillement de têtes pâles à droite et à gauche, un épouvantable silence, et, se découpant nettement sur la façade grise de la Petite Roquette deux grands bras rouges supportant un couperet, qui va tomber inexorablement, mécaniquement…
On se découvre… Dans les arbres des oiseaux chantent, au loin le murmure houleux d’une foule qui s’impatiente. Comme un appel désespéré, le sifflet d’une locomotive déchire l’air, un cheval piaffe, l’horloge sonne la demie, le corps bascule, le déclic joue avec un bruit sec, la tête tombe…
C’est tout ça, une guillotinade !…
Un soupir de soulagement sort de cinq cents poitrines haletantes tout à l’heure… Tous ces gens sont verts.
Des cris s’entrecroisent.
« Avez-vous vu comme il était pâle !
– Il s’est rejeté en arrière quand il a vu le couteau.
– Il est mort piteusement.
– Pas du tout, il a été très brave ! »
Un cliquetis de fouet et des cris : « Gare ! » C’est le fourgon qui s’éloigne au grand trot avec son escorte de gendarmes, et suivi par le fiacre de l’aumônier.
Un tumulte. C’est un cabot de café-concert, qui s’est précipité… Bien que le sang ait été rapidement épongé, il a eu le temps d’en imbiber son mouchoir. On le hue.
Au premier barrage, parmi cette foule qui n’a rien vu, mais qui a passé la nuit là, attirée par cette sympathie inexplicable de l’homme vers un autre homme, qui va mourir et qui, seul dans l’humanité, sait à quel moment précis et de quelle mort il va mourir, – une fille, aux traits fatigués, est reconnue. C’est la maîtresse d’un assassin, qui a fini ses jours ici deux ans avant !… Elle ne manque pas une exécution… Elle suit d’un regard indéfinissable le fourgon qui s’éloigne, puis elle monte dans sa voiture et part, poursuivie par les invectives.
« Va donc, eh ! môme la crotte ! »
Puis tout ce monde s’écoule, très calme, pendant que le Greffier de la Cour d’appel se rend à la Mairie du XIe arrondissement pour faire rédiger l’acte de décès du condamné, « décédé ce matin place de la Roquette, à sept heures et demie. »
_____
(Oscar Méténier, La Chair, Paris : C. Marpon et E. Flammarion, 1885)
UNE TABLE FANTASTIQUE ET DANGEREUSE. – Il est question de produire dans l’Exposition de l’Institut de Franklin, à Philadelphie, une table vraiment fantastique et d’un réalisme effrayant. Cette table se trouve dans le palais Pitti à Florence. Le palais contient les merveilles de la peinture italienne, et il paraît étrange de trouver cette table au milieu des chefs-d’œuvre de l’art. Elle fut fabriquée par Giuseppe Sagatti, qui employa plusieurs années à l’achever. Pour celui qui l’aperçoit, elle paraît un curieux travail de marbres de diverses nuances, car elle ressemble à une pierre polie, et pourtant elle n’est composée que de morceaux de muscles, cœurs et intestins de corps humains. Il a fallu pour la fabriquer une centaine de cadavres.
Cette table est ronde, d’une largeur d’un mètre de diamètre, avec un piédestal et quatre griffes, et le tout est de chair humaine pétrifiée.
Son auteur est mort depuis cinquante ans.
Après avoir passé par les mains de trois propriétaires, dont le dernier s’est suicidé et l’a arrosée de son sang, elle est arrivée au palais Pitti.
Sagatti était parvenu à solidifier les corps en les plongeant dans plusieurs bains minéraux. Il obtenait les cadavres de l’hôpital.
Les intestins servaient pour les ornements du piédestal. Les griffes sont faites avec les cœurs, les foies et les poumons et conservent la couleur de la chair. La table est faite de muscles artistiquement arrangés. Autour, il y a une centaine d’yeux et d’oreilles qui produisent le plus étrange effet. Les yeux, dit-on, semblent vivants et ils vous regardent à quelque point que vous vous placiez. Ce fut le travail le plus difficile de l’artiste. Il fut content de son œuvre et communiqua aux savants sa méthode.
Le dernier propriétaire de cette table, Giacomo Rittaboca, l’avait placée au centre de son salon, et se faisait un plaisir de la montrer aux visiteurs, en disant que c’était l’œuvre d’un sculpteur original ; puis, le soir, il en expliquait la véritable origine.
Une nuit de Noël, il avait réuni quelques amis, et l’on jouait aux cartes sur cette table. Rittaboca perdait, et les yeux de la table le fascinaient ; il était pâle, agité ; enfin, il se leva et marcha à pas pressés, puis vint se rasseoir et perdit encore, distrait par la fixité de ces regards qui le poursuivaient. On voulut le faire changer de place ; on couvrit ces yeux importuns. « C’est inutile, » dit-il, et il raconta à ses amis toute l’histoire de cette table composée de parties humaines. « Ce n’est pas du marbre, dit-il, c’est de la chair, de vrais yeux, de vrais muscles, de véritables cœurs. Voyez ! ils sont encore vivants. Ces yeux vous parlent, je ne puis les supporter ; ils me rendront fou. » Alors, subitement, il prend un poignard, et avant qu’on eût le temps de retenir son bras, il s’était frappé au cœur en disant à ses amis : « J’en suis débarrassé. » Son sang coula sur la table et son cadavre roula par terre. Ses héritiers furent heureux de vendre le meuble au gouvernement ; et si le conservateur du palais Pitti veut le prêter à l’exposition, les Américains amoureux de fortes émotions pourront être satisfaits.
_____
(in L’Univers, 22 février 1885)
UN CRIMINEL DE PIERRE
____
Cette anecdote a inspiré une remarquable nouvelle fantastique de Frederic Martin Burr, « Les étranges expériences d’Algrenzo Deane, » parue initialement en mai 1890 dans The Boston Commonwealth ; elle fut republiée à compte d’auteur, dix-huit ans plus tard, sous ce titre : Un criminel de pierre, étude psychologique (Englewood, New Jersey : Hillside Press). Cette plaquette, dont j’ai eu la chance de recontrer un exemplaire il y a une dizaine d’années, a été tirée seulement à 60 exemplaires sur papier de la Kelmscott Press.
Dans son avant-propos, l’auteur reconnaît son emprunt à un article de la presse new-yorkaise qui décrivait une table constituée de restes humains pétrifiés, conservée dans un musée de Florence. Il affirme avoir vainement effectué plusieurs séjours en Italie pour la localiser et, faute de pouvoir en confirmer l’existence, il conclut qu’elle doit être reléguée au rang de légende, au même titre que le conte qu’elle a inspirée.
MONSIEUR N
LA GORILLE
_____
Chacun de nous avait conté son aventure plus ou moins sensationnelle et conservait secrètement, peut-être, le trésor de ses premiers rêves, de ses impressions les plus fortes.
Seul, Mahalan, le jeune et vaillant explorateur, gardait le silence en se confectionnant, d’un air songeur, une mixture d’eaux-de-vie.
« Laissons-le boire, prononça le commandant Corsillon. Ensuite, qu’il parle, bon Dieu, ou gare à lui ! »
Mahalan dégusta voluptueusement sa boisson complexe, vigoureuse. Puis, un éclair scintilla en ses yeux sombres. Il se renversa dans son rocking, secoua son cigare.
Nous attendions un de ses récits mystérieux ou tragiques, aux horizons profonds.
« Eh bien, fit-il, de sa voix un peu brusque aux inflexions parfois caressantes, nous sommes tout à fait entre intimes… Il y a plus d’un quart de siècle que je te connais et que je t’aime pour ta franchise, mon vieux Corsillon… et vous autres, vous êtes aussi des frères… »
Mahalan n’avait pas l’habitude d’être si tendre, si cordialement ému, ou, du moins, de paraître tel.
Son regard devint fixe. Une sorte de long frisson nerveux le secoua.
Quelle évocation singulière hantait sa rêverie ?
Nous multipliâmes les appels, les instances. Il reprit enfin :
« Soit. Tenez, je n’osais pas ! Même entre nous. C’est unique, c’est fou, et cependant c’est vrai. Et je vis encore, avec intensité, l’horrible et délicieuse aventure. »
*
… Je voguais vers le Caprador et la Théatie où je comptais, malgré les dangers d’un climat et d’une population farouches, acquérir une ample provision d’or et d’ivoire.
Nous étions en vue du promontoire des Hénaffes. La côte semblait peu hospitalière. On jeta l’ancre pour la pêche et l’étude des espèces sous-marines, car le savant Deslandres faisait partie de notre expédition.
La matinée était claire et paisible. Une petite brise tiède. La mer immense, assoupie, semblait méditer dans son recueillement des colères futures.
L’équipage se vouait à la torpeur et à l’ennui.
Pour moi qui ai l’horreur des choses toujours les mêmes, je souffrais de ne pas agir, de ne rien risquer, de ne pouvoir dépenser quelques-unes de mes énergies.
Avec nonchalance, je promenai ma lorgnette sur les flots lumineux et mélodieux. Je l’arrêtai d’abord sur des requins enquête de pâture.
Le vol hardi et comme orgueilleux d’un albatros retint mon attention.
Au large, une île escarpée, – une île aux tons d’ocre, – dominée par un bois touffu, m’hypnotisa. J’ignore pourquoi.
Oui, sa forme, son rivage, sa couleur, exerçaient sur mon esprit une brutale fascination.
Je voulus combattre cette impression baroque. Bah ! Inutile. Une morbide curiosité excitait mes nerfs.
Comme toujours, je pris brusquement un parti.
Je l’annonçai à Deslandes, qui me montra les requins et s’efforça de me dissuader d’un projet qu’il qualifiait d’insensé. Il prévint même le capitaine, lequel mit la chaloupe à ma disposition.
Mais j’avais attaché à ma ceinture un large couteau de chasse et je m’étais précipité avec une sorte d’ivresse dans l’Océan.
*
Je mis près de cinq heures à fendre des lames astucieuses, à vaincre un courant furieux, à déjouer la tentative d’un requin obstiné.
Une vague géante me jeta pantelant sur la côte, au milieu de coquillages roses, non loin des rochers aux teintes de brique, parmi des pierres ponces, des laves mortes jaillies de quelque cratère effacé.
Le soleil semblait jouer doucement sur les arbustes gris et blancs.
Je demeurai comme une épave quelque temps. Ensuite, ayant repris des forces, j’escaladai non sans peine une falaise.
Après cette épreuve, je m’éprouvai un courage et une curioité indomptables.
Des prairies et des bois sollicitaient ma visite. Quoique l’île ne fût pas bien vaste, j’avais la vanité du conquérant.
À travers les pousses et les lianes enchevêtrées, je m’avançai en songeant à un abri, car le soir s’approchait. Vous savez quel est mon sentiment de la nature, et surtout de la nature naturelle. Aussi j’admirais tour à tour de gaies clairières et de sombres frondaisons.
À parler franc, je ressentis alors un autre sentiment assez confus. De la peur ? Point du tout. De l’inquiétude ? Pas précisément. J’avais l’instinct qu’il m’arrivenait quelque chose de nouveau, peut-être d’extraordinaire.
Soudain, j’entendis un cri, ou plutôt un ricanement. Bon ! L’Ile serait-elle habitée par hasard ? Une hyène, sans doute.
J’aperçus un arbre, c’est-à-dire deux arbres mariés, aux troncs puissants, encombrés de branches. Et je résolus d’y grimper, d’y faire mon nid.
Mais, soudain, à une centaine de mètres, adossée à un roc, je distinguai une sorte de hutte au toit pointu. Cela me stupéfia sans m’épouvanter.
Je me mis à l’étudier du regard, à la contempler…
Or, une énorme main velue, oui, une main âpre et sauvage m’appréhenda. Je voulus faire un bond en arrière. Impossible. Mon couteau roula par terre. Un rire violent, sardonique, tinta.
Aussitôt, mes bras furent paralysés par une étreinte formidable, toute puissante. Des yeux me scrutaient. Une face noble, broussailleuse, ravagée, chevelue se pencha sur moi.
Et je fus tout à coup emporté, enlevé, dans une course vertigineuse, à travers les branches qui me griffaient, me lacéraient.
Je ne pouvais lutter, essayer de comprendre. J’étais une chose. J’avoue que je fermais les yeux devant les siens. Une haleine fauve, une haleine énorme me pénétra, m’emporta.
*
… Je m’étais assoupi.
Par une espèce de porte ou de fenêtre, je vis le ciel étoilé.
Donc, j’avais rêvé. Je fus vite debout, frais et dispos.
Où étais-je ? Dans une cabane. Des feuilles sèches en monceaux la matelassaient. Des poutres grossières soutenaient la toiture.
… Mais qu’est-ce que j’avais rêvé, au fait ? Ah oui… Hé Hé ! Quelle plaisanterie !. Non. De la pénombre sortit une ombre. Et ce furent la face, les yeux, la main. Tout cela était d’une humanité rudimentaire, mais réelle.
La clarté lunaire me permit d’examiner cette créature, de rechercher quel était son degré d’animalité par rapport au nôtre.
Elle parlait par cris rauques, par gloussements, échappés des mâchoires gigantesques. Je m’habituais à ses exhalations, aux dents éblouissantes, aux mouvements simples de cet être des bois.
Or, elle s’approcha de moi. Je m’apprêtais au duel. Elle m’enlaça frénétiquement. Mes nippes furent déchirées par ses griffes, par ses ongles, quoi.
Je me sentis nu, en proie à la chaleur, à la force, à la toison de ce… cet-ce que je sais moi… de ce… de cette gorille.
Figurez-vous qu’elle m’enveloppait, qu’elle me prenait avec des transports, des hurlements, qu’elle s’accrochait à ma peau, la femelle, – la femme, – et qu’elle me violait.
Et c’était une volupté à la fois hideuse, merveilleuse et forcenée.
Je sortais du siècle, de la civilisation ; j’appartenais à une race première, véhémente et redoutable, comme la Nature elle-même.
J’étais charrié, moi, un homme, moi qui ai lu Descartes, Gœthe, Shakespeare, saisi la pensée de Newton et de Darwin, parbleu ! par le rut des bêtes de la forêt.
Arc-boutée à moi, la Gorille poussait des soupirs, des râles et puis une vague mélancolie succéda soudain à la crise de lubricité.
Ses yeux, où des étincelles avaient fulguré, s’éteignaient maintenant. Tous deux, nous étions associés, de nouveau, au silence des choses dans la nuit. Et j’avais d’atroces courbatures.
La Femelle restait immobile. Je ne songeai même pas à fuir.
Bientôt elle s’anima. Elle me cherchait encore. Avec de farouches, d’effrayantes caresses, elle réunissait nos sexes pour de nouveaux spasmes, pour d’autres pâmoisons féroces et saccadées.
Un auteur peut-être licencieux de notre joli dix-huitième siècle soupirait à son amante : « Multiplions nos plaisirs par nos attitudes. »
Or, la Gorille pratiquait avec la plus bestiale violence ce conseil galant.
Elle me tournait, me retournait, s’enfouissait, s’ensevelissait avec des exclamations d’ivresse et de triomphe, en ma faiblesse, ou bien, me communiquant une ardeur, une fureur de brute, une électricité neuve, m’obligeait à la posséder, – cette femme ! – à la pétrir, à mon tour, tandis qu’elle me couvrait de sucs et de baves.
Enfin, je sombrai dans un vertige. Il me sembla que je dégringolais dans le néant.
Deslandres, accompagné de quelques matelote me trouva, le lendemain, paraît-il, sur la plage, nu, sanglant, les yeux hagards, en proie au délire.
L’île fut visitée de fond en comble. On n’y découvrit rien d’anormal…
Mahalan se tut. Mais il vivait réellement encore avec des souvenirs hallucinants.
Corsillon lui frappa sur l’épaule.
« Et tu n’as jamais eu l’idée de retourner là-bas, dis donc ?
– Moi ? Oh si… Si… Écoutez… Je ne repris connaissance qu’en arrivant au Caprador… Précisément, j’avais la hantise de l’île, du bois, de la hutte, de la Gorille ! Quand nous repassâmes, un mois plus tard, l’île n’était plus qu’une roche. Une éruption, je suppose… Quelque volcan sous-marin.
– De sorte que ta gorille a dû succomber dans la catastrophe, » déclara en souriant Corsillon.
Mahalan, toujours sombre et tout frémissant, ne répondit pas.
« Voyons, reprit le commandant, rappelle-toi, tu avais dû prendre de l’opium, du haschich ? »
L’explorateur hocha la tête et haussa les épaules. Puis il affirma, non sans mélancolie :
« Mes amis,vous me croirez si vous voulez. C’est peut-être la seule… la seule « maîtresse » qui m’ait réellement aimé à sa façon… et il m’arrive quelquefois d’avoir le regret, la nostalgie de sa force et de ses désirs sauvages… perdus à jamais, morts pour moi et pour tous dans le temps et l’espace… »
LA RACE NOUVELLE
_____
C’était par une tiède soirée de l’an 2006.
Des aviateurs rapides se croisaient dans l’air. Les énormes globes électriques commençaient d’éclairer la cité qui s’apaisait sous les douces lueurs du crépuscule.
L’astronome Simon Le Cartier, après avoir absorbé une pilule contenant la synthèse des éléments nutritifs nécessaires à son organisme, prit sa place devant le mégistocope numéro 1 et se mit à lire le ciel avec autant de patience que d’ivresse.
Il interrogeait ses constellations familières, passait de Sirius à Orion, lorsqu’une sorte de bolide immense lui apparut, alternativement sombre et lumineux.
Une masse pointue. Elle n’avait rien d’un dirigeable. Aucun aéroplane n’eût, d’ailleurs, pu s’aventurer à une telle distance dans l’espace.
Bien qu’habitué aux rêveries lunaires, la savant Le Cartier se frotta les yeux.
Décidément, le phénomène lui sembla étrange.
Il quitta l’instrument et souffla dans un tuyau acoustique. Quelques instants après, l’ingénieur Goury qui demeurait au-dessous, au quatorzième étage, pénétra dans la vaste observatoire.
Ensemble, ils examinèrent, froidement, scientifiquement, cette chose obscure, puis étincelante, qui paraissait venir de la région astrale.
Ils essayaient de la définir. En vain. Pourtant, d’après les apparences essentielles, en constatant que le mobile subissait des variations, ils diagnostiquèrent une pensée, une volonté dirigeant un mouvement.
Dès lors, il ne s’agissait plus d’une perturbation sidérale. Les deux hommes furent secoués par un frisson.
Comme ils échangeaient des opinions à voix haute, Mlle Sidonie Le Cartier, délaissant les accords mélodieux et pathétiques de son organola, vint les rejoindre et unir sa surprise à la leur.
« C’est une véritable machine à la face triangulaire, prononça enfin l’astronome. Des feux s’en échappent, rouges ou violets. »
Et cette machine fut visible, très visible. On eût dit une sorte de pyramide gigantesque et volante.
Le ciel devenait sombre ; la nuit répandait maintenant des flots d’encre sur l’éther. Les étoiles, gros diamants des ténèbres, n’étaient plus que des vers luisants timides.
Le savant projeta des fusées étincelantes vers le mystérieux mobile.
Sidome poussa une exclamation de surprise :
« On croirait que ça va s’écrouler sur nous. »
Blonde et frêle, la jeune fille avait pâli. Elle tremblait. Son père et M. Goury essayèrent de plaisanter.
Une rumeur s’était élevée de la ville énorme qui s’endormait.
Le savant se remit à son appareil, et, grâce à des projecteurs puissants, parvint à suivre la chute raisonnée et de plus en plus lente du mobile.
Il s’interrogeait :
« D’où vient-il ?… De quelle étoile ?… Il s’arrête. On cherche à se diriger… ON !!!… Avec quelle précision, quelle sûreté… il descend…
– Vers nous ! » hurla l’ingénieur. Et, brutalement, il éteignit les six globes et les lampes colossales voisines du mégistocope.
Le géant pyramidal de l’espace décrivit plusieurs courbes et, lentement, majestueusement, flotta sur le hall vitré de Le Cartier, à 400 mètres environ, à la hauteur de la Tour élevée par l’illustre Fravison au centre de l’exposition universelle, en 2000.
Ensuite, il reprit, avec une prudence extrême, sa marche descendante. Il s’acheminait en zig-zag, poursuivant, dans la complicité de l’étendue nocturne, son dessein.
Avidement, avec une curiosité qui dominait son angoisse vague et terrible, Sidonie ne pouvait détourner son regard de la grande chose noire qui venait, qui s’approchait, très réellement, dans la pénombre.
L’ingénieur vociféra :
« Attendez. Je saurai, moi…
– Que voulez-vous faire ? Ne tentez pas Dieu, » supplia Sidonie.
Goury était son ami d’enfance. Elle savait que son père songeait à la marier avec ce jeune homme hardi et vaillant.
« J’irai, dit-il, Dieu est autant sur la terre que dans les autres planètes. Je prendrai mon aéronef blindé. »
Il s’échappa. Le Cartier était haletant.
Le mobile sinistre accentuait la descente avec une sorte de solennité. Un rayon de lune avait percé les bataillons épars des nuages et jetait sa paisible clarté sur le delta fantastique.
Soudain, l’aéronef de Goury s’éleva, fragile et pointu, et monta…
Un jet de vapeur phosphorescente émergea du mobile, enveloppa le pauvre esquif aérien et le précipita dans les ténèbres.
Ensuite, il y eut devant l’observatoire un grincement formidable. De la nuit, un rayon et une pluie d’étincelles jaillirent du delta noir.
Le Cartier s’était rué vers les contrevents de fer. Mais un être immense, agile, velu, sembla sortir de l’air. Il sauta sur lui et le terrassa.
Doué de volonté et d’Intelligence, il saisit l’astronome, ouvrit une porte, le jeta sur un plancher comme une chose en une seconde.
Sidonie avait tourné les boutons électriques. Elle voulut fuir à tâtons. Une lueur bleue emplit la vaste pièce.
La malheureuse se vit perdue. Car il était là, près d’elle, géant au regard lumineux, à la crinière fantastique.
Sidonie demeura d’abord comme paralysée, puis se jeta sur un revolver bijou qui traînait près de l’armoire des lentilles, visa et fit feu. L’arme tomba de ses mains.
LUI eut comme, un gloussement.
Les balles avaient glissé sur ses touffes de poil fauve et scintillant.
Elle aurait désiré s’anéantir. Une curiosité suprême lui laissa la conscience.
L’être arracha sa robe avec une clameur sauvage et triomphale. Et tout à coup, étendue, sous le flamboiement du regard, sous une monstrueuse haleine, elle sentit une peau ardente contre sa eau.
Une souffrance aiguë, horrible déchira sa chair. Ensuite, une brusque volupté, merveilleuse, la traversa. C’était comme de la lumière qui la pénétrait, comme une chaleur nouvelle et sublime qui prodiguait à son corps terrestre toutes les illuminations du ciel et le faisait rayonner splendidement, ainsi qu’un astre, dans le vertige et la domination, et dans l’au-delà. Enfin, elle s’évanouit.
Simon Le Cartier s’efforça de croira à une hallucination collective. Cependant, il avait trouvé sa fille nue, accablée par un sommeil de plomb. Goury, qui avait eu la chance de tomber, avec son aéronef, dans le port de la Concorde d’où il était sorti sain et sauf, ne savait non plus que penser.
Sidonie, elle, demeurait profondément songeuse, frissonnante. Bientôt, elle eut des troubles, ceux de la grossesse. Elle, si mince et si petite, se gonfla.
Après seize mois d’attente, elle accoucha fort laborieusement d’un enfant long, velu, au front garni d’une touffe de cheveux fauves, au regard surpris, triomphant et resplendissant.
_____
(Albert Keim, in Le Supplément, grand journal littéraire illustré, vingt-cinquième année, n° 3007, jeudi 5 novembre 1908, et n° 2881, mardi 21 janvier 1908)
L’auteur d’un dictionnaire étymologique inédit, qui plusieurs fois m’a fait l’honneur de m’adresser des solutions ingénieuses, mais, à mon avis , plus savantes que fondées, m’écrit sur ce point :
« Marmot, comme chacun sait, est le grec μορμυ » (mormô), larve, lamie, spectre, fantôme.
Croquer le marmot, c’est littéralement croquer le fantôme ; soit figurément se nourrir de chimères, se repaître de l’apparence au lieu de la réalité, de l’ombre au lieu du corps que l’on attend. Telle est l’origine de cette locution. »
Je n’en crois rien du tout. Marmot n’est point le grec mormô ; ni le latin marmor, comme le veulent les pères de Trévoux ; ni le vieux français merme (enfant mineur), comme le prétend De Laurière : marmot est le masculin de marmotte. Tout le monde sait que la marmotte, comme l’ours, apprend à se tenir debout sur ses pattes de derrière ; dans cette position, la marmotte représente le contour mal ébauché d’une petite figure humaine : cette ressemblance est cause qu’on a appelé un petit enfant un marmot.
J’ai été charmé de découvrir que je m’étais rencontré dans cette explication avec le savant Biscioni, le bibliothécaire de la Laurentiane en 1741. C’est sur ce vers du Malmantile :
Delia mia donna quattro o sei marmocchi.
(LIPPI, II, 9.)
Minucci, donnant dans la fausse étymologie de Trévoux, avait expliqué ce mot par la ressemblance entre le marbre, marmor, et la peau lisse et polie des enfants. Et il citait en confirmation l’ode à Glycère :
Urit me Glyceræ nitor
Splendentis Pario marmore purius.
(HORACE, I, 19.)
Biscioni le reprend et fait voir que marmocchi est pour marmotti, par la métamorphose connue du t en c, et que marmotti est une sorte de masculin de marmotta.
Observez qu’on dit dans le même sens un marmouset. Qu’est-ce qu’un marmouset, ou plutôt une marmouse, dont marmouset n’est que le diminutif ? Palsgrave dit : « Marmoset, beest. » (page 243.) – À la bonne heure, mais quelle bête ? Je dis que c’est une marmotte. Marmite, en français du moyen âge, signifie sombre, sournois, mélancolique, hypocondriaque, en bas latin malè-mitis. Il nous en reste marmiteux : Il a l’air marmiteux ; – une face marmiteuse. Les mœurs farouches des marmottes, leur sommeil de six mois, leur ont valu ce nom d’animal mélancolique par excellence.
Ménage dit : « Marmotte, de l’italien marmotta. » C’est commode ! les Italiens n’ont plus qu’à dire : Marmotta, du français marmotte, et l’étymologie sera parfaitement élucidée dans les deux langues.
Marmuse ou Marmouse peut être formé de deux racines françaises : Mar, c’est-à-dire mal, et mouse, le même que moue, triste mine, mine boudeuse. – Marmouserie, en vieux langage, est l’équivalent d’hypocondrie : « François Attremen entra en une marmouserie telle que le plus du tems il alloit tout seul par la ville de Gand. » (FROISSART, t. III, chap. 35.)
Le nom propre Marmont doit être le même que Marmuse ; c’est, par la substitution si fréquente de l’n et de l’u, Marmout, marmot, marmotte.
Marmouser, marmonner, marmotter, termes synonymes ; c’est ressembler aux marmottes par l’attitude, ou par une grimace et un remuement de lèvres.
Aux marmottes, dis-je, ou bien aux singes, car marmot et marmouset ont depuis servi à désigner deux espèces de singes. C’est ce qui a fait dire à Ménage : « Marmouset, peut estre du bas breton marmous, singe. » Les bas Bretons disent, en effet, marmous et même marmouset ; Ménage pouvait donc le prendre tout vif et sans recourir à aucune transformation. Mais il est trop clair que le bas breton a emprunté ces mots, comme une foule d’autres, à la langue française. C’est ce qui n’est jamais venu à la pensée de Ménage. Règle générale chez lui : un mot français vient toujours du mot qui lui ressemble dans une langue étrangère. Il arrive les trois-quarts du temps que, pour avoir la vérité, il faut renverser les deux termes de la proposition, et qu’ainsi la prétendue étymologie de Ménage laisse subsister la difficulté tout entière.
À propos des singes, je ferai observer qu’il y en a qu’on appelle babouins, et qu’on se sert également de ce mot pour désigner un enfant, un petit polisson :
… Ah ! le petit babouin !
Voyez, dit-il, où l’a mis sa sottise !
(LA FONTAINE, L’Enfant et le Maître d’école.)
Daunou, dans son Discours sur l’état des lettres au XIIIe siècle, nous apprend que babouin se prenait dès lors pour un petit bonhomme, homuncio : « Les marges (des manuscrits) se remplissaient de peintures… Tracer ou peindre ces figures marginales s’appelait babuinare. » Le verbe babuinare manque dans Du Cange, et même, aux mots BABEWYNUS, BABOYNUS, on n’indique pas l’acception de homuncio comme usitée au moyen âge. C’est une lacune que je saisis l’occasion de signaler.
Ne terminons pas sans rendre compte de croquer le marmot. C’est une expression qui a pris naissance dans l’atelier des peintres, d’où elle s’est répandue dans le monde. L’artiste qu’on fait languir sur un escalier, dans un vestibule, dans une antichambre, pour tromper la longueur du temps, s’amuse à barbouiller, à croquer une petite figure de marmot contre la muraille. Voilà le sens propre ; le sens métaphorique s’ensuit naturellement.
Il n’y a pas d’autre origine à faire sa tête, que nous voyons s’accréditer parmi le peuple, en attendant que l’Académie française l’admette dans son Dictionnaire, où elle a reçu croquer le marmot. Un apprenti qui en a fini avec les nez, les yeux, les bouches et les oreilles, passe à l’ensemble ; à partir de ce jour, il est artiste, il fait le fier, l’important : il fait sa tête !
_____
(François Génin, Récréations philologiques ou recueil de notes pour servir à l’histoire des mots de la langue française, Paris : Chamerot, 1858)