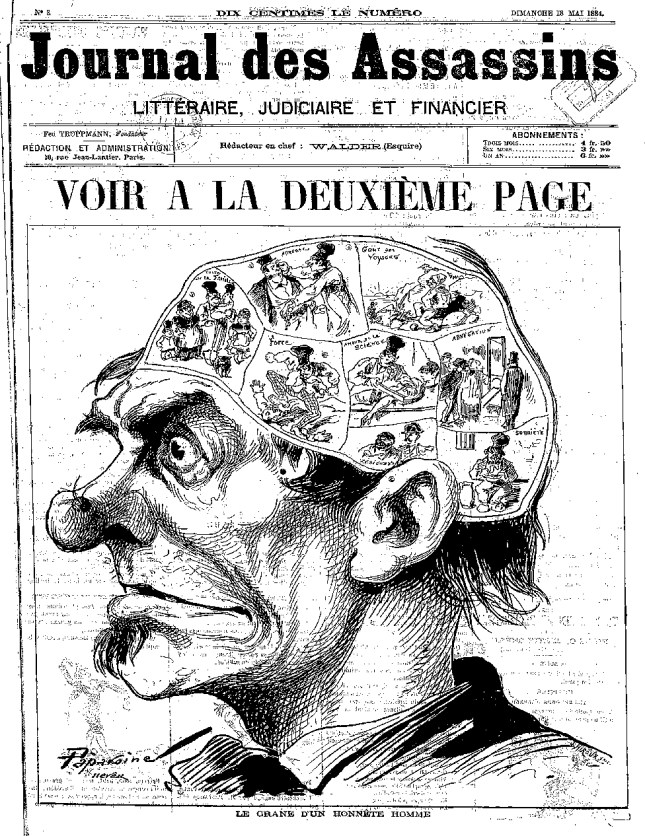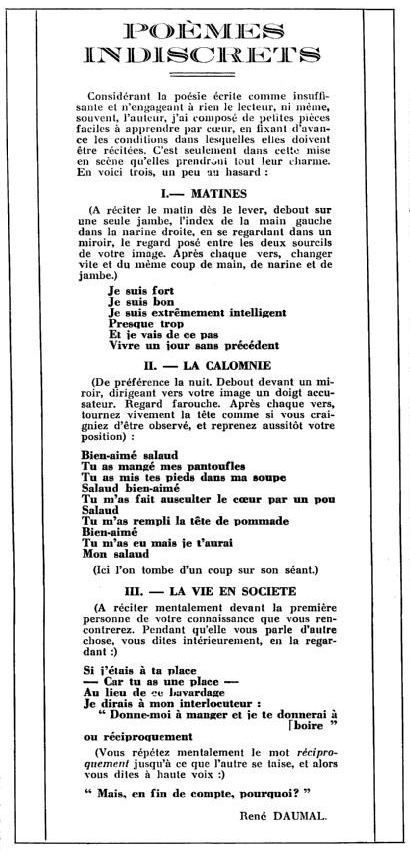ÉTRANGETÉS, RÊVES ET CAUCHEMARS LITTÉRAIRES. CHIMÈRES ET HANTISES.
Articles de la Catés:gorie “LA VIE EN ROSE”
Il vous est arrivé, parfois, d’entrer dans un cirque. Le spectacle y est toujours infiniment plus intéressant et plus drôle qu’à l’Odéon, un jour de conférence.
Vous vous êtes extasié sur les tours de force angoissants des acrobates ; puis sont venus des clowns, qui ont tout d’abord paru maladroits et se sont vite révélés plus extraordinaires dans leurs contorsions, leurs pirouettes et leur effrayante agilité, refaisant ce qui venait d’être fait, sans la moindre apparence d’effort, comme en se jouant. Et vous avez été stupéfait de les voir capables des mêmes vertigineuses dislocations qu’ils agrémentaient de l’imprévu le plus imprévu, surpassant, par les cabrioles les plus inouïes, les divers exercices mesurés, compassés, précis de leurs camarades.
Le clown, en effet, au gré de la fantaisie la plus déréglée, va, vient, saute, retombe, bondit, s’élance, retombe encore. Cocasse, étrange, hallucinant, macabre à l’occasion, railleur, sarcastique, gouailleur, spirituel et naïf en même temps, il crie, s’exclame, laisse son rire fuser brusquement, aigu, communicatif, s’égrenant chromatiquement et finissant en grimace désolée ; jamais fixé, s’il s’arrête, c’est pour repartir aussitôt, endiablé, faisant la roue, se retrouvant sur ses pieds, pirouettant de-ci, de-là, avec une rapidité et une prestesse étourdissantes.
Au lieu d’aller aux « artistes » en maillot collant, soucieux de leur académie, attentifs à ne pas détruire l’harmonie des lignes et presque fatigants par la grâce conventionnelle et l’automatique précision de leurs mouvements, votre sympathie s’est portée sur ces funambules au masque peinturluré et aux oripeaux tapageurs.
Or, la vie littéraire peut être envisagée comme un cirque, avec ses acrobates, avec ses vagues écuyers qui crèvent d’inoffensifs cercles de papier, au bruit d’une musique navrante, et – aussi – ses clowns, qui possèdent le métier des grands premiers rôles, de merveilleuse façon et pourraient, en supprimant leur accoutrement bizarre, le toupet et les enluminures du visage, être pareils à ceux-ci, avec l’originalité en plus.
Parmi ces derniers, Georges Fourest apparaît comme l’un des plus heureusement doués : il est bien le clown littéraire par essence et sa cocasserie ne ressemble absolument à aucune autre.
Ce n’est plus Willy, prince de l’à-peu-près et roi du calembour, ce n’est plus Grosclaude, pince-sans-rire, aux étonnants poncifs, qui, avec des clichés et des phrases qu’ont usés tous les faits-divers, met sur pied les histoires les plus invraisemblables, ce n’est pas Courteline, dieu de la Farce, véritable et génial auteur comique, proche parent de Molière, ce n’est pas Alphonse Allais, G. Auriol, J. Renard, Weber, Tristan Bernard. C’est Fourest, c’est-à-dire un maître ciseleur de vers, personnalité exceptionnellement à part dans cette classe à part d’écrivains.
Georges Fourest n’est pas un « auteur gai » à proprement parler. Il ne cherche pas à provoquer le rire et ne débite point de pantalonnades pour amuser le passant. C’est un poète étrange nourri des plus contradictoires lectures, un poète qui poussera des cris d’orfraie en présence du commun et du convenu, comme Henri III à la vue d’une souris, et qui, pour fuir la banalité, ira du bizarre à l’excentrique, de l’excentrique à l’incohérent, de l’incohérent au baroque le plus stupéfiant, prêt à entreprendre toutes les aventures pour que les rêveries de ses jours et les rêves de ses nuits ne soient pas hantés de ce fantôme d’apparence si débonnaire.
La banalité ! Fuir la banalité ! Aller vivre en des contrées imaginaires, où tout aurait un aspect inattendu et insoupçonnable, échapper à l’obsédante vision de ce fléau qui désole notre malheureuse humanité, règne en despote, et, tyranniquement, envahit la Vie !
C’est là surtout ce qui caractérise le talent de Fourest et suffit à expliquer sa fantaisie, son humour, sa blague, son fun que l’on pourrait croire désordonnés, mais qui sont simplement les manifestations d’une nature très curieuse et très rare, et constituent la marque essentiellement originale d’un artiste avant tout cousin spirituel de Joa Grimaldi.
*
Original et insoucieux des préjugés, je ne connais personne qui le soit plus que lui, et cependant, chose étrange, Fourest demeure fidèlement attaché au vers décadent.
Ce n’est point ici le lieu de discuter s’il a tort ou raison. On constatera toutefois, non sans surprise, que ce tempérament « irrégulier, » qui semblerait ne pouvoir s’accommoder que du vers libre, s’enferme avec joie dans les règles étroites d’une prosodie rigoureuse.
Ce fantaisiste incomparable, qui ne peut se contenir d’une extravagante hilarité devant certains poèmes récents dénués de tout apprêt, est maître de sa forme autant que les plus habiles ouvriers. Ses sonnets, ses ballades, sont d’une impeccable facture et rappellent, à tous points de vue, les meilleures odes funambulesques du maître-orfèvre Théodore de Banville, ou tels Émaux du bon Gautier.
Comme les costumes de bals masqués où scintillent les diamants précieux dans les plus chatoyantes soieries, les poèmes de Fourest sont pailletés de vers étincelants et définitifs :
« Mon Père, l’Ibis Noir et ma Mère, l’Étoile
Gamma du « Petit-Chien » dorment sur le Liban !
Voilà pourquoi je Hais l’infâme Caliban !
À quatorze ans, j’entrai chez un marchand de toile
Peinte ! Cet homme-là ne fut qu’un propre à rien !!
Nabuchodonosor, ô quel Assyrien !!!
MOI, j’ai des Cornes de Licorne dans la Bouche !!!!
Gazelle de Sinople aux juillets Pluvieux ! »
Et comme IL achevait, le Médecin, un vieux
Rasé, dit au Gardien : « Qu’on le mène à la douche ! »
*
Son vers est élégant et narquois, tantôt familier, tantôt bouffonnement épique, martelé et redondant, mais avant tout magnifiquement eurythmique, admirable, en un mot, de perfection.
Est-il un exemple, plus probant que ces quelques strophes de l’Épître Testamentaire :
Pour corbillard je veux un très-doré carrosse
Conduit par un berger-Watteau des plus coquets,
Et que traînent au lieu d’une poussive rosse,
Dix cochons peints en vert, comme des perroquets.
Celle que j’aimai seul, ma Négresse ingénue
Qui mange des poulets et des lapins vivants,
Derrière le cercueil marchera toute nue,
Et ses cheveux huilés parfumeront les vents.
Les croque-morts seront parés de laticlaves
Jaune-serin, coiffés d’un immense kolbach,
Et trois mille zeibecks, pris entre mes esclaves,
Suivront le char, jouant des polkas d’Offenbach.
Vous, sur des hircocerfs, des zèbres, des girafes
Juchés et clamitant des vers facétieux,
Vous cavalcaderez munis de deux carafes
D’onyx pour recueillir le pipi de vos yeux.
Tandis que méprisant ta faune, ô Lacépède,
Drapé dans une peau de caméléopard,
Mon vieux compaing Deibler, sur un vélocipède,
Braillera la « Revue » et le « Chant du Départ ! ». . . .
J’ai tenu à citer le passage tout entier, comme dirait M. Jules Lemaître, parce qu’il est caractéristique et donne une idée très nette du talent de Fourest, cependant qu’il permet de constater la bizarrerie la plus intéressante de ce curieux esprit : excentricité de la pensée, et pureté classique de la forme.
Néanmoins – il sied de signaler ce détail – le poète qui exprime si solennellement les suprêmes instructions « pour régler l’ordre et la marche de ses funérailles » n’a pas toujours employé les rythmes définis et telles Élégies Falotes sont écrites en vers presque libres, qui ne dépassent jamais, toutefois, l’Alexandrin. Il se croirait, en effet, déshonoré s’il laissait échapper un vers de treize syllabes. (1)
Or, des Pierrots, de blancs Pierrots, de doux Pierrots,
blancs comme des poiriers en fleurs,
comme la fleur des pâles nymphéas sur l’eau,
comme l’écorce des bouleaux,
comme la laine des fuseaux,
comme le cygne, oiseau des eaux,
comme les os
d’un blanc squelette,
blancs comme un mois de Marie,
blancs comme un blanc papier-de-riz,
de doux Pierrots, de blancs Pierrots
dansent le falot boléro,
la fanfulla, la bamboula
éperdument, au son de la
maigre guzla,
autour de la
Négresse Blonde ! . . .
On voit dans le vers soi-disant libre de Fourest percer le poète qui cisèle
. . . les mots comme des coupes,
et les rimes pour n’être ici plus classiques conservent « l’appui de la consonne, », et demeurent très riches pour l’oreille.
*
Chose rare, en notre temps, chez un « Jeune, » Fourest a toujours manifesté pour la politique et la sociologie une indifférence impériale.
Convaincu, avec juste raison, que sous tous les régimes, il sera possible de modeler et de peindre, de composer des sonates et de rimer des sonnets, il ne voit pas ce qui, dans la question politique ou sociale, peut solliciter l’attention de l’artiste.
On se souvient que l’Ermitage avait organisé en 1893 un Référendum où il était demandé aux écrivains de la nouvelle génération : « Quelle est la meilleure condition du bien social, une organisation libre et spontanée ou bien une organisation disciplinée et méthodique ? Vers laquelle de ces conceptions sociales doivent aller les préférences de l’artiste ? »
De graves prosateurs et d’aimables poètes, se croyant destinés à régénérer l’univers, envoyèrent avec empressement leurs conseils et leurs avis. Toutes ces réponses, entachées pour la plupart de pédantisme, manifestaient une sincérité comique ; et tandis que René Ghil nous annonçait, en un adorable bafouillage, avoir fondé l’école évolutive collectiviste de libres personnalités artistes vers un but unique, Fourest, concis et facétieux, répondait à la question par cette autre question : Le meilleur des régimes n’est-il pas celui du dattier ?
Et j’imagine volontiers quel put être « l’état d’âme » des sociologues des diverses nationalités, qui, ne voyant que les mots et inaptes à leur donner leur réelle signification, compulsèrent d’importantes encyclopédies pour arriver à déterminer le rôle du dattier dans l’évolution de l’humanité.
*
Né à Limoges en 1867, Fourest fit son droit à Paris et à Toulouse. Dans cette dernière ville, il se lia de la plus étroite amitié avec Ernest Dufour et Laurent Savigny, et les bons bourgeois de la « Cité palladienne, » en constatant au mois d’août 1887, le départ des trois inséparables éprouvèrent, semble-t-il, une satisfaction pure de tout mélange.
À ce moment, l’ambition ne lui était pas encore venue d’être un jour le poète burlesque de sa génération et il signait « Georges Louyat, » tels sonnets mythologiques où le souci de la forme n’arrêtait en rien l’envol de l’inspiration.
Combien qui connaissent notre actuel Fourest retrouveraient, en ces vers (2) d’une rare sonorité, l’auteur du Pseudo-Sonnet truculent et allégorique qui fait encore la joie des tavernes montmartroises.
Quand parut le matin de la jeune vendange
Dans la coupe d’airain, je ne sais quelle Hébé,
Perfide, sut mêler du fiel et de la fange
Au vin pur qu’épanchait le rouge Kélébé.
Mais pour moi la jeunesse eut l’amertume étrange
D’un sinistre poison ; et de pourpre nimbé,
Ainsi qu’un fier démon qu’un Dieu force d’être ange
Je rêve, triste éphèbe, à cet âge courbé
Où les cieux éteignant leurs lampes sidérales,
Contemnant les sanglots, les désirs et les râles
Nous cesserons enfin, fantômes clandestins,
De nous traîner, sanglants sur le marbre des dalles
Et de suivre à travers ses ignobles dédales
Le fil mystérieux des fugaces destins.
De retour à Limoges, après avoir dit adieu aux gras-doubles d’Allard, à la rue Montardy et au Capitole, il envoie ses poèmes au Décadent d’Anatole Baju, à Chimère, à la Plume, fonde avec Henri Mazel et un groupe de nobles et intéressants écrivains l’Ermitage qui eut vite conquis le premier rang parmi les « jeunes périodiques. » Il collabora assidûment à cette revue jusqu’au moment où Mazel se retira, désireux de se recueillir et d’employer à des œuvres plus personnelles tout son temps et toute son activité.
Depuis qu’il n’est plus Ermite, Fourest n’a guère publié que deux ou trois sonnets réservés à la Province Nouvelle.
Nous attendons incessamment la parution de la Chanson falote, dont la plupart des pièces sont fameuses dans les cénacles de la littérature jeune et que le baryton truculent de notre ami Dufour, l’adorable poète de la Chanson Folle et de tant d’autres pures merveilles, contribua fort à faire connaître.
Enfin – symptôme irrécusable de la naissante gloire – il put entendre ses plus extraordinaires poèmes récités çà et là par de vagues courtauds de lettres qui s’en attribuaient, sans la moindre vergogne, la paternité, ainsi que cela advint pour cette Épître testamentaire, dont on a lu plus haut un fragment, et qui est, à mon sens, son chef-d’œuvre.
Ce fantaisiste impénitent, à la silhouette d’officier ratapoil, est doublé – ô ces contrastes ! – d’un éminent jurisconsulte. Georges Fourest est inscrit au barreau d’une Cour d’Appel et partage son temps entre Dalloz et les Contes d’Edgar Poe.
Amoureux fervent de l’excentrique et de l’invraisemblable, ses livres préférés sont Gulliver, Don Quichotte, les Odes Funambulesques de Banville, les Amours jaunes de Tristan Corbière, les Complaintes de Jules Laforgue. « Bouvard et Pécuchet », « Tribulat Bonhomet », Scarron, Henri Heine, sont ses compagnons de tous les jours, et, à lire cette énumération où manque, peut-être, le Livre des Snobs de Thackeray, on ne s’étonnera pas, s’il s’apitoie, que ce soit sur des Sardines à l’huile et s’il est amoureux, que ce soit d’une Négresse blonde. . .
_____
(1) Je ne dis pas « treize pieds, » pour ne point tomber dans l’erreur grossière commise par de doctes critiques, car un vers de treize pieds aurait au moins vingt-six syllabes.
(2) Je dois dire que Georges Fourest renie aujourd’hui hautement les élucubrations de Georges Louyat.
_____
(Joseph Savary, in La Province nouvelle n°13, mai 1897)
Par Saint-Georges de Bouhélier, je n’essaierai pas de dire ici le merveilleux causeur que fut Villiers de l’Isle-Adam, ni comment, en une soirée, il faisait à son entourage l’aumône de soixante-quinze sujets de romans, drames ou féeries.
Non, non ! Ce que je veux simplement rappeler en passant, c’est qu’avec sa voix de fantôme, son masque d’alchimiste, et ses mains blafardes, l’auteur d’Axel fut, à ses moments perdus, un délicieux mystificateur.
Pour amuser ses amis, stupéfier les droguistes, et se procurer les joies incomparables du rire intérieur, le bon Villiers montait d’admirables bateaux dont il se faisait à la fois l’armateur, le subrécargue et le timonier, – bâtiments fantasmagoriques qu’il conduisait d’une main sûre à travers les écueils de la plus haute fantaisie et les aimables archipels du cauchemar.
Il propageait à son gré l’inquiétude et le mystère ; les âmes les mieux amarrées, il les faisait faseyer et tergiverser sous le vent folâtre de l’ahurissement.
Les pianos alcooliques des cabarets, il les emplissait de voix falotes et de chuchotantes chauves-souris. D’un mot, il transformait le café le plus resplendissant en une ténébreuse caverne de brigands.
Lu par lui, le fait divers le plus anodin devenait une chose terrible. Il avait une façon de dire : « Le Président de la République a visité l’institution des jeunes sourds-muets, » qui véritablement faisait frissonner les plus résolus.
Bref, il mettait au service de la fumisterie son indéfectible génie, et, quand il lui plaisait d’être loufoque – il l’était d’une manière toute shakespearienne.
Il entreprit, un soir, d’éberluer un honorable vieux magistrat de province.
« Monsieur, lui dit-il, vous connaissez, sans doute, un charmant pays qu’on appelle Bécon-les-Bruyères… C’est à deux kilomètres environ de cette riante localité que m’est advenue l’aventure suivante, – aventure piquante s’il en fut, monsieur, – et qui ne saurait être tue.
Chargé de mon petit bagage de colporteur, je regagnais Bécon, certain vendredi, et, tout en mâchonnant une chique de bétel, je songeais, vous l’avez deviné, à la fille de l’aubergiste, lorsque j’aperçus trois individus qui s’agitaient véhémentement à main gauche.
Deux de ces hommes paraissaient associés, car ils tapaient avec un ensemble touchant sur le troisième.
Lorsqu’ils furent las de le houspiller, ils s’emparèrent de sa personne et le tirent disparaître – de la façon la plus simple, du reste :
Ils le jetèrent dans un puits.
Après quoi, ils s’éloignèrent tranquillement.
Au bout d’un petit temps – cinq ou dix minutes, un quart d’heure, peut-être, – je m’approchai du puits, et, à mon vif étonnement, je constatai que le gaillard qu’on y avait précipité n’était pas mort.
Alors, je me penchai sur l’orifice, et, après avoir toussé trois ou quatre fois :
« Hé ! l’ami ! fis-je, ne craignez rien, c’est moi qui suis l’envoyé de la Providence ! Vos bourreaux sont partis… parlez ! Qu’y a-t-il pour votre service ?
– À boire ! répondit l’homme. À boire ! à boire ! à boire ! »
Les assassins avaient laissé dans l’herbe la corde et le seau. Qu’auriez-vous fait, monsieur, à ma place ?
« J’aurais essayé de sauver ce pauvre diable, répondit le magistrat.
– Eh bien ! moi, riposta Villiers en baissant la voix, je fis pré-ci-sé-ment le contraire ! Après avoir caché la corde et le seau, je repris le chemin de ma demeure ; – car vous avouerez, monsieur, que, même dans les circonstances les plus graves, il n’est pas permis de se moquer ainsi du monde ! Quand on est con-for-table-ment installé au fond d’un puits, – on ne demande pas à boire ! »
_____
(George Auriol, in Le Supplément, grand journal littéraire illustré, n° 1790, 31 janvier 1901)
En cette semaine où le Chat Noir, daignant descendre des hauteurs de Montmartre et se transvaser à Rouen, est tout d’actualité, il nous a paru intéressant de publier une Chanson Zutiste, non pas d’un des poètes entendus dimanche dans les salons de la Préfecture, mais d’un de ceux qui fut l’un des premiers collaborateurs du gentilhomme Salis et qui apportait l’appoint de son exquise fantaisie aux premières soirées du cabaret de la rue de Laval : nous voulons nommer notre ami Marcel Bailliot, alias Fanfare, dont les délicates productions furent très goûtées des lecteurs du Rouen-théâtre. Voici l’une des œuvres du jeune chansonnier, créée par l’auteur aux soirées de La Plume et que Bruant eût été heureux de signer.
À LOURCINE
_____
I
Vrai, qué malheur ! la vi’ qu’on mène,
On s’éreinte, on s’donne d’la peine,
Et l’on finit dans la débine
À Lourcine.
II
Ma mèr’ qu’était un’ blanchisseuse
De son vivant fut pas heureuse,
Mais elle avait pris d’la vaccine
À Lourcine.
III
Moi, ça m’a pris voilà trois mois,
J’étais alors avec François,
Maint’nant on m’fourr’ d’la vaseline
À Lourcine.
IV
Ça peut durer dix ans, vingt ans,
Ça peut durer mêm’ soixante ans,
C’est c’que m’a dit ma voisine
À Lourcine.
V
Adieu la noce, adieu l’printemps,
J’suis pt’êt là pour ben longtemps,
J’verrai fleurir l’aubépine
À Lourcine.
VI
Ô mes pauv’ sœurs, les pauv’ catins,
Toujours soucieus’ des lendemains,
Sans cesse faut qu’on turbine
Pour Lourcine.
VII
Ça prouve assez que sur la terre,
Qu’on soit d’la haute ou prolétaire,
Y a pas d’roses sans épine
À Lourcine.
_____
(Marcel Bailliot, in La Soirée normande, journal littéraire, artistique et mondain, n° 5, du 10 au 17 décembre 1891)
_____
(in La Bête noire, artistique et littéraire, n° 8, février 1936)
LA VIE DE PARIS
_____
Des poètes ont élu un prince. Aussitôt, d’autres poètes ont élu un antiprince. Toute ma curiosité allait à celui-ci. Car enfin, prince des poètes, c’est un titre honorable et qui ne gêne personne. Léon Dierx s’en accommodait fort simplement. Il rimait, allait au café et puis grossoyait dans un ministère, comme le premier Français venu. Antiprince, au contraire, c’est une appellation qui sent le schisme et la révolte. Et puisqu’elle avait été décernée à M. Georges Fourest, auteur de la Négresse blonde, je me mis aussitôt à la recherche de ce prétendant.
Lorsque enfin je le découvris, dans une maison extrêmement bourgeoise de la rue de Milan, je fus un peu désappointé. Cet antiprince était fort calme et très convenable. Il avait une cravate et des pantoufles. Il était assis dans un excellent fauteuil, auprès d’un solide piano. Ses cheveux n’entouraient pas son front de flammes sataniques : ils étaient strictement peignés. Et enfin, M. Georges Fourest, souriant, courtois et amène, ne paraissait nourrir contre M. Paul Fort aucun projet ténébreux.
Il me dit :
« Voici. C’est bien simple. Les anciens collaborateurs d’une revue défunte – et qui fut si charmante ! – l’Ermitage, ont gardé la coutume de se réunir le 19 de chaque mois, en un banquet amical. Le 19 juin, je suis allé dîner en leur compagnie. Et naturellement, nous avons parlé de l’élection du prince des poètes. Quelqu’un a dit : « En somme, la rive droite n’aura pas de prince. » Et H.-D. Davray a proposé de m’élire. C’est tout. C’était une plaisanterie. J’étais le seul poète présent. On voulait rire. À peine élu, j’ai abdiqué en faveur de Davray, qui n’est pas poète et habite sur la rive gauche : deux titres à la principauté des poètes de la rive droite. »
M. Georges Fourest, ayant dit, sourit avec bonne humeur. Peu de gens considèrent la vie avec autant de gaieté. Jeune étudiant en droit, il faisait des vers d’une étonnante cocasserie. On le rencontrait, hardi et jovial, dans les brasseries du quartier Latin, et ses amis récitaient ses poèmes au Soleil d’Or :
Le soir tombe. Invoquant les deux saints Paul et Pierre,
Chimène, en voiles noirs, s’accoude au mirador.
Et ses yeux dont les pleurs ont brûlé la paupière
Regardent, sans rien voir, mourir le soleil d’or.
Mais un éclair soudain fulgure en sa prunelle :
Sur la plazza, Rodrigue est debout devant elle !
Impassible et hautain, drapé dans sa capa,
Le héros meurtrier à pas lents se promène :
« Dieu ! soupire à part soi la plaintive Chimène,
Qu’il est joli garçon, l’assassin de papa ! »
Lui, cependant, Georges Fourest, magni-fique et altier, se promenait sur le boulevard Saint-Michel.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Il portait la royale
Comme jadis Armand Duplessis-Richelieu ;
Sa moustache était fine et son âme loyale. . .
Il plaisait. Il parlait haut. Il s’amusait beaucoup. C’est lui qui, à la répétition générale des Résignés, d’Henry Céard, interpella soudain Francisque Sarcey, d’une voix éclatante : « Eh bien ! qu’est-ce que vous pensez de ça, mon oncle ? »
À quoi Sarcey répondit tranquil-lement : « Lisez le Temps lundi, jeune fumiste ! »
M. Georges Fourest lisait le Temps, mais c’était pour réchauffer son indignation. Il allait aux spectacles de « l’Œuvre, » s’enthousiasmait, s’irritait, rêvait d’exterminer les pharmaciens, et publiait ses vers dans l’Ermitage, où ils étaient fort goûtés. Avant Franc-Nohain, il composa des poèmes amorphes :
Les pianos
Des casinos
Aux bains de mer
Font rêver les poissons qui nagent dans la mer.
Car (tous les érudits le savent, de nos jours)
Ils sont muets, c’est vrai, mais ils ne sont pas sourds.
Et puis… Et puis M. Georges Fourest disparut. D’un jour à l’autre, nul ne sut ce qu’il était devenu. Il était simplement à Limoges, dans une maison garnie de vieux meubles riches, vivant à l’aise, et, oubliant le Soleil d’or. Parfois, il disait :
« Il faudra bien que je publie mes anciens vers. »
Et il ne les publiait pas. Quelques amis obstinés regrettaient parfois son absence, et déclamaient « l’Épître falote et testamentaire, pour régler l’ordre et la marche de mes funérailles. » Ensuite de quoi, ils demandaient :
« Où est-il, Fourest ? »
Mais personne ne pouvait répondre.
Enfin, un jour, voilà quatre ans, Georges Fourest se lassa de Limoges et revint à Paris. Il publia ses vers sous le titre que nous avons dit et qui est, au premier abord, un peu surprenant. On n’en parla pas assez, parce que le sens de la gaieté s’éloigne de nous. Il n’en fut nullement attristé. Il vit, rue de Milan, dans l’aisance et la paix. Le 19 de chaque mois, il va dîner avec ses compagnons de l’Ermitage. Il porte toujours la royale comme Armand Duplessis-Richelieu. Mais sa moustache est moins fine. Il continue à plaire.
Cet antiprince est un bourgeois heureux.
_____
(Louis Latzarus, in Le Figaro, dimanche 23 juin 1912)
– Encore la maison de Mozart. – On lit dans la Semaine universelle :
« J’ai vu, il y a deux jours, un travail fort curieux de M. Sardou (Victorien).
Il ne s’agit de rien moins que de la maison de Mozart dans la planète de Saturne.
Le dessin, qui peut avoir trente centimètres de hauteur et quarante ou cinquante de largeur, représente un palais en forme de temple, qui ne peut guère servir d’habitacle qu’à un musicien. L’ensemble est composé de notes, de croches, de portées, de clefs, etc., dont l’aspect chatoie et miroite sous les yeux au point de ne laisser apercevoir qu’un chaos indéchiffrable. Puis la vue se remet, et peu à peu les détails prennent leur place. La façade, composée de harpes, de lyres, de portées, le fronton soutenu par des colonnes, de notes autour desquelles s’enroulent des croches, des soupirs et des clefs, puis toute une forêt de colonnettes élégantes, de clochetons, de tourelles, etc. Le dessin est signé Victorien Sardou. Or, Victorien Sardou jure, à qui veut l’entendre, qu’il n’a jamais su se servir d’un crayon. II est vrai que le dessin est fait à la plume, et l’on sait avec quelle finesse V. Sardou a dessiné ses Ganaches et d’autres portraits.
Voici donc comment ce dessin s’est exécuté :
M. V. Sardou s’est enfermé pendant deux heures avec un encrier, des plumes, une feuille de papier blanc, et sa faculté de médium. Au bout de deux heures, il sortait, laissant ce dessin. »
*
S’il y a quelque réalité dans ce récit fantastique, il faut en déduire que le mauvais goût n’est pas un apanage exclusif des habitants de notre monde sublunaire, et que les architectes de Saturne construisent là-bas de bien pitoyables édifices.
Si j’ai bonne mémoire, MM. les spirites plaçaient la résidence de Mozart dans la planète de Jupiter, où il habitait avec Bernard de Palissy. Celle dont il s’agit est peut-être sa maison de campagne.
_____
(in L’Univers musical, journal littéraire et artistique, n° 18, jeudi 30 avril 1863)