

Reliure plein chagrin non signée, avec un motif en cuir repoussé (début XXe)
Frontispice :
« Voilà un talisman auquel la vertu de ta maîtresse ne résistera pas, et tu ne trouveras point de cruelles, tant que tu le porteras sur ton cœur. »



Reliure plein chagrin non signée, avec un motif en cuir repoussé (début XXe)
Frontispice :
« Voilà un talisman auquel la vertu de ta maîtresse ne résistera pas, et tu ne trouveras point de cruelles, tant que tu le porteras sur ton cœur. »
La campagne italo-éthiopienne a, malheureusement prouvé l’utilité des forces motorisées et leur supériorité sur l’homme.
Mais il ne faut pas croire que cette motorisation, cette force défensive et offensive recherchée mécaniquement soit uniquement le souci de notre siècle.
La découverte de la poudre à canon et, plus tard, de la dynamite a complètement modifié les conditions de la guerre, mais les anciens, avec les faibles moyens dont ils disposaient, étaient arrivés à construire des machines de guerre d’une puissance et d’une ingéniosité extraordinaires. L’étude de ces engins ne serait peut-être pas inutile à nos constructeurs de tanks et de mitrailleuses.
Les principales de ces machines étaient les catapultes, les balistes, les béliers et les tollénones. Sans entrer dans des explications techniques, disons que les catapultes agissaient comme des frondes, les balistes comme des arcs, mais dans de colossales proportions, car elles arrivaient à lancer des poutres, d’énormes quartiers de rochers. Les engrenages étaient de bronze et elles se bandaient avec des leviers et des cabestans ; des pivots permettaient de varier la direction du tir et elles avançaient sur des rouleaux. Il y en avait d’immenses que l’on apportait pièce à pièce et que l’on remontait en face de l’ennemi. L’efficacité des catapultes dépendait de la solidité et de l’efficacité des cordages qui décochaient les projectiles. On y employa des tendons pris au cou des taureaux ou aux jarrets des cerfs et plus tard, à Carthage, les cheveux des femmes.
Les béliers étaient d’énormes poutres, vêtues de cuir, cerclées de fer et terminées par une tête de bélier en airain. Suspendus par des cordages à une sorte de portique, ils étaient balancés en mesure par une centaine d’hommes, et allaient frapper les portes des villes qui finissaient par être enfoncées.
Les tollénones se composaient d’une grande poutre qui portait une corbeille carrée où pouvaient prendre place vingt ou trente soldats. À l’aide d’un cabestan, on portait la poutre au-dessus des remparts ennemis et on y déposait les soldats qui, d’ailleurs, ne revenaient presque jamais.
Le roi Démétrius passe pour avoir construit la plus puissante des machines de siège. L’hélépole, ainsi qu’il l’avait appelée, avait neuf étages ; elle était remplie de soldats. Des catapultes et des balistes étaient installés sur sa dernière plate-forme. Construite en bois couvert de lames de bronze, elle avançait lentement sur huit roues jusqu’à ce qu’elle eût atteint le rempart ennemi. Alors les soldats s’élançaient par les portes des neuf étages et sautaient sur le rempart. C’est l’invention de l’hélépole qui valut à Démétrius le surnom de Poliorcète, c’est-à-dire preneur de villes.
L’emploi des chars à faux remonte à une haute antiquité et on en attribue l’invention à Cyrus. Ils étaient à deux ou à quatre chevaux mais ne pouvaient servir qu’en plaine ou sur des routes très unies. Cependant, tous les historiens de l’antiquité s’accordent à dire qu’ils produisaient des ravages formidables. Voici comment Quinte Curce décrit ces chars qui, au nombre de deux cents, suivaient l’armée de Darius :
« L’extrémité du timon était armée de piques ; de chaque côté du collier sortaient trois lances, entre les rayons se dressaient des pointes de fer, et, au centre des roues étaient clouées des faux, en sorte que ces chars taillaient en pièces tout ce qui se trouvait sur leur passage. »

Les Gaulois avaient aussi un char de combat appelé covinus ; il était couvert et garni tout autour de faux ; les chevaux étaient protégés par une cuirasse d’écailles cousues sur du cuir et le conducteur portait un fouet à manche de fer en guise de lance.
D’après Xénophon, les chars employés par Cyrus affectaient la forme d’un tonneau et étaient cerclés de fer ; ils étaient très bas pour donner plus de liberté au conducteur et avaient les essieux très longs pour donner plus de stabilité. Les soldats qui les conduisaient étaient protégés par une cotte de mailles. À l’extrémité des essieux, en dehors des roues, Cyrus avait fait adapter des faux de deux aunes de long, droites et le tranchant tourné en avant. D’autres faux placées au-dessous étaient dirigées vers la terre de manière à faucher les ennemis.
Le char d’un simple soldat n’était monté que par lui ; ceux des chefs portaient, outre ce chef, un conducteur et parfois un troisième combattant. Les chevaux avaient le front, le poitrail et les flancs protégés par des boucliers d’airain.
L’effet de ces chars était terrible dans le tumulte de la bataille, mais quand les soldats conservaient leur sang-froid et étaient habitués à ces redoutables machines, il leur était relativement facile de les éviter, ce qui se produisit, comme l’explique Tite-Live, dans la bataille d’Archelaüs contre Sylla. À partir de l’époque impériale, les chars à faux furent de moins en moins employés.
*
Les auteurs anciens font des éléphants de combat des descriptions terrifiantes ; ces vivantes machines de guerre étaient peut-être les plus redoutables de toutes. Dans les guerres de Rome contre Pyrrhus et contre les Carthaginois, ils décidèrent souvent de la victoire. Ces animaux, soumis à un entraînement spécial, ne redoutaient ni le bruit des trompettes ni la clameur des batailles et ils n’avaient peur ni des flèches, ni même du feu. Dans certaines occasions, pour les rendre plus féroces, on les enivrait avec un mélange de poivre, de vin pur et d’encens, auquel on ajoutait les sommités fleuries du chanvre indien d’où on tire le haschich.
D’ailleurs, ils étaient protégés par une sorte de cuirasse faite de plaques d’airain et formidablement armés. Le poitrail portait un éperon d’acier, leurs défenses étaient allongées par des lances tranchantes et recourbées, et leurs genouillères d’un cuir très épais brandissaient des épieux ; enfin, au bout de leur trompe, on fixait des coutelas acérés, avec lesquels ils fauchaient des rangs entiers de soldats. Sur leur dos, une tourelle de cuir renfermait des archers ou des frondeurs. Dans certaines batailles, il y eut jusqu’à deux cents éléphants qui entrèrent en ligne.
Pour les faire paraître plus effrayants, leurs défenses étaient rougies avec du cinabre, leurs oreilles teintes en bleu, et ils portaient, avec des colliers de grelots, des caparaçons de pourpre ; parfois même leurs défenses étaient dorées.
Pour triompher de ces monstres, on tâchait de leur crever les yeux avec des flèches ou de leur couper les jarrets, on leur lançait des paquets d’étoupes arrosés de pétrole ; souvent aussi, en rampant, un soldat se glissait au-dessous d’eux et leur enfonçait son glaive dans le ventre. Cependant, il arrivait souvent que les éléphants, devenus fous furieux, se retournaient contre leurs alliés chez qui ils causaient d’énormes ravages. Alors le cornac, – les Romains disaient plus noblement l’éléphantarque, – armé d’un coin de fer et d’un marteau, leur fendait le crâne.

Archimède, un des plus illustres mathématiciens de l’antiquité, apporta de grands perfectionnements aux machines de guerre. Pendant le siège de Syracuse par les Romains, il avait inventé des balistes et des catapultes d’une puissance inusitée qui lançaient à une distance prodigieuse des grêles de traits et d’énormes quartiers de roc. De gigantesques mains de fer saisissaient les galères des Romains, les dressaient sur leur poupe, puis les lâchant brusquement, les submergeaient. Enfin, à l’aide de miroirs paraboliques, il incendiait à de grandes distances les vaisseaux de la flotte romaine.
On a longtemps nié l’existence de ces miroirs ardents mais au 17ème siècle, le jésuite Kircher, et plus tard Buffon, réussirent à construire des miroirs ardents par un assemblage de glaces planes. L’appareil de Buffon, installé dans le parc de son château, se composait de 168 glaces planes montées sur un châssis et mobiles dans tous les sens et arrivait à fondre à vingt mètres de distance une assiette d’argent. En 1807, le mathématicien Peyrard perfectionna ce miroir en le rendant plus maniable et démontra qu’avec 590 glaces de 50 centimètres de côté, on pourrait incendier une flotte à un kilomètre de distance.

C’est aussi Archimède qui eut le premier l’idée d’utiliser la force d’expansion de la vapeur d’eau et qui inventa le canon à vapeur ou architonnerre qui a été très probablement employé au siège de Syracuse.
Léonard de Vinci, dans un manuscrit conservé à la bibliothèque de l’Institut, a donné la description et le croquis d’un véritable canon à vapeur, d’après Archimède.
« L’architonnerre, dit-il, est une machine de cuivre fin qui lance des balles de fer avec grand bruit et beaucoup de violence. On en fait usage de cette manière : le tiers de cet engin consiste en une grande quantité de feu et de charbon. Quand l’eau est bien échauffée, il faut serrer la vis sur le vase ABC où est l’eau, et à ce moment toute l’eau s’échappera en-dessous dans la partie chauffée et se convertira aussitôt en une vapeur si abondante et si forte qu’il paraîtra merveilleux de voir la fureur de cette vapeur et d’entendre le bruit qu’elle produira. Cette machine chassait une balle du poids d’un talent. »
On a supposé que Léonard de Vinci, grâce à une traduction arabe, avait eu connaissance du Livre des Feux, une œuvre d’Archimède aujourd’hui perdue et qui contenait la description de toutes sortes de machines de guerre.
Les ingénieurs de la Renaissance, Léonard de Vinci lui-même, ont conçu de curieuses machines de guerre. C’est là un sujet qui pourrait donner matière à un autre article.
Gustave LE ROUGE
_____
(in Le Monde illustré, n° 4091, samedi 16 mai 1936)
Tout ce que j’imagine restera toujours au-dessous de la vérité, car il viendra un moment où les créations de la science dépasseront celles de l’imagination.
(Lettre de Jules Verne à Charles Lemire.)
Trente années se sont écoulées depuis la mort du grand romancier populaire et ses livres se vendent toujours et ne cesseront sans doute pas de se vendre d’ici longtemps. Jules Verne, de sa tranquille retraite d’Amiens, a exercé sur son époque l’action la plus puissante et peut-être la moins observée.
On a fini par reconnaître que les penseurs, ou, comme on disait autrefois, les idéologues ont sur les événements et sur les mœurs une influence beaucoup plus directe et beaucoup plus profonde que les hommes d’action, de brutale réalisation. Napoléon, malgré son génie, n’aurait pu, à lui seul, déclencher l’immense renversement social de 93 dont il profita d’ailleurs et dont les véritables inspirateurs furent Voltaire et J.-J. Rousseau. On a répété avec assez de raison que les romans d’Eugène Sue, les Mystères de Paris, les Misères des enfants trouvés qui se vendaient par centaines de mille ont été une des causes déterminantes de la révolution de 48 et ont fourni au socialisme naissant la plupart de ses thèses favorites. Plus près de nous, les théories d’un Karl Marx, si sèches, si dénuées d’ampleur, si pauvres d’idées qu’elles soient, gardent un incontestable prestige sur les foules non évoluées comme les Russes, les Chinois et les prolétaires illettrés de toutes les nations. Le vieil adage latin reste vrai. Mens agitat molem.
L’auteur de Vingt mille lieues sous les mers n’a exercé autour de lui qu’une bienfaisante influence. N’eût-il eu que ce mérite, il a initié plusieurs générations à la connaissance de l’univers et fait mentir la fameuse définition, d’origine allemande d’ailleurs : Le Français est un monsieur décoré qui ne sait pas la géographie. Mais ses livres, traduits dans toutes les langues, et qui d’abord ne semblaient destinés qu’aux adolescents des collèges, ont eu une portée beaucoup plus grande que, peut-être, il ne l’avait cru lui-même. Il a discerné, prédit et décrit l’immense bouleversement social que les découvertes de la science allaient produire dans le monde. Il faut savoir gré au romancier d’avoir eu confiance dans le progrès de l’intelligence humaine. C’est lui qui a écrit cette phrase : Tout ce qu’un homme est capable d’imaginer, d’autres hommes sont capables de le réaliser.
On demeure stupéfait en constatant qu’il n’est pas une des anticipations prédites par le romancier qui ne se soit réalisée à la lettre. Le Nautilus de Vingt mille lieues sous les mers est devenu une réalité et l’on va prochainement construire entre l’Europe et l’Amérique des îles flottantes dont la première idée vient certainement de l’île à hélice. Dans le Château des Carpathes, il a mis au service d’un conte fantastique les principes alors à peine connus du phonographe, du cinéma et de la télévision, dont il avait prévu les incalculables conséquences. Enfin, comme l’ont démontré récemment des ingénieurs allemands et américains, le voyage de la terre à la lune est devenu possible et n’est plus qu’une question d’argent. Jules Verne a justifié pleinement l’assertion de Gérard d’Houville qui écrivait « que bon nombre des plus hardies découvertes sont nées des Mille et une nuits et des Voyages extraordinaires. »

Le « Nautilus » qui n’est autre que le moderne sous-marin.
Il est assez curieux de constater que Jules Verne, regardé comme un écrivain futile par les gens superficiels, a toujours été pris au sérieux par les explorateurs et par les savants. Voici ce que dit de lui le capitaine Jean Charcot : « J’ai lu, je relis avec passion les Voyages extraordinaires ; la bibliothèque du Pourquoi pas ? les contient tous et, non seulement je les vois entre les mains des membres de l’état-major, mais ils sont très demandés aux heures difficiles par les hommes de l’équipage. Dans ses lettres, le maréchal Lyautey rapportait la conversation qu’il eut avec un bureaucrate hostile à certaines innovations : « Tout ça, mon général, c’est du Jules Verne. – Mais oui, mon bon monsieur, c’est du Jules Verne, parce que, depuis vingt ans, les peuples qui marchent ne font plus que du Jules Verne. »
Le grand savant Charles Richet a écrit : « Si je fus, comme Wilbur Wright, comme mes amis Bréguet, un passionné de l’aviation, c’est pour avoir lu, relu et médité Cinq semaines en ballon. » Et l’amiral Byrd dira avant de s’envoler vers le pôle Sud : « C’est Jules Verne qui m’y emmène ! »

Jules Verne avait imaginé ce scaphandre, plus moderne encore que les derniers que nous avons inventés.
On pourrait allonger à l’infini cette liste des admirateurs du romancier et de ceux dont il a inspiré les découvertes ou les voyages d’exploration. Citons, au hasard du souvenir, Simon Lake, Georges Claude, Boucherot, Remy de Gourmont, Pierre Louÿs, Paul Claudel, Francis Jammes, Alphonse de Chateaubriand, Claude Farrère, Claretie, Brisson, Maurice Barrès.

Louise Michel, qui fut une des inspiratrices de Jules Verne.
Une des caractéristiques de cette œuvre immense est son infinie variété, ses prévisions presque prophétiques s’appliquant aux sujets les plus divers. Comme l’a dit un de ses biographes, M. Allotte de la Fuye, il a tout prévu, tout décrit : aérobus, aréotrains, affiches-réclames projetées sur les nuages, journaux servant à chaque abonné une audition mouvante et colorée des faits mondiaux de la présente minute. En ces métropoles de l’avenir, le télégraphe est remplacé par le phono-téléphoto et Jules Verne indique comme agent transmetteur des images optiques le sélénium dont les propriétés conductrices spéciales seront en effet utilisées seize ans plus tard pour la fabrication des premiers appareils de vision à distance.
Il a prévu de nouveaux accumulateurs d’énergie, condensant les rayons solaires, captant l’électricité intérieure du globe, les chutes d’eau, les fleuves, les vents et les marées. Des transformateurs puisant la force vive en ses accumulateurs la restituèrent à leur source première après en avoir obtenu le travail désiré. La restitution du trop-plein des chaleurs estivales égalisera les saisons, l’hiver n’existera plus, etc., etc.
Ce qui fait que les romans de celui qu’on a appelé le démiurge des livres d’étrennes n’ont pas vieilli, c’est que toutes les inventions de leur auteur offrent un côté pratique et réalisable. Ses imaginations sont audacieuses, mais elles ne sont pas chimériques ; et c’est ce que Maurice Donnay, qui est lui aussi un admirateur du romancier, a souligné d’excellente façon.
« Quand j’étais enfant, écrit-il, les gens sérieux avaient coutume de dire que les livres de Jules Verne donnaient des idées fausses à la jeunesse, parce que, sans doute, il avait écrit Vingt mille lieues sous les mers avant les submersibles, le Capitaine Hatteras avant cet autre professeur d’énergie, Nansen, et le Tour du monde en quatre-vingts jours avant qu’un reporter pût l’accomplir en moins de cinquante. » Ah ! les gens sérieux seront toujours bouffons ! Quoi qu’il en soit, il serait bien injuste, celui qui ne ferait pas la place belle dans une histoire littéraire de notre temps à cette sorte de prophète scientifique.
GUSTAVE LE ROUGE
_____
(in Le Monde illustré, n° 4080, samedi 29 février 1936)
Les Cros sont connus pour avoir été une famille de lettrés, d’artistes et de scientifiques. Sans évoquer la production littéraire de leur grand-père paternel, Antoine Cros, helléniste, philosophe et grammairien, ou de leur père Simon, érudit, écrivain et philosophe, les trois frères Cros paraissent avoir hérité de tous les talents et toutes les excentricités.
Le benjamin, Charles Cros, est poète, écrivain, physicien, chimiste, et inventeur, entre autres, du télégraphe automatique, du procédé de photographie en couleurs et du paléophone.

Le cadet, Henry Cros, peintre et sculpteur sur cire, réinvente la technique de la pâte de verre, selon une composition tenue secrète.

Quant à l’aîné, Antoine Cros, médecin, inventeur, poète et écrivain, dessinateur à ses heures (1), on lui doit la conception du merveilleux « téléplaste, » hypothétique appareil permettant la traduction d’une forme en rythme et sa transmission à distance sans transport de matière, et il héritera du titre de roi d’Araucanie et de Patagonie, peu de temps avant sa mort.

Il n’est pas étonnant qu’une telle fratrie ait pu nourrir l’imaginaire des contem-porains et donner naissance à quelques légendes singulières. L’une d’elles a vraisemblablement pris naissance lors d’un dîner des Vilains Bonhommes : elle attribue la découverte de l’immortalité humaine au Dr Antoine Cros ; il se serait alors heurté à une fin de non-recevoir de la part du père de famille. C’est du moins la version la plus répandue, popularisée par Émile Goudeau dans ses Dix ans de Bohème.
*
Ce poète est éminemment complexe. Un de ses biographes a dit de lui :
« À onze ans, Charles Cros est pris de la folie des langues orientales. Il les apprend surtout en bouquinant sur les quais, ou en se faufilant aux cours publics dans les jambes des graves auditeurs de la Sorbonne. À seize ans, il est en état de professer l’hébreu et le sanscrit, ce qu’il fait avec un certain succès. Je me contenterai de citer deux élèves du jeune professeur : M. Michel Bréal, de l’Institut, professeur au Collège de France, est son élève pour l’hébreu ; M. Paul Meyer, professeur au Collège de France, est son élève pour le sanscrit (2). À dix-huit ans, il entre aux sourds-muets comme répétiteur. Il y fait le cours de chimie, et invente le phonographe, qu’il appelle le paléophone. Il commence alors la médecine, l’exerce avant d’être reçu docteur, et s’obstine à ne pas le devenir ; il veut rester un fantaisiste échevelé en science comme en littérature.
J’ai parlé plus haut du phonographe. Cros en décrivait le principe et la construction dans un pli cacheté, déposé à l’Académie des sciences, le 30 avril 1876. Peu de temps après, la Semaine du clergé (10 octobre 1876), d’après les indications de Charles Cros, confiées à l’abbé Leblanc, donnait une description perfectionnée et complète de cet instrument. Huit mois et demi après, l’Américain Edison prenait son brevet, remplaçant simplement par une feuille d’étain le verre enduit de noir de fumée de Charles Cros.
Le bagage scientifique de Charles Cros est très considérable. Je citerai seulement sa production artificielle d’améthystes, saphirs, rubis, topazes, etc. (cristallisation et coloration de l’alumine), et sa photographie des couleurs, qui remplacera complètement l’ancienne photographie. Étude sur les moyens de communication avec les planètes, où il prétend que Mars et Vénus nous font depuis longtemps des signes que nous ne comprenons pas. (3) La Mécanique cérébrale, travail gigantesque présenté à l’Académie des Sciences, etc., etc. »
Il a de qui tenir. Sa famille est essen-tiellement artistique et scientifique. Son père était un savant de premier ordre, son frère Antoine Cros est poète et médecin, Henry Cros est sculpteur. Pour sortir de cette analyse trop sèche et sérieuse, je veux conter une légende qui a cours dans les ateliers. Voici.
Les trois fils Cros viennent un matin déjeuner chez leur père. Antoine est plus grave que de coutume, et annonce qu’au dessert il fera une communication importante.
Entre la poire et le fromage, le docteur Antoine tenant un petit papier à la main profère :
« Mon cher père, mes chers frères, j’ai enfin découvert le moyen de rendre tous les hommes immortels. J’en ai les preuves là-dessus. »
Aussitôt, Charles et Henry battent des mains : « Bravo ! bravo ! Enfin !!! »
Mais le père est demeuré sombre ; sa figure prend une indicible expression de souffrance.
« Eh bien ! père ? » demande Antoine.
Alors le père se leva et dit : « Quoi ? tu veux prolonger, éterniser cette vie misérable, chétive, où fleurissent les injustices, les poisons, les lèpres physiques et morales ? Tu veux nous lier pour toujours à cette planète basse et arriérée ? Tu voudrais nous priver des cieux attendus ?… Non, mon fils, tu ne feras pas cela ? Non, je t’en supplie… »
Les trois frères demeurèrent atterrés ; puis suppliants, ils crièrent : « Laisse, laisse donner l’immortalité aux hommes !!! »
Le père inflexible déclara : « Je ne le peux pas ! non !!! »
Alors, pâle, Antoine jeta dans le feu le mystérieux papier, tandis que ses frères disaient : « Père, père, tu n’es qu’un Saturnien, tu dévores tes fils ! »
Telle est la légende. La vérité est que les trois frères, extraordinairement doués, se montraient dès lors capables de tout entreprendre et de tout mener à bien, quand la constance les soutenait dans leurs entreprises.
_____
(Émile Goudeau, Dix ans de Bohème, Paris : À la Librairie illustrée, 1888 ; l’anecdote a été reprise dans La Lecture, magazine littéraire bi-mensuel, en 1891, et dans La Chronique médicale, revue de médecine historique, littéraire et anecdotique, en 1900 ; puis dans l’ouvrage de Jean Amiel, Six Ataciens célèbres, Carcassonne : Au Pays du Livre, 1929)
*
On retrouvera cette anecdote à l’occasion d’une notice nécrologique d’Antoine Cros parue dans La Nouvelle Revue, avec cette différence notable que, cette fois, l’invention de « l’art de prolonger la vie » n’est plus attribuée au défunt, mais à son frère Charles.
CARNET DE PARIS
_____
Antoine Cros vient de mourir ; c’est un brave homme qui disparaît. Singulière famille que ces Cros ! à trois frères, ils touchaient à tous les points du cercle des connaissances humaines. Charles Cros, poète savant, philologue, inventeur du phonographe avant Edison, inventeur de la photographie des couleurs, auteur de ce mélancolique et délicieux poème, l’Archet. Henry Cros, peintre, sculpteur, cirier, verrier ne fait que de l’art ; ses conceptions, la ligne de ses œuvres ressortent de l’esthétique grecque ; mais quel modernisme dans sa conception de l’artiste-artisan sans cesse à la recherche, et à la recherche ardente d’un nouveau mode de traduction de sa pensée ! Antoine Cros était le plus modeste ou plutôt le moins généreusement doué des trois. Il n’a excellé en rien, au contraire de Charles et d’Henry, mais quelle universalité ! Il est médecin, médecin distingué, poète d’une bonne faconde, il dessine et enlumine des dessins fantaisistes qu’il appelle des monstres. Ces trois occupations pourtant ne lui suffisent pas. Il s’occupe cinq minutes de politique. Il faillit fonder un parti, il fut, en 1876, le Jérômiste, et presque le Jérômisme. Il était seul à penser que le prince Jérôme dût prendre les rênes du pouvoir, seul, hors peut-être le prince Jérôme lui-même. Il promulgue, un soir, sa doctrine, puis il ne le pensa plus ; le prince Jérôme ne le sut sans doute jamais. Ainsi va le monde ! on ne connaît pas toujours ses admirateurs.
On raconte sur la jeunesse des Cros une histoire peut-être amusante. Le père de ces trois frères de talent avait naturellement pour ses fils si doués le respect le plus attendri. Un jour, en se mettant à table, Charles Cros annonça à sa famille, sans préparation aucune, qu’il vient de faire une découverte étonnante : désormais, il saura prolonger la vie des humains ; personne ne mourra plus. Il est piquant que cette découverte n’ait pas été du fait d’Antoine Cros, qui faisait de la médecine, durant que Charles était seulement physicien, chimiste, philologue et poète. Peut-être les médecins se sont-ils constitués en syndicat pour s’interdire pareille découverte. Mais le père des trois Cros n’eut pas l’ombre d’un instant l’idée d’invoquer à ce moment la compétence d’Antoine ; Charles ne pouvait pas se tromper ; mais comme le père des Cros était pessimiste, il s’élança vers son fils, et, le retenant par le bouton de son veston, il voulut obtenir de lui, tout de suite, avant même qu’il pût se placer à table, un engagement formel que cette découverte ne serait pas divulguée, et que Charles ne s’en servirait pas. L’humanité eût été trop malheureuse, si elle avait acquis le don d’immortalité… Mais voici bien des figures qui disparaissent d’un bon vieux temps encore bien récent, Rollinat, Antoine Cros…
_____
(in La Nouvelle Revue, vingt-quatrième année, novembre 1903)
*
Curieusement, la plus ancienne de ces versions, celle d’Armand Silvestre, est sensiblement différente. Il attribue bien la paternité de l’invention à Antoine Cros, mais pour en faire un nouveau Frankenstein : à l’en croire, il aurait eu l’idée, non de l’immortalité, mais de la production artificielle de l’homme.
Les trois frères Cros étaient des nôtres : Henry Cros, le sculpteur ingénieux dont les belles cires artistiques ont été si remarquées dans les expositions annuelles, très grand, très mince, très brun, avec une figure diabolique et douce à la fois ; Charles Cros, l’auteur du Bilboquet, ce chef-d’œuvre du monologue, et l’auteur aussi du Coffret de Santal, un merveilleux volume de vers que l’Académie (proh pudor !) couronna dans un intervalle lucide, et bien que le talent en fût audacieux, moins grand que son frère, mais aussi noir, avec des yeux de charbon où la braise étincelle en paillettes. On m’a dit qu’il était devenu un grand chimiste ; c’est possible, mais je suis convaincu qu’il est resté un excellent poète. Enfin, Antoine Cros, le docteur, un médecin imbu de toutes les doctrines nouvelles, et qui effraya, un jour, si fort son père, bon chrétien de vieille roche, en lui contant que rien ne lui serait plus simple que de faire artificiellement un homme pensant, par une combinaison de substances chimiques, que le pauvre homme s’écria, du ton de l’autorité paternelle aux abois :
« Monsieur, je vous le défends ! »
Bon poète aussi, Antoine Cros, et qui vient de publier, il y a trois ans, un volume très heureusement fidèle à la Muse : Les Belles heures. Gros et blond, avec les yeux clairs, il ne ressemblait pas à ses deux frères. Mais c’était un trio singulier d’hommes remarquables par leur talent et par l’élévation de leurs goûts.
_____
(Armand Silvestre, « Petites études littéraires : Les Vilains Bonhommes » [deuxième article], in La Revue générale : littéraire, politique et artistique, cinquième année, n° 6, 15 mars 1887)
*
Alors, quelle fut cette innovation qui ne vit jamais le jour : l’immortalité ou l’humanité artificielle ? Et qui en fut l’inventeur : Antoine ou Charles ?
Je me garderai bien de me prononcer, et laisserai aux rêveurs le soin de trancher la question au gré de leur fantaisie…
MONSIEUR N
_____
(1) Nous reviendrons bientôt sur les talents de dessinateur d’Antoine Cros.
(2) Cette opinion d’Alphonse Allais doit être donnée sous toute réserve. [Note d’Émile Goudeau]
(3) Charles Cros et la communication avec les planètes feront prochainement l’objet de deux articles dans « La Porte ouverte. »
Les à-côtés de la littérature réservent parfois d’heureuses surprises. En parcourant il y a quelque temps les colonnes d’un journal littéraire fin-de-siècle, Les Romans inédits, mon attention a été attirée par un texte d’un certain Gustave Guirou, intitulé La Légende anglaise de Kill et Murde.

Présentée comme une « nouvelle inédite, » c’est l’histoire de deux gardiens de phare découvrant l’épave de la « frégate merveilleuse » de Jules César et une peuplade d’hommes marins. Or, ce texte ne m’était pas inconnu ; je n’ai pas tardé à me rendre compte qu’il s’agissait en fait de la réédition d’un conte de Gustave Le Rouge, Le Navire de Jules César, initialement paru dans La Revue d’un passant en novembre 1896.
Les Romans inédits, édités par Fayard, contiennent trois autres nouvelles réalistes ou historiques signées Gustave Guirou :

____
Le Trésor du cerisier [4e série, n° 65, 1899]
_____
Idylle Louis XV [4e série, n° 94, 1899]
____
Le Loup et le masque [4e série, n° 114, 1899]
*
Une recherche rapide m’a permis de localiser deux autres nouvelles de Gustave Guirou, alias Gustave Guitton et Le Rouge :
Le Maître, dans L’Express de Lyon illustré, paraissant le dimanche [4e année, n° 28, dimanche 15 juillet 1900].
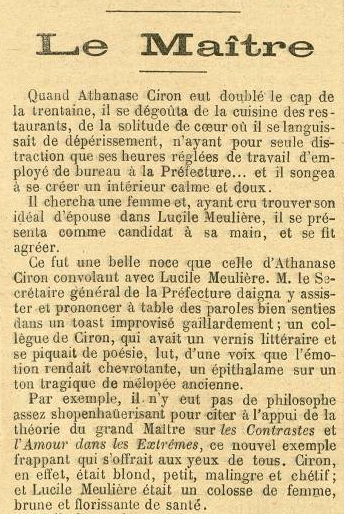
Une seconde nouvelle, La Maison du calvaire, est parue en feuilleton dans le Supplément illustré de la Dépêche tunisienne ; elle est annoncée dans les pages de la Dépêche tunisienne à la date des samedis 18 et 25 novembre 1899 et précède donc le premier séjour de Le Rouge en Tunisie.
Avis aux amateurs de curiosités ; il reste certainement d’autres textes de Gustave Guirou à découvrir… En attendant, qui sait ? de vous présenter un jour un roman oublié de Gustave Le Rouge, je vous engage à lire cette seconde version légèrement remaniée du Navire de Jules César.
MONSIEUR N
*
LA LÉGENDE ANGLAISE DE KILL ET MURDE
NOUVELLE INÉDITE
Kill et Murde s’étaient, toute leur vie, bercés du rêve de pêcher un trésor.
La colonne de granit du phare de Righte qu’ils gardaient, surgit, en pleine mer, d’un réseau d’écueils et de stroms dont les gouffres, dit-on encore maintenant, recèlent quelques-uns des navires de la légendaire Armada.
Maintes fois, d’ailleurs, des indices indubitables étaient venus fortifier leurs croyances.
Un jour, Murde ramena, entre les mailles de sa drague, un grand gobelet d’argent. Kill prétendait distinguer par les temps où l’eau était claire, la carcasse d’un vaisseau de mille tonneaux d’un gabarit inconnu. Souvent, les tempêtes jetaient à la base du phare des pièces de bois, des bouteilles endentellées de concrétions et de coquilles, et jusqu’à des barriques et des coffres.
Mais ils ne trouvaient point de trésor.
Cependant, plus ils vieillissaient, plus ils s’entêtaient dans leur espoir.
Chaque soir, après avoir lu la Bible, ils allumaient leurs pipes et vidaient un bol de grog au genièvre, en faisant des projets.
Murde – quand il aurait trouvé un trésor dans la mer – acheterait aux entours de la ville un cottage de briques coloriées. Il y aurait un parloir de chêne comme celui de l’officier des douanes. Et sa nièce Effie, celle qui tenait un cabaret sur le port, devenue grande dame, verserait le thé d’une bouilloire d’argent.
Kill, plus ambitieux, voulait habiter Londres et voyager sur le continent. Il s’habillerait comme un gentleman, porterait une bague d’or et se ferait construire un yacht.
Les deux gardiens du phare étaient d’accord sur un point, c’était de se partager fidèlement le trésor, et de vivre toujours en bonne amitié quand ils seraient devenus riches.
Quelquefois, Kill faisait la lecture à son compagnon, dans de vieux livres que leur prêtait le capitaine du cutter qui, chaque semaine, ravitaillait le phare. C’étaient les histoires des boucaniers anglais et français, avec d’autres récits tout aussi surprenants. Ainsi ils connurent les exploits de Montbars, l’exterminateur – de sir Hughes – de Pol d’Olonnois – et de Walter Raleigh… Ils apprirent l’existence indubitable du Poisson d’or, qu’on ne pêche qu’une fois l’année, dans la nuit du vendredi-saint, avec un hameçon garni de chair de chrétien – de l’Évêque-de-mer, qui fut capturé sur la côte de Norwège au temps de l’archevêque Olaüs et qui, présenté au pape, lui parla latin.
Mais ni le Krabor, ni les Sirènes, ni le dragon de mer Zedraack ne les intéressèrent autant que l’histoire du navire de Jules César.
C’était, au dire du livre, une frégate tout en or, sur laquelle Jules César était parti de Gaule, avec ses chevaliers, pour conquérir l’île des Bretons. Quatre-vingts boucliers d’argent fin étaient suspendus au-dessus du banc des rameurs, et les fanaux de combat avaient des vitres de pierres précieuses.
Ce merveilleux navire avait péri, corps et biens, sur les récifs de la côte anglaise. L’empereur seul avait réussi à joindre le reste de sa flotte, sur la barque d’un pêcheur. Depuis, nombre d’aventureux plongeurs avaient essayé de retrouver les épaves d’or de la frégate. Nul n’y avait réussi. Et le chroniqueur ajoutait qu’ils avaient tous trouvé la mort « d’une façon singulière. » Une menace aussi vague ne déconcertait point les deux amis.
Comme ils avaient gardé, de leurs navigations, la connaissance des récifs et des amers, ils remarquèrent que beaucoup de courants se rencontraient près de l’îlot où s’élevait leur phare, et que les raz de marée avaient dû, peu à peu, entraîner vers les gouffres voisins les épaves de toute la mer. De là, ils en vinrent à supposer, puis à croire fermement, que le navire d’or devait se trouver tout près d’eux. Il ne s’agissait plus que de savoir la place exacte où il s’était abîmé.
Ils employaient à cette recherche tout le temps que leur laissait le soin de leur lampe.
Inlassablement, ils scrutaient l’eau verte et, s’aventurant jusqu’auprès des tourbillons, raclaient les bas-fonds de leur drague.
Quand revenaient les marées d’équinoxe, alors qu’un vaste espace de rochers reste à sec, ils se livraient, avec plus d’enthousiasme encore, à leurs sondages.
Vers ce temps, Murde, en nettoyant un congre qui s’était pris à leur ligne de fond, trouva un anneau éblouissant, fait d’une pierre qu’il ne connaissait pas. Il mit l’anneau à son doigt, tirant de cette trouvaille un nouveau et sérieux présage de succès.
Un matin qu’ils s’étaient éloignés de leur phare, un brouillard jaune tomba subitement. Et sur la mer de la couleur livide du vieux plomb, ils ne surent plus s’orienter.
Puis, le ciel s’assombrit encore, sembla rouler des fleuves de cendre et des traînées de fange. Le brouillard, plus doux, se résolvait en pluie. La brise fraîchit. Des vagues monstrueuses et blanches d’écume s’enflèrent.
Bien qu’ils eussent replié toutes leurs voiles, ils filaient avec une rapidité vertigineuse, entraînés dans le rugissement de la tempête.
Ils n’avaient point emporté de boussole ni de vivres. Affamés et transis, au fond de leur canot, ils se reprochaient mutuellement leur folie… Pour la chimère d’un hypothétique trésor, ils étaient perdus ! Même si, par fortune, quelque navire les recueillait, ils seraient déshonorés et condamnés à la potence, pour avoir abandonné le feu confié à leur soin.
Comme le soir tombait, une pluie abondante abattit la violence du vent. Des vagues peu à peu calmées, émergeait un archipel de rochers noirs grotesquement contournés, laissant en son centre une petite baie tranquille où aboutissaient des antres basaltiques.
Ils dirigèrent leur barque de ce côté, dans l’espoir de glaner sous les algues quelques coquillages nutritifs.
Ils amarraient le grappin de leur bateau, lorsqu’une apparition les cloua sur place de stupeur… Un être étrange, et semblable de tout point aux monstres de leurs livres, s’avançait vers eux en nageant. Il aurait parfaitement ressemblé à un homme trapu sans ses moustaches de poils rudes, disposées en éventail comme celles des phoques, et sans ses yeux de poisson protubérants et ronds.
Kill et Murde remarquèrent, lorsqu’il approcha, que les doigts de ses mains étaient palmés, et que tout son corps couvert d’écailles argentées ; ses dents et ses ongles étaient de la plus étincelante nacre verte.
« Je n’ai pas l’intention de vous nuire, dit-il, d’une voix gutturale et sourde. Rendez-moi seulement l’anneau que vous avez au doigt, et qui m’appartient. Il ne vous arrivera point de mal. »
Tout tremblant, Murde donna l’anneau.
Alors, la nuit se fit moins sombre. Un courant rapide les saisit. Consternés et transis, ils se retrouvèrent, presque sans savoir comment, à la base de leur tour. La lampe de leur phare, allumée par des mains invisibles, brillait comme chaque soir, sur la mer immensément bleue où se reflétait la pleine lune.
Cette aventure ne laissa pas calmes les deux amis. Leur mélancolie devint profonde. D’avoir entrevu un coin du mystère de la mer, ils devinrent, ainsi que Faust, ambitieux des choses surnaturelles.
Ils continuèrent à côtoyer, pour leurs pêches, le flanc des roches, en gardant toujours, et plus que jamais, l’espoir de découvrir la frégate en or. Mais la crainte des êtres extraordinaires qui hantent les profondeurs les avait rendus prudents. Ils ne s’éloignaient plus, maintenant, qu’à de faibles distances.
Un soir, par un même ciel pluvieux, par une mer pareillement jaune et pâle, Murde, que l’insuccès de leur pêche avait rendu furieux, s’écria :
« Nous menons, à présent, une existence tout à fait ignoble, indigne d’hommes libres… Pour moi, j’aimerais mieux vivre à la façon des poissons comme l’Homme-de-Mer à qui j’ai rendu la bague, plutôt que de végéter jusqu’à la mort, ainsi que nous le faisons, sans connaître les trésors du fond de l’eau verte. »
Son camarade l’approuva de bon cœur. Il ajouta qu’il sacrifierait tout, seulement pour voir la frégate de l’empereur César. Mais, il s’arrêta au milieu de ses jurons, en apercevant à fleur d’eau, au milieu d’une masse de plantes marines, le crâne aplati et les yeux protubérants et glauques de l’Homme-de-Mer, qui les avait tant effrayés une première fois…
Le monstre nagea vers leur barque ; et, d’un sourire singulier que complétaient des gestes gauches de ses bras courts, il leur fit comprendre que leurs vœux allaient être réalisés.
Comme la première fois, leur barque fut emportée parmi un courant… Et, dans la nuit devenue complète, où s’allumait inexplicablement, à leurs yeux, l’étoile du phare déserté, ils furent contraints de s’abandonner à l’aventure. Ils se tenaient très près l’un de l’autre, afin de se porter secours en cas de péril.
Bientôt, une grotte inconnue suspendit sur eux son pendentif de stalactites. Le monstre, qui nageait à l’avant du bateau, s’arrêta. Son corps et ses yeux, de même que tous les objets d’alentour, phosphoraient, d’une tiède lueur bleue qui emplissait toute la grotte.
Au fond de cette grotte, au milieu d’immenses bouquets de coraux, au milieu de guirlandes, toutes frissonnantes sous la vague, et faites de lianes sous-marines, la merveilleuse frégate rutilait de pierres précieuses, dans une brume dorée !
C’était elle, la frégate de Jules César !
Ils s’approchèrent tout palpitants.
Hélas ! de près, le miraculeux navire ne fut plus qu’une épave rongée par l’âge et les bêtes, une coque ridicule, dont le bois pourri s’effritait entre leurs doigts avides.
Les insectes phosphorescents qui s’attachent aux vieilles pièces de bois avaient causé leur illusion. Des crânes verdis, des pièces de monnaie oxydées, voilà tout ce qu’ils virent.
Mais ils poussèrent un grand cri, en se considérant mutuellement. Par leurs chevelures vertes, par la nacre de leurs ongles et par leur crâne aplati, ils étaient devenus pareils, de tout point, à celui qui les avait menés dans cet endroit, à l’Homme-de-Mer. Sous leurs vêtements, qui tombaient déjà d’eux-mêmes, leur corps luisait d’écailles argentées.
Leur souhait, réalisé à la lettre, les faisait, désormais, habitants de la mer.
Tout autour d’eux, des rictus narquois de monstres les narguaient ironiquement.
Ils cherchèrent un abri dans les feuillages, pour y cacher leur désespoir.
Maintenant, ils sont habitués à cette vie.
Tristes souvent, ils se plaisent à écouter, derrière le sillage des barques, la voix des pêcheurs chantant Rule Britannia ou Sweet Home. Et ils les récompensent de leur chanson, en poussant vers les tramailles le peuple effaré des poissons.
Quelquefois, ils nagent avec lenteur autour du phare, et ils guettent – tapis dans les végétations grasses de l’écueil – s’allumer le feu jadis confié à leurs soins.
Dans les tempêtes, alors que s’effarent les pilotes et que triomphent, dans le rugissement du vent, les clameurs de la mort souveraine, il leur arrive de préserver, d’une façon inespérée, les vaisseaux en péril. De leurs doigts écailleux, qui sont devenus pareils aux ailerons des morses, ils s’accrochent aux ferrures du gouvernail. Ils le maintiennent, et orientent, de toute leur puissance, le navire en danger vers les molles plages de sable ou vers l’entrée des ports.
Parfois aussi, ils profitent du brouillard des nuits d’hiver. Et, nageant silencieusement jusque tout près du rivage, ils contemplent, avec de grands soupirs et des regards mouillés de larmes, la rouge lueur qui brille aux fenêtres du petit cabaret sur le port, où Effie, la douce jeune fille à la peau de lait, aux tresses rousses, vend aux marins le porter et le gin, avec le blond tabac et les longues pipes de terre blanche, en narrant elle-même, ou en se faisant raconter les plus jolies légendes et histoires arrivées aux marins de la côte.
Les deux amis regardent longuement la petite lueur rouge de la taverne… Mais ils ne savent plus pleurer. Puis ils regagnent en silence les profondeurs marines, où sommeille l’amas des inutiles richesses.
_____
(Gustave Guirou [Gustave Le Rouge], La Légende anglaise de Kill et Murde, in Les Romans inédits, journal littéraire paraissant le mardi, mercredi, vendredi et samedi, 5e série, n° 2, 1900)

Les vœux étaient prononcés. On se préparait à passer à Aurélie l’habit de religieuse pendant que les sœurs des deux couvents chantaient alternativement les strophes d’un hymne. Déjà l’on avait retiré les roses et les myrtes qui ornaient ses cheveux, et l’on tenait les ciseaux avec lesquels on devait couper ses boucles ondoyantes, quand tout à coup un tumulte s’éleva dans l’église. Les assistants poussés avec force se séparaient et tombaient par terre. Avec des gestes furieux et des regards terribles, un homme à demi nu, n’ayant pour tout vêtement qu’une robe de capucin en lambeaux, traversait la foule en la repoussant de part et d’autre avec les poings fermés et une force gigantesque. Je reconnus sur-le-champ mon double ; mais, au moment où, craignant quelque événement affreux, je voulus m’élancer de ma place et me jeter au-devant de lui, je le vis sauter par-dessus la grille qui entourait l’autel. Les religieuses s’enfuyaient en criant, saisies de frayeur. L’abbesse tenait Aurélie serrée dans ses bras.
« Ah ! ah ! ah ! s’écria l’insensé d’une voix terrible, voulez-vous m’enlever la princesse ?… Ah ! ah ! ah !… La princesse est ma fiancée, ma fiancée ! »
En parlant ainsi, il s’empara d’Aurélie, et lui plongea dans le sein le poignard qu’il tenait élevé, et le sang rejaillit au loin.
« Vivat !… vivat !… Maintenant j’ai conquis la princesse, ma fiancée ! »
Avec cette nouvelle exclamation, il sauta derrière l’autel, et passa dans les cloîtres par la porte grillée. Les religieuses jetaient des cris d’effroi.
« Au meurtre ! s’écriait le peuple. Un assassinat devant l’autel du Seigneur !
– Que l’on ferme les issues du couvent, afin que le coupable ne puisse pas s’échapper, » dit le père Léonard à haute voix.
_____
(L’Élixir du Diable, histoire tirée des papiers du frère Médard, capucin, publiée par C. Spindler, et traduite de l’allemand par Jean Cohen, 4 volumes, Paris : Mame et Delaunay-Vallée, 1829)
La très rare édition originale des Élixirs du Diable d’E.T.A. Hoffmann. D’après Quérard, l’éditeur aurait attribué le roman à Karl Spindler, plus connu en France à cette époque, à des fins commerciales.
(collection de Monsieur N)
À notre ami et compatriote, H. Ernest-Delahaye, nous devons la communication de ces sonnets et de ces dessins inédits du grand poète ardennais Paul Verlaine ; nous lui en témoignons ici notre vive reconnaissance.
Ce fut en octobre 1895, quelques mois avant sa mort, que Verlaine adressa le sonnet des Pingouins et celui des Colibris à son vieil ami Ernest Delahaye. À sa Dédicace, il joignit les amusants dessins qui suivent. C’était une habitude chez lui d’illustrer sa prose ou ses vers : ses lettres à Cazals, publiées dans la Revue Blanche, du 15 novembre et du 1er décembre 1896, en sont une preuve, ainsi que la nombreuse correspondance inédite que nous avons pu voir nous-même chez l’éditeur Vanier.
Ici, à vrai dire, sonnets et dessins tirent plus leur intérêt de leur originalité que de leur valeur intrinsèque. Mais, si les dessins n’ont plus le « trait ferme et incisif de jadis, où chaque coup porte, comme chez les maîtres japonais » (1), dans ce Verlaine et ce Delahaye vus tour à tour en pingouins et en colibris, on sent toujours la simplicité naïve, sans aucune étude et sans aucune science, de l’artiste, qui resta toute sa vie un enfant.
Quant aux sonnets, ce sont de pures dédicaces, et il ne faut pas chercher dans le subtil enchevêtrement de leurs phrases ces vers que M. Jules Lemaître compare à « de petits diamants de poésie naturelle » et qui caractérisent Sagesse, Amour, Jadis et Naguère, Romances sans paroles, et tant d’autres chefs-d’œuvre.
JEAN BOURGUIGNON
INSÉPARABLES
_____
À ERNEST DELAHAYE.
I
Dans ce Paris où l’on est voisin et si loin
L’un de l’autre, que c’est une vraie infortune
De s’y voir, de s’y savoir tels, vu ce besoin
L’un de l’autre, pourtant, qui, donc, nous importune.
Et ce désir commun à nos deux âmes, l’une
De l’autre et de nos esprits mutuels, pingouin
L’un et l’autre figé sur un écueil témoin
Par le flot qui s’oppose et la croissante brune !
Si bien qu’ils sont là nos esprits, quelles, ô ces
Âmes nôtres ! sont là, pauvres monstres blessés,
Par la faute plutôt des gens moins que des choses.
Voulons-en seulement salement à Paris
Et, las de ces sacrés éloignements moroses,
Soyons donc non plus des pingouins, des colibris !
II
Deux colibris parisiens, deux cancaniers
Sans cesse en disant les fausses et les vraies
Nouvelles, disputant à propos d’elles, gaies
Ou tristes, — et bavards n’ayant point de derniers.
Ou soyons, si Paris nous distance quand même,
Ville importune en sa trop factice grandeur,
Comme autrefois des persécuteurs de facteurs —
Pas des lettres, toujours la même et la suprême.
Mais si drôle en raison des dessins sans talent
Aucun, mais amusants pour de pleines journées,
Envoyons-nous, morbleu, des lettres par fournées !
Soyons le colibri, non l’oiseau triste et lent,
Ou plutôt soyons deux copains, légers de langue
Et prompts de main, croquis farce et drôle harangue.
(1) Félix Régamey, Verlaine dessinateur (1896, Paris, Floury).
_____
(in Revue d’Ardenne & d’Argonne, scientifique, historique, littéraire & artistique, quatrième année, n° 2, janvier-février 1897)
_____
Quelques illustrations de Jean Marembert pour Champavert, contes immoraux,
de Petrus Borel (Paris : éditions Montbrun [1947])
Avec l’aimable autorisation du Maître des Lieux d’Au Carrefour Étrange :
grâces lui soient rendues !
BOÎTE AUX LETTRES
_____
Mon cher Directeur,
Voici un petit échantillon de l’effet produit par de récentes mesures sur l’intelligence des douaniers.
J’arrivais de Guernesey, mardi, et débarquais à Cherbourg sous une pluie battante. Les gabelous nous rangèrent sur le pont.
Un premier sbire s’avança, plein de morgue, et m’ordonna, sous menaces, de déclarer une foule de denrées auxquelles je n’avais jamais songé. Puis, satisfait de son examen, il me désigna mon suroît roulé.
« Et qu’est-ce qu’il y a là-dedans ? dit-il.
– Deux livres anglais. (C’étaient Dante and his Circle, de Rossetti – un livre auquel je tiens beaucoup, pour plusieurs raisons – et Evan Harrington de George Meredith.)
– Passez, » dit-il.
Alors, un second sbire s’interposa.
« Montrez les livres ! » hurla le second sbire.
J’interrogeai timidement :
« Est-ce que les livres payent ?
– Montrez les livres ! » hurla le sbire.
Je tendis mon cher Rossetti sous la pluie. Le goujat le tripota, le secoua, y marqua ses doigts, et s’écria triomphalement, en appelant ses camarades du regard :
« Ce n’est pas de l’anglais, c’est de l’italien !
– Ce sont, en effet, expliquai-je à ce gabelou, des poèmes de Dante et de ses amis, qui ont été traduits par Rossetti. Est-ce que les traductions payent ?
– C’est de l’italien, hurla le sbire, que vous rapportez d’Angleterre. »
Il consulta de nouveau ses compagnons du regard, puis grommela, et fit un signe.
Alors un troisième sbire – celui-là en bourgeois – se plaça directement devant moi et me dit :
« Avez-vous d’autres bagages ?
– Non, dis-je, et je n’en suis pas fâché – car je n’aime pas les livres détrempés.
– Alors, répondit cet homme, je me vois forcé de vous demander vos papiers.
– Nous ne vivons pas sous le régime du passeport, lui dis-je, et je n’ai pas de papiers.
– Suivez-moi donc, dit l’homme, puisque vous ne pouvez justifier de votre identité. »
Comme je ne désirais pas, pour le plaisir de la comédie, manquer le train de Paris, je lui tendis ma carte de lecture à la Bibliothèque Nationale.
Là-dessus, excuses basses, courbettes, politesses, allusions à mon nom, et prière de pardonner une conduite obligée par les ordres les plus stricts.
Je lui dis que je lui pardonnais sa conduite, mais non pas d’avoir fait de mon Rossetti une pâte informe triturée par des doigts de garde-chiourme.
Est-il possible d’apprendre quels sont les ordres grâce auxquels on confie à des personnes aussi compétentes le soin d’examiner les œuvres des poètes italiens traduits par les préraphaélites ?
Merci d’avance, mon cher directeur, et tout à vous,
MARCEL SCHWOB.
_____
( in Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, n° 697, samedi 25 août 1894)
PETRUS BOREL (1809-1859), l’auteur des Rhapsodies, de Champavert et de Madame Putiphar, est un de ces poètes qui ont, avec une fougueuse bonne foi et une sorte de logique perverse, vécu leur Romantisme. C’est d’avoir voulu vivre ainsi son Romantisme que le pauvre Gérard de Nerval mourut une nuit d’hiver de 1855 dans la rue Vieille-Lanterne. Petrus Borel, lui, après quinze années de poésie et de misère, s’en alla finir comme colon dans une Algérie encore vierge, lâchant l’Art à tout jamais par une déconversion qui est comme un pressentiment de celle de Rimbaud trente ans plus tard. Mais, en son beau temps, il avait été « le grand homme spécial, » comme dit Théophile Gautier (qui en fit partie), de la bande des Bousingots. On appelait ainsi vers 1830 de jeunes Romantiques qui faisaient de la politique ou plutôt de l’agitation, des libertaires outranciers mais assez inoffensifs qui se distinguaient des Jeune-France, lesquels étaient les esthètes du Romantisme. Comme chef de chœur des Bousingots, l’année triomphale de Petrus Borel fut 1833 où, un an après les Rhapsodies, parut Champavert, Contes Immoraux. Cette année-là, un portrait de Napoléon Thomas au Louvre montrait un Petrus fatal et beau, à gilet cramoisi, habit à grands revers pointus, gants couleur « sang royaliste, » chapeau d’astrologue, barbe et cheveux flottants. Mais cela n’est que la pose et le physique du personnage. En fait, il y a eu autre chose.
Il y a eu ceci d’abord : Petrus Borel avec toutes ses outrances et ses puérilités bousingotes, est un écrivain de race, un satiriste plein de mordant, un lyrique plein d’accent. Et il y a eu ceci encore : Petrus Borel est à certains égards une influence, une source. Il a été trop admiré pour que ceux qui l’admiraient ne lui aient pas dû quelque chose. Baudelaire trouvait « dans plusieurs scènes de Madame Putiphar la marque d’un talent véritablement épique. » Gustave Flaubert et son ami Louis Bouilhet ont bien souvent ensemble « rugi » du Petrus Borel. Dans Flaubert jeune, dans Flaubert homme mûr, il y a eu du Bousingot et des fièvres romantiques à la Borel. Et, de Borel, il persiste chez Flaubert des traces curieuses comme je le montrerai un jour dans cette même ROMANIC REVIEW. En somme, Petrus Borel, ce demi-fou, fut un écrivain entier. Et malgré l’excellence de l’édition et de l’étude que M. Aristide Marie lui a consacrées (1), il est dommage que nous n’ayons sur lui rien de comparable en importance et en pénétration critique au livre de Sprietsma sur Aloysius Bertrand, dit Gaspard de la Nuit.
Ce préambule qui dit l’importance encore mal connue du personnage servira du même coup de raison d’être pour la recherche qui fait proprement le sujet de la présente note : comment Petrus Borel en est-il venu à se donner le surnom de « Lycanthrope » ? Et quel était au juste dans sa pensée le sens de cette image ? Elle apparaît pour la première fois chez lui dans la Préface – datée de novembre 1831 – de ses Rhapsodies publiées en 1832 : « Oui, je suis républicain, comme l’entendrait un loup-cervier : mon républicanisme c’est de la lycanthropie !… J’ai besoin d’une somme énorme de liberté ! la République me la donnera-t-elle ? Je n’ai pas l’expérience pour moi. Mais quand cet espoir sera déçu, comme tant d’autres illusions, il me restera le Missouri !… » Dans ces lignes, la lycanthropie de Petrus Borel, c’est tout simplement l’instinct sauvage de liberté. C’est de cela que pour lui le loup-cervier est le symbole. En fait le loup-cervier, si on en croit le dictionnaire, est un félin carnassier qui vit dans certaines montagnes et dont le nom vient de ce qu’il passe pour s’attaquer aux cerfs. On ne le voit pas très bien comme emblème de « républicanisme, » mais on le voit très bien comme emblème de liberté. Petrus Borel, quand il écrivait ces lignes en 1831, avait l’air de ne pas savoir que lycanthrope veut dire non pas le loup-cervier mais le loup-garou, le werewolf du folklore, c’est-à-dire l’homme-loup. Son surnom n’est pas – au moins dans l’abord – une déclaration de férocité comme semble le croire, dans son excellente étude, M. Aristide Marie. Plus tard, il a pu se complaire à des allures de misanthropie sadique mais sa lycanthropie, prise à la lettre et à l’origine, ce n’est pas du tout cela. La promesse ou la menace que notre homme fait d’émigrer au Missouri, si la République le déçoit, est tout bonnement celle d’un Rousseauiste truculent qui a lu le vicomte de Chateaubriand et les prospectus d’émigration.
Deux ans après la date du passage en question, en 1833, dans le titre même de Champavert, contes immoraux, notre homme signe Petrus Borel, le Lycanthrope. Cette fois, il s’affuble bien nettement de la peau de ce loup dont la Préface des Rhapsodies ne nous donnait encore que l’ombre. Il passe de l’abstrait au concret, au personnel. Dans une des nouvelles qui composent Champavert, intitulée Three Fingered Jack, on lit ce signalement du héros qui est une sorte de projection du Moi déchaîné de l’auteur : « Jack était une de ces organisations fortes, un de ces cerveaux puissants, nés pour dominer, qui manquant d’air dans l’étroite cage où le sort les a jetés, dans cette société qui veut tout courber, tout rapetisser à la taille vulgaire, rompent à tout jamais avec les hommes qu’ils exècrent, s’ils ne rompent avec la vie. »
Ici, le thème lycanthrope est bien sinon celui de la férocité, du moins celui de la misanthropie nihiliste. Il y a « progrès » par rapport à la lycanthropie de la Préface des Rhapsodies, laquelle n’était encore que soif et fièvre de liberté. Tout se passe comme si, cette fois, Petrus Borel s’était avisé que le vrai sens de lycanthrope c’est loup-garou, werewolf et non loup-cervier. Il serait infiniment curieux de se demander si le poids et la force de ce terme de lycanthropie n’ont pas été révélés à notre homme entre la Préface de 1831 (où il l’a écrit d’abord) et Champavert de 1833 (où il lui rend son sens plein et tragique).
Ce caractère forcé et, si j’ose dire, l’air de « cheveux sur la soupe » avec lesquels l’idée de lycanthropie apparaît chez Petrus m’ont amené à me demander ce qui lui a suggéré d’associer avec sa propre personne ce terme de lycanthropie. Or, je crois savoir que cet accouplement a été inspiré à notre homme par une association d’idées qui avait été réalisée fortuitement, bien avant lui, entre le mot lycanthropie et le mot Borelise (lequel évoquait bien nettement son nom de Borel). Cet accident s’était produit dans le Francion de Sorel (1623). Voici le passage :
« Mademoiselle, votre mérite qui reluit comme une lanterne d’oublieux est tellement capable d’obscurcir l’éclipse de l’aurore qui commence à paraître sur l’hémisphère de la Lycanthropie, qu’il n’y a pas un gentilhomme à la cour qui ne veuille être frisé à la Borelise pour vous plaire… » (Francion, édition Colombey, page 243).
Dans ce passage, j’ai souligné par des italiques les deux mots en vedette : Lycanthropie et Borelise. Quant au sens du passage, il nous importe peu et il est peu probable que Petrus Borel l’ait mieux démêlé que nous. Au reste, ce n’est qu’un amphigouri, un pur non-sens. Cela fait partie d’une déclaration burlesque de Collinet à la belle Luce après qu’il a bu « deux ou trois verres d’un vin de singe. » Il suffit de penser que Petrus Borel qui était – comme tout son clan bousingot – extrêmement friand des écrivains de l’époque Louis XIII, a jeté les yeux sur ce passage. C’est cette association du vocable lycanthropie et du vocable Borelise qui lui aura suggéré, à lui Borel, son surnom de Lycanthrope. En conformité logique de souvenir avec le passage de Francion, c’est d’abord seulement de lycanthropie qu’il a parlé dans sa Préface des Rhapsodies. Un peu plus tard, il en a dégagé son sobriquet. Mais c’est toujours le vieux Sorel qui montre l’oreille à travers la peau de notre Lycanthrope.
_____
(1) Œuvres complètes de Petrus Borel Le Lycanthrope, 1922.
_____
Louis CONS
COLUMBIA UNIVERSITY
_____
(in The Romanic Review : A Quaterly Journal…, vol. XXIII, n° 4, october-december, 1932)